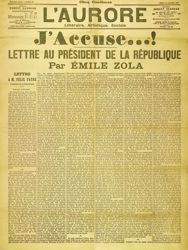Alfred Dreyfus

Alfred Dreyfus est le benjamin des neuf enfants
de Raphaël Dreyfus, industriel, et de Jeannette Libmann-Weill. Il
passe son enfance dans la maison familiale rue du Sauvage. Après
l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne en 1871, Lorrains
et Alsaciens ont la possibilité de partir pour la France s'ils ne
veulent pas devenir citoyens allemands.
En 1872, les Dreyfus
optent pour la nationalité française et quittent l'Alsace pour Paris.
Alfred décide alors de s'engager dans l'armée française, souhaitant
voir l'Alsace revenir à la France. Il entre à l'École polytechnique
en 1878 et devient officier d'artillerie. En 1890, il est admis
à l'École de guerre. La même année, il épouse Lucie Hadamard (23
août 1869-14 décembre 1945), issue d'une famille aisée de diamantaires.
Ils ont deux enfants, Pierre (5 avril 1891-28 décembre 1946) et
Jeanne (22 février 1893-30 avril 1981).
En 1893, il est attaché
à l'état-major de l'armée au ministère de la Guerre comme capitaine-stagiaire.
Il y effectue des stages, passant successivement dans chaque bureau
de l’État-Major, sans toutefois être admis à la Section de statistiques
nom donné au services de renseignements.
C'est son collègue Junck
qui y fait un stage. En septembre 1894, le service de contre-espionnage,
dépendant du Ministère de la Guerre, découvre un bordereau contenant
des informations sur des secrets militaires français. Celui-ci aurait
été transmis à l'ambassade d'Allemagne.
Alfred Dreyfus apparaît
très rapidement comme le suspect idéal du fait de la similitude
de son écriture avec celle du bordereau. En outre, il est passé
par l’État-Major, il est artilleur, et a des origines alsaciennes
et juives. Il est réputé antipathique et prétentieux.

Le 15 octobre, il est arrêté et incarcéré
à la prison du Cherche-Midi. Il passe en conseil de guerre à Paris
le 19 décembre 1894. Il est défendu par un avocat pénaliste talentueux,
Edgar Demange, de confession catholique et choisi par son frère
Mathieu.
Cet avocat tente de démontrer à la Cour l'insuffisance
des charges pesant sur l'accusé puisque les différentes analyses
graphologiques produites se contredisent ; l'une de celle-ci a été
effectuée par Bertillon. Mais, contre toute attente, Dreyfus est
condamné le 22 décembre à l'unanimité pour trahison « à la destitution
de son grade, à la dégradation militaire, et à la déportation perpétuelle
dans une enceinte fortifiée », c'est-à-dire au bagne en Guyane.
Il n'est pas condamné à mort, cette peine ayant été abolie pour
les crimes politiques depuis 1848.
Pour les autorités, la presse
et le public, les quelques doutes d'avant procès sont dissipés.
Son cas est évoqué devant la Chambre des députés et il ne trouve
alors aucun défenseur, ni même en la personne de Jean Jaurès qui
le condamne à la tribune ou de Clemenceau, les deux soulignant que
la peine de mort venait d'avoir été appliquée à un jeune soldat
insolent en vertu du Code de justice militaire.
Alfred Dreyfus
est dégradé le 5 janvier 1895 dans la cour d'honneur de l'École
militaire de Paris devant une foule furieuse qui crie notamment
« À bas le traître, à bas le juif ! ».
Le 22 février 1895 on
embarque Alfred Dreyfus sur le Ville-de-Saint-Nazaire, qui accoste
à l'île Royale le 12 mars. Gardé en secret total sur l'île Royale,
il pose pied sur l'île du Diable cinq jours plus tard. Au début,
il a une relative liberté de mouvement, quoique fortement suspecté
de vouloir s'évader, mais, en 1896, la rumeur d'une tentative de
le faire évader se répand, et les autorités font construire une
palissade autour de sa case. Il ne peut plus voir la mer ; il reste
confiné à l'intérieur de l'enceinte entourant sa case.

Son cas, à nouveau évoqué à la Chambre des
Députés, provoque un scandale dans le cadre de crises ministérielles.
Les preuves produites par le ministre de la Guerre devant la Chambre
se révèleront être des faux commis par les militaires. L'auteur
de ces fausses pièces, le Colonel Henry, sera emprisonné en 1898,
et se suicidera au lendemain même de sa mise en détention.
Après
l'arrêt de la Cour de cassation qui annule le premier jugement pour
violation des droits de la défense aux termes d'un arrêt réputé
particulièrement audacieux pour l'époque, Alfred Dreyfus est rapatrié
pour être jugé par un second conseil de guerre, à Rennes, le 30
juin 1899. Il est de nouveau reconnu coupable de trahison sur la
base de nouvelles pièces apparemment extraites du dossier secret,
reçoit bizarrement le bénéfice de circonstances atténuantes et est
condamné à dix ans d'emprisonnement. Dix jours plus tard, dans un
climat médiatique délétère, Alfred Dreyfus bénéficie d'une grâce
présidentielle.
Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation, saisie
par l'avocat Ludovic Trarieux peu avant sa mort d'un recours en
révision, cassera finalement le jugement de Rennes sans renvoi.
Alfred Dreyfus est réintégré dans l'armée avec le grade de chef
d'escadron, et reçoit peu après la Légion d'honneur, avec le grade
de chevalier. En 1908, il est victime d'un attentat par balles et
blessé lors des cérémonies de transfert au Panthéon des cendres
d'Émile Zola, son défenseur, auteur de la lettre envoyée au président
Félix Faure, « J'accuse…! », où il dénonce et dit que Dreyfus est
innocent. L'auteur de l'attentat, Louis Grégori, sera acquitté.
Il sert pendant la Première Guerre mondiale comme lieutenant-colonel,
et voit l'Alsace-Lorraine revenir à la France. Une anecdote veut
que ce fût lui qui accueillit les deux aviateurs qui avaient détecté
le changement de direction de l'armée allemande qui allait déclencher
la bataille de la Marne.
Il les laisse informer l'état-major
malgré son grade supérieur. Il termine la guerre avec la décoration
d'Officier de la Légion d'honneur. Il meurt en 1935 à Paris d'une
crise cardiaque, à l'âge de 75 ans, et est enterré au cimetière
du Montparnasse