La conspiration de Belfort
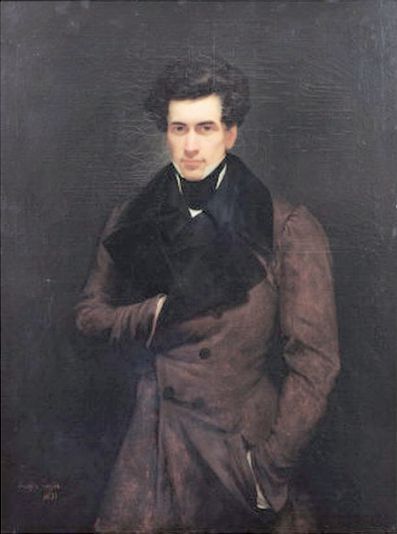
Pendant les premières années de la Restauration,
les libertés recevaient chaque jour de graves atteintes, malgré les
avertissements réitérés de la presse et les manifestations de la majorité
de la nation et de ses députés libéraux, dont le parti grossissait en
dépit des entraves officielles. Les cris de réforme, qui retentissaient
du haut de la tribune nationale, trouvaient de l'écho dans la France
tout entière. Cet état de choses augmentait tellement le mécontentement
général, que plusieurs grands personnages, croyant le moment venu de
l'expulsion de la dynastie régnante, se mirent en mesure de jouer un
rôle dans les événements qui se préparaient. On sait qu'en 1818, après
une tentative d'insurrection qui avorta, les membres les plus influents
de la société des Amis de la Vérité, obligés de quitter la France, allèrent
offrir leurs bras à la révolution de Naples et furent affiliés à une
société appelée des Carbonari, qui enveloppa toute l'Italie. C'est de
ce pays qu'on apporta en France le plan d'une immense association, dans
laquelle on initiait tous les ennemis déclarés du gouvernement royal,
qui se trouvèrent en grand nombre. Ce fut du sein de ces réunions appelées
ventes que sortirent ces violents écrits dont on se souvient encore.
L'avidité avec laquelle on recherchait ces pamphlets, aurait dû ouvrir
les yeux au gouvernement et lui montrer le peu de sympathie du peuple
à son égard ; mais l'aveuglement augmentait à mesure que les années
semblaient affermir un trône qui devait tomber huit ans plus tard, malgré
les formidables baïonnettes suisses dont il s'était entouré.
Le
parti révolutionnaire, voyant que la propagande au moyen de la presse
était insuffisante pour arriver à son but, crut devoir recourir à l'insurrection
armée et triompher enfin par la force: en conséquence, le mot d'ordre
fut lancé.
Dans cette lutte, où des hommes dévoués allaient jouer
leur vie au signal de leurs chefs inconnus, chaque département devait
fournir son contingent. Le Haut- Rhin, tant à cause de son patriotisme
que par sa position frontière qui devait résister au premier choc de
la réaction étrangère, avait été, ainsi que d'autres départements, appelé
à concourir avec Paris à la révolution qui se préparait. Sur les cinq
députés du Haut-Rhin, quatre appartenaient à l'extrême gauche de la
Chambre, c'est à dire à l'opposition.
Ces vigoureux athlètes qui,
du haut de la tribune nationale, battaient incessamment en brèche les
partisans de la monarchie, étaient Voyer-d'Argenson, Bignon, Georges
Lafayette et Jacques Kœcklin, dont nous reparlerons plus tard. Déjà,
en 1820, dans une sédition qui avorta, on vit figurer les noms de Manuel
et des colonels Pailhès, Fabvier et Brach, ainsique ceux du lieutenant-colonel
Caron, et de Dublar, Pégulu et Desbordes, qui furent acquittés par arrêt
de la Chambre des pairs et que nous retrouverons tout à l'heure. Cet
arrêt d'acquittement démontrait déjà que la pression exercée sur cette
Chambre supérieure lors du procès du maréchal Ney n'existait plus, ou
qu'elle était sans influence. Ce fut donc une année plus tard, en 1821,
qu'on prépara la conspiration de Belfort. Le département du Haut-Rhin
avait été définitivement choisi pour le théâtre du hardi coup demain
qui devait avancer de huit ans la révolution de 1830. Napoléon venait
de mourir à Sainte-Hélène ; ses partisans dans la révolte croyaient
s'exposer pour les héritiers de son trône, d'autres songeaient à fonder
une République et d'autres enfin, sans aucunes vues ultérieures, se
laissaient entraîner par le torrent. Le mouvement insurrectionnel qui
devait partir de Belfort, avait été fixé par le comité central de Paris,
à la nuit du 1er au 2 janvier 1822 ; le 29e régiment de ligne, dans
lequel servait Armand Carrel, tenait alors garnison à Belfort. Ce fut
ce régiment, où la charbonnerie napolitaine avait de fortes ramifications,
qui devait donner le signal d'une levée de boucliers destinée à amener
une grande révolution populaire dans la France entière. Le colonel Pailhès
des grenadiers à pied de l'ex garde impériale, avait été désigné pour
commander en chef. À cet effet, il s'était rendu incognito plusieurs
jours d'avance dans les murs de Belfort.
Des députés en renom devaient
venir se mettre à la tête du mouvement pour se constituer sur les lieux
mêmes en gouvernement provisoire et organiser les administrations départementales
et communales, en attendant que la nation pût être appelée à élire une
Assemblée Constituante qui déciderait de la forme définitive du gouvernement,
ainsi que des institutions à donner à la France d'après les vœux de
la majorité. Les députés qui avaient été investis à cette époque du
mandat de représentants pour le pays, étaient Lafayette, Dupont (de
l'Eure), Voyer-d'Argenson, Jacques Kœcklin et de Corcelles, père. Tous
les cinq faisaient partie du comité d'action institué dans la vente
suprême de la charbonnerie française, établie à Paris, au domicile de
M. Schonen, conseiller à la cour royale. A côté des dispositions prises
à Paris et dans les départements éloignés de l'Alsace, des intelligences
avaient été ménagées dans les départements voisins, notamment à Besançon,
Nancy, Metz et Strasbourg. Le colonel Brice, ancien chef de partisans
de la Lorraine, en 1815, opérait sur Metz et Nancy, d'où il devait,
dit-on, amener à Belfort, pour prendre part au mouvement, deux fils
du maréchal Ney, naturellement hostiles aux meurtriers juridiques de
leur père. Bazard, Buchez et Joubert étaient chargés de la correspondance
entre Belfort et Mulhouse. À Strasbourg, le colonel Brach et le chef
de bataillon Conrad, mort général en Espagne, devaient s'emparer du
commandement de cette place, aussitôt l'arrivée de la nouvelle de l'insurrection.
La garnison de Neuf-Brisach , dont faisaient partie les lieutenants
Carrel et de Grometty du 29e de ligne, parce que leurs compagnies étaient,
selon l'usage, détachées de Belfort, se trouvait depuis longtemps initiée
dans le complot et devait au premier signal marcher sur Colmar, chef-lieu
du département, distant de 12 kilomètres, sous la conduite du général
en retraite Dermoncourt, qui connaissait la place pour l'avoir commandée
en 1845.

Ce qui prouve aujourd'hui le peu d'attachement
qu'avaient les fonctionnaires de tout grade pour une famille dont les
fautes lui ont totalement fait perdre l'affection du peuple, seul rempart
inexpugnable, c'est que la plupart des autorités choisies par le pouvoir
même n'attendaient que l'occasion de lui montrer leur secrète aversion.
Le maire de Neuf-Brisach, M. Leroi, ancien colonel d'artillerie, qui
était aussi dans le secret de l'affaire, gardait la ville à la disposition
du corps insurrectionnel. M. Leroi était en outre désigné pour aller
former à Colmar, avec plusieurs autres citoyens notables du pays, notamment
MM. Nicolas Kœcklin, de Mulhouse, Frédéric Hartmann, de Munster, Morel,
ancien maire de Colmar, Blanchard, ancien commissaire ordonnateur des
armées impériales, le noyau de l'administration centrale appelée à gérer
les affaires du département sous le gouvernement provisoire, qui devait
être institué à Belfort le jour de l'insurrection. Dans Belfort même,
une administration municipale avait été sourdement organisée la veille,
sur le modèle de la Constitution de l'An III. En tête étaient M Charles
Blétry, commissionnaire, et l'un des plus notables négociants, qui fut
nommé maire de la ville aussitôt la révolution de 1830, et M. Réchou,
père, que l'on qualifiait alors de Patriote de 1789. Comme on le voit,
tout était parfaitement disposé à l'intérieur comme à l'extérieur de
Belfort pour imprimer au mouvement qui se préparait une marche régulière
et triomphante. Des cinq députés désignés pour composer le gouvernement
provisoire, deux étaient déjà arrivés depuis quelques jours en Alsace:
c'étaient Jacques Kœcklin et Voyer-d'Argenson. Le premier se tenait
à portée de Mulhouse, et l'autre était descendu sans bruit dans ses
propriétés aux forges d'Oberbruck, près de Massevaux. Le point de réunion
des cinq députés ayant été fixé à Belfort, la maison de campagne de
M. Réchou fut désignée pour être mise à la disposition du général Lafayette
et de son fils Georges Lafayette, attendus à Belfort du 1er au 2janvier
1822 pour venir se joindre à ses deux collègues. Quant à MM. Dupont
(de l'Eure), et de Corcelles, ils avaient été empêchés par des causes
majeures et involontaires. Déjà une voiture de cérémonie était commandée
pour aller chercher et amener « le patriarche de la liberté des deux
mondes» , comme on l'appela plus tard dans une chanson qui fit fureur
en 1830, et son fils, ancien officier de hussards, dont l'uniforme,
ainsi que celui de son père, avec les insignes de circonstance, avaient
été précédemment apportés de Paris à Belfort. Jacques Kœcklin arrivait
en poste dans la nuit du 1er au 2janvier jusque devant l'hôtel tenu
par M. Dauphin, au faubourg, quand un de ses neveux affilié, qui était
parti avant lui pour sonder le terrain, lui fit comprendre, en deux
mots faciles à interpréter dans cette situation, que le coup était manqué.
Jacques Kœcklin, saisissant le sens de l'avertissement, profita du trouble
qui régnait aux environs de l'hôtel, et, comme un voyageur contrarié
qui tient à sa tranquillité et n'aime pas le bruit, il rebroussa chemin
à la vue même des gendarmes et des patrouilles, qui ne pouvaient pas
soupçonner que ce paisible citoyen, honorablement connu du reste, fut
devenu tout-à-coup un Catilina à cent lieues de la Rome moderne. Notre
voyageur se rendit chez son ami d'Argenson, au moment où celui-ci se
préparait pour arriver au rendez-vous fixé au 2 janvier au matin, et
il l'instruisit de l'insuccès de la tentative. D'un autre côté, Messieurs
de Lafayette, père et fils, partis en poste de leur terre de La Grange,
arrivaient, cette même nuit, dans un faubourg de Lure, où ils furent
rencontrés par M. de Corcelles, fils, un des conjurés en fuite, parti
à cet effet en courrier depuis Belfort, immédiatement après le coup
de pistolet tiré sur le commandant de place, ce qui fut le signal de
l'avortementde ce grand projet. Messieurs de Lafayette rebroussèrent
chemin et se dirigèrent sur la campagne de leur ami, M. Martin, de Gray,
d'où ils s'en retournèrent à Paris sans être aucunement compromis.
Voici ce qui s'était passé dans Belfort pendant ce temps. Le colonel
Pailhès, qui y était déjà arrivé depuis quelques jours, s'y était tenu
caché ; néanmoins, il s'était mis en rapport avec quelques officiers
et sous officiers du 2ème de ligne, qui devaient lui amener
tout le régiment. Il avait également lié des intelligences et s'était
fait connaître comme chef aux affiliés de Belfort, tels que Charles
Blétry, Réchou, père et fils, le lieutenant en demi-solde Roussillon,
Beaume, fils, Georges, Netzer, Petitjean, etc. C'est chez ce dernier
que se trouvait le dépôt de drapeaux et de cocardes tricolores.
La confiance des conspirateurs était si grande dans la réussite de leur
projet que la Revue d'Alsace rapporte que le lieutenant Dublar, de Paris,
s'était chargé d'entrer dans Belfort, ayant sous le bras un portemanteau
rouge rempli de ces cocardes, ce qu'il effectua en effet sans éveiller
le moindre soupçon, malgré la couleur suspecte et provoquante de ce
porte-manteau qui renfermait la plus terrible des contrebandes. Dans
les hôtels de la ville et des faubourgs étaient successivement arrivés
de Paris une nuée de jeunes gens déterminés et fidèles à leur serment,
envoyés par les diverses ventes de carbonari de la capitale pour prendre
part et donner de suite de la consistance et de l'écho au mouvement
révolutionnaire. Dans la soirée du jour de l'an 1822, tout était prêt
pour la prise d'armes, fixée au lendemain matin. L'adjudant Tellier,
du 29ème régiment, qui, à cause de son zèle, avait été choisi
pour préparer tous les détails, avait eu soin de placer dans les postes
principaux des sous-officiers et des soldats de garde sur lesquels on
pouvait compter.
Toute la journée avait été employée par lui en
courses actives et en pourparlers avec les autres sous-officiers engagés
dans la conspiration. Après l'appel de huit heures du soir, voyant s'approcher
le moment suprême, Tellier fait monter dans sa chambre, à la caserne,
une dizaine de sous-officiers qu'il trouva devant le quartier réunis
en groupe dans l'obscurité, et qu'il croyait tous être de son bord puisqu'ils
formaient une même société. Quand ils furent rassemblés, il assigna
à chacun son rôle pour le lendemain matin, et donna tous les ordres
nécessaires à l'exécution rapide du mouvement. Mais il advint que dans
cette réunion, faite sans précautions, maçonniques deux de ces sous-officiers
se trouvaient initiés pour la première fois à ce complot qu'on leur
avait caché jusqu'alors. Dans le doute, ils voulurent, une fois sortis,
s'assurer par eux-mêmes si, comme l'adjudant venait de le leur dire,
leurs officiers étaient réellement dans la conspiration. Ils se rendirent
à l'instant chacun chez leur capitaine, pour s'assurer de la solidité
du terrain sur lequel ils devaient s'aventurer. Les deux capitaines,
dont aucun n'était dans le secret, se hâtèrent d'aller prévenir leur
colonel, et se transportèrent avec lui, ainsi que le lieutenant de roi
qu'on avait fait avertir, à la caserne du régiment, où se trouvait une
partie des soldats déjà armés ou prêts à prendre les armes, et les autres
mettant des pierres à leur fusil.
L'adjudant Tellier, prévenu de
suite, courut au poste de la porte de France avertir le lieutenant Manoury
que le complot était avorté et que tout était découvert.
Cet officier
emmena Tellier dans un cabaret voisin, tenu par le sieur Boltz, frère
du directeur des postes de Belfort, et ses deux filles, et où se trouvaient
réunis attendant le moment d'agir le colonel Pailhès, en uniforme des
grenadiers de la garde impériale et portant une ceinture rouge avec
deux pistolets et un poignard, le lieutenant Peugnet, du 2ème,
les officiers en non activité Roussillon, qui logeait dans la maison,
Pégulu, Brue, Desbordes, Lacombe et quelques autres. Le lieutenant Peugnet,
enveloppé de son manteau qui cachait son sabre et deux pistolets attachés
aussi à une ceinture rouge, se rendit de suite à la caserne, pours'assurerpar
lui-même si le rapport de l'adjudant Tellier était exact, et pour juger
s'il n'y aurait pas quelque chance de tenter un coup hardi en devançant
l'heure fixée ; mais il revint aussitôt rejoindre les autres conjurés
pour leur confirmer que la mèche avait été éventée et que tout espoir
était perdu. On détruisit de suite plusieurs objets compromettants ;
le lieutenant Manoury retourna à son poste, et les autres conjurés de
la réunion se dirigèrent sur le faubourg du côté du groupe des conspirateurs
du dehors, qui devaient s'y trouver rassemblés. Pendant que le colonel
du 29ème consignait son régiment à la caserne et procédait
à une première enquête, le lieutenant de roi, M. Toutain, sortait de
la ville avec un peloton commandé par un officier. Il rencontre le rassemblement
qui s'était formé au bout du pont du faubourg, et lui ordonne de se
disperser; mais à l'instant le lieutenant Peugnet ouvre son manteau
et saisissant un de ses pistolets, il le décharge à brûle pourpoint
sur le lieutenant de roi, en s'écriant: « Commandant, vous êtes à moi!
» Le lieutenant de roi tombe baigné dans son sang, quoique la balle,
qui avait pénétré de plusieurs pouces dans la poitrine, eût miraculeusement
été amortie par la croix de St- Louis, que portait cet officier supérieur.
Le cri aux armes ! part aussitôt du sein du rassemblement ; mais les
conjurés se trouvant dépourvus d'armes, se dispersèrent. Quelques-uns
furent arrêtés dans les faubourgs, et d'autres dans la ville. L'émoi
était tel que, par un excès de précaution, tous les citoyens, hommes,
femmes, filles, enfants, rencontrés dans les rues, étaient arrêtés de
suite par les patrouilles ou par la police et renfermés dans l'ancienne
sous-préfecture, momentanément transformée en annexe de la prison, trop
petite pour recevoir tant de détenus. Parmi les conspirateurs arrêtés
en ville se trouvaient les quatre officiers en non activité, qui, ayant
été déposés au corps de garde de la porte de France, s'évadèrent avec
le lieutenant Manoury, qui commandait ce poste. Ceux qui ne furent point
arrêtés à l'instant s'enfuirent dans diverses directions. L'adjudant
Tellier et un autre sous-officier du 29ème, nommé Vattebled,
se réfugièrent en Suisse, où Tellier fut arrêté six jours après par
des gendarmes français, au moment où se voyant sans espoir d'en réchapper,
Vattebled venait de se brûler la cervelle dans le grenier d'une ferme,
près de St-Braise, bailliage de Porrentruy, où la gendarmerie et la
police françaises avaient été autorisées à les traquer. Le colonel Faillies
et le lieutenant Dublar, errant dans les montagnes des Vosges, étant
descendus dans une auberge de la ville de Thann, accablés de fatigue
et de besoin, y furent aussitôt arrêtés et réunis à vingt autres de
leurs complices déjà renfermés dans les prisons de Colmar. Pour abréger
les détails, nous dirons que sur quarante-quatre conjurés dont les noms
figurèrent au procès, vingt-trois étaient déjà sous la main de la justice
et vingt et un étaient en fuite. Dans ces derniers se trouvaient deux
Belfortains : Petitjean, qui mourut au moment de s'embarquer, et Beaume,
qui cingla vers l'Amérique, où la fortune lui devint favorable. L'affaire
ne fut évoquée qu'au mois de juillet 1822. Les assises furent présidées
par M.Millet de Chevers, premier président de la cour de Colmar. Depuis
longtemps, les tribunaux n'avaient retenti d'un procès politique de
cette importance. Cent quatre-vingt-un témoins furent interrogés ; les
audiences durèrent vingt jours. Me Barthe, célèbre avocat de la capitale,
dont les talents sont connus et appréciés au loin, était venu apporter
dans cette cause le secours de son éloquence, à laquelle l'opinion du
pays attribua la douceur du jugement qui fut rendu. La cour royale,
par son arrêt, condamna le colonel Pailhès, Guimard, le lieutenant Dublar
et l'adjudant Tellier à cinq ans de détention, plus chacun à 500 fr.
d'amende, aux frais solidaires du procès et à 5 années de surveillance
; les autres accusés présents furent acquittés. Le 30 septembre suivant,
la peine de mort fut prononcée contre les accusés contumaces Brue, Desbordes,
Lacombe, Manoury, Pégulu, Petitjean et Peugnet.
Tel fut le résultat
de cette conspiration qui fit tant de bruit à l'époque, et dont les
détails du procès forment un gros volume imprimé à Colmar et qui eut
une vogue inouïe. En 1828, le roi Charles X, qui régnait depuis cinq
ans, fit un voyage en Alsace. Il a honoré de sa présence et visité en
détail Strasbourg, Schelestadt, Colmar, Cernay, Mulhouse et Ensisheim;
mais, malgré l'importance militaire de Belfort, Sa Majesté n'a pas daigné
venir recueillir les hommages des Belfortains. Nous ne parlerons pas
des mille inscriptions étalées sur les arcs de triomphe semés sur sa
route, ni des médailles frappées à cette occasion par les villes privilégiées,
pas plus que des discours exprimant un dévouement éternel qui ne devait
pas durer deux ans.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025