La bataille d'Ivry
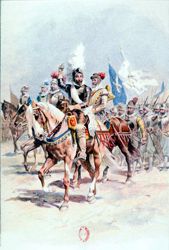
Entre la bataille d’Azincourt qui eut lieu le
25 octobre 1415 et celle d’Ivry qui se déroula le 14mars 1590, plus
d'un siècle et demi s'est écoulé.
Dans cet intervalle, une véritable
révolution s'est opérée, tant dans la constitution et l'organisation
générales des armées, qui sont devenues permanentes, que dans les méthodes
de guerre et dans les procédés de combat, radicalement transformés par
l'adoption universelle des armes à feu. Toutefois, si la renaissance
des lettres et des arts a coïncidé avec la renaissance de l'art militaire
lui-même, celui-ci ne prendra réellement et définitivement sa forme
moderne que dans la première moitié du siècle suivant, avec Gustave-Adolphe.
L'illustre roi de Suède est, en effet, le véritable restaurateur de
la stratégie, cet art de faire mouvoir les armées sur de vastes échiquiers
et de mettre au service d'une politique à vues plus ou moins étendues
et plus ou moins profondes les grandes combinaisons de la guerre. Entre
ce prince et les trois grands capitaines de l'antiquité, Alexandre,
Annibal et César, il n'y a point de nom qui s'élève à leur hauteur commune,
point d'intermédiaire qui puisse être comparé à aucun d'eux, même de
loin.
En revanche, de temps à autre, dans l'antiquité, au moyen
âge et de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que nous avançons
dans le XVIème siècle, nous rencontrons des tacticiens éminents,
c'est-à-dire des généraux habiles à amener, dans les conditions les
plus favorables, les troupes sur le champ de bataille; à improviser,
grâce à leur coup d'œil et à leur sang-froid, des dispositions propres
à décider la victoire en leur faveur, et aussi — quoique plus rarement,
il faut en convenir — à tirer de leur succès tous les fruits qu'il peut
produire. Le duc d'Albe, Alexandre Farnèse, Ambroise Spinola, du côté
des Espagnols ; Coligny. La Noue, Saint-André, Henri IV enfin, chez
les Français, sont de ceux-là, et c'est à leur école que se forment
les deux généraux éminents qui vont être, dans les premières années
du XVIIème siècle, les précurseurs immédiats du grand Gustave
: Maurice de Nassau et le duc de Rohan.
Henri IV, en particulier,
était, suivant l'expression de Carrion-Nisas, « né avec le plus beau
génie pour la guerre ». Seulement, il occupe un rang trop élevé
parmi les grands politiques et les fins diplomates pour qu'on accorde
ordinairement à ses talents militaires toute l'estime et même toute
l'attention qu'ils mériteraient. Chacun sait qu'il était brave, d'une
bravoure héroïque et chevaleresque dont témoignent maintes anecdotes,
et connaît le nom des principales victoires qu'il a remportées: Coutras,
Arques, Ivry, Fontaine-Française ; mais on ignore généralement, ou,
du moins, l'on ne prend pas assez garde qu'il les a gagnées par une
science profonde du terrain et du maniement des troupes, bien plus encore
que par sa vaillance légendaire : ce n'est pas uniquement un grand soldat,
c'est aussi un vrai général, et les rivaux de la France l'eussent sans
doute appris à leurs dépens, s'il n'avait été empêché de mener à bien
son « grand dessein» par le coup de couteau de François Ravaillac.
Entre les diverses batailles qu'il livra, nous avons choisi de préférence
celle d’Ivry, non seulement comme la plus célèbre et la plus décisive,
mais aussi comme celle qui fait le mieux connaître l'homme de guerre,
arrivé à sa pleine maturité. Les circonstances dans lesquelles il la
donna sont assez connues pour que nous nous bornions à les rappeler
brièvement. Roi, de droit, -depuis quelques mois, Henri ne l'était pas
encore de fait et avait, comme il l'a dit lui-même, à « conquérir son
royaume ». Le succès d'Arques, en septembre 1589, avait rétabli ses
affaires plutôt qu'il ne les avait avancées. La capitale était toujours
aux mains des Ligueurs et, après une première tentative restée infructueuse,
il avait dû renoncer à s'en rendre maître de vive force. Aussi se résolut-il
à l'envelopper dans une sorte de cercle qui irait toujours en se rétrécissant
de plus en plus, et, pour commencer, dans l'hiver de 1589-1590, il s'empara
successivement des principales plaines du Maine et de la Normandie;
En dernier lieu, il avait mis le siège devant Dreux, qu'il pressait
vivement et pensait réduire avant peu. Cette ville avait alors une grande
importance, à cause de sa situation à mi-chemin d’Orléans et de Rouen,
dont elle couvrait ou barrait les communications ; le duc de Mayenne,
chef et général de la Ligue, résolut donc de la délivrer.
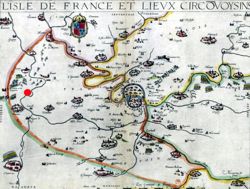
Il venait de recevoir du duc de Parme, commandant
de l'armée espagnole des Pays-Bas, un important renfort de troupes wallonnes,
que lui avait amené le comte d'Egmont. A la tête de son armée reconstituée,
il se dirigea sans retard sur Mantes, où il passa la Seine. Averti de
son approche, Henri n'eut garde de l'attendre sous les murs de Dreux,
auquel il venait de livrer un assaut inutile : il se porta à la rencontre
des Ligueurs, mais non pas toutefois directement. Faisant surveiller
la marche de l'ennemi par un détachement posté à Ivry, sous le maréchal
d'Aumont, et par un corps léger poussé plus loin encore, à Pacy-sur-Eure,
aux ordres du marquis de Rosny, celui qui deviendra le duc de Sully,
il prit, avec le gros de ses forces, la direction d'Évreux, comme s'il
avait l'intention de se retirer en Normandie. Son but en agissant ainsi,
était d'attirer son adversaire hors de la vallée de l'Eure, où la cavalerie
royale, regardée comme bien supérieure à celle de la Ligue, sinon en
nombre, du moins en qualité, n'aurait pu agir aussi efficacement que
dans les plaines découvertes qui s'étendent, à l'ouest, entre celle
rivière et son affluent de gauche, l'Iton. La feinte réussit à souhait.
De Mantes, Mayenne, qui s’était porté d'abord sur Ivry, obliqua à droite,
vers Saint- André, et cela avec d'autant moins d'hésitation que d'Aumont
venait de se replier lui-même dans cette direction, pour rejoindre le
roi. Celui-ci, alors, fit un changement de front vers l'est et, de Nonancourt,
qu'il venait d'atteindre, marcha droit sur Saint-André, puis, de là,
par Foucrainville, sur Ivry. Cette petite ville, qui a donné son nom
à la bataille et en a pris son surnom, « d’Ivry la Bataille » s'appelait
auparavant Ivry-Ia-Chaussée, était une ancienne place forte qui avait
joué un certain rôle dans la guerre de Cent Ans et avait été, en dernier
lieu, prise et démantelée par Dunois. Elle conservait néanmoins quelque
valeur militaire, à cause de ses ponts sur l'Eure, que l'on ne peut
passer à gué, au-dessus et au-dessous, qu'en un petit nombre d'endroits.
Mais le duc de Mayenne ayant déjà effectué son passage lorsque ses coureurs
se heurtèrent à ceux du roi, Ivry est resté complètement en dehors du
théâtre de l'action, sinon de la poursuite ; c'est à 6 ou 7 kilomètres
au nord-ouest que les deux armées en sont venues aux mains, un peu en
avant de l'emplacement du monument commémoratif de la bataille d’Ivry.
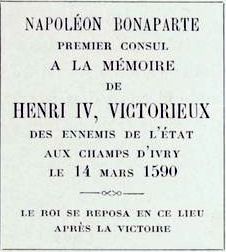 Mayenne avait son aile droite; son centre, décrivant un arc de cercle,
c'est-à-dire un « rentrant» assez prononcé, était au hameau de Tourne-Boisset,
qu'un étroit ravin sépare du bois de Garennes, lequel domine immédiatement
la vallée de l'Eure; sa gauche s'appuyait à Boussey. En face des Ligueurs,
les troupes royales, campées ou cantonnées la veille à Foucrainville
et à Batigny, avaient pris un ordre de bataille sensiblement parallèle,
à cela près toutefois qu'elles n'avaient point refusé leur centre, comme
Mayenne avait jugé bon de le faire. Ainsi Henri avait sa droite vers
Boussey et étendait sa gauche dans la direction d'Epieds. Entre les
deux armées, non plus d'ailleurs que sur leurs flancs, pas un accident
de terrain notable ; le plateau est, à la vérité, légèrement ondulé,
mais aucune des rides du sol n'a un commandement de plus de 4 à 5 mètres,
et il serait assez difficile de désigner exactement, aujourd'hui l'
« éminence» où, d'après les auteurs, le grand maître de l'artillerie
du roi, Philibert de la Guiche, disposa les six pièces qui, avec deux
couleuvrines, constituaient tout « le canon» de l'armée royale, à la
bataille d'Ivry. Dans une plaine aussi unie et aussi découverte, on
conçoit l'importance exceptionnelle acquise, ce jour-là, par un groupe
de trois poiriers qui s'apercevaient d'assez loin pour que le roi les
ait indiqués à ses compagnons comme point de direction et de ralliement.
A la place même qu'occupaient ces arbres historiques, se dresse aujourd'hui
le monument destiné à perpétuer le souvenir de la bataille. C'est un
obélisque de pierre, se terminant en pyramide, dont le soubassement
est entouré d'une grille circulaire. Il est haut de 17 mètres et très
simple. Sur les quatre faces du piédestal sont placées autant de plaques
de bronze, dont les deux latérales sans inscriptions, ni ornements.
Mayenne avait son aile droite; son centre, décrivant un arc de cercle,
c'est-à-dire un « rentrant» assez prononcé, était au hameau de Tourne-Boisset,
qu'un étroit ravin sépare du bois de Garennes, lequel domine immédiatement
la vallée de l'Eure; sa gauche s'appuyait à Boussey. En face des Ligueurs,
les troupes royales, campées ou cantonnées la veille à Foucrainville
et à Batigny, avaient pris un ordre de bataille sensiblement parallèle,
à cela près toutefois qu'elles n'avaient point refusé leur centre, comme
Mayenne avait jugé bon de le faire. Ainsi Henri avait sa droite vers
Boussey et étendait sa gauche dans la direction d'Epieds. Entre les
deux armées, non plus d'ailleurs que sur leurs flancs, pas un accident
de terrain notable ; le plateau est, à la vérité, légèrement ondulé,
mais aucune des rides du sol n'a un commandement de plus de 4 à 5 mètres,
et il serait assez difficile de désigner exactement, aujourd'hui l'
« éminence» où, d'après les auteurs, le grand maître de l'artillerie
du roi, Philibert de la Guiche, disposa les six pièces qui, avec deux
couleuvrines, constituaient tout « le canon» de l'armée royale, à la
bataille d'Ivry. Dans une plaine aussi unie et aussi découverte, on
conçoit l'importance exceptionnelle acquise, ce jour-là, par un groupe
de trois poiriers qui s'apercevaient d'assez loin pour que le roi les
ait indiqués à ses compagnons comme point de direction et de ralliement.
A la place même qu'occupaient ces arbres historiques, se dresse aujourd'hui
le monument destiné à perpétuer le souvenir de la bataille. C'est un
obélisque de pierre, se terminant en pyramide, dont le soubassement
est entouré d'une grille circulaire. Il est haut de 17 mètres et très
simple. Sur les quatre faces du piédestal sont placées autant de plaques
de bronze, dont les deux latérales sans inscriptions, ni ornements.

Celle qui fait face à l'allée d'accès porte en
relief l'inscription.Au-dessus de cette plaque, dans la partie inférieure
de la pyramide, est enchâssé un médaillon en marbre blanc où l'on a
sculpté le profil traditionnel du Béarnais entre deux branches de laurier;
sur la face opposée, un médaillon semblable porte les armes de la maison
de Bourbon, et la plaque du même côté une seconde inscription.
C'est
à Bonaparte, en effet, qu'est dû l'obélisque actuel, qui fut érigé en
1804, à la place d'un premier monument élevé, dans la seconde moitié
du XVIIIème siècle, par le duc de Penthièvre, et que la Révolution
avait détruit, encore qu'il ne rappelât qu'une journée glorieuse pour
les armes françaises et que le vainqueur eût été le seul roi dont le
peuple ait gardé la mémoire, suivant le vers si connu de la Henriade
de Voltaire.
Quelques mots maintenant sur la force et la composition
des deux armées en présence. Celle du roi se composait de 8 000 hommes
de pied et de 2 500 chevaux; dans cet effectif, les troupes suisses
entraient pour un peu plus du quart, et la cavalerie venait d'être renforcée
par un bel « escadron » de 300 reîtres (Reiter qui signifie cavalier)
allemands levés et commandés par le comte de Schomberg. Ce corps faisait
partie de l'aile droite, aux ordres du maréchal de Biron ; le roi s'était
réservé la conduite de son centre, où il se tenait à la tête de son
propre escadron, fort de 600 chevaux et disposé sur cinq rangs, dont
le premier était composé de princes et de grands seigneurs. Le duc de
Montpensier commandait l'aile gauche, avec le maréchal d'Aumont en sous-ordre.
Nous avons déjà vu que l'artillerie consistait en 6 canons et de 2 couleuvrines
et que le grand maître, Philibert de la Guiche, la dirigeait en personne.
Le duc de Mayenne n'avait à lui opposer que 4 (d'autres disent 5)
bouches à feu ; mais il était sensiblement supérieur à son adversaire
en infanterie forte de 13 500 hommes, aussi bien qu'en cavalerie composée
de 3 500 chevaux. Une bonne moitié de ces troupes étaient étrangères
: c'étaient des Suisses, des reîtres, des lansquenets ; levés pour Henri
IV et passés à la Ligue moyennant une légère augmentation de solde,
ce qui explique le massacre qu'on en fit après la bataille. Le quartier
d'Henri IV avait été marqué dans ce dernier village. Avant de s'y rendre,
le roi voulut reconnaître le terrain environnant; il visita ses postes,
et ce ne fut qu'à neuf heures du soir qu'il arriva dans le logement
qui lui avait été préparé. « Toute cette nuit, dit l'historien Davila,
se passa de part et d'autre en un travail perpétuel et en grande inquiétude.
On allumait à tout moment de grands feux entre les deux camps, et il
y avait par toute la plaine des sentinelles posées. Les mestres de camp
en faisaient la ronde et prenaient soin de les changer toutes les demi-heures.
Cependant l'armée du roi, pour l'abondance des vivres et la commodité
des maisons, outre que l'infanterie s'était close et fortifiée partout
de bonnes palissades, avait sur celle de la Ligue l'avantage de se reposer
plus tranquillement et de se délasser ainsi de la fatigue des armes.
Le 14, avant le jour, un coup de canon fit prendre les armes aux troupes
du roi. Celui-ci voulut faire, avec de Vie, l'office de sergent de bataille
et ranger lui-même son armée. A ce moment même, Rosny recevait à Pacy-sur-Eure
la lettre que voici, écrite la veille au soir: « Mon amy, je ne pensai
jamais mieux donner une bataille que ce jourd'huy; mais tout s'est passé
en légères escarmouches et à essayer de se loger chacun à son avantage.
Je m'assure que vous eussiez eu regret toute votre vie de ne vous y
être pas trouvé ; pourtant, je vous avertis que ce sera pour demain,
car nous sommes si près les uns des autres que nous ne nous en saurions
dédire. Je vous conjure donc de venir et d'amener tout ce que vous pourrez.
Adieu, mon amy.» Au reçu de cette lettre, Rosny fit sonner le boute-selle
et marcha avec tant de diligence qu'il arriva une heure avant la bataille.
Pendant que l'armée royale prenait entre Epieds et Boussey une formation
quasi en ligne droite, dont le bout gauche faisait un peu plus de corne
que le droit ; les maréchaux de camp de Mayenne, Jean de Saulx, vicomte
de Tavannes et le baron de Rosne, rangeaient en demi-cercle sur la rampe
du plateau d'Epieds, l'un les escadrons, l'autre les bataillons de la
Ligue.

Comme à Coutras, les deux armées offraient un
contraste remarquable :les armes des ligueurs, disent les historiens
du temps, étaient brillantes d'or et de clinquant, tandis que les soldats
du roi n'étaient chargés que de fer. L'armée de la Ligue restant immobile
dans sa position, le roi résolut de ne pas différer l'attaque. Après
avoir placé sur son front, en guise d'avant-garde, les compagnies que
venait d'amener Rosny: « Quant à vous, dit-il à son ami, venez avec
moi; je veux vous apprendre aujourd'hui votre métier. » Bientôt,
l'armée entière s'ébranla; mais, après une courte marche, le roi fit
faire halte et rectifia les distances et les alignements. Ce fut alors
qu'il fit faire à son aile droite un léger mouvement de conversion,
afin de se rapprocher de 150 pas de l'aile gauche ennemie et de tourner
le dos au vent et au soleil. Monté sur un grand coursier bai et armé
de toutes pièces, il passa ensuite devant le front de ses troupes et
sa présence aussi bien que ses discours portèrent l'enthousiasme au
plus haut degré parmi elles.
« Ils sont plus nombreux que nous,
lui dit un reître. — Tant mieux, répondit-il; plus de gens, plus de
gloire! D'ailleurs, la cavalerie défaite, nous aurons beau jeu des gens
de pied. » Ayant rencontré Schomberg, auquel il avait parlé, deux
jours auparavant, avec vivacité: « Je vous ai blessé, lui dit-il,
mais je connais votre mérite; pardonnez-moi. » La réponse du capitaine
allemand fut digne de ces nobles : « Il est vrai que Votre Majesté
me blessa l'autre jour; mais aujourd'hui elle me tue, car l'honneur
qu'elle me fait m'oblige de mourir pour son service. » Schomberg
devait tenir parole. Ce qui préoccupait surtout le roi, c'était le ralliement
des escadrons après la charge. Il montra à ses capitaines trois poiriers
qui formaient une masse distincte, en arrière de l'aile droite ennemie:
« C'est là qu'il faudra se réunir, mes compagnons, leur dit-il; j'y
serai, et, si vous perdez vos cornettes, ralliez-vous à mon panache
blanc » Sur ces entrefaites, on vint annoncer au roi que les sieurs
d'Humières et de Mouy ne tarderaient pas d'arriver avec 300 chevaux
levés en Picardie, et beaucoup de gentils hommes de cette province.
Le maréchal de Biron proposa de les attendre; mais, impatient de combattre,
Henri ne suivit pas ce conseil- L'ordre fut envoyé à d'Humières et à
de Mouy de se joindre à la réserve, et l'armée royale continua son mouvement.
Lorsqu'elle fut à portée de canon, le roi ordonna au grand maître de
l'artillerie d'ouvrir le feu. Il était près de midi quand M. de la Guiche
commença ses canonnades. Il tira neuf volées à bon escient avant que
l'artillerie de Mayenne eût répondu, les canonniers qui la servaient
étant peu exercés. M. de Rosne se trouvait à la droite de l'armée de
la Ligue avec un corps de cavalerie légère : l'artillerie royale lui
faisant éprouver des pertes considérables, il s'avança pour la charger.
Le maréchal d'Aumont s'aperçoit de ce mouvement, s'élance contre le
corps ennemi, le prend en flanc et le met en désordre. Cependant, les
deux corps de reîtres placés en arrière de la cavalerie que commandait
de Rosne avaient suivi le mouvement de celui-ci et s'étaient portés
avec beaucoup de résolution vers l'artillerie du roi ; mais, ayant été
chargés par les escadrons de Givryet du comte d'Auvergne, ils tournèrent
bride en criant qu'ils étaient aussi « de la religion ». Dans leur fuite,
ils se jetèrent sur les Suisses, puis sur les lansquenets qui baissèrent
leurs piques contre eux et, après avoir mis l'aile droite de Mayenne
en grand désordre, ils disparurent du champ de bataille. Les lanciers
wallons du comte d'Egmont s'ébranlèrent pour rétablir le combat et dérober
à l'armée du roi le désordre qu'avait occasionné la fuite des reîtres.
Chargée par eux, la cavalerie légère du comte d'Auvergne et de Givry
fut enfoncée. Elle aurait été entièrement défaite si le baron de Biron
et le duc de Montpensier n'avaient marché rapidement pour la soutenir.
Les Wallons plièrent à leur tour et vinrent se rallier à la droite à
l'escadron de Mayenne. Ce fut alors seulement que s'ébranla ce corps
d'élite. Exécuté plus tôt, son mouvement aurait pu être décisif ; mais,
occupé de rétablir l'ordre dans le centre de son armée, le chef des
Ligueurs avait laissé échapper l'occasion de s'assurer la victoire.
Henri avait, au plus haut degré, ce coup d'œil rapide et cette vigueur
dans l'exécution qui manquaient à son adversaire. Il sentit que le moment
de charger avec ses meilleurs troupes était venu. Aussitôt, il s'élance
à la tête de son escadron : une décharge des arquebusiers espagnols
à cheval ne l'arrête pas un moment. La mêlée fut terrible. Le roi, combattant
comme un simple gendarme courut les plus grands dangers et tua de sa
main plusieurs cavaliers ennemis. Schomberg périt à ses côtés, tandis
que, dans le parti opposé, d'Egmont était tué d'un coup de pistolet,
après avoir montré la plus brillante valeur. « Les deux troupes furent
tête à tête un quart d'heure durant, frappant à qui mieux mieux, avant
que nul ne cédât et que les escadrons ployassent ; enfin les Wallons
se firent jour et presque toute la gauche de l'escadron royal s'enfuit.
» Le maréchal de Biron, resté jusque-là « en conserve », prit alors
part au combat. La marche du corps qu'il commandait jeta l'épouvante
dans la cavalerie de Mayenne; elle tourna le dos sur tous les points.
Le roi la poursuivit l'épée dans les reins et s'empara de trois étendards
wallons. La rapidité de sa course l'avait séparé des siens : s'étant
aperçu que douze ou quinze cavaliers seulement l'accompagnaient, il
s'arrêta, de peur de fâcheuse rencontre, sous les trois poiriers— là
où s'élève aujourd'hui une pyramide commémorative— et ses cavaliers
vinrent de tous côtés se rallier à son panache blanc. Lorsque les siens
le rejoignirent, des cris de : « Vive le roi! » se firent entendre de
toutes parts. La joie fut d'autant plus vive que son éloignement avait
causé plus d'alarmes. Le jeune comte de Rhodes, atteint pendant la mêlée
d'un coup de feu qui l'avait privé de la vue, fut emporté par son cheval
; comme il portait la cornette blanche, les bruits les plus sinistres
circulèrent un moment. Mais bientôt le baron de Biron, le maréchal d'Aumont
et le duc de Montpensier furent réunis autour du monarque. Le maréchal
de Biron les suivait ; Henri alla au-devant de lui: « Sire, lui dit
le maréchal, vous avez fait le devoir du maréchal de Biron, et le maréchal
de Biron a fait ce que le roi aurait dû faire. » De tous côtés, l'infanterie
royale s'avançait dans la plaine pour achever l'œuvre de la cavalerie.
Le désordre était à son comble parmi les Ligueurs. Au lieu de couvrir
la retraite de l'infanterie, leurs escadrons fuyaient à toute bride.
Les lansquenets ne tardèrent pas à être atteints et égorgés sans pitié,
en souvenir de leur trahison : 1 300 de ces étrangers restèrent sur
la place. Seule, l'infanterie helvétique de la Ligue, quoique abandonnée
à elle-même au milieu d'une vaste plaine, faisait bonne contenance.
Le roi fit avancer contre elle son artillerie ; en même temps, l'infanterie
de l'aile droite qui n'avait point encore combattu se disposa à l'attaquer.
Les Suisses allaient subir le même sort que les lansquenets ; mais,
se rappelant les services rendus par leurs compatriotes à la couronne
de France, Henri fit suspendre l'attaque. Sommés de se rendre, ils déposèrent
les armes et furent admis à capitulation ; l'acte qui leur laissait
leurs enseignes et leur accordait de l'argent et des vivres pour retourner
dans leur pays fut signé après la bataille. Après avoir si vaillamment
combattu pour la victoire, le roi voulut en recueillir le fruit en ne
laissant pas de relâche à l'armée battue. Il prit le galop avec ce qu'il
put réunir de cavalerie ; le prince de Conti, le duc de Montpensier,
le comte de Saint- Paul, le maréchal d'Aumont, le sieur de la Trémouille
le suivirent. C'est alors que le Roi se serait écrié, dit-on: « Sauvez
les Français, et main basse sur l'étranger! »
Les pourparlers
engagés avec les Suisses avaient pris du temps : Mayenne le mit à profit
pour repasser l'Eure à Ivry et détruire les ponts. Beaucoup de fuyards,
et surtout les reîtres, perdirent ainsi tout moyen de retraite : une
partie se noya en essayant de franchir à la nage la rivière grossie
par les pluies. D'autres, après avoir cherché un asile dans les bois
voisins du champ de bataille, tombèrent sous les coups des paysans,
plus impitoyables pour eux que les Royaux. Un certain nombre s'étaient
barricadés dans les rues d'Ivry, le maréchal de Biron ayant reçu l'ordre
d'attaquer le bourg avec son infanterie, les barricades n'arrêtèrent
les vainqueurs que quelques instants ; 400 reîtres et beaucoup de cavaliers
et de fantassins français y furent tués ; l'artillerie et les bagages,
empêtrés dans les rues, tombèrent au pouvoir des troupes royales. Pendant
l'attaque d'Ivry, le Roi avait fait chercher un gué pour sa cavalerie.
Ceux de Buchaille et de Nantilly, en aval, ayant paru trop dangereux,
il remonta la rivière et la franchit au gué de la Tourniole. Mayenne
s'était dirigé vers Mantes, la cavalerie royale suivit ses traces jusqu'au
milieu de la nuit et fit bon nombre de prisonniers. Le roi soupa et
coucha au château de Rosny. Quoique la bataille n'eût duré que trois
heures, Henri n'en avait pas encore gagné d'aussi décisive. Du côté
des Ligueurs, 2 400 hommes de pied et 1 000 cavaliers restaient sur
le champ de bataille. Le nombre des prisonniers était plus considérable
encore ; à peine un quart de l'armée de Mayenne parvint à s'échapper
; son canon et beaucoup de ses enseignes tombèrent entre les mains des
vainqueurs. L'armée du Roi, au contraire, n'avait pas perdu 500 hommes.
La consternation fut grande, dans Paris, lorsqu'on y reçut la nouvelle
de la défaite de Mayenne. Il est même probable que le roi aurait pu
s'emparer assez aisément de la ville s'il s'y était porté sans perdre
un instant. Des conseils trop prudents et qui n'étaient point absolument
désintéressés, selon les uns ; la nécessité de laisser quelque repos
à l'armée qui, comme toutes les troupes d'alors, aimait mieux commencer
par jouir de la victoire que de la pousser à fond, selon les autres;
le mauvais temps, si l'on en croit Davila ; de graves embarras d'argent,
d'après Sully Iui-même, obligèrent Henri IV à s'arrêter quinze jours
à Mantes. Ce répit permit aux Ligueurs de se remettre de leurs frayeurs
et d'organiser plus fortement que jamais la défense de la capitale.
Mais le roi reprit alors l'exécution de son plan, occupa par capitulation
ou emporta de vive force Lagny, Corbeil, Provins, Moret, Montereau,
Melun, Brie-Comte-Robert, etc. ; en un mot, se rendit maître de toutes
les avenues de la capitale et de toutes les rivières par lesquelles
elle pouvait s'approvisionner. Dès lors, un étroit blocus devenait possible
et la reddition de Paris était inévitable à brève échéance, si le duc
de Parme, accourant à la tête de l'armée espagnole, ne fût venu retarder
le moment de sa chute et la pacification du royaume.
La victoire
d'Ivry n'eut donc pas, à proprement parler, des résultats matériels
immédiats ; mais son effet moral fut considérable, comme aussi son retentissement.
On commença à voir dans le Béarnais un général heureux, capable de l'emporter
sur ses rivaux par ses talents, et peut-être le peuple lui soit-il encore
moins gré de son habileté que de sa fortune. On loua, tout autant que
son courage, sa cordialité, son humanité, sa compassion pour les pauvres
gens, sa familiarité avec la noblesse, qu'il affectait de traiter d'égal
à égal, ne prétendant qu'à être, disait-il lui-même, « le premier gentilhomme
de son royaume». Quelque vingt-cinq ans après, sous la minorité de Louis
XIII, Legrain, conseiller de la Régente, terminait ainsi le récit qu'on
l'avait chargé de faire au jeune prince de la bataille de 1590 :
« Ne passez pas plus avant, Sire, sans tirer profit et instruction de
cette grande victoire d'Ivry, qui fut comme le coup d'État qui redressa
la couronne sur la tête du Roi votre père, et l'affermit par là sur
la vôtre, devant que vous ne fussiez né. Considérez sa diligence de
toujours suivre l'ennemi à la trace et de ne le point perdre de vue
; son courage en l'attaquant toujours en nombre inégal ; sa prévoyance
en ses entreprises, sa suffisance en ses conseils ; sa capacité en l'assiette
de son armée, son jugement à assigner leur rang à ses chefs ; son bon
sens et sa vaillance dans la mêlée ; son mépris du butin pour suivre
l'ennemi jusqu'en sa retraite ; enfin sa clémence envers les vaincus
prisonniers, ce qui fut la plus grande et la plus utile victoire qu'il
gagna, puisqu'il se vainquit lui-même et sut renverser les chatouillements
que donne au cœur des princes victorieux le désir de la vengeance. »
On ne saurait que souscrire sans réserve à ce jugement, car, en termes
un peu oratoires, le bon conseiller a fort bien démêlé et résumé les
véritables causes des succès de Henri IV, — et de ses succès politiques
aussi bien que de ses succès militaires!
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025