Les origines de Lutèce
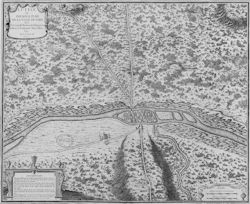

Il y a des points du globe, des bassins de
vallées, des versants de collines, des confluents de fleuves qui
ont une fonction. Ils se combinent pour créer un peuple. Dans telle
solitude, il existe une attraction, le premier venu s'y arrête.
Une cabane suffit quelquefois pour déposer la larve d'une ville.
Le penseur constate des endroits de ponte mystérieuse. De cet œuf
sortira une barbarie, de cet autre une humanité. Ici, Carthage là,
Jérusalem.
Il y a des villes monstres, de même qu'il y a des
villes prodiges. Carthage naît de la mer, Jérusalem de la montagne.
Quelquefois le paysage est grand, quelquefois le paysage est nul.
Ce n'est pas une raison d'avortement. Voyez cette campagne. Comment
la qualifierez-vous ? Quelconque. Çà et là des broussailles. Faites
attention. La chrysalide d'une ville est dans ces broussailles.
Cette cité en germe, le climat la couve. La plaine est mère ; la
rivière est nourrice. Cela est viable, cela pousse, cela grandit.
A une certaine heure, c'est ParisS. Le genre humain vient là se concentrer.
Le tourbillon des cercles s'y creuse. L'histoire s'y dépose sur
l'histoire. Le passé s'approfondit, lugubre. C'est là Paris. Et
l'on médite. Comment s'est formé ce chef-lieu suprême ?

Paris est une sorte de puits perdu. Son histoire, microcosme de l'histoire générale, épouvante par moments la réflexion. Cette histoire est, plus qu'aucune autre, spécimen et échantillon. Le fait local y a un sens universel. Cette histoire est, pas à pas, l'accentuation du progrès. Rien n'y manque de ce qui est ailleurs. Elle résume en soulignant. Tout s'y réfracte, mais tout s'y réfléchit. Tout s'y abrège et s'y exagère en même temps. Pas d'étude plus poignante. L'histoire de Paris, si on la déblaye comme on déblayerait Herculanum, vous force à recommencer sans cesse le travail. Elle a des couches d'alluvion, des alvéoles de syringe, des spirales de labyrinthe. Disséquer cette ruine à fond semble impossible, une cave nettoyée met à jour une cave obstruée. Sous le rez-de-chaussée, il y a une crypte ; plus bas que la crypte, une caverne ; plus avant que la caverne, un sépulcre ; au-dessous du sépulcre, le gouffre. Le gouffre, c'est l'inconnu celtique. Fouiller tout est malaisé. Gilles Corrozet l'a essayé par la légende ; Malingre et Pierre Bonfons, par la tradition Du Breul, Germain Brice, Sauval, Béquillet, Pignaniol de La Force, par l'érudition Hurtaut et Magny, par la critique ; Félibien, Lobineau et Lebeuf, par l'orthodoxie ; Dulaure, par la philosophie.

Chacun y a cassé son outil. Prenez les plans
de Paris à ses divers âges super posez-les l'un à l'autre concentriquement
à Notre-Dame ; regardez le XVème siècle dans le plan
de Saint-Victor, le XVIIème dans le plan de Bullet ;
le XVIIIème dans les plans de Gomboust, de Roussel, de
Denis Thierry, de Lagrive de Bretez, de Verniquet le XIXème,
dans les plans actuels, l'effet de grossissement est terrible. Vous
croyez voir, au bout d'une lunette, l'approche grandissante d'un
astre. Qui regarde au fond de Paris a le vertige. Rien de plus fantasque,
rien de plus tragique, rien de plus superbe. »
La page magnifique
qu'on vient de lire est empruntée à Victor Hugo, à l'auteur immortel
de Notre-Dame de Paris.
Nous ne pouvions trouver une meilleure
introduction à l'article que nous consacrons à la ville, grande
entre toutes, surnommée si justement la moderne Athènes.
Paris
(Lutetia, Civitas Parisiorum, Parisii), capitale de la France
et chef-lieu du département de la Seine; grande, belle, riche et
l'une des plus florissantes villes du monde ; la première ville
de l'Europe pour le nombre, la beauté et la variété de ses monuments
publics la seconde pour la population et la quatrième pour l'étendue,
est située dans la vallée de la Seine, par 48° 50 13" de lat. Nord
et par long. 0° 0' 0" E. de l'Observatoire; 0° 0' 35" Est. du Panthéon;
19° 53' 45" E. du méridien de l'ile de Fer; 2° 20' 9" Est. du méridien
de Greenwich. Son altitude est niveau de la Seine au 0° de l'étiage
du pont de la Tournelle, 34 mètres point culminant, seuil de la
porte de l'Observatoire, 66 mètres. La superficie de Paris, dans
l'enceinte nouvelle des fortifications, jusqu'au pied du glacis,
est de 7,802 hectares ; son enceinte se développe sur une longueur
de 34,350 mètres mesurée au pied du glacis la longueur développée
de la rue Militaire est de 33,330 mètres ; sa population est de
2,269,023 habitants. (Le recensement de 1876 donnait 1,988,806 habitants.)
D'après un relevé récent, l'enceinte fortifiée de Paris est percée
de 55 portes ou poternes, plus 2 portes fermées, celles de Sablonville
et de la Révolte ; il s'y trouve 2,258 rues, 115 impasses, 325 passages,
142 places ou carrefours ; 156 cités, galeries ou villas; 45 cours;
171 boulevards, avenues ou allées; 45 quais, 26 ponts et 2 passerelles;
53 halles et marchés, 41 théâtres et concerts. Paris, archevêché,
résidence du gouvernement, du Sénat et de la Chambre des députés,
renferme toutes les grandes administrations centrales, les directions
générales, administratives et financières, telles que le conseil
d'État, les ministères, la cour de cassation, la cour des comptes,
le trésor public, les caisses d'amortissement et des dépôts et consignations,
la grande chancellerie de la Légion d'honneur, l'état-major général,
les comités consultatifs de la marine, de l'artillerie, le dépôt
central de l'artillerie, le conseil de santé; les conseils généraux
des mines, des ponts et chaussées, etc.

Paris est le centre d'une administration
départementale dont le siège est à l'Hôtel de ville. Sous le rapport
politique et administratif, Paris est une ville à part, en France,
et son organisation municipale lui est toute particulière. C'est
le seul chef-lieu de département qui ne soit pas aussi, en réalité,
chef-lieu d'un arrondissement, de cantons et de communes. C'est
également la seule ville de France dont le territoire, ainsi entièrement
compris dans l'enceinte d'un mur, ne forme exactement qu'une ville
et non pas une commune, et à laquelle ce dernier titre ne s'applique
pas en effet. Administrativement, elle est divisée en 20 arrondissements
dont les maires et les adjoints sont désignés par le préfet ; chaque
arrondissement, sectionné en quatre quartiers, comprend un ou plusieurs
collèges électoraux, suivant le chiffre de sa population. Comme
commune, celle ville est administrée par le préfet et représentée
par un conseil municipal élu à raison d'un membre par quartier ;
les conseillers municipaux font en même temps partie du conseil
général du département. La préfecture et la mairie centrale ne forment
à certains égards qu'une seule et même administration. Il y a par
arrondissement une mairie, une justice de paix, un bureau de bienfaisance,
un comité local d'instruction primaire, deux recettes de perceptions
particulières et au moins un commissariat de police par quartier.
Le préfet de police est chargé de la police municipale ; il est
assisté d'un conseil de salubrité pour veiller à l'assainissement
de la grande cité. Le revenu de la ville de Paris dépasse 'celui
de tous les États secondaires de l'Europe il est de plus de 306,935,030
francs (budget de 1884)
La première fois que le nom de cette
ville, réservée à de si grandes destinées, est prononcé, c'est par
César. Il l'appelle Lutetia, donnant sans doute une physionomie
latine au nom celtique qu'elle portait jusque-là et que les celtophiles
pensent être Loutouhezi, c'est-à-dire habitation au milieu des eaux.
Les Romains dérivaient tout simplement Lutetia de lutum, boue, et
assurément la ville, qui n'était alors qu'une île boueuse au milieu
de la Seine, méritait bien cette épigramme. Mais, comme l'a judicieusement
fait observer nous ne savons plus quel vieil auteur sur Paris, il
est peu probable que les Parisii fussent fort curieux de dénominations
latines avant l'arrivée de Jules César.

Strabon et Ptolémée écrivent Leucotetia,
et l'empereur Julien adopte l'orthographe Louchetia, en parlant
de cette cité qui lui fut si chère. L'abbé Lebeuf, le P. Toussaint
Duplessis, Bourignon et autres savants ont cherché dans les langues
celtiques, bas-bretonne, irlandaise et dans la langue grecque, l'origine
du nom de cette ville. En décomposant les mots de ces langues, ils
y ont vu diverses significations : Ile aux corbeaux, Ile aux rats,
Ile au milieu des eaux, enfin la, Blanche, d’un grec mot, qui signifie
blanc. Cette dernière étymologie, qui pourrait provenir de la blancheur
du plâtre qu'on fabriquait peut-être déjà au nord de Lutèce, paraît
confirmée par une inscription gauloise conservée au musée de Cluny,
et par les mots lucotios, lucoticnos, gravés sur des monnaies gauloises.
Au IVème siècle de l'ère chrétienne, le nom des Nautæ~Parisiaci
l'emporte et se substitue à celui de Lutetia. Comme nous l'avons
vu plus haut, l'étymologie du nom donné à la tribu des Pariii n'a
pas moins exercé les savants que celle du mot Lutetia ; nous n'y
reviendrons pas.
Qu'il nous suffise de dire qu'Ammien Marcellin
appelle la ville Parisii. Trois lois publiées en 365 par Valentinien
et Valens sont aussi datées de Parasii.
Lutèce n'appartient
plus dès lors qu'à l'archéologie ou à la poésie; Paris est le nom
que se répète le monde.
Pour mettre plus de clarté dans l'immense
histoire de cette ville, nous la diviserons en un certain nombre
de périodes
Paris avant la domination romaine
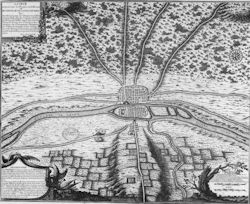

Qu'était-ce que Paris avant la conquête de César ? Nous l'avons dit une réunion de quelques habitations de barbares dans une petite ile de la Seine, « qui avait, dit Sauval, la forme d'un navire enfoncé dans la vase et échoué au fil de l'eau. » L'ile que nous appelons la Cité ne donne qu'une imparfaite idée de l'étendue de la primitive Lutèce. Nous ne voyons plus que deux iles dans la Seine, la Cité et l'ile Saint-Louis. Il y en avait cinq alors la place Dauphine et le Pont-Neuf occupent aujourd'hui le sol de deux petites iles qui n'ont été réunies que plus tard à la Cité actuelle, et l'ile Louviers, ou ile aux Javiaux, a été réunie en 1847 au quai Morland, aujourd'hui boulevard Morland, qui longe la bibliothèque de l'Arsenal. Les exhaussements successifs qui ont formé les quais n'ont pas moins contribué à l'agrandir. La Seine était beaucoup plus large deux ponts de bois unissaient l'ile à la terre ferme, l'un sur l'emplacement du Petit-Pont, l'autre sur celui du pont au Change. On estime que la population de Lutèce pouvait s'élever alors à 6,000 habitants.
Paris sous les Romains
Quand César parut en Gaule, la cité des Parisii
était à peu près inconnue. Il en révèle l'existence au VIIème
livre de ses Commentaires « Labiénus, dit-il, part pour Lutetia
avec quatre légions ; c'est la forteresse des Parisii, posée dans
une ile de la rivière Sequana. » Malgré la résistance des habitants,
le lieutenant du conquérant romain s'empara de leur ville, ou plutôt
de ses débris fumants, car ils l'avaient incendiée.
Elle se
releva assurément bientôt. En effet, au commencement de la sixième
campagne, César, inquiet de l'absence des députés de certains peuples,
ceux de Trèves, de Chartres et de Sens, qu'il avait convoqués avec
les autres peuples de la Gaule à Samarobriva (Amiens) en assemblée
générale, dissout cette assemblée et indique à bref délai, comme
nouveau lieu de réunion, Lutetia Parisiorum, où il devait présider
lui-même les États. Après avoir intimidé les Senones par sa présence,
il revient par la rive droite de la Seine avec ses sept légions,
42,000 hommes environ sans compter les contingents alliés et la
cavalerie gauloise auxiliaire et vient camper sur le plateau qui
s'étendait des buttes Chaumont et des hauteurs de Belleville aux
forts de Romainville, de Noisy et de Rosny. Ce camp retranché, qui
fut plusieurs fois occupé par les troupes romaines qui surveillaient
le pays des Parisii, a laissé quelques traces de sa circonvallation
sur la crête du plateau qui regarde la plaine des Vertus. Plus tard,
une villa romaine occupa une partie de son emplacement ; telle est
l'origine de Romainville.

Sous les Romains, une voie traversait du
nord au sud le pays des Parisii; au nord, elle passait sous les
retranchements mêmes du camp retranché, traversait l'ile du Corbeau
(Lutèce) et gravissait le plateau méridional de la rive gauche;
selon l'habitude romaine, elle était bordée de tombeaux de chaque
côté, garnie d'un camp à gauche de l'Ara: à droite d'un cirque;
le théâtre était en face du palais des Thermes, ne laissant place
qu'à quelques habitations, à un seul faubourg. Près du palais des
Thermes, dont les jardins s'étendaient jusqu'à la Seine, était le
champ de Mars (jardin du Luxembourg).
Ainsi, dès l'époque romaine,
des faubourgs se formèrent autour de l'ile qui fut le berceau de
Paris; l'enceinte resserrée de la Lutèce primitive obligea de s'établir
au dehors des vestiges de voies conduisant dans plusieurs directions
au nord et à l'est, des cimetières placés le long de ces voies et
les médailles romaines qu'on y a trouvées démontrent la présence
d'habitants sur la rive droite de la Seine. La rive gauche était
riche en édifices là se trouvait un palais, situé près de la grande
voie de Lutèce à Genabum (Orléans), un quartier de soldats, un établissement
de bains, l'aqueduc d'Arcueil, un vaste cimetière sur le versant
méridional du mont Leucotitius (entre la rue Saint-Jacques et la
rue Mouffetard actuelles) ; sur le versant septentrional, des Arènes
; un port sur le petit bras de la Seine. Enfin, une population nombreuse
se porta vers le sud ; des antiquités gallo-romaines trouvées près
de l'emplacement de l'ancienne église Saint-Marcel, au Luxembourg
et auprès de l'église Saint-Germain-des-Prés prouvent l'importance
de ce faubourg à l'époque qui nous occupe.
Durant plus de trois
siècles après la conquête, il n'est plus question de Lutèce; ce
silence dure jusqu'aux empereurs Constantin, Constance et Julien.
Celui-ci, prince éclairé, aimait cette petite ville gauloise, comme
s'il eût pressenti que cette grâce et cette délicatesse d'esprit,
cette raillerie fine et cette incrédulité savante qui caractérisent
ses ouvrages, auraient là plus tard leur principal foyer.

C'est moins, cependant, chose merveilleuse
pour leur esprit que pour leur sagesse qu'il vante les Parisiens
« Ils n'adorent Vénus, dit-il, que comme présidant au mariage; ils
n'usent des dons de Bacchus que pour avoir de nombreux enfants;
ils fuient les danses lascives, l'obscénité et l'impudence des théâtres.
Il vante aussi le climat de Paris, le produit de ses vignobles.
Pour qu'il ait préféré à tant de lieux célèbres une bourgade des
bords de la Seine, qu'il soit venu y passer cinq hivers, de 355
à 361, il faut au moins que Lutèce fût déjà ornée de quelques édifices
importants. On ne doute point, en effet, qu'il n'y ait eu un palais
construit dès lors dans la Cité même. Toutefois, nous l'avons dit
tout à l'heure, c'est sur la terre ferme que se trouvaient les édifices
les plus considérables, surtout sur la rive gauche. Là s'élevait
ce palais qu'on appelle encore aujourd'hui les Thermes de Julien
et qui borde le boulevard Saint- Michel. De vastes jardins l'entouraient.
La montagne Sainte-Geneviève était occupée par un champ de Mars,
un camp romain s'étendait sur l'emplacement du palais du Luxembourg
et de ses abords. Des villas romaines se voyaient également sur
les deux rives ; des tombeaux ont été découverts dans les fouilles
pratiquées rue Vivienne et au Palais-Royal. L'aqueduc d'Arcueil
apportait déjà à Paris les eaux de Rungis. Enfin il existait une
corporation de nautes (bateliers) parisiens, qui avait le monopole
des transports sur la Seine et qui se perpétua pendant l'époque
mérovingienne et le moyen âge sous le nom de Mercatores aquæ
parisiaci La confrérie des marchands de l’eau
C’est à romaine
qu'appartient la conversion des Parisiens au christianisme. D'après
Grégoire de Tours, la religion nouvelle y fut apportée vers 250
par saint Denis, qui en fut le premier évêque. Toutefois, il n'y
a de certitude que pour Victorinus, qui passe pour le sixième évêque
de Paris et qui figure avec ce titre au concile de Cologne, en 346.
Vers 360, un synode fut réuni pour la première fois à Paris, ce
qui semble prouver que les prédicateurs de l'Évangile y avaient
fait de nombreux prosélytes. Le paganisme n'y fut cependant pas
entièrement déraciné avant l'épiscopat de Marcellus (saint Marcel),
si célèbre depuis sous le nom de saint Marceau, donné d'abord à
un bourg, qui, réuni bientôt à la ville, devint par la suite un
de ses faubourgs. C'est Marcellus qui, d'après la légende, entraina
avec le pli de son manteau et précipita dans la Seine l'affreux
dragon qui désolait Paris, emblème de la religion païenne. Il mourut
en 436 ; son tombeau, foyer de miracles, donna naissance à une église,
et l'église au bourg, puis au faubourg qui couvrait l'éminence appelée
mons Certadus, d'où est Moucetar, puis Mouffetard.
Vers
cette époque, Attila et ses Huns assiégeaient Orléans au grand effroi
de toute la Gaule. Une jeune bergère de Nanterre, sainte Geneviève,
sut, au dire de la légende, rassurer les Parisiens alarmés et les
préserver de cette invasion terrible. Paris en a fait sa patronne.

Au milieu du Bassin parisien, deux iles sur
la Seine constituent le cœur historique de Paris : l'ile de la Cité
à l'ouest et l'ile Saint-Louis à l'est. La ville s'étend de part
et d'autre du fleuve, sur une superficie environ deux fois supérieure
au nord, sur la rive droite, à celle au sud, sur la rive gauche.
Plusieurs reliefs composés de buttes-témoin gypseuses forment de
petites collines
sur la rive droite Montmartre (131 m), Belleville
(128,5 m), Ménilmontant (108 m), les Buttes-Chaumont (103 m), Passy
(71 m) et Chaillot (67 m) ; sur la rive gauche Montparnasse (66
m), la Butte-aux-Cailles (63 m) et la Montagne Sainte-Geneviève
(61 m). Le Point zéro des routes de France est situé devant Notre-Dame
de Paris . Paris intramuros, délimitée de fait en 1844 par l'enceinte
de Thiers, puis administrativement en 1860 par l'annexion de communes
ou de leurs quartiers, est aujourd'hui séparée de ses communes limitrophes
par une frontière artificielle qui est le boulevard périphérique,
voie rapide urbaine de 35 km. Les accès routiers se font par les
portes de Paris ou par les routes et autoroutes qui rejoignent cette
rocade, dont la couverture progressive permet de mieux ouvrir Paris
à son agglomération. Au-delà de l'enceinte de Thiers, deux grands
espaces boisés ont été aménagés par le baron Haussmann, préfet de
la Seine de 1853 à 1870, sur des communes voisines, avant d'être
rattachés à Paris en 1929 : à l'ouest, le Bois de Boulogne de 846
hectares, dans le 16ème arrondissement et à l'est, le
Bois de Vincennes de 995 hectares, dans le 12ème arrondissement,
ce qui porte le périmètre de la ville à 54,74 km. Paris s'étend
également sur l'héliport dans le 15ème arrondissement
. Plus anecdotique, depuis 1864, la ville de Paris est propriétaire
du domaine entourant les sources de la Seine, à 231 km de la ville.
Paris sous la domination des Mérovingiens et des Carolingiens
Nous avons déjà dit que Paris devint la capitale d'un royaume sous les Mérovingiens. Clovis y résida le premier il occupait un palais dans la partie occidentale de la Cité. Ses quatre fils, en se partageant ses États, jugèrent la possession de Paris tellement importante qu'ils la partagèrent et qu'ils convinrent qu'aucun d'eux n'y pourrait entrer sans le consentement des autres. Lorsque Clodomir mourut, c'est à Paris que Clotilde retint auprès d'elle les trois fils qu'il laissait sous sa tutelle c'est là qu'elle reçut le terrible message de Childebert et de Clotaire, et que ces scélérats égorgèrent de leurs propres mains deux de ces enfants, qu'elle avait mieux aimé « voir morts que tondus. » Plus tard, dans le même siècle, Sigebert, roi de Metz, fondit sur Paris et brula plusieurs quartiers. Les habitations de la Cité furent consumées par un autre incendie, deux ans après.

C'est surtout par des édifices religieux
que les rois mérovingiens se plurent à décorer leur ville de Paris.
Pour eux-mêmes, ils se contentèrent probablement des palais romains
; Childebert habitait les Thermes avec son épouse Ultrogothe. Clovis
fonda, soit en 499, en mémoire de sa conversion, soit en 511, en
souvenir de sa victoire sur les Wisigoths, la basilique des apôtres
saint Pierre et saint Paul, depuis nommée abbaye Sainte-Geneviève.
Il y fut enterré avec son épouse Clotilde, et leurs tombeaux ont
été retrouvés dans ces derniers temps.
Aujourd'hui, une rue Clovis
et une rue Clotilde se croisent à l'angle du lycée Henri IV, et
le nom de tour de Clovis est resté à la vieille tour dont la masse
grise domine les bâtiments de ce lycée qui occupe l'emplacement
de l'antique et célèbre abbaye. Childebert bâtit, avec les dépouilles
de l'Espagne et surtout de l'église de Tolède, l'église Saint-Vincent-et-Sainte-Croix,
plus tard Saint-Germain- des-Prés, parce qu'elle fut dédiée par
saint Germain, évêque de Paris. « Les arceaux de chaque fenêtre,
dit le légendaire, étaient supportés par des colonnes de marbre
très précieux. Des peintures, rehaussées d'or, brillaient au plafond
et sur les murs. Les toits, composés de lames de bronze doré, lorsque
les rayons du soleil venaient à les frapper, produisaient des éclats
de lumière qui éblouissaient les yeux. » La première cathédrale,
placée sous l'invocation de saint Étienne ; les premières églises
Saint-Germain-l’Auxerrois, Saint- Gervais, Saint-Laurent datent
également de cette période. Il est permis de croire aussi que les
rois mérovingiens, si jaloux de la possession de Paris, fortifièrent
cette ville, dont l'importance les avait tant frappés. Quelques
expressions de Grégoire de Tours s'accordent à cet égard avec la
découverte que l'on fit, en 1829, d'un grand fragment de muraille
de la Cité, portant les caractères du Vème siècle.

Les Carlovingiens, ne résidant point à Paris,
s'en occupèrent peu, et leur autorité était devenue à peu près illusoire
quand parurent les Normands. Ces pirates, remontant la Seine, ravagèrent
en 841 les environs de Paris et en 845 Paris lui-même, déserté par
ses moines et ses habitants. Charles le Chauve s'avança jusqu'à
Saint-Denis, non pour combattre, mais pour peser aux barbares sept
mille livres d'argent. À ce prix, les Normands voulurent bien se
retirer pendant quelques années ; mais, en 856, ils reparaissent,
s'emparant de l'abbé de Saint-Denis, qui leur paya chèrement sa
liberté ; brulèrent l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et l'abbaye
de Saint-Vincent.
Nouveaux ravages en 861. Mais, en 885, ils
trouvèrent à qui parler. L'abbé Gozlin, élu évêque, de concert avec
le comte Eudes, avait organisé une défense énergique. Des tours
en bois avaient été construites aux deux têtes de chaque pont ;
il y en avait une également, sur un massif de maçonnerie, à l'extrémité
occidentale de la Cité. Les moines s'étaient réfugiés dans la petite
enceinte de Lutèce avec leurs reliques et leurs objets précieux.
Les barques des Normands couvraient le fleuve dans un espace de
deux lieues ils demandèrent la rupture du grand pont afin de pouvoir
remonter la Seine ; elle leur fut refusée. Alors ils s'arrêtèrent
devant la Cité et lui livrèrent huit assauts en treize mois. Toutes
leurs tentatives furent repoussées. Ils revinrent l'année suivante
; cette fois, Charles le Chauve était encore là avec son armée.
C'était tout bénéfice pour eux ils y gagnèrent mille quatre cents
marcs d'argent et passèrent sans tenter une attaque.
Temps désastreux
pour notre capitale En vingt-trois ans, quatorze années de famine
et, dans plusieurs (850, 855, 868, 873), les hommes se dévorèrent.
Au siècle suivant, de nouvelles famines donnèrent naissance à ce
terrible mal des ardents qui consumait les chairs vivantes et les
faisait tomber en lambeaux. Plus de commerce, plus d'industrie.
Les Normands avaient dispersé ou pris les marchands et les navigateurs
de la Seine ce fleuve était abandonné des mariniers. Les marchands
syriens, qui abondaient à Paris sous la première race, avaient disparu
pour toujours.
Un capitulaire de 864 nous apprend qu'il y avait
dès lors à Paris un hôtel des monnaies. « Et pour ce que Paris est
la métropolitaine et première ville de France, disait Malingre au
XVIIème siècle, la monnoye qui s'y forge est marquée
de l'A, comme de meilleur alloy et poids que les autres (qui portaient
les autres lettres de l'alphabet). Cela a donné lieu au proverbe
commun quand, pour porter témoignage d'un homme de bien, on dit
« il est des bons, il est marqué de l'A. »
Paris jusqu’au règne de Philippe Auguste

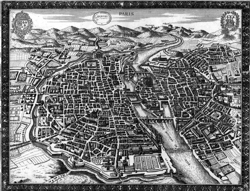
Les mêmes fléaux décimèrent Paris sous les
premiers Capétiens. Si les Normands avaient disparu, les violences
brutales du régime féodal naissant n'étaient guère plus propres
à développer la prospérité publique. Quand les sires de Corbeil
de Montlhéry, du Puiset, s'en allaient, la lance au poing, détroussant
les passants sur les routes voisines de la capitale, ou que le roi
Philippe Ier pillait les trésors de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
le commerce avait assurément peu de sécurité à Paris. La propriété
n'était guère sure non plus, quand les preneurs et les chevaucheurs
du roi faisaient chez les habitants leurs réquisitions de fournitures
et de meubles de toutes sortes pour le service de la cour. Malgré
tous ces désordres, la seule présence des rois, si faibles qu'ils
fussent alors, était un gage assuré de progrès pour Paris, qui ne
pouvait plus craindre d'être oublié comme sous les Carlovingiens.
Robert fait reconstruire l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et l'église
de Saint-Germain- l'Auxerrois, détruites par les Normands, et se
bâtit à lui-même un palais remarquable (palatium insigne) dans la
Cité ; Philippe institue le premier prévôt de la ville. Ce prévôt,
nommé Étienne, fut, à la vérité, un coquin ; c'est lui qui conduisit
le roi au pillage de l'abbaye de Saint- Germain-des-Prés, et la
légende ajoute que, au moment où il portait une main sacrilège sur
la fameuse croix de diamants rapportée d'Espagne par Childebert,
il fut frappé de cécité.
Sous Louis VI, l'activité augmente.
C'est à lui qu'on attribue la fondation du Grand et du Petit Châtelet,
le premier à l'extrémité septentrionale du pont au Change, le second
à l'extrémité méridionale du Petit-Pont. On a prétendu également
rapporter à son règne la construction d'une enceinte de la ville.
Mais la plus grande obscurité règne sur cette question. Il est à
peu près certain que la partie de la ville située sur la rive droite
était enclose de murailles. Louis VI en fut-il le fondateur ou seulement
le réparateur ? Quant à la rive gauche, nous citerons ce passage
d'une étude sur les Anciennes enceintes de Paris, par Monsieur Bonnardot
« Exista-t-il jamais sur la rive gauche un mur d'enceinte antérieur
à celui de Philippe-Auguste ? Cette question n'a pu jusqu'à présent
sortir des ténèbres de l'hypothèse. Il suffit, je crois, pour la
résoudre négativement, des considérations suivantes Cette partie
de la ville se trouvait établie sur le petit bras de la Seine, presque
toujours à sec en été, au pied d'une colline assez escarpée ; cette
position seule indique qu'elle était peu commerçante. C'était, en
effet, avant Philippe-Auguste, et même de son temps, dans la Cité
et dans la ville qu'étaient agglomérés les riches habitations et
les établissements de commerce. Sur la rive gauche, on ne voyait
guère que d'immenses clos en culture et çà et là quelques églises
et chapelles les collèges et les couvents ne s'y multiplièrent qu'au
XIIIème et au XIVème siècle. Le petit nombre
de rues alors formées se composaient de paisibles el silencieuses
habitations ; il n'y avait un peu de mouvement qu'aux abords du
Petit-Pont et sur la ligne de la grande chaussée d'Italie, nommée
plus tard rue Saint-Jacques. Les églises, autour desquelles se groupaient
quelques maisons, avaient des tours crènelées ; le palais des Thermes
pouvait lui-même passer pour la citadelle de la rive gauche. »
Paris au XIVème siècle

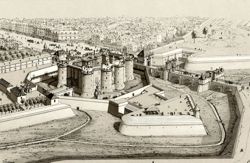
Paris était, au XIVème siècle,
divisé en trois grands quartiers séparés par la Seine. Le quartier
situé sur la rive droite et dit quartier d'Outre Grand- Pont s'étendait
dans l'intérieur des murailles entre le quai du Louvre et le quai
Saint-Paul, et depuis la Seine jusqu'à la porte Saint-Denis. Postérieurement,
il prit le nom de « la Ville ».
Le quartier d'Outre Petit-Pont,
sur la rive gauche, s'étendait de la tour de Nesle à la Tournelle,
et depuis la Seine jusqu’aux portes Saint- Jacques et Saint-Marcel.
La Cité, troisième quartier de Paris, était circonscrite entre les
deux bras de la Seine ; elle communiquait avec la terre ferme par
deux ponts : au nord, le Grand Pont, défendu par le Grand-Châtelet
et qui fut appelé « Pont au Change » parce que les changeurs vinrent
s'y établir ; au midi, le Petit Pont, où se trouvait un bureau de
péage et que commandait le Petit-Châtelet.
L’enceinte de Philippe
Auguste (2 600 toises) était haute de 30 pieds et « si moult forte
et espesse que on y menroit bien une charrette dessus », a écrit
un chroniqueur. Elle était flanquée de tours, percée de portes ou
poternes, et protégée extérieurement par le Louvre et le Temple.

Sous Jean le Bon, en 1356, on recula au nord
les limites de l'en¬ceinte et on la fortifia par un fossé et un
arrière-fossé ; du côté du midi, on creusa des fossés tout autour
des murailles, et après les guerres des XIV, XV et XIVème
siècles, quand revint la sécurité publique, les fossés se comblèrent,
des maisons s'élevèrent sur leurs bords, et ainsi se formèrent les
rues des Fossés-Saint-Bernard, Saint-Jacques, etc.
Pour continuer
l'enceinte interrompue par le cours de la Seine, on avait tendu
des chaînes que portaient des bateaux liés à de forts pieux, et
les deux ponts ainsi formés complétaient la ligne des fortifications.
L’Outre Grand-Pont était le plus peuplé des trois quartiers. Il
l'em¬portait à ce point de vue sur la Cité, dont la superficie était
très restreinte, et aussi sur l'Outre Petit-Pont, parce que l'enceinte
de Philippe Auguste avait embrassé, sur la rive gauche, une trop
grande quantité de terrains pour que ceux-ci fussent rapidement
couverts de constructions.
On comptait sous Philippe le Bel environ
228 000 habitants, 310 rues, ruelles et culs-de-sac, 10 places,
11 carrefours, 25 portes, 3 ponts, et, détail curieux, près de 4000
tavernes. Abstraction faite des rues sans nom, ruelles, etc., les
principales rues se répartissaient comme suit entre les trois quartiers
:
L’Outre Grand-Pont, 104 rues ; — l'Outre Petit-Pont, 80 rues
; — la Cité, 36 rues. Les divisions administratives étaient les
mêmes que les divisions ecclésiastiques : il y avait 33 paroisses,
dont 14 dans l'Outre Grand- Pont, 12 dans la Cité, 7 dans /'Outre
Petit-Pont, plus les 8 paroisses des faubourgs.
Il existait des
différences tranchées entre la population des trois quartiers. Le
commerce et la riche bourgeoisie habitaient sur la rive droite de
la Seine. L'Outre Petit-Pont était spécialement le quartier des
études. On l’appela plus tard l’Université, et plus tard encore
le quartier ou pays Latin.
La Cité, avec ses églises nombreuses,
était comme le domaine de l'Église et le centre de sa domination.
Paris jusqu’au règne de Saint-Louis

La période dans laquelle nous entrons est
capitale dans l'histoire de Paris. Cette ville, résidence continuelle
des rois, s'agrandissait avec le royaume. Pour la première fois,
sous Philippe-Auguste, elle fut enfermée dans une enceinte complète
et bien authentique dont nous avons encore aujourd'hui des débris
sous les yeux. Parlons d'abord de cette enceinte qui nous donnera
une idée approximative de l'étendue de Paris à cette époque approximative,
disons-nous, car il n'est pas douteux que certaines parties de l'enceinte
dite de Philippe-Auguste n'aient été modifiées plus tard et que
des Muséum d'histoire naturelle du Jardin des plantes et que des
terrains non bâtis n'y aient été originairement enveloppés.
Cette
enceinte fut commencée en 1190 sur la rive droite et continuée sur
l'autre rive entre 1200 et 1211. Le roi acheta le terrain ; la ville,
selon toute probabilité, se chargea de la construction des murs
et des tours. Aussi disait-on d'abord les murs de la ville ; et
ce n'est que plus tard que l'on dit les murs du roy. L'enceinte
de la rive gauche formait un demi-cercle qui commençait par la Tour
de Nesle (pavillon de l'Est de l'Institut) et finissait par la Tournelle
(quai de la Tournelle, près de la rue des Fossés-Saint-Bernard),
ayant pour points principaux porte Bussy (rue Saint-André-des-Arts,
près de la rue Mazet); porte des Cordeliers (rue de l’École-de-Médecine);
porte Gibart ou d'Enfer (place Saint-Michel); porte Saint- Jacques
(près de la rue Paillet); porte Saint-Victor (entre la rue Thouin
et la rue Saint-Victor). L'enceinte de la rive droite formait aussi
un demi-cercle qui commençait par la Tour qui fait le coin (près
du pont des Arts), et finissait par la Tour Barbeaux (près du port
Saint-Paul), en ayant pour points principaux porte Saint-Honoré
(rue Saint-Honoré, près de l'Oratoire); porte Coquillère (à l'entrée
de la rue Coquillère) ; porte Montmartre (numéros 15 et 32 de la
rue Montmartre); porte Saint-Denis (rue Saint-Denis, près de l'impasse
des Peintres); porte Saint-Martin (rue Saint-Martin, près de la
rue Grenier-Saint-Lazare) ; porte de Braque (rue de Braque, près
des Archives nationales); porte Barbette (rue Vieille-du-Temple,
près de la rue Barbette) porte Baudet (place Baudoyer); porte Bordet
(rue de Fourcy). Ces murs, qui se développaient à peu près également,
comme on le voit, sur les deux rives, étaient construits avec soin.
Ils sont formés de deux murs de soutien composés de pierres de petit
appareil et reliés ensemble par un blocage de moellons solidement
cimentés. L'épaisseur totale était d'environ 3 mètres à fleur du
sol et 2m,30 a une hauteur de 6 ou 7 mètres au-dessus des fondements.
La hauteur totale était à peu près de 9 mètres. Cette clôture murale,
surmontée d'un parapet crènelé, était fortifiée par des tournelles
espacées d'environ 70 mètres, qui paraissent avoir été au nombre
de trente-quatre au midi et trente-trois au nord, en tout soixante-sept,
et non pas six cents ou cinq cents comme Sauval et Félibien l'ont
avancé avec tant d'exagération. Les portes étaient défendues par
des tours de 15 ou 16 mètres de haut, de véritables donjons.

Philippe-Auguste ne jugea pas que ce fût
assez pour la sureté de Paris ou pour la sienne propre. Il fit bâtir
en dehors de l'enceinte la Tour du Louvre. Les rois avaient là,
dit-on, une louvèterie, d'où le nom de Lupara, Louvre.
Plusieurs
lettres datées de cette forteresse portent Apud Luparam prope
Parisios, au Louvre, près de Paris. C'était une simple tour,
qui servait à la fois de séjour aux rois, de forteresse et de prison
politique. C'est là que fut enfermé Ferrand, comte de Flandre, fait
prisonnier à Bouvines. D'autres seigneurs eurent le même sort. Aussi
quel respect ou quelle haine les seigneurs féodaux ne portaient-ils
pas à ce donjon duquel relevaient tous les fiefs du royaume La construction
de la tour du Louvre était achevée en 1204.
Quand cette nouvelle
résidence n'était point encore bâtie et que le roi habitait son
palais de la Cité (aujourd'hui le Palais de justice), « il s'approcha
un jour des fenêtres où il se plaçait quelquefois pour se distraire
par la vue du cours de la Seine. Des voitures, trainées par des
chevaux, traversaient alors la Cité, et, remuant la boue, en faisaient
exhaler une odeur insupportable. Le roi ne put y tenir, et même
la puanteur le poursuivit jusque dans l'intérieur de son palais.
Dès lors il conçut un projet très difficile, mais très nécessaire,
projet qu'aucun de ses prédécesseurs, à cause de la grande dépense
et des graves obstacles que présentait son exécution, n'avait osé
entreprendre. Il convoqua les bourgeois et le prévôt de la ville,
et, par son autorité royale, leur ordonna de paver, avec de fortes
et dures pierres, toutes les rues et voies de la Cité. La ville
fit les frais, alors considérables, de ce pavage, qui consistait
en grosses dalles ou carreaux de grès d'environ d’un mètre de carré
sur à peu près 0,16 mètres d'épaisseur.
Paris ne doit pas seulement
son premier pavé à Philippe-Auguste il lui doit aussi ses halles,
établies sur le territoire des Champeaux; il lui doit aussi la première
clôture du cimetière des Innocents,ouvert jusque-là aux hommes et
aux animaux. Autant de mesures qui contribuèrent puissamment à assainir
la ville.
C'est encore sous Philippe-Auguste, en 1182, que fut
consacré par un légat du Saint-Siège l'autel de la cathédrale nouvelle
dont l'évêque de Paris, Maurice de Sully, avait commencé, en 1163,
la construction. Immense édifice qui ne pouvait être l'œuvre que
de plusieurs siècles réunis, alors surtout que les fléaux, les guerres,
la faiblesse du gouvernement paralysaient ou ralentissaient tous
les travaux. On suppose que le chevet de l'église était seul construit
alors. En 1257, le portail méridional n'existait pas encore, quoique
la construction en fût alors commencée par Jean de Chelles. Le portail
septentrional ne fut bâti que vers 1312 avec les richesses enlevées
aux templiers, et, au XVème siècle, Charles VII était
encore obligé de donner des secours considérables pour achever cet
édifice. Ainsi s'est élevée lentement cette magnifique cathédrale
qui porte le cachet des divers âges de l'architecture ogivale, depuis
la simplicité austère du début jusqu'à la riche ornementation de
la fin monument dont notre grand poète Victor Hugo a, en quelque
sorte, exprimé toute la poésie dans son beau roman de Notre-Dame
de Paris.

De nos jours, Viollet-le-Duc a restauré avec
un grand soin cette belle création gothique et lui a, autant que
cela était possible, restitué son aspect du XIIIème siècle;
nous disons :« autant que possible ; car tout ne pouvait pas être
remis dans le même état l'église Notre-Dame s'enterre insensiblement
elle-même par l'exhaussement continuel du sol; comme on a retrouvé
du pavé de Philippe- Auguste à près de 3 mètres sous terre, de même
les treize marches qu'il fallait monter pour entrer dans l'église
ont disparu et l'édifice a dû y perdre beaucoup de sa majesté et
de son effet (1). C'était la foi qui édifiait ces montagnes de pierres
vivantes pour parler comme on faisait alors (vivi lapides).
Et, chose singulière, ce même édifice consacré à la prière, et dont
les sombres voutes inspirent encore à nos générations moins crédules
un respectueux recueillement, était chaque année témoin des plus
grossiers divertissements et des plus obscènes bouffonneries où
les acteurs étaient les ecclésiastiques eux-mêmes. Nous voulons
parler de ces fameuses fêtes des fous ou fêtes des sous-diacres,
qu'on appelait par dérision, mais fort exactement, fêtes des diacres
souls.
Depuis le 26 septembre, jour de Saint-Étienne, jusqu'au
6 janvier, jour de l'Épiphanie, le clergé de Notre-Dame, sous la
conduite de l'évêque des fous, librement élu, au bruit des cloches,
sous des déguisements de femmes et les travestissements les plus
grotesques, se livrait dans la cathédrale et jusque sur l'autel
à des orgies, où tout ce qui était prohibé en d'autres temps devenait
permis, sans excepter les plus monstrueuses immoralités. En 1198,
Eudes de Sully, qui avait succédé à Maurice, ordonna, mais inutilement,
la suppression de ces saturnales chrétiennes. « Il s'y commettait,
dit-il lui-même, d'innombrables abominations, des crimes énormes.
Ce n'était pas seulement des laïques qui y figuraient ; mais, ce
qui est horrible à dire, ces scènes scandaleuses, ces turpitudes
étaient commises par des ecclésiastiques, dans l'église même, au
pied des autels, pendant qu'on célébrait les messes et qu'on chantait
les louanges de Dieu. »
Au reste, le moyen âge est le temps
des contrastes bizarres; on se portait à toute chose avec une ardeur
également impétueuse et déréglée. Un contemporain nous peint par
ces traits les écoliers du temps « Ils sont plus adonnés à la gloutonnerie
qu'ils ne le sont à l'étude; ils préfèrent quêter de l'argent plutôt
que de chercher l'instruction dans les livres; ils aiment mieux
contempler les beautés des jeunes filles que les beautés de Cicéron.
Toute science est avilie, l'instruction languit, on n'ouvre plus
les livres » Tandis qu'un de ces moroses dépréciateurs de leur époque,
qui se rencontrent dans tous les siècles, traçait ce tableau, la
rue du Fouarre regorgeait d'auditeurs avides de science. « Foare
ou Fouarre, nous dit Charles Nodier, dont il nous reste fourrage,
est un vieux mot français qui signifiait de la paille. Dans les
titres latins de l'époque, la rue du Fouarre est appelée vicus
Straminis, via~Straminea.

La place Maubert était alors un lieu d'enseignement
public. Sous Philippe- Auguste, l'emplacement des écoles s'étendit
; il s'en établit de nouvelles dans la rue du Fouarre. Les étudiants
de cet âge de simplicité assistaient sur de la paille aux leçons
de leurs maitres ; et cet usage avait appelé en grand nombre autour
d'eux les gens qui faisaient ce commerce, rapprochement dans lequel
les journaux trouveraient aujourd'hui une source intarissable de
délicieuses plaisanteries. De là vient le nom de la rue du Fouarre.
La rue du Fouarre fut d'abord fermée à ses deux extrémités. En 1362,
le roi Jean assigna deux arpents de bois de sa forêt de Fontainebleau
pour en renouveler les portes et pour les entretenir. Cette clôture
avait pour objet d'empêcher le passage des voitures, dont le bruit
aurait pu incommoder ou distraire les étudiants. Tant de sollicitude
pour l'instruction n'annonçait pas un gouvernement trop barbare
; et, en effet, la génération qui s'élevait alors allait préparer
les beaux siècles de notre littérature. » Nodier aurait pu ajouter
qu'aujourd'hui les lourdes voitures qui passent sous les murs de
la Sorbonne en ébranlent les fenêtres, couvrent la voix des professeurs
et souvent troublent l'intelligence des candidats déjà suffisamment
émus.
De la rue du Fouarre, sans se déplacer beaucoup et sans
passer l'eau, nos écoliers du XIIIème siècle allaient
prendre au Pré-aux-Clercs leurs ébats quelque peu turbulents. Dès
1163, ils avaient eu maille à partir avec les moines de Saint-Germain
des- Prés, propriétaires dudit Pré, et l'affaire avait été jugée
assez grave pour être portée devant le concile de Tours et pour
y donner lieu à de longues discussions. On donna tort aux écoliers.
Peu leur importait. En 1192, les voici qui se querellent si bel
et bien avec les habitants du bourg Saint-Germain qu'un des leurs
perd la vie ; puis nouveau débat avec les moines, lequel est soumis
au pape, qui ne prononce rien. En 1200, les étudiants allemands
mettent à mort un marchand de vin qui avait maltraité le domestique
d'un seigneur de leur nation. Les Parisiens et le prévôt de Paris
à leur tête s'arment pour venger ce marchand cinq étudiants allemands
sont tués. Aussitôt les maitres des écoles se plaignent ; le roi
fait arrêter le prévôt et ses adhérents, fait raser leurs maisons,
arracher leurs vignes et leurs arbres fruitiers. Philippe-Auguste
protégeait énergiquement son Université de Paris.

Au reste, il ne traitait pas plus mal pour cela les bourgeois de sa capitale, et c'est sous son règne que la municipalité de Paris reçut ses premiers développements. Elle existait de temps immémorial à l’état rudimentaire, pour ainsi dire. À côté du prévôt de Paris, officier du roi qui rendait la justice au Grand-Chatelet, il y avait le syndic ou juré des marchandises, nommé par la communauté des marchands de la ville, lequel siégeait au Parloir aux bourgeois et protégeait les intérêts privés et industriels. Ce syndic prit, sous Philippe-Auguste, le nom de prévôt des marchands. Il était assisté des échevins qui formaient son conseil. Ses droits s'accrurent alors considérablement. La police, la voirie, la réparation des édifices publics, l'administration des domaines de la ville passèrent des attributions du prévôt de Paris dans celles du prévôt des marchands. Pour subvenir à ces dépenses, il obtint du roi l'abandon de certains droits prélevés jusque-là par l'officier royal. L'ancienne hanse parisienne s'était bien agrandie : c'était une immense corporation fédérative des différents métiers. Le cours de la rivière lui appartenait ; elle seule avait le droit de faire remonter des bateaux depuis Mantes jusqu'à Paris, et aucun étranger ne le pouvait faire s'il n'était associé d'un bourgeois de Paris. Elle obtint de construire un port destiné au débarquement et au dépôt de ses marchandises, moyennant un octroi sur la consommation de la ville. Elle acheta, en 1220, par une rente annuelle au fisc, le criage de Paris, en d'autres termes le droit de lods et ventes. C'est à elle que le roi confia l'étalon des poids et mesures et le soin de les régler. Enfin sa juridiction, qui ne comprenait à la vérité que la petite justice, s'exerçait dans cette sphère à côté de celle du roi et de celles des seigneurs ecclésiastiques, de l'évêque de Paris, des abbés de Sainte-Geneviève et de Saint- Germain-des-Prés. Le Parlouer aux borjois avait ses clercs et ses sergents. Enfin la bourgeoisie de Paris avait déjà acquis une telle importance et une telle faveur auprès du roi, que Philippe-Auguste, partant pour la croisade, désigne six bourgeois parisiens pour être les gérants de sa fortune et de ses domaines, et ses exécuteurs testamentaires en cas de mort.
Paris jusqu’à Charles V

Le progrès de Paris, favorisé avec tant d'intelligence
par Philippe-Auguste, alla toujours croissant sous ses successeurs.
« Quand, sous Philippe-Auguste, on faisait le tour du mur d'enceinte
à l'intérieur, dit M. Bonnardot, on rencontrait d'immenses espaces
vides, des cultures, des jardins, des terrains en friche et à vendre
mais, à l'approche des bourgs populeux récemment incorporés à la
ville, la promenade était interrompue, car les maisons de la rue
principale de ces bourgs touchaient au mur d'enceinte. Ce mur, vu
du dehors, paraissait donc isolé au milieu des champs, hors aux
approches des portes importantes, puisque la majeure partie des
hôtels, collèges ou couvents, fondés sous le règne de Louis IX,
n'existaient pas encore. Les vides immenses laissés entre la ville
et la muraille se peuplèrent un peu plus tard, grâce au zèle du
saint roi, d'établissements religieux accompagnés d'immenses jardins.
»
On voit dans quelle direction Paris s'agrandit au XIIIème
siècle. Il s'occupa à remplir son enceinte sans l'excéder encore.
Les établissements religieux dont on vient de parler sont principalement
les églises Sainte-Catherine-du- Val-des-Écoliers, rue Saint-Antoine,
à la place du marché actuel de Sainte-Catherine ; de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
rue Saint-Victor; puis de nombreux couvents des Jacobins, rue Saint-Jacques,
c'étaient les dominicains; des Cordeliers, en face de l'École actuelle
de médecine; des Grands-Augustins, entre la rue et le quai de ce
nom, là où a été longtemps le marché à la volaille désigné sous
le nom de la Vallée, et que des constructions particulières ont
remplacé; les Carmes, où est le marché de la place Maubert ; des
Chartreux, établis d'abord à Gentilly, puis auprès des murs de Paris,
dans le vieux château de Vauvert, hanté, disait-on, par le diable,
d'où la locution envoyer au diable Vauvert, et par corruption au
diable au vert, peut être encore le nom de la rue d'Enfer. Un établissement
plus utile assurément que tous ces couvents est l'hospice des Quinze-Vingts,
que saint Louis fit bâtir en 1260 et auquel il octroya trente livres
de rente destinées au potage de trois cents aveugles. Quant aux
collèges fondés alors, nous citerons celui d'Harcourt, établi par
Raoul d'Harcourt, docteur en droit, pour les pauvres écoliers normands,
et celui de la Sorbonne, appelé d'abord la pauvre maison, par Robert
Sorbon., chapelain du roi, destiné à ceux qui n'avaient pas assez
de fortune pour arriver au grade de docteur.
En 1239, saint Louis
acheta cent mille livres à Baudouin, empereur de Constantinople,
une couronne d'épines que celui-ci assurait être celle qui avait
été posée sur la tête du Christ. Le bon roi alla au-devant de la
merveilleuse relique jusqu'à Villeneuve-l'Archevèque (Yonne) en
compagnie de toute sa famille et l'apporta à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs
puis, lui-même, pieds nus, avec son frère Robert, la transporta
solennellement à la chapelle Saint-Nicolas, dans l'enceinte du palais.
Mais un si rare objet méritait bien un logis spécial. C'est pour
le recevoir que fut bâtie la Sainte-Chapelle, chef-d’œuvre de Pierre
de Montreuil et le morceau le plus accompli peut-être de l'architecture
ogivale dans toute sa pureté. « En laquelle l'on dit, raconte
l'auteur de la vie de saint Louis, que il despendit bien 40,000
livres de tournois et plus. Et li benaiez rois aourna d'or et d'argent
et de pierres précieuses et d'autres joyaux les lieux et les châsses
où les saintes reliques reposent (3). Et croit t'on que les aournements
desdites reliques valent bien 100,000 livres de tournois et plus.
».

Malgré ses petites dimensions, c'est l'édifice
gothique le plus élégant de Paris, véritable bijou, malheureusement
en partie caché par les autres constructions du Palais. Elle mesure
35 mètres de longueur et de hauteur sur 11 de largeur. La Sainte-Chapelle,
dont la restauration a été confiée successivement à Duban, Lassus,
Viollet-le- Duc et Bœswillwald, ne sert au culte qu'une fois par
an, pour la messe du Saint-Esprit, à la rentrée des tribunaux. Elle
a heureusement échappé à la destruction en 1871, quoiqu'elle fût
presque complètement environnée de bâtiments en feu.
Les admirateurs
passionnés du moyen âge, qui ne voient que les cathédrales gothiques
et point les souffrances du peuple, devraient bien faire attention
à certains passages des auteurs de ce temps. Joinville nous apprend
que, sous saint Louis, pendant qu'il était en terre sainte, le séjour
de Paris n'était pas tenable. Le prévôt, au lieu de protéger les
habitants, les tyrannisait à ce point qu'ils désertaient en foule
et s'en allaient dans d'autres prévôtés. « La terre du roi était
si déserte que, quand il tenait ses plaids, il n'y venait pas plus
de douze personnes. Outre cela, se trouvaient à Paris et dans les
environs tant de malfaiteurs et de voleurs, que tout le pays en
était plein. » Lorsque saint Louis eut confié ensuite la prévôté
de Paris à Étienne Boileau, ce bon justicier qui punissait « étroitement
les malfaiteurs, sans égard au riche plus qu'au povre, » on remarqua
comme chose merveilleuse « que désormais n'y avoit larron, meurtrier
ou autre qui osast demeurer à Paris, qui ne fust pendu ou puni à
la rigueur de justice. » Le roi lui-même allait souvent s'assoir
auprès de Boileau pour encourager cette louable sévérité. Un de
ces admirateurs du Moyen Age dont nous parlions s'émerveille qu'une
garde de soixante hommes suffit à une ville qui comptait déjà 50
000 habitants.
Il existait, en effet, soixante sergents, moitié
à pied, moitié à cheval, sous les ordres d'un chevalier du guet,
pour faire la police pendant la nuit, et c'est sous ce régime précisément
que la ville était pleine de vols, viols, meurtres et incendies
à tel point que les bourgeois demandèrent à se garder eux-mêmes
et que saint Louis les autorisa, en 1254, à établir une garde appelée
guet des métiers ou des bourgeois. Dans la suite, le guet royal
destiné à courir la ville fut désigné sous le nom de guet levé ;
tandis que le guet municipal ou bourgeois, qui était sédentaire
et occupait des postes fixes, fut désigné sous le nom de guet assis.
Étienne Boileau releva la prévôté de Paris par la manière dont
il en remplit les fonctions. Au reste, à cette charge, jusque-là
vendue aux enchères, le roi attacha désormais un salaire ; ce qui
supprima un grand nombre d'abus. Tout le monde sait que c'est Étienne
Boileau qui organisa les métiers de Paris et qui leur donna des
statuts examinés et approuvés par « les plus sages et les plus anciens
hommes de Paris. »
Les écoles de Paris prirent pour la première
fois sous saint Louis le nom d'Université. Au reste, toujours même
ardeur et même éclat dans les études, affluence toujours croissante
d'écoliers de toutes nations, et toujours même turbulence. Sous
Louis VIII, les écoliers avaient assiégé le légat du pape dans sa
maison et l'eussent égorgé sans l'intervention du roi. En 1229,
ils saccagent la maison et répandent tout le vin d'un cabaretier,
puis courent par la ville, frappant et tuant les bourgeois qu'ils
rencontrent. Le prévôt fond sur eux avec sa troupe ; quelques-uns
périssent. Aussitôt l'Université suspend ses cours pendant deux
années. Suspension semblable en 1252, quoique moins longue. En 1278,
l'abbé de Saint-Germain-des-Prés fait construire un mur sur le Pré-aux-Clercs.
Les écoliers, trouvant que ce mur les gêne, le démolissent. L'abbé
appelle, au son du tocsin, tous les domestiques de l'abbaye et les
habitants du bourg Saint- Germain quelques écoliers furent encore
tués, d'autres pris. L'Université suspendit ses cours et ne les
reprit qu'après que l'abbé et le prévôt eurent été forcés à une
réparation éclatante.

Un fléau dont il convient de parler comme
d'un signe à la fois de prospérité matérielle et de dépravation
des mœurs, la prostitution, se répandait dans Paris et particulièrement
envahissait certaines rues. Un contemporain, le cardinal Jacques
de Vitry, trace le tableau suivant, un peu chargé de couleur peut-être,
mais évidemment vrai en général : « Les habitants de Paris se livrent
à tous les crimes, se vautrent dans toutes les ordures de la débauche.
Le clergé est encore plus dissolu que le reste du peuple. Semblable
à une chèvre galeuse, à une brebis malade, il communique à tous
ceux qui affluent dans cette cité la contagion de ses exemples pernicieux
; il les corrompt, les dévore et les entraine dans l'abime.
Alors, à Paris, une simple fornication n'était point réputée un
péché. Les filles publiques, dans les rues, dans les places, devant
leur maison, arrêtaient effrontément les ecclésiastiques qui y passaient,
et si, par hasard, ils refusaient de les suivre, elles criaient
après eux en les appelant sodomites. Car ce vice honteux et abominable
est tellement en vigueur dans cette ville, ce venin, cette peste
y sont si incurables, que celui qui entretient publiquement une
ou plusieurs concubines est considéré comme un homme de mœurs (2)
Il faut toute la sainteté de Louis IX pour racheter de tels désordres.
L'ordre et la sécurité que ce monarque avait réussi à faire
régner dans sa capitale y attirèrent de nombreux habitants pendant
le siècle qui suivit. On est étonné surtout du nombre considérable
de collèges que l'on voit s'établir quatre sous Philippe III, six
sous Philippe IV, et parmi eux le collège de Navarre, où est aujourd'hui
l'École polytechnique ; un sous Louis X, c'est le collège de Montaigu,
célèbre par ses éperviers et ses haricots, collège de pouillerie,
comme l'appelle Rabelais; quatre sous Philippe V et Charles IV entre
autres le collège du Plessis, rue Saint-Jacques (Louis-le-Grand);
quatorze sous Philippe VI, etc. Paris devenait, par l'importance
des études, la capitale de l'intelligence, comme elle devenait par
sa population et son étendue la capitale du royaume.
Ses habitants,
devenus riches, protégés des rois, puissamment organisés en confréries,
commencent à sentir leurs droits et leur force.
Paris va prendre
un nouvel aspect. Ce ne sera plus la petite ville faible, opprimée,
se laissant gouverner et implorant la protection des rois. Ce sera
une grande cité, populeuse, unie par la communauté des sentiments,
ardente et toujours prête à se faire droit elle-même, fût-ce contre
les rois. C'est au moment où la convocation des états généraux marque
l'avènement du tiers état à la vie politique, qu'éclate dans Paris
la première insurrection populaire. Ce ne sont plus seulement des
écoliers tapageurs, c'est le peuple lui-même, cette fois, qui se
lève pour réclamer contre l'excès des impôts, l'oppression des collecteurs,
l'altération des monnaies.

Irrité de voir les bourgeois refuser les
monnaies altérées, il se précipite à la courtille Barbette, maison
de plaisance d'Étienne Barbette, riche bourgeois, et la livre aux
flammes.
Le roi avec ses barons, ne pouvant tenir tête à cette
formidable émeute, s'était réfugié dans la tour du Temple l'émeute
apaisée, il fit pendre vingt-huit insurgés aux quatre entrées de
Paris. Cette même tour, où Philippe IV avait trouvé un asile, Louis
XVI y trouva plus tard une prison et d'où le premier était sorti
pour punir le peuple, le second sortit, hélas pour aller recevoir
le triste châtiment de la monarchie. Les templiers avaient reçu
chez eux leur plus mortel ennemi. Établis en ce lieu depuis la première
croisade, ils y avaient amassé leurs immenses richesses. La tour
carrée flanquée de quatre tourelles, où Philippe avait trouvé sa
sureté et qui n'a été démolie qu'en 1811, avait été bâtie en 1222
par frère Hubert, leur trésorier; elle était entourée de dépendances
considérables. Les richesses de ces moines guerriers, maintenant
inutiles, puisqu'ils ne les dépensaient plus en armements contre
les infidèles, avaient tenté l'avidité du roi, toujours à court
d'argent, et leur puissance offusquait son despotisme. Ils étaient
15 000 chevaliers avec une multitude de frères servants et d'affiliés
; c'est-à-dire que, tous réunis, ils pouvaient défier toutes les
armées royales de l'Europe. Ils possédaient plus de 10 000 manoirs,
un grand nombre de forteresses, entre autres celle du Temple, à
Paris ; leur trésor renfermait 150,000 florins d'or ; une puissante
organisation, qui tenait tous les chevaliers sous la main du grand
maitre, rendait ce corps extrêmement redoutable. En outre, leur
orgueil irritait le peuple et de vagues rumeurs les accusaient de
toute sorte de crimes. Ils n'étaient coupables, sans doute, que
d'un grand relâchement de mœurs et d'avoir mêlé aux cérémonies religieuses
quelques coutumes bizarres de l'Orient. Philippe le Bel résolut
leur perte, et, après avoir obtenu l'assentiment du pape Clément
V, sa créature, il employa pour l'anéantissement de l'ordre cette
vigueur en même temps que cette barbarie que tout le monde connait.
Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1307, les chevaliers furent partout
arrêtés ; la torture leur arracha des aveux qu'ils rétractèrent
plus tard. Les états généraux, assemblés à Tours, les jugèrent dignes
de mort. Le concile de Paris fit bruler, à petit feu, en un jour,
au faubourg Saint-Antoine, cinquante-quatre templiers. Le grand
maitre, Jacques Molay, et Guy, commandeur de Normandie, furent brulés
vifs dans l'Ile aux Juifs, appelée aussi l'Ile aux Vaches, parce
que les Parisiens y faisaient paitre leurs vaches en payant une
redevance, à l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui en était seigneur.
Elle était située à l'extrémité de la Cité, à peu près où est la
statue de Henri IV.

Philippe le Bel fonda le parlement de Paris.
C'était le second triomphe du tiers état, qui s'empara par ses légistes
de la puissance judiciaire. Ces légistes furent installés dans le
palais même des rois qui finirent par le leur abandonner entièrement
en 1431, Charles VII cessa d'y résider. Là se trouvait la vaste
salle qui servait à la réception des hommages des vassaux, aux audiences
des ambassadeurs, aux festins publics et aux noces des enfants des
rois. À l'une des extrémités de cette salle était la fameuse table
de marbre, cette merveilleuse tranche de marbre, si longue, si large
et si épaisse, autour de laquelle s'asseyaient seules les têtes
couronnées les princes et les seigneurs mangeaient à des tables
particulières. C'est sur cette table que les clercs de la Basoche
représentaient, à diverses époques de l'année, leurs farces et sottises.
Ce fut Philippe le Bel qui, par une lettre en date du 9 juin
1312, adressée au prévôt des marchands, ordonna la construction
du plus ancien quai de Paris, le long du couvent des Augustins jusqu'à
la tour de Nesle. « Tout le bord de la rivière du côté des Augustins,
dit Félibien, n'estoit alors revêtu d'aucun mur. Il estoit en pente
et garni dc saules, à l'ombre desquels les habitants alloient se
promener mais les inondations fréquentes de la rivière minoient
peu à peu le terrain et faisoient craindre pour les maisons.
En 1313, il fut enjoint au prévôt des marchands de faire prolonger
devant l'hôtel de Nesle le quai dont une partie avait nom quai des
Augustins, qu'il porte encore, et dont l'autre, en aval, a été appelée
successivement du nom de ses habitants, quai de Nesle, quai Guénégaud
et enfin quai Conti, dénomination qui lui est restée.

A cette époque se rattachent les sinistres
légendes de la tour de Nesle, qui sont demeurées, sinon comme des
faits historiques, au moins comme une trace de la luxure et des
passions violentes de la cour de ce temps.
Là où s'élève aujourd'hui
le pavillon oriental de l'Institut, « une tour noire, appuyée d'une
tourelle où était pratiqué un escalier à vis, se mirait dans les
eaux du fleuve. Une énorme chaine garrotait ce donjon, s'étendait
sur les eaux et l'unissait à un autre monument du même genre, situé
sur l'autre bord. On appelait celui-ci la tour Ronde. La tour de
la rive gauche porta d'abord le nom de Philippe Hamelin, puis elle
prit le nom de tour de Nesle de celui d'un hôtel dont elle était
voisine, et qui fut habité par la reine Jeanne, femme de Philippe
le Long. » C'est de Jeanne que Villon a dit
Semblablement
où est la royne
Qui commanda que Buridan
Fust jeté en un sac
en Seyne?
Mais où sont les neiges d'antan?
Voici
simplement ce que dit Brantôme « Elle se tenait à l'hostel de
Nesle à Paris, laquelle faisant le guet aux passants, et ceux qui
lui revenoient et agréoient le plus, de quelque sorte de gens que
ce fussent, les faisoit appeler et venir à soy, et après en avoir
tiré ce qu'elle en vouloit, les faisait précipiter du haut de la
tour qui paroît encore, en bas, en l'eau, et les faisoit noyer.
Je ne veux pas dire que cela soit vrai, mais le vulgaire, au moins
la plupart de Paris, l'affirme, et n'y a si commun, qu'en lui montrant
la tour seulement et en l'interrogeant, que de lui-même ne le die.
»
Le luxe et la recherche des vêtements prirent un singulier
essor dans la première moitié du XIVO siècle. Cette noblesse étourdie
et légère, qui allait perdre les batailles de Crécy et de Poitiers,
s'occupait déjà prodigieusement de sa toilette. Un auteur écrit
en 1346 « Cette nation, journellement livrée à l'orgueil, à la débauche,
ne fait que des sottises ; tantôt les habits qu'elle adopte sont
trop larges, tantôt ils sont trop étroits. Dans un temps ils sont
trop longs, dans un autre ils sont trop courts ; toujours avide
de nouveautés, elle ne peut conserver pendant l'espace de dix années
la même forme de vêtements. » La mode régnait donc déjà avec toute
sa mobilité. Que de besoins à satisfaire ! Aussi rien de plus animé
dès lors que l'aspect de Paris. On n'y voyait point nos belles boutiques,
nos magnifiques magasins de nouveautés, expression qui semble faite
pour justifier l'écrivain du XIVème siècle ; mais on
était assourdi des cris des marchands qui encombraient les rues.

Depuis le matin jusqu'au soir, ils ne cessaient
de braire, nous dit Guillaume de Villeneuve dans ses vers intitulés
Crieries de Parisis. On criait le hareng frais et le hareng saur,
la chair fraiche et la chair salée, la purée de pois toute chaude,
les pommes et les poires, les nèfles et les noix fraiches, les châtaignes
de Lombardie et les raisins de Mélite ou de Malte, le vin à 6 deniers
ou à 32 deniers la pinte, le vinaigre à la moutarde, les pâtés chauds,
le flan, les oublies renforcées, les siminaux, espèce de pâtisserie
; les roinssoles ou couennes de cochon grillées; on entendait
aussi les cris des marchands de vieilles défroques, mises hors d'usage
par quelque nouvelle coupe de vêtement, vieilles bottes et vieux
souliers, chapes, cottes, surcots, mantels, pelisson ; d'autres
criaient : Chapeaux ! chapeaux ! d'autres s'offraient à polir les
pots d'étain, à réparer les hanaps et les cuviers. Des meuniers
allaient aussi par les rues demandant à tue-tête qui avait du blé
à moudre. Les écoliers, les moines ; les trois cents aveugles des
Quinze-Vingts renforçaient ce concert discordant. « Je ne sais,
disait le poète Rutebeuf, pourquoi le roi a réuni dans une maison
300 aveugles, qui s'en vont par troupes dans les rues de Paris,
et qui, pendant que le jour dure, ne cessent de braire. Ils se heurtent
les uns contre les autres et se font de fortes contusions, car personne
ne les conduit.» Le saint roi avait pourtant fait là une belle
chose; mais aujourd'hui nos aveugles sont encore mieux traités.
Les Lombards et les Juifs ne manquaient pas dans une ville où
l'argent était si nécessaire. Les seconds subirent d'innombrables
persécutions qui avaient pour principal objet de les dépouiller.
Ils avaient à Paris deux synagogues l'une rue de la Juiverie, l'autre
au cloitre Saint-Jean-en-Grève, dans la vieille tour du Pet-au-Diable
; ils avaient aussi deux cimetières et un moulin particulier, On
obligeait ces parias de la société chrétienne à porter une corne
sur leur chapeau et une roue de drap jaune sur la poitrine. Pendant
toute la semaine sainte, on leur jetait des pierres dans les rues
en l'honneur du Christ ; enfin, le jour de Pâques, on en trainait
un dans chaque église pour y recevoir un soufflet.
Paris jusqu’au règne de François 1er
Pour Paris, comme pour le reste de la France,
l'avènement des Valois ouvre une période de désolation. En 1343
furent décapités aux Halles, par ordre de Philippe VI, des seigneurs
qui, dans les dissensions de Montfort et de Charles de Blois, avaient
pris parti contre le roi de France. En 1348, une épidémie fit de
tels ravages que l'on compta 500 morts par jour à l'Hôtel-Dieu.
En 1350, lorsque le roi Jean monta sur le trône, il convoqua à Paris
les états généraux et en obtint des subsides pour faire la guerre
aux Anglais ; mais il fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers
le 19 septembre 1356. Dès lors commença, entre le dauphin Charles
et les Parisiens, une hostilité qui se manifesta aux états généraux
de la même année.
Le roi et la noblesse féodale n'avaient pas
su défendre la France. Ce fut ce peuple de Paris, naguère révolté
contre Philippe le Bel, qui prit au moins la défense de la patrie.
Un homme remarquable par son intelligence et son caractère, le prévôt
des marchands, Étienne Marcel, le premier qui réclama pour Paris
ses libertés communales, se mit à sa tête. Appuyé à la fois sur
le peuple de Paris comme force matérielle, et sur les états généraux
comme force morale, il imposa au dauphin le renvoi des ministres
qui gaspillaient le trésor public, l'obligea de renoncer à l'altération
des monnaies, ce vol fait au publie, et prépara des plans de la
plus haute portée dont l'exécution eût avancé de cinq siècles la
Révolution.
Il donna au peuple de Paris un signe de ralliement,
le chaperon mi-parti bleu et rouge avec la devise A bonne fin.

Il transféra le Parloir aux bourgeois, situé
jusque-là auprès du Grand-Châtelet, dans une maison de la place
de Grève appelée Maison aux Piliers. Cette place devint dès ce moment
le véritable centre du royaume ; c'était le Forum du peuple de Paris
alors régnant. C'est là qu'il écoutait les discours et pesait les
adulations des princes qui venaient le haranguer sur les degrés
d'une grande croix où les criminels s'agenouillaient avant le supplice.
Ces princes étaient le dauphin et le roi de Navarre quelquefois
c'était au Pré-aux-Clercs ou bien à la Halle qu'ils tenaient leurs
conciones. Que voulait Marcel ? Profiter de la division et
de la rivalité des deux princes pour exercer la dictature, ou bien
les faire vivre tous deux en paix pour le salut de la France. Mais
aucun n'était sincère. Le dauphin manque à sa parole, le peuple
se soulève et pénètre dans le palais. Marcel va sommer le dauphin
de mettre fin aux abus et de s'occuper de la défense du royaume
; sur son refus, il fait égorger les maréchaux de Normandie et de
Champagne aux côtés même du prince, qui tombe à genoux et demande
la vie. Marcel lui assure la vie sauve, lui met sur la tête le chaperon
mi-parti et reçoit en échange le chaperon doré du dauphin, qui se
vit obligé de porter, ainsi que sa suite, les couleurs de Paris.
Mais le craintif dauphin s'échappe encore et revient assiéger Paris
; la discorde se met dans les états ; obligé de se rejeter du côté
du roi de Navarre, Marcel est assassiné à la porte Saint- Antoine
par Jean Maillard et les partisans du dauphin au moment où il tenait
les clefs qui allaient l'ouvrir à l'armée du Navarrais, le1er août
1358. Cette courte apparition de la puissance du peuple parisien
cessa avec le retour du dauphin, qui rentra l'amnistie sur les lèvres
et qui, quelques jours après, fit décapiter un échevin, deux bourgeois,
un avocat, sans parler du chancelier et du trésorier du roi de Navarre.
Ce dernier bloqua la ville, empêcha les arrivages. Un baril de harengs
se vendit trente écus ; il mourait 80 personnes par jour à l'Hôtel-Dieu.
Les Anglais arrivèrent, par surcroit, et ravagèrent les plaines
de Vaugirard et de Montrouge; mais Marcel avait paré à ce danger
; une enceinte nouvelle, construite par ses soins, protégeait la
partie méridionale de Paris. Bientôt le roi Jean revint de sa captivité
et rentra au milieu des fêtes dans cette ville que le patriotisme
de Marcel lui avait conservée, à lui le vaincu de Poitiers. Les
rues étaient tendues de draperies à la porte Saint-Denis, des fontaines
versaient du vin ; le roi marchait sous un dais d'or que portaient
quatre échevins: la ville lui offrit un buffet d'argenterie du poids
de mille marcs.

Le règne pacifique de Charles V fut utile
à l'agrandissement de Paris. Par ses ordres, Hugues Aubryot, prévôt
de Paris, compléta l'enceinte de Marcel. Cette enceinte consistait
en un mur flanqué de bastides carrées et précédé d'un fossé et d'un
arrière-fossé que séparait une chaussée en dos d'âne. Elle commençait
à la tour de Bois, près des Tuileries, et finissait à la tour Billy,
sur le boulevard Bourdon, en suivant à peu près la ligne que voici
place du Carrousel, rue du Rempart, angle sud-est du Palais-Royal,
place des Victoires, rues des Fossés-Montmartre, Neuve-Saint-Eustache,
Bourbon-Villeneuve, Sainte-Apolline, Meslay, puis la ligne actuelle
des boulevards jusqu'à la rivière. A ces fortifications Charles
V fit ajouter la bastille Saint-Antoine, dont le prévôt de Paris
posa la première pierre en 1369.
C'est cette fameuse Bastille
qui devint la prison d'État où la monarchie fit gémir ses ennemis
et qui ne tomba qu'avec elle. Ce formidable édifice était moins
destiné à défendre Paris contre l'étranger que le roi lui-même contre
Paris. Elle faisait pendant au Louvre, qui fut, de son côté, fortifié
et agrandi. Charles V ne voulut plus résider au centre de la ville
et abandonna le palais de la Cité, où il avait vu braver son autorité.
Tantôt il habita l'hôtel Saint-Paul, vaste assemblage de douze hôtels
réunis par autant de galeries, avec préaux, chapelles, ménagerie,
fauconnerie, forges d'artillerie, écuries, selleries, colombiers
etc., et qui occupait tout l'espace entre les rues Saint-Antoine,
Saint-Paul, le quai des Célestins et le fossé de la Bastille. Tantôt
il habita le Louvre, dont M. Vitet nous trace en ces termes le pittoresque
tableau « Le séjour de cette forteresse eût été par trop sévère
si le roi n'eût fait élever en dehors des fossés une multitude de
bâtiments de service et d'agrément d'une hauteur moyenne, formant
ce qu'on appelait alors des basses-cours et reliés au château par
des jardins peu spacieux du côté de la rivière; mais assez étendus
du côté opposé. On ne peut imaginer tout ce qui était entassé dans
ces dépendances et dans ces jardins. Outre des logements pour tous
les officiers de la couronne, nous y trouvons une ménagerie garnie
de lions et de panthères, des chambres à oiseaux, des volières pour
les papegaut (perroquets) du roi, des viviers, des bassins,
des gazons taillés en labyrinthes, des tonnelles, des treillis,
des pavillons de verdure, parures favorites de nos jardins du moyen
âge. Ces parterres à compartiments symétriques, jetés au milieu
de ces bâtiments si divers de forme et de hauteur, ce chaos de tours
et de tourelles, les unes lourdement assises dans le fond même des
fossés, les autres suspendues en quelque sorte aux murailles et
soutenues en porte-à- faux ce pêle-mêle de toits pointus, ici couverts
de plomb, là de tuiles vernissées, les uns coiffés de lourdes girouettes,
les autres de crêtes, de panaches reluisant au soleil tout cela
ne ressemblait guère à ce qu'on nomme aujourd'hui un palais de souverain
mais ce désordre, ces contrastes, qui pour nous ne sont que pittoresques,
parlaient alors tout autrement aux imaginations et ne manquaient
ni de grandeur ni de majesté. Ce sont là les beaux jours du Louvre
féodal, le temps où il fut vivant, peuplé et bien entretenu. »
En dépit des guerres civiles ou étrangères et des épidémies
qui ravageaient de temps en temps la capitale, l'industrie s'était
développée. Ces lignes de Froissart montrent quel était, après le
règne de Charles V, la puissance du peuple parisien :

« Il y avoit alors, en 1382, de riches
et puissants hommes, armés de pied en cap, la somme de trente mille,
aussi bien appareillés de toutes pièces comme nuls chevaliers pourroient
être, et disoient, quand ils se nombroient, qu'ils estoient bien
gens à combattre d'eux-mêmes et sans aide les plus grands seigneurs
du monde. »
Quoique Charles V eût laissé des économies,
elles ne suffirent pas pour entretenir la magnificence du nouveau
roi, que l'abus des plaisirs devait plus tard conduire à la démence
ses oncles, les ducs de Berry, de Bourgogne, d'Anjou et de Bourbon
n'étaient pas moins dilapidateurs. Accablés d'impôts, les Parisiens
tinrent plusieurs assemblées et obtinrent une ordonnance qui révoquait
tous les subsides établis depuis Philippe le Bel, considérant que
le peuple était « moult grevé et dommaigé par les aydes. » La masse,
peu satisfaite de cette concession, demanda l'expulsion des juifs
et des lombards.
Les malheureux israélites, dépouillés et battus,
ne trouvèrent de refuge que dans la prison du Grand-Châtelet. Le
duc d'Anjou, qui avait cédé devant l'émeute, prit diverses mesures
pour l'avenir dès qu'il se crut assez fort, il rétablit les anciens
impôts. Quand les receveurs des aides se présentèrent aux Halles
pour percevoir les taxes sur les fruits et les légumes, la foule
assomma les receveurs, courut à l'Hôtel de ville, où elle s'empara
de maillets de plomb (d'où le nom de maillotins), pesant chacun
vingt-cinq livres, qui avaient été distribués sous le règne de Charles
V dans la crainte d'invasion des Anglais. Mais il manquait un homme
comme Marcel. Faute de direction, l'unité fait défaut, la cour rentre
menaçante ; la ville paye 100 000 livres, 300 bourgeois sont emprisonnés,
12 sont décapités ; la prévôté des marchands, l'échevinage, les
maitrises sont abolis ; l'Hôtel de ville devient la prévôté de Paris,
les chaines qu'on tendait la nuit dans les rues depuis que Marcel
en avait introduit l'usage sont portées à Vincennes et toutes les
armes au Louvre, de quoi armer 100,000 hommes.
Le mouvement
des maillotins n'était qu'une insurrection; celui des cabochiens
( du nom du boucher Caboche, leur chef) faillit, comme celui de
Marcel, devenir une révolution. La démence de Charles VI, la rivalité
des Armagnacs et des Bourguignons excitée par le meurtre du duc
d'Orléans, avaient plongé la France et surtout Paris dans un abime
de sang. La puissante corporation des bouchers demeura la violente
maitresse de la ville après avoir égorgé les Armagnacs.
Alors
parut, sous l'inspiration des docteurs de l'Université, cette fameuse
ordonnance cabochienne qui n'allait à rien moins qu'à révolutionner
l'état politique du pays.
L'anarchie de cette époque lamentable
favorisait la marche des Anglais ; ils furent bientôt aux portes
de la capitale. Le traité de Troyes, du 21 mai 1420, par lequel
Charles VI reconnaissait pour héritier le roi d'Angleterre, à l'exclusion
de son propre fils, indigna la nation.

Malheureusement, comme en 1357, le peuple
était victime de l'ambition des princes qui se disputaient son appui
et ne lui laissaient pas de repos. Il fut obligé de se déclarer
pour le duc de Bourgogne, qui avait pris un rôle populaire, et cette
alliance l'entraîna dans le parti anglais. Paris devint anglais
en haine des princes et de l'aristocratie méridionale qui l'avaient
pillé. Temps de cruelles souffrances et d'horrible famine dont un
bourgeois de Paris nous a laissé la vive peinture dans son journal.
L'aspect de la ville fut bien remarquable pendant cette époque,
alors que, sous Charles VI, les hôtels habités par les princes et
les seigneurs étaient, en quelque sorte, les camps des divers partis.
La cour habitait toujours l'hôtel Saint-Paul. L'hôtel de la Miséricorde,
plus tard hôtel Soubise, aujourd'hui palais des Archives nationales,
s'élevait non loin de là, rue du Chaume, le connétable de Clisson
l'avait fait bâtir avec la rançon des Parisiens, en 1382. Il s'y
rendait, venant de l'hôtel Saint-Paul, quand il fut assassiné. C'est
en sortant de l'hôtel Barbette, habité par la reine Isabeau et situé
entre les rues Vieille-du-Temple, de la Perle, des Trois-Pavillons
et des Francs-Bourgeois, que fut assassiné lui aussi le duc d'Orléans,
dans la rue Vieille-du-Temple, tandis qu'insouciant et fredonnant
un gai refrain il retournait le soir à son bel hôtel de Bohème,
situé entre les rues Coquillière, de Grenelle, d'Orléans et des
Deux-Écus.
Cet hôtel, que ce brillant et malheureux prince avait
orné d'objets d'art, de sculptures, de jardins et d'eaux jaillissantes,
et qui fut plus tard remplacé par l'hôtel de Soissons, avait été
habité auparavant par le roi de Bohême, à qui Philippe VI en avait
fait don. L'ennemi cruel qui avait ordonné le meurtre et qui vint
lui-même, une lanterne sourde à la main, s'assurer que sa victime
était bien morte, Jean sans Peur, habitait l'hôtel d'Artois, compris
entre les rues du Petit-Lion, Saint-Denis, Mauconseil et Montorgueil,
alors appelée rue Comtesse d'Artois. Cet hôtel, quartier général
des Bourguignons, s'appuyait sur le mur d'enceinte de Paris, il
était entouré de murs crènelés, et sa principale défense consistait
dans un beau donjon, chef d'œuvre de l'architecture de l'époque,
que l'on peut encore voir aujourd'hui près des Halles, rue aux Ours
prolongée.
Le duc de Bourgogne était là tout près des halles,
théâtre de sa popularité. L'hôtel de Nesle, qui cède plus tard la
place à l'hôtel Conti, au collège des Quatre-Nations et enfin à
l'Institut, était la demeure du duc de Berry. Le palais des Tournelles,
sur l'emplacement de la place Royale, fut habité par Bedford, régent
du royaume pour le roi d'Angleterre.
Deux monuments de cette
époque nous rappellent encore aujourd'hui, avec le nom d'un bourgeois
de Paris, Nicolas Flamel, et avec la Danse macabre, de fantastiques
souvenirs. Adressons-nous à Charles Nodier. « Le surnom de la
tour Saint- Jacques-la-Boucherie est facile à expliquer elle le
doit au voisinage de la grande boucherie et aux nombreuses habitations
de bouchers et de tanneurs dont elle était environnée. » Le
vaisseau de l'église était grand et imposant, mais d'un assez mauvais
gothique. Il fut démoli en partie, du côté du chevet, en 1672, pour
donner de la place et de l'air à la rue des Arcis (confondue aujourd'hui
avec la rue Saint-Martin), qui tire peut-être son nom des arceaux
et des ogives des anciennes constructions.

La tour, remarquable par son élévation, ne
l'est pas moins par le goût et la délicatesse de son travail.
Elle ne fut achevée que sous le règne de François 1er.
Son faite, qui domine tous les monuments de Paris, est encore couronné
aux quatre coins par les symboles des quatre évangélistes. Le petit
portail de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, du côté de la rue de Marivaux,
avait été bâti, en 1399, aux dépens du célèbre Nicolas Flamel, habile
calligraphe du XIVème siècle et, nonobstant son talent
d'artiste, homme entendu dans les affaires, dont ignorance du peuple
a fait un alchimiste. Du temps de Nicolas Flamel, comme du nôtre,
la pierre philosophale, c'était le travail et l'habileté. La figure
du donataire et celle de Pernelle, sa femme, se voyaient taillées
sur un pilier près de la chaire, et elles ornaient aussi la petite
porte qu'ils avaient fait construire. L'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie
jouissait du droit d'asile, qui fut aboli par Louis XII.
Aujourd'hui,
la tour Saint-Jacques s'élève seule et isolée, dans un beau square,
au milieu de la rue de Rivoli, dont le prolongement a emporté les
rues étroites et les vieilles maisons qui se pressaient autour de
sa base quadrangulaire; gigantesque reine du moyen âge dépaysée
au milieu de la droite et large voie moderne. D'autres changements
ont emporté le marché des Innocents. « Cet immense marché, qu'arrose
la plus élégante de nos fontaines, chef-d'œuvre dû au ciseau de
Jean Goujon, était au moyen âge un hideux cimetière, enfermé d'une
enceinte de pierre dont la moitié avait été construite aux frais
du maréchal de Boucicaut, et l'autre à ceux du fameux calligraphe
Nicolas Flamel.
L'enceinte dont nous parlons formait une
galerie voutée qu'on appela les Charniers, et qui était réservée
aux morts privilégiés. La foule se pressait alors sous ces arceaux
noirs et humides et sur ces pavés composés de pierres tumulaires,
entre les cabinets des écrivains et les étalages riants des modistes,
qui payaient des loyers fort considérables pour ce temps, et qui
s'en dédommageaient amplement sur leurs chalands. C'était le Palais-Royal
de nos bons aïeux. Il faut avouer que la vogue a eu de singuliers
caprices. Au milieu du cimetière s'élevait un obélisque surmonté
d'une lanterne qui éclairait, pendant toute la nuit, ce vaste champ
de mort, et qui animait seule son affreuse solitude. On y distinguait
tout au plus quelques chiens errants attirés par les exhalaisons
des fosses, ou quelques malfaiteurs qui cherchaient un refuge. C'était
un horrible silence dans lequel une oreille attentive pouvait presque
entendre le travail assidu des vers du cercueil mais la nuit écoulée,
tout changeait d'aspect, le jour avait ramené le bruit, le luxe
et le plaisir.
En '1785, un arrêt du conseil d'État convertit
le cimetière en marché. On en exhuma 1 200 000 squelettes, qui sont
allés servir de matériaux au grand ossuaire des catacombes.
Les
Anglais, maitres de Paris, avaient choisi ce cimetière, en 1424,
pour y donner une fête en réjouissance de la bataille de Verneuil.
On y dansa la Danse Macabre, genre de divertissement très convenablement
approprié à ce théâtre. Un siècle et demi plus tard, les Anglais
y auraient probablement joué Hamlet.

Les Anglais occupaient encore Paris en 1429.
L'armée royale, conduite par Jeanne d'Arc vint tenter un assaut
et campa en face de la porte Saint- Honoré, sur la butte Saint-Roch,
alors couverte de moulins à vent. Au pied de cette butte, amas,
d'immondices selon les uns, ancien tumulus gaulois selon les autres,
se tenait alors le marché aux chevaux, où l'on faisait bouillir
les faux monnayeurs, cérémonie qui attirait toujours là une grande
foule. Jeanne, avec bon nombre de gens d'armes, descendit d'abord
dans l'arrière-fossé, « puis, avec une lance, elle monta jusque
sur le dos d'âne, d'où elle tenta et sonda l'eau, qui estoit bien
profonde; quoy faisant, elle eut d'un trait les deux cuisses percées,
ou au moins l'une, mais ce nonobstant, elle ne vouloit en partir
et faisoit toute diligence de faire apporter et jeter des fagots
et du bois en l'autre fossé, dans l'espoir de pouvoir passer jusques
au mur, laquelle chose n'estoit possible, vu la grande eau qui y
estoit. Il fallut que le duc d'Alençon l'allast querir et la ramenast
lui-même. » Il y avait six ans que Jeanne d’Arc était apparue
devant les murs de Paris en 1436 ; ses habitants, réduits aux dernières
extrémités de la misère par la guerre, la famine et la peste, voyant
que le duc de Bourgogne s'était réconcilié avec Charles VlI pour
chasser les étrangers, appelèrent eux-mêmes dans leurs murs les
troupes royales, commandées par le connétable de Richmond et Dunois.
Conduites par un marchand nommé Michel Lallier, elles entrèrent
par la porte Saint-Jacques aux acclamations des bourgeois. Les Anglais,
qui s'étaient réfugiés dans la Bastille, en sortirent en trois colonnes
et se dirigèrent sur les Halles et les portes Saint-Martin et Saint-Denis.
Ils furent repoussés et obligés de s'enfuir. Délivrée des Anglais,
la ville cacha ses ruines et s'efforça de paraitre belle pour recevoir
Charles VII.
Celui-ci se rendit à Paris non pour sévir, mais
pour faire acte de possession; puis « il la quitta, dit un bourgeois
du temps, comme s'il fut venu seulement pour la voir. » Ses successeurs
conservèrent longtemps cette aversion pour la ville turbulente qui
avait préféré les Bourguignons et massacré les Armagnacs.
Pourtant
Louis XI, dont l'avènement fut accueilli par les Parisiens comme
l'aurore d'une meilleure administration, fut reçu dans sa bonne
ville par des fêtes magnifiques, Toutefois, lui-même n'y résida
guère et se borna à prodiguer les amitiés à ses bons compère les
bourgeois parisiens.
Après Montlhéry, il les alla voir, dinant
chez l'un, chez l'autre, causant et faisant de salés contes. Il
augmenta leurs privilèges, les appela dans son conseil, se mit de
leur confrérie, prit parmi eux ses ministres, leur donna des franchises
pour leurs marchés et les organisa en 72 compagnies de milice formant
30 000 hommes. Il établit à la Sorbonne la première imprimerie de
France, laquelle prit pour enseigne Au Soleil d'or, et il fonda
une école de médecine rue de la Bûcherie, entre les rues des Rats
et du Fouarre.
Ce dernier établissement fut accordé par lui
aux sollicitations de son médecin, Jacques Coictier, qui avait une
belle maison rue Saint-André-des-Arts avec un abricotier sculpté
au-dessus de la porte et ce jeu de mots A l'Abri Coictier.

« L'an mil quatre cent quatre-vingt-dix-neuf,
dit le vieux Corrozet, le vendredi devant la Toussaint, 25ème
jour d'octobre, le pont Notre-Dame, assis sur pieux avec soixante
maisons dessus, édifices en très bel ordre et de mesme hauteur,
une heure devant midi, trébucha dans la rivière de Seyne, 82 ans
après avoir esté basty. » Un moine jacobin, frère Joconde, le
reconstruisit avec six robustes piles qui supportaient encore au
siècle dernier 68 maisons de brique dont Vasari fait le plus grand
éloge comme architecture. Ce travail fut achevé en 1511. « Le nouveau
pont de frère Joconde, ajoute Charles Nodier, fut longtemps le bazar
des marchands d'objets curieux et le rendez-vous de la bonne compagnie.
Il était du bel air d'y étaler ses plumes ou son pourpoint neuf
avant la construction du pont de Henri IV, qui lui enleva la vogue
et qui la céda bientôt à son tour aux galeries du palais. » Le Paris
du XVème siècle a été admirablement décrit par Victor
Hugo dans son livre de Notre-Dame de Paris (livre Ill, chapitre
II, Paris à vol d'oiseau); nous voudrions citer tout le chapitre
où il fait revivre avec autant de verve que de talent la grande
cité du moyen âge ; dans l'impossibilité où nous nous trouvons de
faire une aussi longue citation, nous extrairons du moins de ce
chapitre les lignes suivantes, qui esquisseront ce que nous ne pouvons
dessiner complètement.
« Au XVème siècle, Paris
était divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées,
ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs
coutumes, leurs privilèges, leur histoire La Cité, qui occupait
l'île, était la plus ancienne, la moindre et la mère des deux autres,
resserrée entre elles (qu'on nous passe la comparaison) comme une
petite vieille entre deux grandes belles filles. L'Université
couvrait la rive gauche de la Seine, depuis la Tournelle jusqu'à
la tour de Nesle, points qui correspondent, dans le Paris d'aujourd'hui,
l'un à la Halle aux vins, l'autre à la Monnaie. Son enceinte échancrait
assez largement cette campagne où Julien avait bâti ses Thermes.
La montagne de Sainte- Geneviève y était renfermée. Le point culminant
de cette courbe de murailles était la porte Papale, c'est-à-dire
à peu près l'emplacement actuel du Panthéon.

La Ville, qui était le plus grand des trois
morceaux de Paris, avait la rive droite. Son quai, rompu toutefois
ou interrompu en plusieurs endroits, courait le long de la Seine,
de la tour de Billy à la tour de Bois, c'est-à-dire de l'endroit
où est aujourd'hui le grenier d'abondance à l'endroit où sont les
Tuileries. Ces quatre points, où la Seine coupait l'enceinte de
la capitale, la Tournelle et la tour de Nesle à gauche, la tour
de Billy et la tour de Bois à droite, s'appelaient par excellence
les quatre tours de Paris. La Ville entrait dans les terres plus
profondément encore que l'Université. Le point culminant de la clôture
de la Ville (celle de Charles V) était aux portes Saint-Denis et
Saint-Martin, dont l'emplacement n'a pas changé.
Chacune des
trois grandes divisions de Paris était une ville, mais une ville
trop spéciale pour être complète, une ville qui ne pouvait se passer
des deux autres. Aussi trois aspects parfaitement à part. Dans la
Cité abondaient les églises, dans la Ville les palais, dans l'Université
les collèges. Pour négliger ici les originalités secondaires du
vieux Paris et les caprices du droit de voirie, nous dirons, en
ne considérant que les ensembles et les masses dans le chaos des
juridictions communales, que l'île était à l'évêque, la rive droite
au prévôt des marchands, la rive gauche au recteur ; le prévôt de
Paris, officier royal et non municipal, sur le tout. La Cité avait
Notre-Dame, la Ville le Louvre et l'Hôtel de ville, l'Université
la Sorbonne. La Ville avait les Halles, la Cité l'Hôtel-Dieu, l'Université
le Pré-aux-Clercs. Le délit que les écoliers commettaient sur la
rive gauche, dans le Préaux- Clercs, on le jugeait dans l'île, au
Palais de justice, et on le punissait sur la rive droite, à Montfaucon,
à moins que le recteur, sentant l'Université forte et le roi faible,
n'intervînt ; car c'était un privilège des écoliers d'être pendus
chez eux. La plupart de ces privilèges, pour le noter en passant,
et il y en avait de meilleurs que celui-ci, avaient été extorqués
aux rois par révoltes et mutineries.
C'est la marche immémoriale
le roi ne lâche que quand le peuple arrache. Il y a une vieille
charte qui dit la chose naïvement, à propos de fidélité : Civibus
fedelitas in reges, quæ tamen aliquoties seditionibus interrupta,
multa peperit privilegia. »
Enfin, pour compléter cette
description, nous ajouterons que Gilles Corrozet ; le premier historien
de la ville de Paris, donne de Paris la description suivante, en
1532, au commencement de la Fleur, singularités et excellence
de la plus noble et triomphante Ville et Cité de Paris.
Cette ville est de unze portes
Avec gros murs, qui n'est pas
peu de chose;
Profonds fossez tout il l'entour s'estendent,
Où maintes eaux de toutes parts setendent;
Lequel enclos
sept lieues lors contient,
Comme le bruyet tout commun le maintient
;
Puis après sont cinq grands ponts,
Par-dessus l'eau, aussy
pour passer et repasser
Depuis la Ville en la noble Cité,
De la Cité en l'Université.
Paris sous François Ieret sous Henri IV


Paris, abandonné depuis près d'un siècle
par les rois, commença à les revoir dans son sein, après que les
discordes civiles complètement apaisées eurent affranchi l'autorité
royale de toute crainte à l'intérieur. Le danger venait maintenant
du dehors avec la lutte terrible engagée avec Charles-Quint amena
plusieurs fois les ennemis au cœur de la Champagne ; Paris était
donc très exposé. Or, son ancienne enceinte était en fort mauvais
état, si l'on en croit Rabelais « Panurge considéroit les murailles
de Paris et en irrision dist à Pantagruel Voyez cy ces belles murailles
! O que fortes sont et bien en poinct pour guarder les oysons en
mue. Par ma barbe, elles sont complètement meschantes pour une telle
ville comme ceste-cy, car une vache avecques ung pet en abbattroit
plus de six brasses. »
D'ailleurs, l'ancien système de fortification
ne valait plus rien depuis que l'artillerie avait adopté le tir
à plein fouet; la hauteur des murs et des tours devenait un danger
battus en brèche, leurs débris écrasaient les défenseurs et, comblant
les fossés, facilitaient l'assaut. On imagina donc de former devant
la vieille enceinte une autre enceinte d'ouvrages avancés, de diverses
formes, composés de terre, fort bas et revêtus seulement d'un parement
de pierre du côté de l'escarpe, afin que l'artillerie produisît
peu de dégâts.
Sous François Iere, on donnait déjà
à ces bastillons (bastions) la forme angulaire qu'ils ont de nos
jours, forme qui permet de battre l'ennemi en flanc et de défendre
la courtine et les approches des fossés. La première ordonnance
pour l'exécution de cette enceinte bastionnée est de 1523 ; mais
les travaux ne commencèrent sérieusement qu'en 1536 ; les bourgeois
de Paris et les habitants des villages circonvoisins furent tenus
de fournir à leurs dépens des gens pour y travailler; toutes œuvres
dans la ville durent cesser pendant deux mois. Pendant les règnes
de François Iere' et de Henri II, on s'occupa presque
constamment d'achever cette dispendieuse enceinte.
Paris, qui
s'entourait de fortifications appropriées au nouvel art de la guerre,
s'ornait en même temps d'édifices dans le genre nouveau de la Renaissance.
Les particuliers et les rois y concouraient également. Jacques d'Amboise,
fils du ministre de Louis XII, faisait construire le gracieux hôtel
de Cluny, aujourd'hui consacré aux antiquités nationales. Le chancelier
Duprat bâtissait sur le quai des Augustins l'hôtel d'Hercule, qui
n'existe plus, que François Ier se plut à habiter et
dans le voisinage duquel il fit construire l'hôtel d'Étampes pour
la duchesse, sa favorite.
Ce prince s'occupa aussi du Louvre,
dont nous parlerons en détail un peu plus loin, et fit poser en
1533 la première pierre d'un nouvel hôtel de ville que Henri II
fit plus tard recommencer sur de nouveaux plans, quoiqu'il eût déjà
été élevé jusqu'au second étage.
François Ier qui
fit bruler vif dans Paris même, sur la place de l'Estrapade, bon
nombre de protestants, protégeait néanmoins les lettres, par une
contradiction habituelle aux princes qui ne favorisent l'essor de
l'esprit humain qu'autant qu'il faut pour jeter de l'éclat sur leur
règne. C'est lui, « le grand Apollon gaulois, » comme l'appelle
Corrozet, qui fonda au collège de Cambrai les chaires réunies sous
le nom de Collège de France ; c'est lui qui allait dans l'obscure
et tortueuse rue Jean-de- Beauvais visiter en son établissement
Bobert Estienne, le célèbre et savant imprimeur, et qui, appuyé
sur la barre de la presse, exigeait qu'il ne se dérangeât point
de son travail avant d'avoir terminé son épreuve. Dans la même rue
logea un peu plus tard Ramus, glorieuse victime de la Saint-Barthélemy,
et pas loin de là, dans une maison de la rue des Fossés-Saint-Victor
(aujourd'hui rue Thouin), adossée au mur de la ville, habita Ronsard,
qui y réunissait les poètes de la Pléiade et y reçut quelquefois
la visite de Charles IX.

Les guerres de religion vinrent tout à coup
troubler dans son repos la capitale de la France. Il ne s'y trouvait
guère à l'origine que 7,000 ou 8,000 huguenots contre 250,000 catholiques
une mouche contre un éléphant, comme dit La Noue. Ils furent chassés
; la population catholique prit les armes et mit à sa tête le duc
de Guise.
On connait les vicissitudes de cette longue guerre
et les sanglantes scènes de la Saint-Barthélemy. Dans la soirée
du 24 aout 1572, tous les bateaux furent réunis et solidement amarrés
sur la rive droite de la Seine ; toutes les portes furent fermées,
les quarteniers des seize quartiers, les cinquanteniers et les dizainiers
distribuèrent à leurs hommes, comme signe de ralliement, des manches
blanches qui devaient se mettre au bras gauche, et des croix blanches
pour attacher aux chapeaux. Les portes des protestants furent marquées
à la craie. Les Suisses prirent position au Louvre, les garde-françaises
le long de la Seine, les hallebardiers près de la tour de l'Horloge
ou dans des embarcations réservées. Chose inouïe, ces promenades
d'hommes armés, ce cliquetis de fer, la lueur des torches qui s'allumaient
n'éveillèrent l'attention d'aucun réformé. Pendant que le duc de
Guise et le chevalier d'Angoulême couraient réveiller leurs complices,
le prévôt des marchands haranguait la foule assemblée dans la grande
salle de l'Hôtel de ville « Or sus, mes amis, s'écriait-il, le
roi a pris la résolution d'exterminer tous ces séditieux. Par ma
foi, cela est venu bien à point ; car leurs princes et capitaines
sont comme en prison dans l'enclos de la ville. C'est par eux qu'on
commencera cette nuit-là. Quant aux autres, leur tour arrivera.
C'est l'horloge du palais qui donnera le signal. »
A minuit,
la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois le fit entendre, ce signal
meurtrier; il fut répété par la cloche du palais et le massacre
commença. La plupart des protestants, surpris dans leur premier
sommeil, furent égorgés sans défense quelques-uns se défendirent
avec énergie d'autres, essayant de fuir par les toits, furent criblés
de balles et de pierres ; d'autres encore furent jetés dans la Seine.
On ignore exactement le nombre des victimes de cette horrible boucherie
mais il dut être considérable. « Le bruit continuel des arquebuses
et des pistolets, dit un contemporain, les cris lamentables de ceux
qu'on massacroit, les hurlements des meurtriers, les corps détranchés
tombant des fenêtres et trainés à la rivière, le pillage de plus
de six cents maisons, faisoient ressembler Paris à une ville prise
d'assaut. »

Si nous en croyons une tradition populaire,
qui a été contestée, Charles IX, posté à une fenêtre de l'hôtel
du Petit-Bourbon, aurait tiré avec une longue arquebuse sur les
protestants qui, le Pont- Neuf n'existant pas encore, s'efforçaient
de traverser la Seine à la nage pour gagner le faubourg Saint-Germain.
Cet hôtel occupait la place où les victimes de Juillet sont
restées longtemps ensevelies sous la colonnade du Louvre. C'est
dans ce même hôtel, d'où un roi tira sur ses sujets, que furent
tenus quarante ans plus tard les avant-derniers états généraux de
la monarchie, ces états de 1614 où le tiers état fut si outrageusement
traité par les nobles. Au reste, il ne s'y rattachait que de sinistres
souvenirs. Bâti par Louis de Condé à la fin du XVème
siècle sur l'emplacement de l'ancien hôtel Marigny, d'où Enguerrand
avait été arraché pour être conduit à Montfaucon, l'hôtel du Petit-Bourbon
était resté sans maître après la mort du connétable, son fils, tué
devant Rouen le 5 mai 1527. Le connétable avait été déclaré criminel
de lèse-majesté.
Le roi ne fit point raser son hôt01; mais on
sema du sel dans ses appartements, on brisa les armoiries et les
portes furent brossées de jaune, en signe d'infamie, par la main
du bourreau. Plus tard, en 1658, comme pour défunester cet édifice,
Mazarin permit à Molière d'y établir sa troupe et d'y jouer alternativement
avec les comédiens italiens. « Un jour, dit Charles Nodier, une
femme belle et parée s'appuya sur la fenêtre d'où le roi parricide
avait foudroyé ses sujets. Ce n'était pas la mère de Charles IX,
l'implacable Catherine de Médicis, c'était la maitresse de Molière,
la jolie comédienne Béjart. »
La première victime de la Saint-Barthélemy
fut l'amiral Coligny qui, deux jours auparavant, comme il sortait
du Louvre avait été blessé d'un coup de feu. Au premier signal du
massacre, Guise était accouru chez Coligny et s'était fait ouvrir
au nom du roi. Cosseins, chargé de protéger l'amiral, remplit la
cour de soldats tout ce qui se présente est immolé. Au bruit de
la mousqueterie, aux cris des victimes, Coligny et ses compagnons
se préparent à la mort. La porte de la chambre est enfoncée les
sbires des Guises, couverts de cuirasses et armés d'épées, entrent
tumultueusement. Besme, l'un d'eux, se rue sur l'amiral, lui enfonce
son épée dans le corps, la retire et lui en frappe plusieurs fois
le visage. Guise était dans la cour avec plusieurs gentilshommes
« Est-ce fait ? » cri a-t-il à Besme, et Besme jeta le corps tout
chaud par la fenêtre. Guise et ses hideux compagnons foulèrent aux
pieds la tête de leur victime, remontèrent à cheval et coururent
à de nouveaux massacres. Le lendemain, le cadavre de Coligny, trainé
dans les rues par la populace, fut pendu par les cuisses au gibet
de Montfaucon, La reine l'y alla voir et y conduisit ses fils, ses
filles et son gendre.

Henri de Navarre, le mari de Marguerite,
sœur du roi, et Condé n'échappèrent à la mort qu'en se faisant catholiques.
La messe ou la mort leur avait dit Charles IX. La crainte maitrisa
leurs consciences mais ces conversions durèrent aussi peu que les
motifs qui les avaient arrachées. Le célèbre philosophe Pierre Ramus
fut égorgé dans son logement du collège de Presles ; Jean Goujon,
pendant qu'il travaillait à orner de ses gracieuses productions
le palais du roi, fut tué par une balle.
Le chirurgien Ambroise
Paré, médecin du roi, fut un des rares protestants qui furent épargnés.
Il est bon de retenir les noms des principaux massacreurs, ne serait-ce
que pour les vouer à l'exécration de la postérité. Outre les inspirateurs
et les organisateurs de cette horrible hécatombe, la reine mère
Catherine de Médicis et les Guises, elle stigmatisera le comte de
Coconnas, le capitaine gascon Sarlaboz, le boucher Pezou ; René,
parfumeur de la reine ; Jean Ferrier, avocat, et Croizet, tireur
d'or, qui se vantait d'avoir tué pour sa part quatre cents hérétiques.
Nous avons dit que le cadavre de l'amiral Coligny fut honteusement
attaché aux fourches patibulaires de Montfaucon.
Jetons un coup
d'œil sur ce hideux édifice, qui vit expirer tint de coupables et
d'innocents et qui compta tant d'illustres victimes depuis Pierre
de Brosse jusqu'à Semblançay. La butte sur laquelle était bâti le
gibet de Montfaucon se trouvait près de l'extrémité du faubourg
Saint-Martin, entre les rues Saint-Maur et de la Butte-Chaumont,
et à l'ouest de la route qui conduisait à Pantin cette route est
devenue de nos jours la rue Grange-aux-Belles. Sur le sommet de
cette éminence se voyait un massif de maçonnerie de 15 à 18 pieds
de haut, composé de 10 ou 12 assises de gros quartiers de pierres
brutes et bien liées, bien cimentées et refendues dans leurs joints,
formant un carré long de 40 pieds sur 25 ou 30 de large. Sa partie
supérieure offrait une plate-forme à laquelle on accédait par une
rampe de pierre assez large et dont l'entrée était fermée par une
porte solide. De cette plate-forme et le long de trois côtés seulement,
s'élevaient seize piliers carrés hauts de 32 à 33 pieds, formés
de pierres d'un pied d'épaisseur, semblables à celles de la base
et également bien liées entre elles. Le quatrain suivant de la satire
Ménippée nous fait connaitre que tous ces piliers étaient encore
debout à la fin du XVIème siècle.
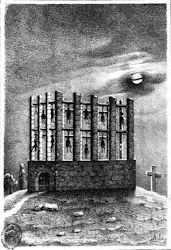
A chacun le sien c'est justice;
A Paris seize quarteniers,
A Montfaucon seize piliers,
C'est à chacun son bénéfice.
Les piliers étaient
unis entre eux par de doubles poutres en bois qui s'enclavaient
dans leurs chaperons, et supportaient des chaînes de fer de trois
pieds et demi de long destinées à suspendre les condamnés. Au-dessous,
à moitié de leur hauteur, ces piliers étaient également liés par
d'autres traverses servant au même usage que les poutres supérieures.
De cette dernière disposition vient l'expression fréquemment employée
« Pendu au lieu le plus éminent, au plus haut du gibet. » Au milieu
de la plaie-forme une ouverture permettait de jeter dans un caveau
les ossements des suppliciés. Le gibet de Montfaucon cessa, sous
Richelieu, de servir soit au supplice des coupables, soit à l'exposition
de leurs cadavres. Dès 1650, quand Sauval écrivait, il ne restait
plus debout que trois ou quatre piliers, et tout à l'entour de la
butte on exploitait de nombreuses plâtrières. Chose étrange les
environs de Montfaucon, couverts de tavernes renommées, étaient,
aux jours de fête, le rendez-vous de la population parisienne, qui
allait là rire et faire de folles orgies, à quelques pas de ce charnier
dont la puanteur devait se mêler à l'odeur des mets. On se rappelle
que chose semblable arriva au cimetière des Innocents.
Charles
IX, l'élève du bon Jacques Amyot, fut loin d'être insensible aux
charmes de la littérature et des beaux-arts, il faisait des vers,
appelait Ronsard son ami et il forma le projet d'établir à Paris
une Académie de poésie et de musique; ce fut sous son règne que
Pierre Lescot continuait le Louvre; Androuet du Cerceau, les Tuileries,
et que l'Arsenal fut fondé.
Paris, purgé de protestants par
la Saint-Barthélemy, put devenir peu de temps après le foyer de
la Ligue. Elle naquit, dit-on, d'une assemblée de bourgeois, de
docteurs et de moines qui se tint au collège Fortel, rue des Sept-Voies,
no 27 (aujourd'hui rue Valette). Elle s'empressa de créer, pour
les seize quartiers de la ville, le conseil secret des Seize, qui
devint son principal organe. Bientôt Henri III, tout occupé de ses
mascarades et de ses pénitences, vit entrer dans Paris, malgré ses
ordres, le duc de Guise accueilli comme un triomphateur. Il appela
les Suisses Guise souleva le peuple. La révolte éclata à la place
Maubert, et par le Châtelet et l'Hôtel de ville, poussa ses barricades
jusqu'au Louvre. Henri III vit succomber ses Suisses, et, n'ayant
plus de ressources que dans la fuite, feignit de se rendre au château
des Tuileries, que l'on commençait à bâtir hors des murs un cheval
l'attendait à la porte Neuve (entre le pont Royal et le pont des
Saints-Pères) ; il piqua des deux, et, sans être atteint par les
balles des bourgeois postés à la tour de Nesle, de l'autre côté
de la rivière, il s'échappa au galop. L'Estoile dit qu'il se retourna
vers la ville, et, la maudissant, jura de n'y rentrer que par la
brèche. Il n'y rentra jamais.
Paris fut pendant quinze années
le quartier général du fanatisme. Ce n'étaient que processions,
prédications furibondes, apprêts de guerre. Le déchainement fut
terrible après l'assassinat du duc de Guise. Henri III fut déclaré
déchu du trône. Bientôt, il arriva avec les protestants et assiégea
sa capitale. Il la contemplait des hauteurs de Saint- Cloud, et,
tout en regrettant la ruine d'une aussi belle ville, déclarait qu'elle
avait besoin d'une saignée pour la guérir. « Encore quelques
jours, ajoutait- il, et l'on ne verra plus ni tes maisons ni tes
murailles, mais seulement la place où tu auras été. » Quelques
jours après, Paris célébrait par des danses et des cris de joie
le coup de poignard de Jacques Clément.
Cependant Henri IV assiégeait
Paris; son armée, à peine forte de 6 000 hommes, couronnait les
hauteurs de Gentilly, de Vaugirard et de Mont- Rouge. Sully, le
duc d'Aumont et Châtillon pénétrèrent dans le faubourg Saint-Germain
quinze à vingt hommes poussèrent même une reconnaissance jusqu'en
face du Pont-Neuf. Au moment même où les ligueurs proclamaient roi
le cardinal de Bourbon sous le nom de Charles X, le roi de Navarre
se présentait devant Paris, s'emparait des faubourgs, brulait les
moulins ; mais il ne voulut pas brusquer la victoire.

Henri IV revint plus tard. C'est cet horrible siège chanté par Voltaire et qui couta la vie à 30 000 personnes. Paris se lassa de tant de souffrances et des excès des Seize ; la Satire Ménippée acheva ; Henri IV, ayant abjuré à Saint-Denis, entra dans la ville en vainqueur, occupa le Louvre, les Châtelets, le Palais, le Temple et la Bastille, d'où il congédia les Espagnols. « Allez, messieurs, leur disait- il, bien des choses à votre maitre mais n'y revenez plus » La ville était dans un état déplorable. « Il y avait peu de maisons entières et sans ruines ; elles étaient la plupart inhabitées ; le pavé des rues était à demi couvert d'herbes quant au dehors, les maisons des faubourgs étaient toutes rasées il n'y avait quasi un seul village qui eût pierre sur pierre, et les campagnes étaient toutes désertes et en friche. » La ville était infestée de voleurs « tout ainsi que dans une forest. » La nuit venue, nul n'osait plus sortir de chez soi. Henri IV fit renaitre l'ordre en rétablissant la garde bourgeoise, le guet royal et les gardes de la connétablie. Henri IV continua à Paris les grands travaux d'architecture commencés sous ses prédécesseurs, et en entreprit de nouveaux. François Ier habitait le palais des Tournelles, où était mort Louis XII et où mourut ensuite Henri II, lorsque, en 1539, ayant offert à Charles-Quint de traverser la France, il eut l'idée de le recevoir au Louvre. Aussitôt des milliers d'ouvriers sont jetés dans cette vieille et inhabitable demeure. La tour féodale tombe, les murs se couvrent de peintures et de tapisseries ; tout, jusqu'aux girouettes, est redoré avec prodigalité. Le palais fut prêt à temps ; mais une fois l'empereur parti, François Ier reconnut qu'il n'avait fait qu'une restauration passagère et peu durable. Il résolut de bâtir, sur la place même du Louvre, un nouveau palais et en confia le soin à Pierre Lescot, secondé par Jean Goujon. Les travaux furent commencés en 1541 et furent conduits jusqu'à la mort de Henri II avec une sage lenteur. C'est la plus belle partie du Louvre, l'angle sud-ouest. Catherine de Médicis, devenue maîtresse du pouvoir, congédia Lescot, prit un architecte italien, et, négligeant les plans de l'architecte français, fit bâtir cette aile qui s'avance vers la rivière, où Henri IV fit plus tard construire la galerie des Rois, remaniée sous Louis XIV et baptisée galerie d'Apollon.

En 1564, Catherine de Médicis se dégoute
des travaux du Louvre et échange contre le domaine royal de Chanteloup,
près de Châtres (Arpajon), le terrain de la Sablonnière, situé de
l'autre côté des murs et occupé par des fabriques de poterie et
des fours à chaux c'est ce qu'on appelait les tuileries Sainct-Honoré.
Philibert Delorme est chargé d'y construire un palais. Son plan
consistait en un parallélogramme de bâtiments et de galeries partagé
en trois cours d'inégale grandeur. Les travaux marchèrent six ans.
Puis Catherine, ayant appris de son astrologue qu'elle mourrait
près de Saint-Germain sous les ruines d'une grande maison, abandonna
tout à coup tous les travaux des Tuileries parce qu'elle était là
sur la paroisse de Saint-Germain l'Auxerrois.
C'est alors qu'elle
fit bâtir par Bullant le charmant hôtel de Soissons, à la place
qu'occupe actuellement la halle au blé. Il n'en reste plus que la
fameuse colonne d'où l'astrologue Huggieri lisait dans le ciel les
destinées de tant de grands personnages. La partie des Tuileries
achevée au moment où Catherine arrêta les travaux se bornait au
pavillon central, aux ailes ou galeries qui s'étendaient à droite
et à gauche et aux deux pavillons auxquels ces galeries aboutissaient.
Le pavillon central était beaucoup plus petit que celui qui existait
avant l'incendie de 1871 et était surmonté d'un dôme demi-sphérique,
malheureusement remplacé plus tard par une lourde calotte à quatre
pans. On fit à ce palais, à l'époque de Louis XIV, et surtout sous
Louis-Philippe, d'autres malencontreux changements. L'idée sur laquelle
reposèrent tous les travaux exécutés au Louvre et aux Tuileries
sous Henri IV fut celle d'unir ces deux palais, « Afin, dit Sauval,
d'être par ce moyen dehors et dedans la ville quand il lui plairait,
et de ne pas se voir enfermé dans des murailles où l'honneur et
la vie de Henri III avaient presque dépendu du caprice et de la
frénésie d'une populace irritée. » Dans ce but, furent bâtis le
pavillon de Flore et la grande galerie qui réunit ce pavillon à
la partie du Louvre construite par Catherine de Médicis. Une révolution
apparut alors dans l'architecture. Ce n'était plus cette école française
si délicate et si gracieuse des Lescot, des Bullant et des Delorme
; c'était une imitation de l'Italie et de ce genre colossal si froid
et si sec. L'architecte était Androuet du Cerceau.
C'est ce
même Androuet du Cerceau qui acheva, en 1606, l'Hôtel de ville commencé
en 1553 sur les plans de l'Italien Dominique Boccardo di Cortone;
édifice gracieux et coquet plutôt que majestueux, et qui faisait
dire au sévère prévôt des marchands, François Myron « A quoi diable
pensait cet étranger. Sa construction est bonne à loger des ribaudes
et non des magistrats. » Considérablement agrandi sous Louis-Philippe
(1837-1841), l'Hôtel de ville, devenu un édifice immense et fort
agréable à la vue, mais dont le détail et le style n'étaient plus
en harmonie avec l'étendue, a été brulé à la fin de l'insurrection
communaliste de 1871. Il a été reconstruit depuis, comme nous le
dirons plus loin. Le souvenir de Henri IV est particulièrement attaché
au Pont-Neuf. Henri III en posa la première pierre en 1578. Ce même
Androuet du Cerceau, dont nous venons de parler, en avait tracé
le plan et en dirigea les premiers travaux, suspendus ensuite pendant
les troubles de la Ligue. Ils furent repris en 1602 et achevés en
1607 par Charles Marchand.Le Pont-Neuf devint :

Le rendez-vous des charlatans,
Des
filous, des passe-volans
Pont-neuf, ordinaire théâtre
Des
vendeurs d'onguent et d'emplâtre,
Séjour des arracheurs de dents,
Des fripiers, libraires, pédants;
Des chanteurs de chansons
nouvelles,
D'entremetteurs de demoiselles,
De coupe-bourses,
d'argotiers,
De maitres de sales métiers,
D'opérateurs et
de chimiques,
Et de médecins purgitique,
De fins joueurs
de gobelets,
De ceux qui vendent des poulets.
Là,
le théâtre de Mondor et de Tabarin, les tours de maitre Gonin, les
marionnettes de Brioché et les beaux tours de son singe attiraient
la foule des badauds. La pompe de la Samaritaine, construite en
1607, était ainsi appelée parce qu'on y avait représenté le Christ
demandant à boire à la Samaritaine. La statue de Henri IV, érigée
en 1614, renversée en 1792, fut rétablie en 1817. Le Pont-Neuf traversait
l'ilot où avaient été brulés les templiers. Cet ilot fut réuni à
la Cité et le roi en fit la cession en forme au premier président,
Achille de Harlay, à la charge d'y construire une place et de payer
une redevance annuelle au trésor royal. Cette place, bâtie régulièrement
en pierre et en brique, fut appelée place Dauphine en l'honneur
du dauphin Louis (1607). Enfin la rue Dauphine fut percée pour servir
de débouché au Pont-Neuf, ainsi que les rues Christine et d'Anjou-Dauphine
(actuellement rue de Nesle). Sur la rive droite, dans le Marais,
furent ouvertes, sur des terrains dépendants de la censive du Temple,
les rues larges et bien alignées d'Orléans, de Bretagne, de Berry,
de Poitou, de Touraine, de Limoges, de la Marche, de Saintonge,
d'Angoulême, de Beaujolais et de Beauce, dont la plupart ont conservé
leur désignation primitive. L'usage des coches avait été introduit
par Catherine de Médicis Paris commençait à avoir des rues larges
et droites. C'est encore sous Henri IV que fut élevée la place Royale,
sur l'emplacement où se trouvait alors le marché aux chevaux. L'Arsenal
fut agrandi et donné pour demeure à Sully, qui y amassa de l'argent,
des canons et de la poudre, « ingrédients et drogues propres à médiciner
les plus flascheuses maladies de l'État. » Les manufactures de tapisseries
de la Savonnerie furent établies à Chaillot ; l'hospice des soldats
invalides, rue de Lourcine l'hôpital Saint-Louis, etc., datent de
la même époque. La superficie de Paris était alors de 1,660 arpents
(84,660 ares).

Neuf mois après son entrée dans la capitale, Henri IV était frappé d'un coup de couteau à la mâchoire supérieure par Jean Châtel, élève des jésuites. Ravaillac, en 1610, devait réussir où Jean Châtel avait échoué. Ce fut en allant à l'Arsenal, visiter son ministre Sully, qui était malade, que Henri IV fut assassiné, dans la rue de la Ferronnerie, vis-à-vis du numéro 3 de la rue Saint- Honoré. Il était dans son carrosse avec les ducs d'Épernon et de Montbazon, et cinq autres seigneurs, sans escorte. Un embarras de voitures arrêta le carrosse ; Ravaillac, qui l'avait suivi, monta sur une borne et frappa le roi de deux coups de couteau, dont le second atteignit le cœur. Le Parlement condamna l'assassin à être écartelé. « Les juges, dit un historien, ne lui trouvèrent pas ou n'osèrent point lui trouver de complices. »
Paris sous les Règnes de Louis III à Louis XV
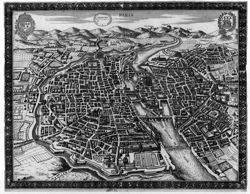
Le règne de Henri IV avait mis fin aux folies
de la Ligue et ramené le calme dans Paris. Ce calme ne fut guère
troublé sous Louis XIII, et la ville alla croissant avec une telle
rapidité que, dès 1626, une nouvelle enceinte fut jugée nécessaire.
On s'était contenté jusque-là de celle d'Étienne Marcel et de Charles
V. La nouvelle suivait à peu près la ligne de nos boulevards depuis
la porte Saint-Denis, enveloppait les Tuileries et leur jardin,
ainsi que la butte Saint-Roch, encore dépourvue de constructions
autres que ses moulins à vent ; à son extrémité, près de la Seine,
fut ouverte la porte dite de la Conférence. Le Marais, l'île Saint-Louis,
la butte Saint-Roch, la rue Richelieu, le Pré-aux-Clercs, (faubourg
Saint-Germain) se couvrirent de maisons.
Jusqu'à cette époque
le Pré-aux-Clercs avait été, comme son nom l'indique, une agréable
prairie consacrée aux ébattements des clercs ou écoliers, et que
partageait un canal de treize à quatorze toises de largeur, appelé
la petite Seine, qui allait se perdre dans les fossés de l'abbaye,
alors flanquée de tours.
C'est là qu'ont existé de nos jours
le couvent et l'église des Petits-Augustins, sur l'emplacement desquels
s'élève maintenant l'École des Beaux-Arts. Dès le milieu du xv le
siècle, on avait commencé à y bâtir la rue du Colombier et la rue
des Marais. Le reste des constructions de ce quartier ne s'acheva
que sous le règne de Louis XIV. Ce fut dans le grand Pré-aux-Clercs
que l'armée de Henri IV campa en quand le bon roi assiégea sa bonne
ville. Après avoir été le camp de Henri IV, il devint le champ de
bataille de Cyrano. C'est aujourd'hui un quartier très civilisé
(le faubourg Saint-Germain) où l'on danse et où l'on fait de la
politique. »
Les édifices publics continuèrent à s'élever en
grand nombre. En 1616, Marie de Médicis entreprit la construction
du palais du Luxembourg, qu'elle s'efforça de faire appeler palais
Médicis ; mais l'usage l'emporta. Le duc de Piney-Luxembourg avait
fait l'acquisition de l'hôtel qui s'élevait là au XVIème
siècle ; Marie de Médicis le lui acheta en 16i 2. Le palais de la
Cité, détruit, ainsi que sa fameuse table de marbre, par un incendie,
fut reconstruit, en 1618, par Jacques de Brosse. Entre 1621 et 1630,
s'éleva, rue Saint-Honoré, l'église de l'Oratoire pour cette fameuse
congrégation fondée par le cardinal de Bérulle et destinée sans
doute à faire contrepoids aux jésuites. « C'est un corps, disait
Bossuet, où tout le monde obéit et où personne ne commande. »
« L'église des oratoriens, dit Charles Nodier, est devenue de nos
jours le temple des protestants. Les catholiques ultramontains et
les jésuites, s'il en reste, pensent probablement qu'il n'a pas
beaucoup changé de destination. En 1633, Lemercier commença la construction
de l'église Saint-Roch, qui ne fut achevée qu'en 1736.

La Sorbonne fut rebâtie par les soins de
Richelieu, qui y avait été élevé et dont on y voit le tombeau, œuvre
de Girardon. Le pont au Change et le pont Saint- Michel furent reconstruits.
La place Royale était achevée dès 1612. Richelieu y occupa l'hôtel
qui porte aujourd'hui le n° 21. De là il pouvait quelquefois reposer
ses yeux sur la demeure de Marion Delorme, qui habitait aussi la
place Royale, vers l'angle nord-est de la place, et que Victor Hugo
occupa depuis. En 1639, on y érigea la statue de Louis XIII. « La
véritable décoration de la place Royale, dit le critique que nous
venons de citer, c'est la vieille architecture italienne de ses
trente-cinq pavillons c'est le souvenir de ses fêtes, de ses carrousels,
de ses duels ; c'est le square agréable qu'on y a ménagé pour la
délectation des enfants du quartier et qui est fort susceptible
de s'embellir à peu de frais. Il ne faut pour cela qu'un massif
d'arbres de plus et une statue de moins. »
Richelieu voulut
avoir un palais à lui et construisit le palais Cardinal, commencé
dès 1629 sous le nom d'hôtel de Richelieu. En 1636, le cardinal
en fit une donation entre vifs au roi aussi, dès 1643, le palais
Cardinal fut appelé palais Royal. Il s'y trouvait une magnifique
galerie d'hommes illustres, peinte et décorée par Philippe de Champagne,
Vouet, etc.
Pour cette construction, il avait fallu renverser
la vieille muraille de la ville et combler l'ancien fossé. Les contemporains
étaient émerveillés de cette magique transformation de la capitale,
et leur étonnement se peint dans ce passage du Menteur de Corneille
:
Doriante
Paris semble à mes yeux un pays de romans
;
J'y croyais ce matin voir une île enchantée (ile Saint-Louis)
Je la laissai déserte et la trouve habitée.
Quelque Amphion
nouveau, sans l'aide des maçons,
En superbes palais a changé
ces buissons.
Géronte
Paris voit tous les jours de ces
métamorphoses :
Dans tout le Pré-aux-Clercs tu verras mêmes
choses,
Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal
Aux
superbes dehors du palais Cardinal;
Toute une ville entière
avec pompe bâtie,
Semble d'un vieux fossé par miracle sortie.
Une multitude d'hôtels particuliers s'élevaient en même temps
que les édifices publics. L'hôtel de Rambouillet, si célèbre comme
le rendez-vous des beaux esprits sous Louis XIII, venait d'être
bâti par la belle Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet.
Il était construit en briques avec des ornements de pierre et occupait
une partie de la place du Palais-Royal. Plus tard, l'esprit de l'hôtel
de Rambouillet dégénéra et mérita les satires de Scarron, de Boileau
et de Molière.
Un grand luxe y entretenait une sorte d'enchantement
perpétuel ce n'étaient qu'objets rares, parfums, corbeilles de fleurs
toujours pleines. Le luxe, au reste, était partout. Les dorlotières
ou modistes faisaient un commerce considérable pour la toilette
des hommes comme pour celle des femmes.

Nœuds argentés, lacets, escharpes,
Bouillons en nageoires de carpes,
Porte-fraises en entonnoir,
Oreillettes de velours noir,
Doublures aux masques huilées,
Des mentonnières dentelées,
Des sangles à roidir le buse,
Des endroits où l'on met du musc, etc.
Le palais
était plein de ces boutiques de brimborions, et un contemporain
blâme fort les marchands de ce lieu qui, pour attirer les chalands,
« leur laissent la liberté de parler à leurs femmes, de leur dire
des choses lascives, avec attouchement et regards. Le tout pour
vendre une douzaine d'aiguillètes de soie, un collet à la mode,
une bourse d'enfant, une dragme ou deux de parfum pour la perruque
ou bien pour une petite épée de bois à mettre au côté d'un enfant
; ainsi pour peu de chose. En parlant de perruque, il ne faut pas
oublier l'artiste célèbre du temps, M. Binet, qui fait les perruques
du roi, rue des Petits-Champs. La magnifique perruque de Louis
XIV et de ses courtisans, pesant plusieurs livres, coutant jusqu'à
mille écus et surmontant le front de cinq à six pouces de cheveux,
s'appelait alors une binette, du nom de son auteur. Le mot est resté
pour désigner une figure grotesque dans le langage du gamin de Paris.
Il était du suprême bon ton d'être coiffé par M. Binet, d'avoir
une binette ; cet échafaudage capillaire donnait à quelques financiers
parvenus une drôle de figure, une drôle de binette. Le mot a été
retrouvé de nos jours, et non pas inventé par le gamin de Paris.
Parmi les fondations de toutes sortes qui remontent au règne
de Louis XIII, citons encore celle de l'Académie française, qui
tint d'abord ses séances chez Conrart, puis dans l'hôtel du chancelier
Séguier et que Louis XIII accueillit au Louvre ; l'Imprimerie royale
(aujourd'hui Imprimerie nationale), elle aussi, eut d'abord ses
ateliers au Louvre, puis à l'hôtel de Toulouse, et, en 1809, à l'hôtel
de Soubise, dans la rue Vieille-du-Temple, où elle est encore le
collège de Clermont (collège de Louis-le- Grand), rue Saint-Jacques,
fut reconstruit ; le Jardin des Plantes, dont la direction devait
échoir plus tard à Buffon, en1781, fut fondé sur la proposition
de Labrosse, médecin du roi ; la reine Anne d'Autriche, pour célébrer
sa grossesse et la naissance de Louis XIV, édifia le Val-de-Grâce,
chef d'œuvre de Mansart, dont on a fait un hôpital militaire l'hôpital
de la Pitié, celui des Incurables, le Port-Royal (aujourd'hui hospice
de la Maternité), y furent ouverts aux malades et aux femmes en
couche ; enfin de riches bourgeois firent bâtir, en dehors de la
porte Saint-Honoré, tant d'hôtels que ce faubourg se trouva joint
aux villages du Roule et de la Ville-l'Évêque ; la grande rue du
faubourg Saint-Antoine et les rues adjacentes furent percées. La
dernière révolte de Paris avant la Révolution fut la Fronde. Au
pied de la butte Saint-Roch, dans le fossé de la ville, les petits
garçons du quartier avaient alors l'habitude d'aller se battre à
coups de fronde. Quand l'archer paraissait, ils se sauvaient ; dès
qu'il était parti, ils recommençaient. Dans les premiers troubles
du parlement, un jeune conseiller, Bachaumont, remarqua le silence
et la docilité des magistrats en présence du roi, leur turbulence
en son absence « On se tait à présent, dit-il, mais, quand il
sera parti, on frondera de plus belle. » Le mot resta. La Fronde
gagna bientôt toute la ville, qui s'y trouvait particulièrement
intéressée puisque le premier grief était un nouvel octroi et un
impôt sur les maisons construites en dehors de l'enceinte. Assiégée
par le peuple furieux dans le Palais-Royal, Anne d'Autriche fut
obligée de relâcher le vieux conseiller Broussel, qu'elle avait
fait arrêter.
Le Parlement leva une armée parmi les Parisiens
l'armée des portes cochères, parce que le propriétaire de chaque
maison ayant une porte cochère devait fournir un homme tout équipé.
La guerre commença. Mais le peuple de Paris n'eut point alors dans
sa révolte la majesté terrible du XIVème ou même du XVIème
siècle.

La querelle, suscitée et dirigée par les
parlementaires et les nobles, demeura mesquine et frivole. Il assista
en spectateur au combat de la porte Saint-Antoine, où Condé, chef
des rebelles, ne dut son salut qu'au canon de la Bastille, tiré
par l'ordre de la duchesse de Montpensier, la grande Mademoiselle,
comme on l'a appelée, qui devait plus tard tirer les bottes de Lauzun.
Condé, si vaillant capitaine, ne sut que semer l'anarchie dans la
ville, qui, enfin, lassée, ouvrit ses portes au roi. Ce fut elle
surtout qui paya les frais de la révolte. Ses privilèges furent
abolis, ses chaines brisées, ses milices remplacées par une garnison
royale, ses officiers municipaux par des magistrats royaux. Les
registres du parlement et de l'Hôtel de ville, qui contenaient les
actes de cette époque, furent lacérés par la main du bourreau. Privé
pour un siècle et demi de toute individualité et de toute indépendance,
Paris demeura le théâtre où s'étalèrent les splendeurs de la cour
de Louis XIV. Dès 1662, ce roi donna l'idée de ce que coûterait
son règne dans cette fameuse fête du carrousel qui couta un million
deux cent mille livres (somme qui représenterait aujourd'hui cinq
millions de francs) et qui a laissé son nom à la vaste place située
entre le Louvre et les Tuileries. « L'or et l'agent étaient employés
avec une si grande profusion sur les habits et les housses des chevaux,
qu'à peine pouvait-on discerner le fond de l'étoffe d'avec la broderie
dont elle était couverte. Le roi et les princes brillaient extraordinairement
par la quantité prodigieuse de diamants dont leurs armes et les
harnais de leurs chevaux étaient enrichis. » A la même époque
de 1660 à 1664, l'architecte Levau achevait le palais des Tuileries
par la construction du pavillon de Marsan, et complétait le Louvre
en élevant les façades intérieures auxquelles Perrault adossa plus
tard sa fameuse colonnade et la façade extérieure du midi entre
1667 et 1680.
C'est en 1665 que Le Nôtre fut chargé de dessiner
le jardin des Tuileries. Comme les anciens jardins français, celui-ci
était jusque-là un pêlemêle de toutes sortes de choses on y voyait
un étang, un bois, un rocher, une volière, une orangerie, un écho,
un petit théâtre et un labyrinthe. Près de la porte de la Conférence,
le long du quai, se trouvait une jolie petite habitation cachée
mystérieusement au milieu des arbres le roi ; Louis XIII en avait
fait don à son valet de chambre, Renard, qui l'avait meublée d'objets
rares et précieux et en avait fait un lieu de fins soupers et de
secrets rendez-vous fréquenté par les jeunes seigneurs. Tout cela
fit place au majestueux et sévère jardin que nous admirons aujourd'hui.
Louis XIV fit bâtir un palais pour les vieux soldats. En 1670, il
posa la première pierre de l'hôtel des Invalides, chef-d’œuvre de
Jules Hardouin-Mansart, qui sut imprimer à l'édifice un caractère
à la fois religieux et militaire, bien conforme à sa destination,
et dessiner le plus beau dôme de France. En même temps s'achevait
le Val-de-Grâce, dont la voute fut décorée des peintures de Mignard,
le plus grand morceau de fresque qu'il y ait en Europe. D'autres
monuments étaient consacrés aux sciences et aux lettres ; le collège
Mazarin ou des Quatre-Nations, devenu, en 1795, le palais de l'Institut,
s'achevait sur les dessins de Levau ; l'Observatoire s'élevait sur
ceux de Perrault avec des caves égales en profondeur à la hauteur
de l'édifice.

D'autres monuments, infiniment moins utiles,
étaient offerts à la vanité du monarque par des sujets trop complaisants.
La ville de Paris dépensa plus de cinq cent mille francs à construire
la porte Saint-Denis, sur les dessins de Blondel, et sans doute
à peu près autant à la porte Saint-Martin (1671-1674). Mais le plus
insigne monument de flatterie fut la place des Victoires, à la création
de laquelle le prévôt des marchands et les échevins sollicitèrent
l'honneur de participer ; elle est surtout l'œuvre du duc de La
Feuillade en 1686. Ce duc avait fait les frais d'un groupe composé
d'une statue de Louis XIV que la Victoire couronnait et qui foulait
aux pieds un Cerbère. Le monument fut inauguré au bruit des fanfares
et de l'artillerie ; on se prosterna devant l'idole et on lui brûla
de l'encens ; on grava dessous en lettres d'or Viro immortali
Quatre fanaux allumés éclairaient ce groupe pendant la nuit ; un
Gascon plaisant écrivit :
La Feuillade, sandis, jé crois
qué tu mé bernes,
De placer lé soleil entré quatré lanternes.
On fit abattre les fanaux.
Ils nous rappellent que Paris
commença d'être éclairé la nuit par des lanternes en 1667.
Rappelons
aussi d'autres souvenirs moins fastueux, mais plus intéressants
pour l'esprit humain. Dans la Cité, dans la rue de la Juiverie (aujourd'hui
disparue), vis-à-vis de l'église de la Madeleine et près du pont
Notre-Dame, était le fameux cabaret de la Pomme de pin, compté déjà
par Rabelais au nombre des « tabernes méritoires où cauponisoient
joyeusement les escholiers de Lutèce. » Les ivrognes n'y manquaient
pas au temps de Regnier le satirique, qui parle d'un certain nez
d'ivrogne,
Où maint rubis balais, tout rougissants de
vin, Montroient un hac itur à la Pomme de pin.
Cependant
la Pomme de pin tombait en décadence. Elle se releva sous Louis
XIV par l'habileté du grand Crénet. Ses tables, peu magnifiques,
mais fort chargées de bouteilles, réunissaient une fois par semaine
Molière, Racine, La Fontaine et Boileau. Ils y rencontraient quelquefois
Lulli, Mignard et Dufresnoy. C'est là que furent en partie composés
les Plaideurs et le Chapelin décoiffé. C'est là que Chapelle, le
plus assidu sans doute, enivrait Boileau,
Et répandait
sa lampe à l'huile
Pour lui mettre un verre à la main.

Les cafés allaient détrôner les cabarets.
Soliman-Aga, ambassadeur de la Porte, introduisit à Paris, en 1669,
l'usage du café. Bientôt le premier établissement où se vendit cette
généreuse liqueur s'ouvrit à la foire Saint-Germain, qui était alors
un des lieux les plus fréquentés et les plus à la mode, et dont
la suppression, vers la fin du XVIIIème siècle, fut un
coup mortel porté à l'industrie et au commerce de la rive gauche
au profit de la rive droite. Un Arménien appelé Pascal établit ensuite
sur le quai de l'École un café qui eut de la vogue (café Manouri)
; et, enfin, en 1689, le Sicilien Procope ouvrit le sien vis-à-vis
de la Comédie-Française, dans la rue des Fossés-Saint-Germain (rue
de l'Ancienne-Comédie). Les illustres amis dont nous venons de parler
ne se réunissaient pas toujours chez Crénet ou Boucingault. Souvent
aussi un petit appartement de la rue du Vieux-Colombier, que Boileau
avait loué en quittant la cour du Palais pour y fuir l'humeur acariâtre
de sa belle-sœur, Mme Jérôme Boileau, voyait les amis réunis autour
d'une table modeste. Au milieu s'élevait l'énorme in-folio de la
Pucelle de Chapelain chaque faute d'un des convives était punie
par la lecture de vingt vers du poète proscrit; « la lecture de
la page entière, dit Louis Racine, était assimilée à la plus grande
punition » Un jour le malin Racine (nous parlons du père), en sortant
de la rue du Vieux-Colombier, emmena Boileau rue des Cinq-Diamants,
quartier des Lombards, chez ce même Chapelain, et le présenta à
l'infortuné poète épique sous le nom de bailli de Chevreuse. Mais
la conversation étant promptement tombée sur la poésie, Boileau
ne tarda pas à prendre feu, et Racine fut obligé de l'emmener prestement
pour l'empêcher de trahir son incognito et de déchirer sa malheureuse
victime autrement qu'en vers. Racine s'en allait ensuite paisiblement
dans sa petite rue des Marais-Saint-Germain (rue Visconti), au milieu
de sa famille. Corneille demeurait rue d'Argenteuil, au numéro 18.
Un jour sa servante jette imprudemment de la paille devant la porte,
et le grand Corneille fut obligé de comparaître devant le magistrat
du quartier, qui, au reste, l'acquitta. Molière, on le sait, est
né sous les piliers des halles, dans la même maison et peut-être
la même chambre où naquit ensuite Regnard, son seul héritier ; il
mourut au numéro 34 de la rue Richelieu, en face de l'endroit où
s'élève aujourd'hui la fontaine Molière. Ce quartier se peuplait
; les moulins de la butte Saint-Roch avaient disparu entièrement
en 1672, et, dès 1670, Lulli était venu faire bâtir dans la rue
Sainte-Anne une magnifique et trop peu modeste maison dont on voit
encore la façade ornée de sculptures qui représentent des instruments
de musique, et des masques de théâtre.

Quant à la société aristocratique, son centre
était toujours le Marais. Dans la rue Culture-Sainte-Catherine (rue
Sévigné actuelle) s'élevait l'hôtel Carnavalet, bâti par Du Cerceau
et Mansart, décoré par Jean Goujon, et illustré surtout par le séjour
de Madame de Sévigné. Le bel hôtel Lamoignon réunissait dans la
rue Payée-Saint-Antoine ; l'élite des esprits sérieux ; et celui
de Ninon de Lenclos, rue des Tournelles, l'élite des esprits frondeurs
et hardis au milieu desquels le hasard apporta un jour si judicieusement
le berceau de Voltaire.
C'est en vain que Louis XIV abandonna
Paris, Versailles y gagna et put compter jusqu'à cent mille habitants;
mais Paris n'y perdit guère. Sa population atteignait presque cinq
cent mille âmes on y comptait cinq cents grandes rues, neuf faubourgs,
cent places, neuf ponts.
L'accroissement de la population rendit
nécessaire l'extension de l'enceinte ; on l'effectua en circonscrivant
Paris dans de vastes boulevards; ces boulevards ne furent complètement
achevés qu'en 1761. La nouvelle enceinte enferma les quartiers de
Saint-Benoît, du Luxembourg et de Montmartre ; les remparts, abattus
sur les boulevards intérieurs, donnèrent naissance à de magnifiques
promenades ; les Champs-Élysées furent plantés. D'autres créations
moins fastueuses et plus utiles signalent encore cette époque ;
citons l'hospice des Enfants-Trouvés ,l'hospice des Orphelins Sainte-Pélagie,
destinée aux femmes et aux filles condamnées à une pénitence variée,
devenue plus tard une prison pour dettes et une prison politique
; la Madeleine; Saint-Sulpice; la Bibliothèque royale (aujourd’hui
Nationale), rue de Richelieu, sur l'emplacement de l'hôtel Mazarin;
la manufacture des Gobelins; l'Académie des inscriptions et belles-lettres;
celle des sciences, installée au Louvre en 1699 celle de peinture,
etc. Après cette rapide et incomplète nomenclature, on ne peut s'étonner
de ce que Vauban écrivait alors « Cette ville est à la France ce
que la tête est au corps humain. C'est le vrai cœur du royaume,
la mère commune de la France, par qui tous les peuples de ce grand
État subsistent, et dont le royaume ne saurait se passer sans déchoir
considérablement. » Un aussi juste coup d'œil sur l'importance nécessaire
de Paris était digne du grand homme qui a écrit ces lignes. Paris
fut, pendant tout le XVIIIème siècle, le centre du gouvernement
et des affaires, des idées et des plaisirs. Tandis que le régent
remplissait de ses orgies le Palais-Royal et y célébrait les scandaleuses
fêtes d'Adam, on s'étouffait dans la rue Quincampoix pour avoir
des actions de la compagnie de Law, et trois ou quatre personnes
y étaient écrasées chaque jour. Les rues Saint-Martin, Saint-Denis,
Aubry-le-Boucher étaient encombrées par de longues files d'équipages.
La moindre chambre de la rue Quincampoix se louait dix louis par
jour ; des maisons de sept à huit cents livres de loyer en rapportaient
cinquante à soixante mille. Celle où siégeait la banque de Law existait
encore il y a une vingtaine d'années à l'endroit où l'on a bâti
la maison qui porte le numéro 47, au coin de la rue Rambuteau. L'affluence
toujours croissante obligea bientôt de transférer la banque dans
un local plus vaste, l'hôtel de Soissons. La cause de tout ce tripotage
qui tenait du vertige était dans les embarras que le régent avait
éprouvés en prenant la direction du pouvoir. En effet, Louis XIV
en mourant en 1715 avait laissé une dette publique de 2 milliards
62 millions. Dans l'espérance de se tirer d'affaire, Philippe d'Orléans
avait prêté l'oreille aux conseils de l'aventurier écossais et accepté
ses combinaisons, qui aboutirent à une sorte de banqueroute.
Après le Mississipi, ce fut le tombeau du diacre Pâris qui eut la
vogue. Ce tombeau, situé dans le cimetière de l'église Saint-Médard
et réputé miraculeux, attira cette multitude prodigieuse de convulsionnaires
et d'illuminés divisée en sectes nombreuses et dont les excentricités
obligèrent l'autorité à fermer le cimetière. C'était surtout des
jeunes filles exaltées. L'une d'elles, Jeanne Muller, se faisait
donner sur l'estomac de grands coups d'un lourd chenet qui pénétrait
assez profondément ; et à chaque fois elle s'écriait avec délices
« Ah que cela est bon! Ah que cela me fait du bien ! Mon frère,
redoublez encore vos forces, si vous pouvez » D'autres sautaient,
miaulaient, aboyaient, etc.
Quand le cimetière eut été fermé,
un plaisant écrivit sur la porte
De par le roi défense
à Dieu
De faire miracle en ce lieu.
Et le ridicule
emporta ces tristes folies. Il ne fut plus, depuis, question des
Convulsionnaires.
Si l'homme se déshonorait au Palais-Royal,
dans la rue Quincampoix et au cimetière Saint-Médard par le vice
et la folie, il se relevait et atteignait toute la grandeur que
lui prêtent la raison et le génie dans d'obscurs logis de la capitale.
Rue Plâtrière (rue Jean-Jacques-Rousseau), dans la maison numéro
21, au quatrième étage, Rousseau copiait de la musique pour vivre.
Plus tard, pendant la Révolution, cette maison modeste devint un
lieu de pèlerinage et le loyer en augmenta considérablement.

Au numéro 25 de la rue Molière, alors appelée
rue Traversière, Voltaire habitait en compagnie de Mme du Châtelet
; c'est là qu'il accueillait, défrayait et instruisait Lekain encore
pauvre et obscur, dont il avait deviné le talent au-dessus de son
logement, il fit construire un petit théâtre où cet acteur célèbre
jouait avec sa société et avec les nièces du poète philosophe. La
dernière demeure de Voltaire fut, comme chacun sait, l'hôtel Villette
(quai Voltaire), où il vint habiter en 1777, et mourut le 30 mai
1778, dans l'appartement du premier étage. Tout près de la rue Traversière,
rue des Moulins, était le logis du bon et spirituel Piron, qui s'en
allait de là, par le passage des Feuillants, faire sa promenade
quotidienne aux Tuileries. Ces hommes de génie ou d'esprit, qui
pullulaient au XVIIIème siècle, on les retrouvait encore
avec tout le brillant de leur esprit dans tous ces cafés, devenus
des lieux de réunion où se débitaient les idées nouvelles, les anecdotes
plaisantes, les piquantes épigrammes, où se formulaient les jugements
de la critique littéraire.
Il y avait une quinzaine de cafés
qui possédaient une vogue de ce genre : à leur tête étaient le café
Procope, qui vit bien des fois réunis Voltaire, Piron, Fontenelle,
Saint-Foix; le café de la Régence, qui a disparu par suite des démolitions
de la place du Palais-Royal, et où Rousseau jouant aux échecs attirait
une foule si considérable de curieux que le lieutenant de police
fut obligé de placer une sentinelle à la porte ; le café de la Rotonde,
qui rassemblait la société du Caveau, Piron, Collé, Duclos, Crébillon
fils, Boucher, Rameau, Bernard; plus tard le café de Foy, où le
poète Lebrun, vieux et aveugle, venait tous les soirs, appuyé sur
le bras de sa servante, prendre son café, et où Camille Desmoulins,
par ses discours patriotiques, conquit le titre de premier apôtre
de la liberté, etc.
En face du café Procope était le théâtre
de la Comédie-Française, qui avait ouvert le 18 avril 1689 par la
tragédie de Phèdre et qui fut occupé jusqu'en1770 par les comédiens
ordinaires du roi ; ce théâtre menaçant ruine, ils l'abandonnèrent
alors pour se transporter aux Tuileries, et c'est dans le théâtre
du palais des rois que Voltaire reçut, en 1777, cette ovation extraordinaire
qui couronna si dignement sa longue existence. C'est surtout l'Opéra
qui prit de grands accroissements au XVIIIème siècle:

Il faut se rendre à ce palais magique,
Où les beaux vers, la danse, la musique,
L'art de charmer
les yeux par les couleurs,
L'art plus heureux de séduire les
cœurs,
De cent plaisirs fait un plaisir unique.
Au
moment où Voltaire dépeignait par ces vers charmants l'Académie
royale de musique, ce théâtre réunissait une brillante pléiade Vestris,
la Guimard, Sophie Arnould, etc. Il est probable qu'alors les appointements
de ces acteurs avaient été augmentés ; en 1713, ils étaient bien
modestes les premiers acteurs ou actrices avaient mille cinq cents
livres ; les premiers danseurs mille livres. Aujourd'hui, on ne
compte que par cent mille francs. Les reines de l'Opéra étaient
alors en grande vogue. Les riches seigneurs, et surtout les gros
financiers, les millionnaires, fermiers généraux, défrayaient ces
demoiselles avec un luxe prodigieux. Le fermier général était, sur
ce chapitre, préféré de beaucoup aux ducs, comme le prouve cette
épigramme :
Fières de vider une caisse,
Que celles
qu'entretient un fermier général
N'insultent pas dans leur ivresse
Celles qui n'ont qu'un duc l'orgueil sied toujours mal,
Et la
modestie intéresse.
Ces riches traitants bâtissaient
alors tout un nouveau quartier de Paris, celui que nous appelons
quartier de la Chaussé-d'Antin.
Au commencement du siècle, Paris
s'arrêtait à peu près à nos boulevards ; au-delà, on ne voyait que
des jardins maraîchers et les carrières de plâtre de Montmartre.
Regnard, qui, moins pauvre que Molière, possédait un bel hôtel à
la place même où s'est établi de nos jours le café Frascati, décrit
ainsi la vue dont il jouissait de ses fenêtres.
L'œil
voit d'abord ce mont, dont les antres profonds
Fournissent à
Paris l'honneur de ses plafonds,
Où de trente moulins les ailes
étendues
M'apprennent chaque jour quel vent chasse les nues.
….Les yeux satisfais
S'y promènent au loin sur de vastes
marais.
C'est là qu'en mille endroits laissant errer ma vue,
Je vois croître à plaisir l'oseille et la laitue;
C'est
là que, dans son temps, des moissons d'artichauts
Du jardinier
actif fécondent les travaux,
Et que de champignons une couche
voisine
Ne fait, quand il me plait, qu'un saut dans ma cuisine.
Là se trouvait l'enclos appelé la Ville l’Évêque et
qui relevait, comme son nom l'indique, de l'évêque de Paris.
Là, au milieu des marécages peuplés de grenouilles dont le souvenir
se conserva dans le nom de la rue Chante-Raine (rue de la Victoire),
s'élevait la petite ile de la Grange-Batelière.
Le fermier de
cette grange vendait du pain, du beurre, des œufs, du lait, des
poulets, du jambon, des gâteaux; aussi l'appelait-on, au XIVème
siècle, la Grange Batelière. Le Parisien, déjà grand ami de la campagne,
y courait le dimanche. Les alentours, pourtant, n'étaient pas très
surs la nuit ; l'égout du faubourg Montmartre qu'on y avait établi
s'ouvrait béant comme un abime d'ordure et de boue où finissait
quelquefois la course des ivrognes attardés revenant des Porcherons.
C'était aussi le théâtre des exploits d'une bande audacieuse de
brigands qui, un beau jour, ou plutôt une belle nuit, arrêta le
grand Turenne lui-même. Le grand Turenne donna bonnement sa bourse
; les voleurs, ne la trouvant pas suffisamment garnie, ne l'acceptèrent
que comme un acompte , et le lendemain leur chef se présenta à l'hôtel
du maréchal, qui lui paya religieusement la somme à laquelle il
s'était engagé. Le traitant Crozat, qui avait fait bâtir un superbe
hôtel près de la porte Richelieu, se fit faire, hors de l'enceinte
de la ville et sur les terrains de la Grange, de magnifiques jardins,
vers l'époque où les anciens remparts furent transformés en un cours
qui jouit d'une grande vogue, et qui n'est autre que nos boulevards
actuels.
C'était au commencement du XVIIIème siècle.
Bientôt ce fut une fureur de ce côté. Bouret, Le Normand d'Étioles,
Daugny y construisirent des palais dont les filles de d'Opéra furent
les premiers habitants. Le duc de Choiseul y eut aussi un hôtel
superbe. Paris avait changé de centre. La place Royale et le Marais
étaient devenus province. Collé et Sedaine protestaient plaisamment
:
On n'est plus de Paris quand on est du Marais,
Mais
aussi n'est-on pas de Vienne.
La critique a beau dire, on y
vient sans relais,
Il faut même que l'on convienne
Qu'on
n'en saurait être plus près.
Vive, vive le quartier du Marais!
Durant cette période, Paris reçut une extension et des embellissements
considérables ; en 1726, sa superficie était de 3,319 arpents (169,269
ares); son enceinte commençait au nord de l'Arsenal, suivait les
boulevards jusqu'à la rue Saint-Honoré, passait au boulevard des
Invalides, coupait les rues de Babylone, Plumet, de Sèvres, des
Vieilles-Tuileries, allait en droite ligne jusqu'à la rue de la
Bourbe, d'où elle longeait les murs du Val-de-Grâce, la rue des
Bourguignons (aujourd'hui disparue), la rue de Lourcine, la rue
Censier et aboutissait en droite ligne vis-à-vis de l'Arsenal. Les
faubourgs Saint-Honoré et Saint-Germain se décorèrent d'hôtels somptueux
; le beau quartier de la Chaussée-d‘Antin fut créé. L'Élysée-Bourbon
fut bâti en 1718 par le comte d'Évreux ; acquis par Mme de Pompadour,
il devint la résidence du financier Beaujon. L'École- Militaire
fut érigée en 1751 pour que les jeunes gentilshommes sans fortune
ou dont les pères seraient morts au service de l'État y fussent
instruits dans l'art de la guerre le Champ-de-Mars s'étendit depuis
l'École-Militaire jusqu'au quai qui borde la rivière.
Parmi
les autres créations de cette époque, citons encore: l'église Sainte-Geneviève,
bâtie en 1757 sur les dessins de Soufflot, que la Révolution a nommée
le Panthéon en y déposant les cendres des grands hommes, de Rousseau,
de Voltaire, de Mirabeau, etc., et qui, déjà rendue au culte sous
l'Empire et la Restauration, lui a été rendue de nouveau sous Napoléon
III ; l'École de droit, l'École de médecine, l'Odéon, le Théâtre-Français
de la rue de Richelieu, l'hôtel des Monnaies, la halle au blé, la
place Louis XV, appelée plus tard place de la Révolution et aujourd'hui
place de la Concorde; une statue équestre de Louis XV, élevée au
milieu, donna lieu à de mordantes plaisanteries; on y lut un jour
ces vers, allusion aux statues des quatre vertus la Force, la Prudence,
la Paix et la Justice, placées aux angles du piédestal:

O la belle statue! O le beau piédestal
!
Les vertus sont à pied, le vice est à cheval.
En
1770, la place Louis XV, théâtre des fêtes célébrées en l'honneur
du mariage du dauphin et de l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche,
devint tout à coup celui d'une affreuse catastrophe amenée par l'excès
d'affluence il y eut près de 300 personnes étouffées, et les esprits
chagrins et impressionnables considérèrent ce malheur comme un funeste
présage.
En 1774, Louis XV mourut son petit-fils lui succéda
sous le nom de Louis XVI son premier acte fut de rappeler le Parlement,
banni depuis 1753 puis il fonda le Mont-de-Piété, abolit les corvées
et la torture (1). L'affaire du collier, où fut compromis le cardinal
de Rohan, agita un instant l'opinion ; mais de plus graves préoccupations
allaient s'imposer à l'attention le déficit énorme laissé par Louis
XV avait encore été augmenté, grâce aux folles prodigalités de la
cour et aux complaisances de Calonne. Une assemblée de notables
est convoquée ; le ministre est congédié ; Brienne, archevêque de
Toulouse, lui succède, mais est bientôt forcé de se retirer. La
cour cède devant les réclamations du Parlement et surtout par la
peur que lui inspirent les agitations de Paris. Necker est rappelé
et l'ouverture des états généraux est fixée au 1er mai
1789. Ils s'ouvrent à Versailles dans la salle des Menus-Plaisirs.
La vérification des pouvoirs amène la question du vote par ordre
ou par tête. La cour envoie des troupes et ferme aux députés du
tiers la salle des séances ; ceux-ci se réunissent au Jeu de paume
et jurent de ne se séparer que lorsqu'ils auront donné à la France
une constitution. La Révolution débutait.
Paris sous la République et le Premier Empire


La Révolution, nous venons de le voir, commença
à Versailles ; mais elle fut bientôt ramenée à Paris, son véritable
théâtre. Les Parisiens, apprenant que le roi rassemblait des troupes,
s'inquiétèrent ; le jardin du Palais-Royal, que le duc d'Orléans
avait récemment dépouillé des beaux marronniers de Richelieu et
entouré d'une enceinte de portiques et de maisons, était devenu
le rendez-vous des nouvellistes et de tout ce qui s'occupait de
politique, c'est-à-dire un véritable forum. Camille Desmoulins monte
sur une table, jette au milieu de cette foule émue un ardent appel
aux armes, et le lendemain (14 juillet 1789), la Bastille est enlevée
; la vieille forteresse des rois, la prison cruelle où 'avait gémi
presque tout ce qui pensait librement, est abattue à ras du sol
un bal public s'établit à la place avec cette inscription Ici l'on
danse ! Avec les pierres se construisit le pont Louis XVI (de la
Concorde). Ce n'est pas assez on apprend que le roi se prépare à
fuir ; le peuple souffre de la faim tandis que la cour enivre, dit-on,
les gardes du corps aussitôt la multitude se lève, court à Versailles
et ramène le roi et sa famille.
« Nous ramenons le boulanger,
la boulangère et le petit mitron, » criaient les femmes de la
halle, comme si la présence du souverain eût dû faire régner l'abondance
dans la capitale. L'Assemblée constituante se transporta aussi à
Paris et siégea d'abord à l'archevêché, puis dans la salle du Manège,
qui occupait l'emplacement de la rue de Rivoli, entre la rue des
Pyramides et la rue Castiglione.
C'est là qu'elle termina ses
grands travaux.

Le 14 juillet 1790, anniversaire de la prise
de la Bastille, fut la plus belle fête de la Révolution. Toute la
France y contribua avec enthousiasme, en envoyant des députés que
les Parisiens se disputèrent l'honneur d'héberger. Depuis quinze
jours, la fête était en quelque sorte commencée. Douze mille ouvriers
n'ayant pas suffi pour édifier les talus qui bordaient le Champ-de-Mars,
mais qui n'existaient pas encore (ils sont aujourd'hui détruits),
toute la population s'était jointe à eux avec une patriotique émulation.
Il n'y eut pas jusqu'aux grandes dames, aux prêtres et aux sœurs
de charité, qui ne vinssent remuer la pelle et pousser la brouette.
Enfin, tout fut prêt pour le grand jour l'autel de la Patrie se
dressait au milieu de la plaine ; l'évêque d'Autun, Talleyrand de
Périgord, y célébra la messe, le roi y prononça le serment de fidélité
à la constitution. Il pleuvait par moments ; le sol n'était que
boue ; qu'importait à ce peuple généreux ? Il avait foi dans l'avenir
; les farandoles, les acclamations, les fanfares de 12,000 musiciens
transportaient toutes les imaginations.
Le 2 avril 1791, une
foule immense et inquiète encombrait la rue de la Chaussée-d'Antin.
Au numéro 42 mourait Mirabeau, dont le corps fut solennellement
porté au Panthéon.
Le 21 juin, tout Paris était encore en rumeur.
Le roi s'était enfui pendant la nuit. Bientôt on le ramenait de
Varennes au milieu du silence des Parisiens, silence plein de reproche
et de dignité. On voyait sur les murs cette affiche « Celui qui
applaudira le roi sera battu ; celui qui insultera le roi sera pendu.
» Ainsi la royauté était à la fois réprimandée et protégée.

Déjà l'Assemblée constituante était dépassée
par des opinions plus hardies. Une pétition pour la déchéance du
roi fut déposée au Champ-de-Mars sur l'autel de la patrie. Dans
le désordre qui accompagna cette manifestation, plusieurs hommes
furent tués. L'autorité municipale intervint à la tête de la garde
nationale et fut accueillie à coups de pierres. Bailly et La Fayette
proclamèrent la loi martiale et firent tirer sur les Parisiens,
dont une trentaine furent tués le 17 juillet. Les souverains de
l'Europe s'étaient coalisés contre la Révolution on leur déclara
la guerre. Le peuple de Paris s'arma de piques et s'organisa en
sections. Le 20 juin 1792, Louis XVI fut forcé de coiffer le bonnet
rouge. Le 10 aout, les Tuileries furent prises d'assaut ; dans cette
dernière journée, le château, défendu par les Suisses, est attaqué
avec l'artillerie par les Marseillais, forcé, envahi, inondé du
sang des soldats étrangers, que quelques gentilshommes indignes
de ce nom (si le fait était prouvé) abandonnèrent lâchement en s'esquivant
par la galerie du Louvre. Pendant ce temps, Louis XVI, retiré à
la salle du Manège, assistait tristement à la séance de l'Assemblée
dans la loge du logographe. Huit jours après, la tour du Temple
recevait dans ses sombres murailles le malheureux monarque avec
sa famille. Il n'en devait sortir que pour monter sur l'échafaud.
Après avoir achevé son œuvre et déclaré qu'aucun de ses membres
ne serait réélu à la prochaine législature, la Constituante se retira.
Les opinions hardies qui commençaient à se faire jour avaient
pour organes les clubs. Celui des Jacobins se tenait au couvent
des Jacobins, à la place qu'occupe actuellement le marché Saint-
Honoré, là fut le siège de cette société qui se ramifiait par toute
la France. Dirigée par Robespierre, ce fut elle qui imprima à la
Révolution sa terrible énergie. Sur l'autre rive de la Seine, la
salle d'étude de théologie du couvent des Cordeliers était le lieu
de réunion du club plus violent encore où Danton et Camille Desmoulins
semaient leurs paroles de feu. Là se trouve aujourd'hui la place
de l'École-de-Médecine. Ce furent les clubs, surtout ce dernier,
qui, au 20 juin, au 10 août, poussèrent le peuple des faubourgs
sur les Tuileries. Alors le pouvoir de l'Assemblée législative s'effaça
devant la dictature révolutionnaire de la Commune de Paris. «
Il faut, avait dit Danton, il faut faire peur aux royalistes. »
C'est la Commune qui se chargea de cette terrible mission. Dans
les premiers jours de septembre, des massacres organisés et soldés
par elle ensanglantèrent les prisons de la Force, de l'Abbaye, du
Châtelet, de la Conciergerie, de Bicêtre et de la Salpêtrière. Étrange
histoire que celle de cette prison de la Force, ancien hôtel qui
eut pour maîtres d'abord des rois de Naples (Charles d'Anjou), de
France (Charles VI), de Navarre, puis des cardinaux ; enfin ce duc
de La Force, dont il a retenu le nom et qui donna des fêtes brillantes
dans les mêmes lieux plus tard habités, avant 1789, par les débiteurs
et les vagabonds, puis par des victimes politiques, et en dernier
lieu par des forçats, terribles hôtes de la fameuse fosse aux lions.
Hôtel et prison ont disparu sous le marteau des démolisseurs.
Après ces déplorables journées d'anarchie, la Convention nationale
ouvrit ses séances, le 20 septembre 1792, le jour même où nos jeunes
conscrits, intrépides sous le feu des Prussiens, signalaient leurs
premières armes par la victoire de Valmy le lendemain 21, la Convention
proclamait la République. Pour consommer la rupture de la France
avec la royauté, elle décréta la mise en accusation de l'infortuné
roi de France. Le 2l janvier 1793, Louis XVI, condamné par la Convention
à la peine capitale, est tiré du Temple par Santerre accompagné
de deux officiers municipaux ; à huit heures et demie dit matin,
il monte dans la voiture du maire avec son confesseur et deux gendarmes
le temps était brumeux, humide et froid ; la voiture suivit le boulevard
au milieu d'une foule immense et silencieuse et d'une double haie
de garde nationale. Arrivé à la place de la Concorde, Louis XVI
monta avec courage sur l'échafaud, et sa tête tomba au bruit d'un
roulement de tambours. Il fut inhumé au cimetière de la Madeleine,
où plus tard la Restauration a fait élever un monument expiatoire.
Sous le règne de Louis XVI, Paris vit s'élever ou se fonder
le couvent des capucins de la Chaussée d'Antin, l'église Saint-Louis,
l'église Saint-Nicolas du- Roule, l'hôpital Beaujon, l'hôpital Necker,
l'hôpital Cochin, l'hôpital des Vénériens, l'hospice Saint-Merri,
l'hospice de La Rochefoucauld, l'École des ponts et chaussées, l'École
des mines, l'École royale de chant et de déclamation, l'Institution
des Sourds-Muets, l'Institution des Jeunes-Aveugles au même règne
remontent les marchés Beauvau, des Innocents, Sainte-Catherine,
la pompe à feu de Chaillot, la pompe à feu du Gros-Caillou, le pont
de la Concorde, d'abord nommé pont Louis XVI plus de soixante-dix
rues furent percées les fossés des anciens remparts furent comblés
on commença à débarrasser les ponts des constructions qui les obstruaient,
et les cimetières furent transportés hors de la ville.
En 1782,
sur la proposition des fermiers généraux, un nouveau mur d'enceinte,
percé d'ouvertures exclusivement destinées à l'introduction des
denrées nécessaires à la consommation des habitants, engloba les
faubourgs. Il fut achevé en 1790 ; il était percé de 55 entrées
ou barrières, avait 28 kilomètres de tour et servit de clôture à
Paris jusqu'en 1860. C'est à propos de cette enceinte que fut écrit
le vers satirique suivant
Le mur murant Paris rend Paris
murmurant.
Après l'exécution du roi, toute la force tomba
aux mains de cette fameuse Commune de Paris qui dirigeait la Convention,
et par elle gouvernait la France entière. Si elle fut violente et
sanguinaire, il faut convenir, en revanche, que c'est d'elle surtout
que partit la résistance opiniâtre au fédéralisme des girondins
; l'idée de l'unité de la France était une idée essentiellement
parisienne; autant les provinces, encore pleines des souvenirs de
leur ancienne indépendance, trouvaient d'attraits au fédéralisme,
autant Paris mettait son honneur à demeurer la capitale d'une grande
république une et indivisible.
Jetons un coup d'œil sur cette
Commune. Avant la Révolution, la municipalité de Paris était composée
du prévôt des marchands, de 4 échevins, de 26 conseillers du roi,
tous pris parmi les plus anciennes familles bourgeoises. Il y avait,
en outre, un procureur et avocat du roi et de la ville, un greffier
en chef, un trésorier, seize quarteniers, soixante-quatre cinquanteniers
et deux cent cinquante-six dizainiers. Sans changer cette organisation,
Necker établit, en 1789, à l'occasion des élections des états généraux,
une division de la ville en 60 districts pour procéder à la nomination
d'un électeur sur 100 individus, payant un cens de deux journées
de travail.
L'assemblée des électeurs, ayant procédé à l'élection
des députés, continua de se réunir malgré les défenses de l'autorité,
et prit le nom d'Assemblée du tiers état de la Ville de Paris. Elle
forma une sorte de petit gouvernement populaire à l'usage de la
ville de Paris, un point de ralliement pour la population parisienne.
C'est à l'Hôtel de ville que s'organisa le mouvement du 14 juillet
1789. Le 16, les électeurs abolissent le titre de prévôt des marchands,
que Flesselles porta le dernier, et y substituent celui de maire
de Paris, donné à Bailly. En même temps, ils organisent la garde
nationale sous le commandement de La Fayette (1).
L'assemblée
des électeurs prit fin le 25 juillet de la même année. On y substitua
une municipalité provisoire, composée de 120 députés des districts,
avec le titre de représentants de la Commune. Cet état de choses
dura près d'un an. Le 27 juin 1790, la base de la représentation
municipale fut changée. Aux 60 districts furent substituées 48 sections.
La municipalité fut composée d'un maire, de 16 administrateurs,
de 32 conseillers et de 96 notables. Enfin, deux ans après, le 10
août 1792, les commissaires des sections, ne jugeant plus cette
municipalité en harmonie avec les nouveaux besoins de la Révolution,
se rendent au nombre de 180 à l'Hôtel de ville, la suspendent, nomment
Santerre commandant de la garde nationale, et obligent l'Assemblée
législative à changer l'organisation municipale. Celle-ci, maintenant
les 48 sections, ordonne que chacune d'elles nommera un membre pour
remplir la charge d'administrateur du département. De cette nomination
et des lois du 30 août et du 2 septembre naquit la célèbre Commune
de Paris, Constitutionnelle sous Bailly, républicaine avec Pétion
pour maire et Danton pour substitut du procureur de la Commune,
démocratique quand Pétion, maire plutôt de nom qu'en réalité subit
l'influence populaire ; enfin ultra-démocratique avec Pache pour
maire, Chaumette pour procureur et Hébert pour substitut. Fleuriot
remplit ensuite les fonctions de maire. S'étant uni avec les triumvirs,
Robespierre, Saint-Just et Couthon, il périt avec eux. Déjà Bailly
et Pétion avaient eu le même sort.
La violente Commune d'Hébert
trouva dans les girondins des adversaires au sein de la Convention.
Ils réussirent à le faire décréter d'arrestation par l'assemblée
; ce fut le signal de l'insurrection qui, la Commune en tête et
précédée par des canons, se porta sur les Tuileries. En effet, depuis
le 10 mai 1793, la Convention avait quitté la salle du Manège et
était venue s'installer dans une vaste salle construite à la place
de la salle de spectacle du palais. Un mot sur cette salle de spectacle
Elle était l'œuvre de Vigarani (1662), et passait pour la plus grande
de l'Europe après celle de Parme. Sept à huit mille personnes pouvaient
y être convenablement placées. Elle occupait toute la largeur de
l'aile du pavillon Marsan d'un mur à l'autre. C'est dans cette vaste
enceinte, où la royauté s'était amusée de fêtes et d'opéras, que
se jouait maintenant le drame formidable de la Révolution. C'est
là que la Convention livra ses grands débats ; c'est là que les
tribunes tremblaient sous les trépignements d'un public pressé et
frémissant.
Tous les comités dont se composait alors le gouvernement
siégeaient aux Tuileries. Le comité de Salut Public se réunissait
dans le pavillon de Flore, alors pavillon de la Liberté. L'insurrection
arrive donc, demandant les têtes des girondins. Ceux-ci veulent
sortir par la place du Carrousel et trouvent les canons pointés
contre eux ; ils rentrent dans la Convention pour entendre leur
arrêt. (Journée du 31 mai.)
Cependant les chefs les plus hardis
de la Révolution allaient disparaitre. Le 13 juillet 1793, à cinq
heures du soir, des cris retentissent au n° 18 de la rue de l'École-de-Médecine.
Charlotte Corday venait d'assassiner Marat. C'est là (1), dans un
cabinet qui donnait sur une petite cour au-dessus du puits, au premier
étage, que le fougueux rédacteur de l'Ami du peuple expia frappé
dans son bain tout le sang qu'il avait fait couler par ses funestes
conseils. Là s'étaient réunis maintes fois Collot d'Herbois, Billaud-Varennes,
Chaumette,Legendre, Saint-Just, Robespierre. Souvent, en se rendant
au club des Cordeliers, Danton, qui demeurait dans le passage du
Commerce, passait chez Marat ou l'appelait de sa voix tonnante au
bas de l'escalier en pierre qui conduisait au pauvre appartement
du journaliste. Danton aussi vit bientôt la fin de sa carrière,
le 5 avril 1794, Robespierre, qui l'envoya à l'échafaud, approchait
également de la sienne. Il la termina par la célébration de la fameuse
fête de l'Être suprême, à laquelle il présida et qui, commencée
aux Tuileries, s'acheva au Champ-de-Mars. Attaqué le 9 thermidor
par les dantonistes et par les débris des girondins, il se réfugie
à l'Hôtel de ville au sein de la Commune, dont Fleuriot était maire.
Le peuple fut appelé à sa défense. De son côté, la Convention fit
marcher ses forces ; elle l'emporta. Le lendemain, Robespierre et
ses compagnons furent conduits à l'échafaud. En passant devant sa
modeste demeure, la maison du menuisier Duplay, rue Saint-Honoré,
no 104 ou 106, il fut insulté par la foule. Aucun supplice n'avait
attiré une aussi grande affluence. En ce jour finit le règne de
la Commune de Paris ; en même temps finissait la période révolutionnaire
qu'on a appelé la Terreur.
L'échafaud, cette arme terrible de
la Révolution, avait d'abord été dressé à la place de Grève, où
se faisaient autrefois les exécutions. C'est là que, le 25 avril
17\)2, on fit la première expérience de la guillotine sur un assassin.
En 1793, l'échafaud fut transporté sur la place Louis XV, alors
place de la Révolution, puis, l'année suivante, à la place Saint-Antoine,
et ramené ensuite à la place de la Révolution pour l'exécution de
Robespierre.
Les thermidoriens prétendirent se montrer cléments
en laissant rentrer quelques émigrés peu de jours après, la bibliothèque
de l'abbaye Saint-Germain- des-Prés est incendiée, la poudrière
de Grenelle saute. Le peuple s'alarme et voit dans ces faits des
preuves de complots royalistes. Il s'insurge, il menace, il demande
du pain « Nous en avions, s'écrie-t-il, sous Robespierre.»-Six cents
femmes se rassemblent à la section des Gravilliers et viennent demander
du pain à la Convention. Elles sont repoussées. Mais un mois après
une insurrection armée s'organise et envahit la Convention nationale.
Boissy d'Analas est menacé ; le député Féraud est tué et sa tête
promenée sur une pique. Son assassin est conduit au supplice ; mais
le peuple le délivre et l'enlève. Alarmée de cette opiniâtreté de
l'insurrection, la Convention fait cerner le faubourg Saint-Antoine
par 30,000 hommes et le menace d'un bombardement.
Après avoir
vaincu la Commune, la Convention eut à vaincre l'autre parti extrême.
Le 13 vendémiaire, un mouvement royaliste éclate ; le général Danican,
commandant les forces des sections, menace les Tuileries avec 36,000
hommes. Barras, chargé de défendre la Convention, s'en remet au
général Bonaparte ; celui-ci n'avait que 8,000 combattants, mais
il disposait de 40 pièces de canon qu'il fit mettre en batterie
au pont Tournant, à la tête du pont Louis XVI, à celle du pont Royal,
au Carrousel, au débouché des rues qui aboutissent aux Tuileries.
À quatre heures du soir, l'armée de Danican attaque les forces conventionnelles.
Bonaparte monte à cheval, fait avancer ses pièces en face de l'église
Saint-Roch et mitraille les insurgés. Les traces, malgré les réparations,
se voient encore sur la façade de l'église.
La Constitution
de l'an III triomphait. La Convention se retira victorieuse. Le
4 brumaire an III (26 octobre 1790), elle déclarait sa mission terminée
elle avait siégé 3 ans 1 mois et 6 jours.
Au milieu d'une guerre
terrible au dedans et au dehors, que de fondations utiles furent
son ouvrage. Les lycées de Paris, alors appelés écoles centrales
; les Écoles normale et polytechnique, la première établie d'abord
à l'amphithéâtre du Jardin des Plantes, d'où elle fut transférée
rue des Postes (aujourd'hui rue Lhomond) ; la seconde au collège
de Navarre, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, où elle est restée;
le musée du Louvre ; le Conservatoire des arts et métiers, rue Sain
Martin, formé sur la proposition de Grégoire ; l'administration
des télégraphes, dont Chappe fut l'inventeur, rue de l'Université
; une foule d'hôpitaux civils et militaires, principalement ceux
de la Pitié et Saint-Antoine, le premier occupé d'abord par les
Enfants de la patrie, orphelins des deux sexes, etc.
Certes,
jamais Paris n'a vécu et ne vivra sans doute d'une vie plus pleine
et plus ardente, mais aussi plus tristement agitée, que pendant
les grands jours de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée législative
et de la Convention.
Le Directoire eut à réprimer la conspiration
de Babeuf et dut sévir contre les royalistes qui travaillaient ouvertement
à la restauration de la monarchie; ensuite eut lieu le coup d'état
du 18 fructidor, à la suite duquel les directeurs Barthélemy et
Carnot, en même temps que 53 députés, furent condamnés à la déportation.
Cette période fut marquée par une extrême corruption des mœurs :
l'amour du plaisir sous toutes ses formes, longtemps comprimé, fit
tout à coup explosion. Bientôt le 18 brumaire renversa le nouvel
état de choses. Sous les beaux jours du Consulat, Paris vit renaître
son ancienne prospérité l'industrie, le commerce, les arts, qui
avaient tant souffert de la tempête révolutionnaire, refleurirent;
de nouvelles constructions s'élevèrent; on démolit la plus grande
partie des maisons de la rue Saint-Nicaise, qui avaient été fort
endommagées par l'explosion de la machine infernale, et à leur place
fut construit le corps de bâtiment qui s'attache au pavillon de
Marsan et qui, longtemps arrêté à la rue de Rohan, fut achevé en
1852. Paris vit alors de grandes fêtes. Telles furent les cérémonies
célébrées dans l'église de Notre-Dame, naguère temple de la Raison
; l'une eut lieu le 18 avril 1802, jour de Pâques, pour le rétablissement
du culte catholique.

L'autre, la plus splendide de toutes par
la magnificence des costumes, l'éclat des uniformes et la richesse
des toilettes des femmes, fut celle du sacre, le 1erdécembre
1804. Enfin, il y eut encore pour Paris des jours d'enthousiasme
à l'occasion des grandes victoires de l'empereur.
On ouvrit
les marchés Saint-Joseph, Saint-Honoré, Saint-Martin, des Blancs-Manteaux,
Saint-Germain, chef-d’œuvre de Blondel, sur l'ancien emplacement
de la foire; des Carmes, à la viande, à la volaille, aux fleurs;
enfin l'entrepôt des vins, quai Saint- Bernard, élevé par Gaucher
sur l'emplacement de l'ancienne halle aux vins, de l'abbaye Saint-Victor,
de la terre d'Aletz et de plusieurs maisons particulières; c'est,
pour l'étendue, une ville de quatrième ordre.
On construisit
les cinq abattoirs Montmartre, Ivry, Popincourt, Vaugirard, du Roule.
On jeta sur la Seine les ponts d'Austerlitz, de la Cité, des Arts,
d'Iéna, celui-ci miné par les Prussiens et que Louis XVIII ne sauva
de la destruction qu'en le baptisant pont des Invalides. En face,
sur la hauteur de Chaillot, où se trouve aujourd'hui le palais du
Trocadéro, construit en 1878, devait s'élever le palais du roi de
Rome. De nombreuses fontaines furent édifiées, entre autres le Château-d‘Eau,
chef-d’œuvre de Gérard. La dérivation des eaux de l'Ourcq vers Paris,
commencée en 1799, fut achevée. L'eau arriva dans le bassin de La
Villette on creusa un canal de la Seine à la Seine, composé de deux
branches l'une se dirigeant vers Saint-Denis, l'autre par les faubourgs
vers les fossés de la Bastille, transformés en gare d'eau. Le trajet
par la Seine était de trois jours ; celui-ci est de huit heures.
On ouvrit les cimetières Montmartre, Vaugirard, Sainte-Catherine
et du Père-Lachaise, ainsi nommé de la maison de campagne du jésuite
confesseur de Louis XIV, qui est enfermée dans son enceinte. 3,000
mètres de quais nouveaux, accompagnés de ports magnifiques dégagèrent
les abords de la Seine. Un quartier superbe s'éleva depuis la rue
de Rivoli jusqu'aux boulevards. Enfin, le palais de la Légion. d'honneur,
ancien hôtel du prince de Salm, brûlé en 1871 et rebâti depuis à
l'aide d'une souscription parmi les légionnaires ; le Palais-Bourbon,
qui avait servi aux séances des Cinq-Cents en 1797, avait été décoré
en 1807 de la belle façade qui regarde le pont, et qui est occupé
aujourd'hui encore par la Chambre des députés, après avoir abrité
le Corps législatif sous le premier et le second empire; le palais
de la Bourse, commencé en 1808; l'arc de triomphe de l'Étoile, commencé
en 1806 par Chalgrin et achevé sous Louis-Philippe; l'arc de triomphe
du Carrousel, élevé en 1806 par Percier et Fontaine ; la colonne
Vendôme, d'où la statue colossale de Napoléon fut renversée en 1814
et remplacée par un drapeau blanc qui a cédé la place, en 1833,
à la statue en redingote et au petit chapeau, exécutée avec un scrupuleux
respect de la tradition historique par M. Émile Seurre.*

Sous le deuxième Empire, la colonne de la
place Vendôme a été surmontée d'un Napoléon en costume d'empereur
romain. Abattu pendant la Commune de 1871, ce monument, élevé à
la gloire de la grande armée à l'aide des canons pris sur l'ennemi,
a été réédifié dans son état primitif. C'est sous le Directoire
et le Consulat que l'organisation municipale de Paris fut fixée
telle qu'elle est demeurée jusqu'en 1860. La ville fut divisée en
l'an IV en douze municipalités, dont l'administration fut confiée
au département de la Seine, composé de 7 administrateurs. La loi
de pluviôse an VIII substitua à ces administrateurs12 maires et
2 préfets, l'un chargé de l'administration du département, et l'autre
de la police. Sous l'Empire et la Restauration, au mode électoral
succédèrent les nominations arbitraires. « Ainsi disparurent dans
la ville de Paris, dit M. Henrion de Pansey, jusqu'aux traces du
régime municipal. »
Le premier préfet de la Seine fut M. Frochot;
il a eu pour premiers successeurs MM. de Chabrol, Alexandre de Laborde,
Odilon Barrot, de Bondi, Rambuteau et Haussmann. Ces deux derniers
ont laissé de très honorables traces de leur magistrature municipale,
en donnant un grand essor aux embellissements de la capitale.
Quand les alliés envahirent la France en 1814, Napoléon, partant
pour les combattre, rassembla la garde nationale parisienne et lui
confia sa femme et son fils. Malgré ses efforts, 200,000 ennemis
arrivèrent sous Paris. Marmont avait ordre de défendre la place
jusqu'à son arrivée. Les Parisiens couraient aux armes et couvraient
les redoutes qui protégeaient le nord de la ville. Les invalides,
les élèves des Écoles d'Alfort et polytechnique, 40,000 gardes nationaux
organisés, joints à 20,000 hommes de troupes régulières, contraignirent
l'ennemi d'engager toutes ses réserves. Telle fut la journée du
30 mars, glorieuse, pour Paris. Mais la trahison livra la ville
le lendemain, à midi, l'empereur de Russie et le roi de Prusse y
firent leur entrée, par la barrière Saint-Martin, à la tête d'un
brillant état-major et de 50,000 hommes d'élite. Des courtisans
sans pudeur et des femmes de cour éhontées embrassaient les genoux
des soldats étrangers ou leur jetaient des fleurs. Un petit nombre
d'émigrés précédaient les alliés dans leur marche, agitant des drapeaux
blancs et criant Vivent les Bourbons ! Le peuple accueillit cette
manifestation avec une sombre tristesse. Le lendemain, le conseil
municipal de Paris déclarait qu'il renonçait à toute obéissance
envers Napoléon, et, le 2 avril, le Sénat proclamait sa déchéance.
Le 12, le comte d'Artois, frère de Louis XVIII, entrait dans Paris
; le roi y était reçu solennellement le 30 et ratifiait le traité
qui enlevait à la France ses conquêtes et la réduisait à ses limites
de janvier 1792.
Un an après, le 20 mars 1815, Napoléon reparaissait
en maitre aux Tuileries ; le 1er juin, il réunissait
au Champ de-Mars les députés des départements, des gardes nationales
et de l'armée. Mais la journée de Waterloo détruisait à tout jamais
ses espérances. Il rentra cependant à Paris et occupa l'Élysée-Bourbon,
abdiqua une seconde fois et se retira à la Malmaison. Le 3 juillet,
Davout capitule malgré les cris de rage de l'armée et du peuple.
Louis XVIII remonte le 8 aux Tuileries. Des fenêtres il voit les
Cosaques qui bivouaquent dans la cour du Carrousel ; il voit le
Louvre dévalisé ; il voit les grandes dames de sa cour former avec
les barbares soldats du Nord des rondes infâmes.
Paris sous la Restauration.
Le nouveau règne fut tristement inauguré
par deux exécutions politiques, celles du colonel Labédoyère et
du maréchal Ney, regardées comme les représailles du meurtre du
duc d'Enghien. Tandis que la terreur blanche régnait au dehors,
la tranquillité de la capitale ne fut pas troublée pendant les premières
années du règne de Louis XVIII ; après la vie agitée de la Révolution,
les guerres sanglantes de l'Empire, qui avaient enlevé aux familles
le plus généreux de leur sang, on aspirait au repos ; on avait besoin
de calme. Malgré les fautes des conseillers de Louis XVIII, qui
restauraient l'ancien régime, aucun désordre grave ne s'était encore
manifesté, lorsque le duc de Berry fut assassiné par Louvel, le
13 février 1820, au sortir de l'Opéra. Le meurtrier avait cru mettre
fin à la branche ainée des Bourbons ; mais, le 29 septembre, la
duchesse de Berry accouchait d'un fils qui, sous le nom du duc de
Bordeaux, devait être l'héritier présomptif du trône, et qui est
mort sans avoir régné le 24 aout 1883. Du 30 mai au 9 juin, des
troubles graves eurent lieu à l'occasion de la loi électorale ;
le gouvernement accrut l'irritation en voulant la réprimer par la
force, et la lutte parlementaire s'établit surtout en 1823. La majorité
de la Chambre des députés alla jusqu'à ordonner l'expulsion de Manuel,
l'orateur populaire et le plus hardi de l'opposition, tandis que
le peuple frémissait d'indignation au triste spectacle de l'exécution
des quatre sergents de La Rochelle, victimes d'un entrainement libéral
qui était commun à toute la France, et pour lesquels on avait espéré
un sursis, une commutation de peine.

Louis XVIII, accablé d'infirmités, mourut
en 1824, aux Tuileries. On crut d'abord que Charles X, son successeur,
saurait conquérir et conserver une popularité nécessaire au repos
de la France ; mais ce roi se vit bientôt entouré et circonvenu
par un parti rétrograde qui lui fit commettre faute sur faute la
désaffection vint, et bientôt les hostilités du parti libéral recommencèrent.
Charles X avait aboli la censure, et cette mesure avait excité dans
Paris un enthousiasme immense effrayé du terrain qu'elle perdait,
la camarilla s'empara de l'esprit du roi, et, en 1825, Paris assistait
avec un étonnement railleur à la procession du jubilé, cérémonie
empruntée par l'esprit clérical aux pratiques du passé, que, dans
l'intérêt même de la religion, on n'aurait pas dû tenter dans une
grande cité comme Paris, où l'élément voltairien dominait. Les funérailles
du général Foy (1825), représentant du pur libéralisme, furent encore
pour le peuple de Paris une occasion de faire comprendre à la royauté
dans quelle voie dangereuse elle s'engageait. Les ministres, loin
de, tenir compte de l'esprit public, sévirent contre la presse ils
annoncèrent une loi restrictive de cette liberté, ironiquement qualifiée
de loi de justice et d'amour, et ils la présentèrent.
L'Académie
française, les journaux, les imprimeurs, les libraires réclamèrent
énergiquement contre cette mesure; cette fois, on la retira Mais,
le 28 avril 1827, le roi passa en revue au Champ-de-Mars la garde
nationale de Paris, qui fit entendre des cris hostiles au ministère
A bas les ministres à bas les jésuites ! Charles X déclara qu'il
était venu recevoir des hommages et non des leçons. La garde nationale
fut dissoute. La même année, Paris voit les funérailles de Manuel,
de Stanislas Girardin et de La Rochefoucauld- Liancourt. Béranger
expie en prison les élans libéraux de sa muse ; mais il peut du
fond de son cachot entendre au loin ses refrains dans lesquels le
peuple trouve à la fois des souvenirs de gloire, une consolation
à ses souffrances et des espérances pour l'avenir.
Le 20 novembre,
des troubles éclatèrent à propos des élections ; le quartier Saint-Martin
en fut le principal théâtre. Il fallut enlever des barricades rue
Grenéta et au passage du Grand- Cerf. C'était le prélude des journées
de juillet. Le 26 juillet 1830, des ordonnances attentatoires à
la liberté de la presse et aux lois électorales donnent lieu à une
agitation immense qui dégénère bientôt en insurrection.
Le premier
fait d'armes du peuple pour défendre ses droits fut l'enlèvement
du poste de l'Hôtel de ville. Maitres de ce point, les vainqueurs
s'y maintinrent avec un courage héroïque contre les Suisses et plusieurs
autres régiments soutenus par quatre pièces d'artillerie. D'ailleurs,
ils furent secourus par des bandes venues des faubourgs. L'une de
celles-ci, arrivant par les quais de l'Archevêché, se vit arrêtée
au pont suspendu par la mitraille des royalistes. On hésitait un
jeune homme de dix-sept ans s'élance un drapeau tricolore à la main
« Mes amis, s'écrie-t-il, suivez-moi, je vais vous montrer comment
on brave les feux de l'ennemi. Si je succombe, je m'appelle d'Arcole.
» Et il court planter son drapeau au milieu du pont. Il tomba frappé
à mort, mais son exemple avait entrainé les citoyens le pont fut
franchi au pas de charge et la colonne victorieuse déboucha sur
la place de Grève. Le nom d'Arcole fut donné au pont qui avait été
le théâtre de son courageux dévouement. Ceci se passait le 28 juillet.
Le lendemain, 29, fut installé à l’Hôtel de ville une sorte de gouvernement
provisoire présidé par le général Dubourg.

Dans cette même journée, le Louvre fut emporté
d'assaut par les citoyens armés, à la tête desquels s'était placé
le général Gérard. Ce fut un combat meurtrier. Les Suisses et la
garde royale défendirent avec acharnement ce dernier boulevard de
la monarchie légitime. Les victimes tombées du côté du peuple furent
ensevelies au pied de la colonnade du Louvre, où leurs restes demeurèrent
dix années. En 1840, on les transporta dans les caveaux creusés
sous la colonne de Juillet, sur laquelle on grava leurs noms ; une
inscription d'une grande simplicité rappelle la destination de ce
monument. Sur le faite se dresse une statue dorée représentant le
génie de la Liberté ayant brisé les fers du despotisme et éclairant
le monde du flambeau de la liberté, le 9 aout, le duc d'Orléans
est proclamé roi dans une réunion de deux cent cinquante-deux députés
et prend le titre de roi des Français, tandis que le vieux roi Charles
X suivait tristement sur la route de Cherbourg, avec toute sa famille,
le chemin de l'exil.
Les quinze années de paix dont jouit la
France pendant les deux Restaurations, de 1814 et de 1815, favorisèrent
le développement matériel de la prospérité publique dans Paris.
La plus grande partie des travaux d'embellissement et d'assainissement
commencés sous l'Empire furent continués ou achevés ; le régime
des prisons et des hospices reçut des améliorations notables ; à
partir 1819 pour l‘éclairage des rues, on employa le gaz hydrogène
En 1823, on estimait le nombre des rues de Paris à 1,070, outre
120 culs-de-sac et 70 places.
Parmi les institutions et établissements
nouveaux fondés dans la capitale vers la même époque, citons la
Caisse d'épargne (1818) l'École des beaux-arts (1819); l'École des
chartres (1821); le Musée des antiquités égyptiennes (1827) École
centrale des arts et manufactures (1828) les églises Notre-Dame-de-Lorette
(1823) Saint-Vincent- de-Paul (1824); les collèges Saint-Louis(1820),
sur l'emplacement de l'ancien collège d'Harcourt; Stanislas (1822);
Rollin (1823); les théâtres du Gymnase-Dramatique, des Nouveautés,
etc., etc., la salle de l'Opéra, rue Lepelletier (1821); la salle
Ventadour (Théâtre-Italien), les ponts des Invalides, de l'Archevêché
et d'Arcole (1827). On décora les églises de statues et de tableaux
une nouvelle statue équestre de Henri IV fut placée sur le terreplein
du Pont-Neuf. Ajoutons encore le séminaire de Saint-Sulpice (1820)
; la chapelle expiatoire de Louis XVI (1826), et l'église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle,
et nous aurons dressé le bilan des embellissements de Paris sous
la Restauration.
Paris sous Louis-Philippe

Sous Louis-Philippe, Paris vit des insurrections,
le terrible choléra et aussi des fêtes. Le 13 février 1831, il voit
flotter sur les flots de la Seine les livres, chasubles, mitres,
objets de culte arrachés à l'archevêché et à Saint-Germain-l'Auxerrois.
Une manifestation légitimiste dans cette église avait provoqué l'émeute.
Le 27 mars 1832, le choléra morbus, fléau jusque-là inconnu, faisait
irruption dans la capitale, où l'on compta jusqu'à 1,000 victimes
par jour. En juin de la même année, le canon foudroie les républicains
du cloître Saint-Merri, et en avril 1834 ceux de la rue Transnonain.
Les attentats régicides se succèdent avec une déplorable furie.
Tandis qu'à la Chambre des députés et dans la presse une lutte acharnée
éclate entre les modérés et les libéraux, le sang est versé dans
les duels politiques, et Paris entier assiste aux funérailles d'un
homme de bien, Armand Carrel (24juillet 1836), tombé victime d'une
de ces luttes sacrilèges.
Mais voici que tout un peuple
court au Champ-de-Mars, c'est la joie qui l'y conduit il va voir
les fêtes célébrées en l'honneur du mariage du duc d'Orléans. Hélas
! la joie se change en deuil ; on s'étouffe au sortir du Champ-de-Mars,
de nombreuses victimes restent sur la place.

On compara ce désastre à celui du mariage
de Louis XVI, et quelques-uns y virent un présage funeste. Quatre
ans après, l'église Notre-Dame se revêt de tentures funèbres, le
duc d'Orléans, sur lequel les plus sages comptaient pour rallie
tous les partis, s'est tué sur la route de Neuilly en sautant de
sa voiture pour échapper à ses chevaux emportés. Avec lui périt
l'espoir de la dynastie, car que d'années séparent le vieux roi
de son petit-fils, le comte de Paris.
Entre ces deux deuils,
Paris en avait eu un autre qui avait plutôt le caractère d'une fête
les cendres de Napoléon Ier, furent apportées, le 15
décembrc 1840, sous le dôme des Invalides, où un tombeau devait
être élevé pour les recevoir Louis- Philippe avait confié au duc
de Joinville, l'un de ses fils, le soin de ramener aux bords de
la Seine les restes du proscrit de Sainte-Hélène. Le monument est
achevé aujourd'hui par l'art et la main d'un grand architecte, Visconti,
et d'un grand sculpteur, Pradier. Douze Victoires, taillées d'un
seul jet dans le granit et ne faisant qu'un avec les piliers massifs
qui portent le temple même, veillent sur l'urne de porphyre qui
contient le corps embaumé de Napoléon lcr.
Chose étrange sous
le règne pacifique de Louis- Philippe, Paris fut cuirassé pour la
guerre. Une immense enceinte fortifiée, précédée d'un système de
forts détachés, l'entoura complètement. Depuis bien longtemps, Paris
n'avait plus de fortifications, 1815 rendait la précaution plausible.
On sait trop qu'elle ne servit à rien et qu'elle n'empêcha pas en
1871 les hordes germaniques d'assiéger, de bombarder et d'affamer
la capitale, dont elles ne souillèrent d'ailleurs, par leur courte
présence, qu'une minime partie.
Cependant, le triste rôle que
joua la France en 1840 dans les affaires d'Orient ; plus tard l'indemnité
Pritchard et des scandales publics, où se trouvèrent malheureusement
mêlés des hommes appartenant de près ou de loin ait gouvernement,
réveillèrent l'agitation politique qui s'était graduellement apaisée
depuis 1830. Le gouvernement, ne s'appuyant que sur une classe,
la bourgeoisie censitaire, était profondément discrédité. Ce fut
alors que l'opposition commença sa campagne par les banquets pour
la réforme électorale, présidés par les députés, mais propagés sous
l'influence prédominante du parti républicain. Un banquet de ce
genre, qui devait avoir lieu à Paris, près, de l'avenue des Champs-Élysées,
et auquel le gouvernement crut devoir s'opposer, donna aux mécontents
l'occasion de se compter et d'entraîner l'opinion.

Le 22 février, des bandes de gardes nationaux,
d'ouvriers et d'étudiants parcourent la ville aux cris de Vive la
Réforme ! A bas Guizot ! Après deux jours de lutte, le 24 février,
la monarchie était de nouveau renversée et la République, à la surprise
du plus grand nombre, fut proclamée. Quant au roi Louis-Philippe,
après avoir essayé une abdication tardive et inutile en faveur de
son petit-fils le comte de Paris, il se retira en Angleterre, où
il mourut trois ans après.
Louis-Philippe fit moins bâtir des
édifices nouveaux qu'achever ou réparer les anciens, la Madeleine,
l'arc de triomphe de l'Étoile, l'Hôtel de ville, l'église Saint-Vincent-de-Paul,
le palais d'Orsay, la décoration de la place de la Concorde. Il
fit commencer l'agrandissement du Palais de justice, la restauration
de Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle, construire la fontaine Molière,
les ponts Louis-Philippe et du Carrousel ; ouvrir les musées des
Thermes et de l'hôtel Cluny.
Sous ce règne, malgré les agitations
incessantes des premières années, l'industrie et le commerce firent
de grands progrès un nombre considérable d'usines et de manufactures
importantes furent fondées dans les faubourgs les vieilles boutiques
commencèrent faire place à des magasins éblouissants de luxe et
de richesse ; plus de 4,000 maisons furent construites de 1831 à
1848 la double ligne des quais fut complétée, la Cité déblayée des
bouges qui l'occupaient ; les abords de l'Hôtel de ville furent
en partie dégagés, ainsi que ceux des Halles, les prisons de la
Roquette et de Mazas furent construites.
Enfin le redressement
et l'alignement des rues (notamment la rue de Rambuteau) portèrent
dans des quartiers obscurs et malsains le jour et la santé. Le puits
artésien de Grenelle, dont l'eau jaillit de 547 mètres de profondeur,
fut destiné à alimenter les bornes-fontaines de la rive gauche.
Les gares des chemins de fer, surtout celle du chemin de fer de
Strasbourg, furent de nouveaux monuments pour l'ornement comme pour
l'utilité de la ville.
Paris sous le seconde République

Le 24 février, Louis-Philippe, abandonné
par la bourgeoisie parisienne, pour laquelle il avait tant fait,
avait abdiqué vers midi, pendant qu'on se battait encore sur la
place du Palais-Royal ; puis, après bien des hésitations, protégé
par quelques régiments, il avait pu partir avec sa famille sans
être poursuivi ni inquiété. Pendant ce temps, la duchesse d'Orléans,
accompagnée du jeune duc de Nemours, s'était rendue avec ses enfants
à la Chambre des députés. En vain Odilon Barrot et Dupin essayèrent-ils
de poser la question de la régence ; Ledru-Rollin et Lamartine proposèrent
l'établissement d'un gouvernement provisoire qui fut ainsi composé
Lamartine, Dupont (de l'Eure), Arago, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès,
Crémieux et Marie, auxquels furent adjoints comme secrétaires d'abord,
ensuite comme collègues, Louis Blanc, Flocon, Armand Marrast et
Albert.
A peine constitué et installé à l'Hôtel de ville, le
gouvernement provisoire proclamait la République, décrétait la formation
des 24 bataillons de garde mobile et ouvrait aux ouvriers sans travail
ces funestes ateliers nationaux dont la fermeture devait quelques
mois plus tard occasionner la terrible insurrection de juin. Pendant
qu'une commission, chargée de s'occuper du sort des travailleurs,
siégeait au Luxembourg sous la présidence de Louis Blanc et proclamait
le droit aux travail, Lamartine, pour rassurer l'Europe, déclarait
dans un manifeste que la République ne menacerait personne, mais
qu'elle empêcherait toute intervention ayant pour objet de comprimer
les réclamations légitimes des peuples, et Arago faisait décréter
l'émancipation des noirs de nos colonies.
Cependant, une vive
agitation, entretenue par 237 clubs et 140 journaux, régnait dans
les esprits et faisait craindre une lutte nouvelle. Le 16 mars,
les compagnies d'élite de l'ancienne garde nationale firent en corps
une manifestation à l'Hôtel de ville le lendemain, les corporations,
ouvrières, les délégués du Luxembourg, les ateliers nationaux organisèrent
une contremanifestation dans laquelle défilèrent plus de 120 000
personnes. Le 16 avril fut signalé par une manifestation socialiste
60 000 hommes, partis du Champs-de-Mars, se dirigèrent vers l'Hôtel
de ville dans le but de substituer un comité de Salut public au
gouvernement provisoire ; la garde nationale, avec l'aide de la
garde mobile, dispersa la colonne des clubistes. Le 2l avril, la
fête de la Fraternité parut réunir pour un moment et confondre tous
les esprits dans un commun désir de paix et de réconciliation.

Le 4 mai, la première Assemblée française
nommée par le suffrage universel se réunissait au Palais- Bourbon,
proclamait solennellement la République et confiait le pouvoir à
une commission exécutive de cinq membres Arago, Garnier-Pagès, Marie,
Lamartine et Ledru-Rollin. Mais la confiance était loin de renaitre,
et l'envahissement de l'Assemblée nationale au 15 mai accentua encore
la sourde mésintelligence qui s'était élevée entre le peuple remuant
de Paris et les représentants, et ces troubles, qui avaient eu pour
prétexte une pétition en faveur de la Pologne et que la garde nationale
put réprimer encore, étaient le triste prélude de désordres plus
graves.
Dans les premiers jours de juin, l'Assemblée nationale,
au lieu de se ranger du côté de ceux qui étaient d'avis de procéder
avec prudence et méthode au licenciement des ateliers nationaux
dont tout le monde avait reconnu le danger, parut vouloir adopter
le parti proposé par Monsieur de Falloux, comme plus radical et
plus énergique, c'est-à-dire en ordonner la dissolution immédiate
et jeter sur le pavé, sans ressources et sans pain, 100 000 travailleurs.
C'était allumer la guerre civile. En effet, à la nouvelle du
vote probable de la dissolution des ateliers nationaux, qui constituaient
une puissante armée de prolétaires possédant des armes, des chefs
et une véritable discipline, les têtes s'exaltèrent ; aux mécontents
que cette mesure atteignait si cruellement, puisqu'elle les jetait
eux et leur famille dans la misère absolue, se joignirent les messieurs
des clubs et les agents bonapartistes et légitimistes. Le 22 juin,
des barricades s'élèvent tout à coup avec une étonnante rapidité
dans les faubourgs et occupent bientôt la moitié de Paris. La commission
exécutive n'avait à sa disposition qu'une vingtaine de mille hommes
de la ligne, la garde mobile et une partie de la garde nationale.
Le général Cavaignac, qui était ministre de la guerre depuis le
18 mai, refusant d'adopter le plan de la commission exécutive, qui
consistait à combattre l'insurrection à mesure qu'elle se manifestait,
laissa, au contraire, la ville se hérisser de barricades qui s'étendaient
en demi-cercle depuis le clos Saint-Lazare sur la rive droite jusqu'au
Panthéon sur la rive gauche. Au début, l'insurrection n'avait ni
chef ni plan arrêté. Elle prit pour centre la place de la Bastille
et eut pour objectif de converger vers l'Hôtel de ville. Dans la
journée du 23, on ne lui opposa d'autres forces que. la garde mobile
et la garde nationale ; le soir seulement, le général Cavaignac
engagea quelques troupes. La nuit interrompit un instant le combat,
qui recommença le lendemain avec furie. En présence de ces évènements,
l'Assemblée nationale proclama l'état de siège et concentra tous
les pouvoirs entre les mains de Cavaignac. Maître absolu du gouvernement,
celui-ci sortit enfin de son apathie et agit avec une énergie terrible.
Le 25 au matin, le faubourg Saint-Antoine restait seul au pouvoir
des insurgés. C'est là que s'était rendu la veille l'archevêque
de Paris, Denis Affre, dans l'espérance d'arrêter l'horrible effusion
de sang humain qui, depuis trois jours, rougissait les rues de la
capitale. Le prélat avait pénétré dans le faubourg par la grande
barricade qui en masquait l'entrée et avait été accueilli avec sympathie.
Mais à peine avait-il prononcé quelques paroles que le feu, un instant
éteint, recommençait de nouveau et que l'archevêque tombait, frappé
d'une balle
Dans la nuit du 25 au 26, des négociations furent
entamées ; mais le général Cavaignac refusa d'accorder aux insurgés
la capitulation qu'ils demandaient la lutte recommença et se termina
par la prise et l'occupation du grand faubourg. Les lugubres journées
de juin coutèrent à la France 12 000 morts parmi les insurgés, et
le nombre des arrestations s'éleva à près de 20 000. On eut à déplorer
la perte de 8 généraux, parmi lesquels nous nommerons le général
Bréa et le général Négrier ; un grand nombre de soldats succombèrent
aussi dans cette guerre fratricide. La République sortit singulièrement
affaiblie de cette lutte affreuse, bien que dans les deux camps
on criât Vive la République.

La révolution de Février, en envoyant en
exil les membres de la famille d'Orléans, avait ouvert les portes
de la France à ceux de la famille Bonaparte.
L'Assemblée nationale
avait établi pour bases du gouvernement nouveau une Assemblée unique
et un président de la République, élu par le suffrage universel.
Le 10 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier,
était élu président de la République par plus de 5 000 000 de voix,
tandis que le général Cavaignac, son concurrent, en obtenait à peine
1 500 000.
Le nouveau président s'empressa de prêter serment
à la Constitution. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif
s'entendirent d'abord tout le temps qu'il s'agit de comprimer les
partis extrêmes ; ainsi, une tentative d'émeute, organisée le 29
janvier 1849, échoua devant les mesures prises par le général Changarnier.
Aux termes de la nouvelle Constitution, une Assemblée législative
avait été élue et s'était réunie le 28 mai 1849. Elle renfermait
dans son sein un grand nombre de partisans des régimes déchus. Le
13 juin, en apprenant qu'une armée française était envoyée en Italie
sous le commandement du général Oudinot pour faire rentrer Rome,
qui avait proclamé la République, sous le pouvoir papal, les députés
républicains, ayant Ledru-Rollin à leur tête, proposèrent la mise
en accusation du président et de ses ministres et descendirent dans
la rue ; mais ce mouvement fut aussitôt comprimé. La session de
1850 fut marquée par la loi du 31 mai qui mutilait le suffrage universel
et rayait 3 000 000 d'électeurs.
Durant cette année et pendant
les onze premiers mois de 1851, la tranquillité matérielle ne fut
pas troublée à Paris; mais un conflit s'était élevé entre l'Assemblée
et le président. Ce conflit devait se terminer par le coup d'État
du 2 décembre. Le 7 novembre, les questeurs de l'Assemblée avaient
présenté un projet de décret qui investissait le président de l'Assemblée
du droit de requérir directement la force armée pour veiller à la
sûreté de la représentation nationale ; cette proposition fut repoussée
et ajourna à quinze jours le dénouement du drame. Le 26 novembre,
le général Magnan fit part à tous les généraux de son armée des
projets de coup d'État et leur demanda leur concours ; le 1er
décembre, cet acte était décidé, et les proclamations furent portées
à l'Imprimerie nationale, dont personne ne put sortir jusqu'à ce
que tout fût terminé ; le Palais législatif fut occupé par surprise,
et le 2 décembre, au matin, les chefs des différents partis de l'Assemblée
étaient arrêtés chez eux et jetés à Mazas.

Paris se réveilla au frémissement de la grande
nouvelle et lut sur les murs le décret qui dissolvait l'Assemblée
nationale, rétablissait le suffrage universel, convoquait le peuple
français dans ses comices et mettait Paris en état de siège. En
même temps paraissaient une proclamation au peuple français et une
autre à l'armée. Cependant un petit nombre de représentants, après
avoir tenté inutilement de se réunir au Palais législatif, se rendirent
à la mairie du Xème arrondissement (aujourd'hui le VIIème),
s'y constituèrent en assemblée, décrétèrent la déchéance du président
et nommèrent le général Oudinot commandant de l'armée de Paris mais
des troupes nombreuses ne tardèrent pas à les envelopper les uns
furent conduits à la prison Mazas, d'autres au Mont-Valérien ou
à Vincennes; la plupart, toutefois, furent mis en liberté après
quelques jours de détention. Le 3, un certain nombre de représentants
et de républicains déterminés essayèrent sans succès d'organiser
la résistance au faubourg Saint-Antoine, et une frêle barricade
fut construite, c'est là que le représentant Baudin tomba foudroyé
par une balle. À partir de ce moment, l'agitation grandit et acquit
des proportions considérables. Des rassemblements se formaient de
toutes parts et prenaient d'heure en heure, dans les quartiers du
centre surtout, une attitude plus menaçante. Entre les boulevards,
la rue du Temple, la rue Saint-Denis et les quais, dans ce fouillis,
inextricable en ce temps-là, de rues populeuses, étroites, tortueuses,
éminemment favorables à la guerre de barricades, on commençait à
rencontrer des groupes armés, rares encore, mais pleins d'audace.
Sur la rive gauche de la Seine, l'agitation avait gagné le faubourg
Saint-Marceau. À Belleville, Madier de Montjau et Jules Bastide
réussissaient à déterminer un commencement de résistance. Mais cette
résistance fut bientôt comprimée. Pourtant de nouvelles tentatives
se produisirent dans la matinée du 4 décembre et des combats acharnés
furent livrés dans la rue Saint-Denis, dans la rue de Rambuteau
et dans le faubourg Saint-Martin.
Dans la rue Montorgueil tomba,
frappé de deux balles, Denis Dussoubs, qui, par une héroïque usurpation,
s'était revêtu de l'écharpe de son frère, représentant de la Haute-Vienne.
Toutefois, de tous les épisodes des journées de décembre, il
n'en est pas qui aient laissé une impression plus profonde que ceux
qui eurent pour théâtre les boulevards Bonne-Nouvelle, Poissonnière,
Montmartre et des Italiens. Nous en empruntons le récit abrégé à
l'ouvrage de M. Eugène Ténot :

« Le 4 décembre, à trois heures, les troupes stationnaient ou défilaient lentement, avec des haltes fréquentes, sur les boulevards. La foule qui les entourait était surtout curieuse, mais cependant en général peu sympathique des cris hostiles au président se faisaient entendre sur quelques points souvent aussi des rires moqueurs, des lazzis à l'adresse des soldats. Ceux-ci, très excités contre la population, s'exagérant sans doute le degré de son hostilité, l'esprit hanté par le souvenir de la terrible « guerre des fenêtres » en juin, s'imaginaient être sous le coup d'une agression subite ; il est certain qu'ils supposaient les maisons garnies d'ennemis invisibles prêts à faire feu ; ils se croyaient environnés d'embûches, ils étaient dans un de ces états de surexcitation nerveuse où les hommes gardent difficilement leur sang-froid. Cet état mental des soldats massés le 4 décembre sur les boulevards était-il aggravé par des causes physiques, des excès de nourriture et de boisson ? On l'a dit avec tant d'insistance que le gouvernement a cru devoir le démentir dans son organe officiel. Les dispositions des troupes étant telles, on s'explique naturellement ce qui arriva, ce qui a été d'ailleurs raconté par des témoins oculaires des coups de feu sont tirés vers la tête de colonne, boulevard Bonne-Nouvelle ; les premiers pelotons ripostent, criblant de balles les fenêtres ; la masse est frappée comme d'une commotion électrique. Plus de doute pour les soldats, c'est la guerre des croisées qui commence. Et, peloton par peloton, ils font feu les uns après les autres sur les groupes qui stationnent, sur les spectateurs des balcons et des fenêtres, criblant de balles ces ennemis imaginaires. Vainement la plupart des officiers, ceci a été constaté par un grand nombre, essayent-ils d'arrêter cet entrainement. Pendant un quart d'heure, c'est un véritable ouragan de feu et de plomb depuis le boulevard Bonne-Nouvelle jusqu'à celui des Italiens. « Quelques minutes après la première décharge, rapporte M. William Jesse, officier anglais qui assistait à cette horrible fusillade, des canons furent braqués et tirés contre le magasin de M. Sallandrouze. La foule se précipita, frappée d'épouvante, vers les portes des maisons, vers les débouchés des rues adjacentes, en proie à une terreur trop légitime. La grêle des balles s'abattit, en partie, sur ces groupes effarés. On les vit se courber sous l'ouragan, tomber sur les trottoirs, sur le seuil des portes. Beaucoup aussi furent frappés aux fenêtres et dans l'intérieur des appartements par les balles qui ricochaient contre les murs. »

Dès le 5 décembre, le triomphe de Louis-Napoléon
était assuré. La Constitution républicaine de 1848 était déchirée
par celui-là même qui avait juré de la défendre. Il est vrai que,
quelques semaines plus tard, il prétendit « n'être sorti de la légalité
que pour rentrer dans le droit. » Quoi qu'il en soit, les lambeaux
du pacte gisaient à terre rougis du sang de 380 citoyens et de 181
soldats, d'après les constatations officielles.
Pendant les
journées qui suivirent le coup d'État, de nombreuses arrestations
furent opérées dans Paris. Un décret exila momentanément les généraux
Bedeau, Changarnier, Lamoricière et Leflo; MM. Duvergier de Hauranne,
Baze, Thiers, Rémusat, etc. un grand nombre de représentants du
peuple républicains furent désignés pour la transportation à Cayenne
ou exilés. Vers la fin de décembre furent organisées, par une circulaire
ministérielle, les fameuses commissions mixtes, que l'on a quelquefois
comparées aux cours prévôtales de la Restauration, et qui jugèrent
et condamnèrent à l'exil ou à la déportation les accusés sans les
entendre. Dufaure devait plus tard flétrir ces magistrats trop dociles
du haut de la tribune française. Conformément à la proclamation
du 2 décembre, le scrutin pour le plébiscite s'ouvrit ; le résultat
donna 7 439 246 oui et 640 737 non. Ainsi la France acceptait la
Constitution proposée par le président de la République et lui conférait
le pouvoir pour dix ans. C'était un acheminement au rétablissement
de l'Empire. En effet, un sénatus consulte le proposa bientôt ;
il fut adopté par les comices populaires le 21 et le 22 novembre.
Le 2 décembre 1852, l'Empire était solennellement proclamé.
Durant cette courte période de moins de quatre années si remplie
d'évènements, l'embellissement de la capitale continua: l'hospice
Louis-Philippe, aujourd'hui l'hôpital de La Riboisière, fut terminé;
la bibliothèque Sainte-Geneviève s'éleva sur les ruines du vieux
collège Montaigu; les travaux de l'église Sainte-Clotilde furent
poursuivis avec ardeur. Citons encore l'achèvement des réparations
de la Sainte-Chapelle, la continuation de celles de Notre-Dame l'érection
de plusieurs nouvelles mairies, les alignements des anciennes rues,
le percement d'un très grand nombre de nouvelles, au premier rang
desquelles il nous faut placer le prolongement de la rue de Rivoli
et d'autres travaux entrepris ou terminés.
Paris sous Napoléon III

Le nouvel empereur prit le nom de Napoléon III. La nation, avide de repos et de tranquillité, accepta sans grande peine la suppression de presque toutes les libertés politiques ; un désir immense de bienêtre et de jouissance s'empara des masses. L'activité de tout un peuple parut se porter vers les conquêtes de l'industrie et celle des richesses qui en dérivent. Le gouvernement donna aux travaux publics une activité qui, en dix ans, renouvela presque les grandes villes, mais aussi surexcita la spéculation et amena des désastres. Paris, sous l'administration du nouveau préfet de la Seine, M. Haussmann, fut comme rebâti sur un plan nouveau et grandiose, Le Louvre s'achève et va rejoindre les Tuileries; le pavillon de Flore est reconstruit le Musée restauré reçoit de nouveaux chefs-d’œuvre et voit s'ouvrir de nouvelles galeries, les places s'élargissent ou se transforment en squares et en jardins, des voies et des avenues nouvelles s'ouvrent, des quartiers entiers aux rues étroites et mal famées, aux maisons insalubres, tombent sous le marteau des démolisseurs, laissant partout pénétrer l'air et la lumière ; des cités ouvrières s'élèvent ; la rue de Rivoli prolongée va rejoindre la rue Saint-Antoine, une caserne monumentale, de splendides habitations qui étalent sur leurs façades les mille caprices de l'architecture de l'époque, bordent son parcours ; les Halles centrales s'achèvent ; un nouveau marché du Temple est construit ; le canal Saint-Martin, vouté sur une longueur de 1,800 mètres ; le boulevard Voltaire, qui s'appela d'abord boulevard du Prince-Eugène, est ouvert ; les boulevards de Strasbourg, de Sébastopol, du Palais et Saint-Michel traversent Paris du nord au sud ; on supprime d'affreuses ruelles qui se cachaient dans la partie occidentale de la place de l'Hôtel-de-Ville pour les remplacer par l'avenue Victoria, qui fait communiquer cette place avec celle du Châtelet, dotée de la fontaine de la Victoire et de deux grands théâtres ; l'hôtel de la Banque reçoit de nouveaux agrandissements, tandis que dans son voisinage s'élèvent le nouvel hôtel du Timbre, une caserne modèle et la Mairie du IIIème arrondissement (aujourd'hui le II ème) la Bibliothèque nationale restaurée laisse voir, du côté de la rue Vivienne, sa charmante façade Louis XIII ;

non loin de là, la place Louvois est transformée
en square un nouvel Opéra est construit, autour duquel les rues
Auber, Scribe, etc., bordées d'hôtels luxueux comme des palais,
qui offrent aux étrangers toutes les délicatesses d'un élégant confort;
la large avenue de l'Opéra met ce superbe édifice en communication
directe avec le Théâtre-Français; de nouvelles églises, celles de
la Trinité, rue Clichy, de Saint-André, dans la cité d'Antin, de
Saint-Eugène, sur la limite du IXème et du Xème
arrondissements, sont élevées; la vieille tour Saint- Jacques-la-Boucherie
est rendue à l'air et à la lumière. La Cité, cet antique berceau
de Paris, voit se continuer les embellissements commencés sous le
règne du roi Louis-Philippe et disparaitre ces ruelles fangeuses,
refuge du vice et de la déhanche, pour faire place au tribunal de
commerce et à une caserne monumentale. La vieille basilique de Notre-Dame,
dégagée de la forêt d'étais et d'échafaudages qui la cachaient aux
yeux de tous, réapparait habilement restaurée et rajeunie, disposée
à braver encore bien des siècles ; la Sainte- Chapelle, débarrassée
des archives poudreuses de la justice, élance dans les airs sa belle
flèche dorée et fleurdelisée, tandis que le Palais de justice étale
aux quatre points cardinaux ses nouvelles façades.
Nos vieux
ponts, le Pont-Neuf lui-même, sont réparés ou reconstruits, et leurs
trottoirs, rendus praticables, offrent de belles promenades; le
pont d'Iéna n'est plus isolé et a vu s'élever dans son voisinage
deux nouveaux ponts, ceux de l'Alma et de Solférino ; le pont au
Change a été rebâti et placé dans l'axe du boulevard de Sébastopol.
De nouveaux égouts, entre autres le grand égout collecteur,
sont construits ; les anciens sont assainis ou élargis; enfin, grâce
à l'écluse monumentale de la Monnaie, la Seine voit le bras de sa
rive gauche devenir navigable, et son lit, autrefois si souvent
desséché pendant l'été hors des atteintes des rayons du soleil.
Les quais, redressés et garnis de trottoirs, s'embellissent de plantations.
Dans cette fièvre de constructions nouvelles, les plaisirs ne
sont pas oubliés les anciens théâtres sont restaurés et de nouveaux
s'élèvent, tandis qu'aux Champs-Élysées, dont les fossés sont supprimés
et les abords remaniés, le Palais de l'Industrie, aux dimensions
colossales, chasse du carré Marigny, que l'on appelait autrefois
le carré des Fêtes, le peuple et ses bruyants plaisirs. Au bois
de Boulogne et au bois de Vincennes, changés en beaux parcs, jaillissent
d'abondantes cascades qui alimentent une rivière aux bords gazonnés.

Au Champs-de-Mars, aplani et nivelé, l'École-Militaire
s'est agrandie. De la Madeleine part un nouveau boulevard, celui
de Malesherbes, qui aboutit à la Seine. Un autre, partant de l'ancienne
barrière Monceaux, en traversant la plaine du nord-est au sud-ouest,
gagne le parc de Neuilly. La place de l'Étoile est transformée et
embellie ; elle devient le point central de réunion de 12 boulevards
ou avenues.
La rive gauche, quoique moins bien partagée que sa
voisine, a sa part dans ce mouvement général : la rue des Écoles
s'achève ; les abords du Luxembourg et du Panthéon s'embellissent;
la gare du chemin de fer de l'Ouest orne un des boulevards les plus
oubliés autrefois, tandis que la rue de Rennes, aux larges dimensions,
vient la mettre en communication avec le centre du faubourg Saint-Germain
le boulevard Saint-Germain décrit un immense arc de cercle qui s'appuie
d'un côté au pont Sully et de l'autre au pont de la Concorde, en
traversant tout le faubourg Saint-Germain ; l'église Sainte-Clotilde
est livrée au culte; le palais des Beaux-Arts agrandi ; le musée
de Cluny, le palais des Thermes sont restaurés. Le boulevard Saint-Marcel
unit le boulevard de l'Hôpital à la rue Mouffetard, tandis que le
boulevard de Port-Royal fait communiquer cette vieille rue complètement
rebâtie avec le carrefour de l'Observatoire ; le boulevard Arago
débouche sur la place Denfert- Rochereau. Enfin, un grand nombre
de voies nouvelles sont ouvertes et plusieurs anciennes prolongées
la rue Monge, la rue Gay-Lussac, la rue des Feuillantines, la rue
de Médicis, etc., etc. Nous n'en finirions pas, si nous voulions
énumérer ici toutes les transformations que la ville a subies pendant
les dix-huit années qu'a duré l'Empire. Nous en reparlerons d'ailleurs
plus loin, en faisant la description de Paris. Rappelons toutefois
le bois de Boulogne transformé, le Jardin zoologique d'acclimatation
créé; le bois de Vincennes métamorphosé en parc à l'instar du bois
de Boulogne; le parc Monceau ouvert au public; la colline du Trocadéro
transformée d'abord en un triste amphithéâtre de verdure, qui depuis
a fait place à l'immense palais édifié pour l'exposition de 1878;
le parc de Montsouris commencé ; les travaux du puits artésien de
Passy achevés ; les eaux de la Dhuis et de la Vanne amenées à Paris;
l'Hôtel-Dieu reconstruit; de spacieux abattoirs généraux et un marché
central de bestiaux établis à La Villette. Pendant que s'opéraient
ces splendides, mais couteuses transformations, qui d'ailleurs ont
fait de la capitale de la France la plus belle ville du monde, l'opinion
publique sommeillait et la politique chômait ; aussi l'historien
n'a-t-il à noter, durant la plus grande partie de ce règne, que
peu d'évènements remarquables, relatifs à Paris. Les dernières années
seules attireront spécialement notre attention.

En 1853, le 30 janvier, le mariage de Louis
Bonaparte avec la comtesse espagnole Eugénie de Montijo était célébré
à Notre-Dame avec une pompe extraordinaire.
Un an après, le
16 janvier 1854, le gouvernement créait la caisse du service de
la boulangerie pour prévenir, en cas de disette, la trop grande
élévation du pain à Paris.
Le 28 avril 1855, au moment où il
passait à la hauteur du Château-des-Fleurs, vers 5 heures du soir,
Napoléon III était l'objet d'une tentative d'assassinat de la part
d'un Italien nommé Pianori l'empereur ne fut pas atteint. Pianori,
arrêté, déclara qu'il n'avait pas de complices, qu'il avait voulu
venger sa patrie amoindrie par Napoléon Bonaparte ; il fut condamné
à mort et exécuté. Le 15 mai de la même année s'ouvrit au Palais
de l'Industrie une exposition universelle ; elle inaugurait ces
luttes pacifiques du travail, les seules pour lesquelles les peuples
devraient utiliser leurs forces.
Elle dura jusqu'au 16 octobre.
En 1854, l'empereur qui, avant d'être couronné, avait dit « L'Empire,
c'est la paix, » avait néanmoins, de concert avec l'Angleterre,
déclaré la guerre à la Russie qui menaçait d'envahir les possessions
de la Turquie. La flotte anglo-française était entrée dans la mer
Noire, tandis qu'une armée se rassemblait sous les murs de Constantinople.
Le 14 septembre 1854, la victoire de l'Alma avait permis de commencer
le siège de Sébastopol qui ne fut pris que le 8 septembre 1855.
La paix fut signée à Paris le 30 mars 1856. Avant cette date, c'est-à-dire
le 29 décembre 1855, avait eu lieu, au milieu des réjouissances
publiques, l'entrée solennelle à Paris de la garde impériale et
de plusieurs régiments de ligne revenant de Crimée.
Le 16 mars
1856, le prince impérial naissait cet évènement sembla devoir consolider
la dynastie napoléonienne; il fut célébré par des fêtes, notamment
sur la place de l'Hôtel de Ville que l'on élargissait alors.

Le 3 janvier1857, l'archevêque Sibour était
assassiné dans l'église Saint-Étienne-du-Mont par un prêtre interdit
nommé Verger. Un peu plus d'un an après, le 14 janvier 1858, avait
lieu l'attentat d'Orsini contre la vie de l'empereur, lequel, accompagné
de l'impératrice, se rendait à l'Opéra où devait avoir lieu une
représentation extraordinaire. Au moment où la voiture impériale
s'engageait dans le passage réservé, trois détonations terribles,
provenant de l'explosion de bombes fulminantes, éclatèrent coup
sur coup. Ni l'empereur ni l'impératrice n'avaient été atteints,
quoique la voiture eût été criblée de projectiles. Orsini avait
trois complices, dont un seul, nommé Pieri, fut exécuté en même
temps que lui. Cet attentat, dans lequel 156 victimes avaient été
tuées ou blessées, servit de prétexte pour frapper de nouveau le
parti démocratique 2,000 personnes suspectes de républicanisme furent
jetées en prison, et, peu après, en vertu de la loi de sureté générale
; que s'empressa de voter le Corps législatif, plus de 400 républicains
étaient transportés en Algérie. Le 24 février 1858, un décret du
gouvernement proclamait la liberté de la boucherie à Paris, et,
le 8 mai, le Corps législatif votait une loi sur les grands travaux
de la capitale par laquelle il était stipulé que 180 millions seraient
consacrés à l'ouverture ou à l'achèvement des grandes voies de communication.
Une autre loi, du 28 mai 1859, portait jusqu'aux fortifications
les limites de Paris, à partir du 1er janvier 1860. Entre
temps, la guerre avait été déclarée à l'Autriche, qui, en dépit
des efforts de la diplomatie européenne, avait passé le Tessin le
29 avril. Les victoires de Magenta et de Solferino terminèrent celle
guerre ; la paix, signée à Villafranca, fut confirmée plus tard
par le traité de Zurich, et, le 28 août 1859, les troupes de l'armée
d'Italie firent à Paris une entrée triomphale.
Jusqu'en 1863,
nous n'avons rien à signaler le 30 juin de cette année, la liberté
de la boulangerie fut décrétée, et la loi qui remettait aux municipalités
le soin de fixer la taxe du pain fut suspendue.
Le 1er
avril 1867 s'ouvrit au Champ-de-Mars une grande exposition universelle
à cette occasion, la capitale reçut la visite de plusieurs souverains,
notamment du sultan, du roi de Prusse et de l'empereur de Russie.
Ce dernier fut l'objet d'une tentative d'assassinat, au bois de
Boulogne, de la part d'un jeune Polonais nommé Bérézowski, que le
jury de la Seine condamna aux travaux forcés à perpétuité.
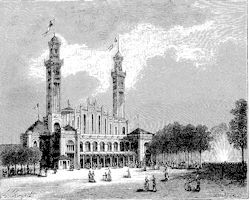
En juin 1868, une loi plus libérale permit
l'ouverture de nombreuses réunions publiques. L'opinion, si longtemps
endormie, commençait à se réveiller elle se souvint du représentant
du peuple Baudin, tué le 3 décembre 1851, à la barricade du faubourg
Saint-Antoine, et une imposante manifestation eut lieu sur sa tombe,
au cimetière Montmartre, le 2 novembre de cette année. L'année suivante,
le 23 mai, les élections pour le Corps législatif donnèrent à Paris,
aux candidats de l'opposition, une majorité considérable. Le meurtre
de Victor Noir (10 janvier 1870), à Auteuil, par le prince Pierre
Bonaparte, occasionna une émotion extraordinaire, et l'enterrement
de la victime provoqua une manifestation immense, à laquelle prirent
part plus de 100,000 Parisiens.
Le 7 février, l'arrestation
de M. Henri Rochefort, dont le pamphlet la Lanterne flagellait chaque
semaine l'Empire et ses serviteurs, fut suivie d'une tentative d'insurrection
aussitôt réprimée.
A tous ces signes et à d'autres encore, le
gouvernement comprit que c'en était fait du pouvoir personnel ;
aussi un sénatus-consulte du 20 avril 1870 propos a-t-il au peuple
français la transformation de l'Empire autoritaire en Empire libéral.
Le 8 mai 7 300 000 citoyens répondirent oui. Paris, lui, avait
donné une grande majorité hostile au gouvernement, qui pourtant
se crut affermi par cc vote.
Cette croyance trompeuse et funeste
l'engagea bientôt à déclarer à la Prusse cette guerre folle qui
devait conduire la France au bord de l'abîme. On sait quelle fut
l'origine ou plutôt le prétexte de cette lutte sanglante que la
France a provoquée, mais que la Prusse a voulue et en vue de laquelle
elle organisait depuis un grand nombre d'années la plus formidable
machine de guerre que le monde eût encore vue.
Au mois de juin
1868, une révolution précipitait du trône d'Espagne la reine Isabelle
; alors se produisit la candidature à la couronne de ce pays du
prince Léopold de Hohenzollern, parent du roi de Prusse. L'entente
s'étant faite définitivement à la fin de juin 1870, le gouvernement
français déclara à la tribune du Corps législatif qu'il s'y opposerait
« sans hésitations et sans faiblesse. » Notre ambassadeur à Berlin,
M. Benedetti, reçu par le roi Guillaume aux eaux d'Ems, demanda
que celui-ci donnât au prince de Hohenzollern l'ordre de renoncer
ait trône d'Espagne.

Le roi répondit qu'il ne pouvait accéder
à ce désir, ajoutant néanmoins qu'il approuverait la renonciation
du prince Léopold si celui-ci consentait à la faire. Le gouvernement
français ne se contenta pas de cette réponse, et M. Benedetti fut
chargé d'insister. Le 12 juillet, le prince allemand avait donné
la renonciation exigée et toute cause de conflit paraissait écartée,
lorsque l'ambassadeur français demanda au roi de Prusse de promettre
d'interposer son autorité dans le cas où le prince Léopold reviendrait
sur sa décision. Guillaume, alors, refusa catégoriquement.
Dans
la séance du 15 juillet, 14I. Émile Ollivier et Monsieur de Grammont
présentèrent ces négociations sous un jour injurieux pour la France.
M. Benedetti reçut l'ordre de revenir à Paris, et, malgré l'énergique
opposition de M. Thiers et de quelques-uns de ses collègues, il
fut décidé que la guerre serait déclarée à la Prusse.
Le ministère
impérial, M. Émile Olivier en tête, venait de déchaîner sur son
pays « d'un cœur léger les horreurs de la plus épouvantable guerre
qu'on ait jamais vue, en y associant une majorité servile et aveugle
».
Le 19 juillet, le chargé d'affaires de la France à Berlin
remettait au gouvernement du roi Guillaume une note dénonçant la
guerre. Pendant que, sur les boulevards, des bandes salariées poussaient
le cri « À Berlin ! » la population parisienne assistait morne et
inquiète au départ de l'armée. L'empereur lui-même s'empressa de
quitter la capitale, en laissant la régence à l'impératrice, et
se rendit à Metz où se trouvait le quartier général impérial.