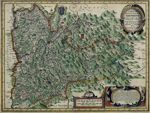Le Dauphiné

Le Dauphiné fut jadis occupé par les tribus gauloises
des Allobroges, les Segovellaunes, les Voconces et les Tricastins. La
capitale de l'époque était alors Vienne. Grenoble (Cularo) n'était qu'un
point de passage pour franchir l'Isère. Le pays des Allobroges fut conquis
par les Romains bien avant l'expédition de César en Gaule. Il fut incorporé
à la province narbonnaise. Vienne fut érigée en colonie romaine et devint
une des cités les plus importantes de Gaule. Les premières traces du
Christianisme dans la province remontent au IIème siècle.
Les groupes de chrétiens se trouvaient alors essentiellement à Vienne.
Ils s’étendirent à l’ensemble du Dauphiné au IVème siècle.
Le plus connu des prédicateurs fut Saint Marcellin. Il fonda un évêché
à Embrun en 350
Le Dauphiné connut diverses invasions. Wisigoths
et Alains pillèrent de nombreuses cités (Valence, Montélimar…). Les
Burgondes s'installèrent dans la région en 442, et choisirent Vienne,
qui gardait son prestige de grande cité romaine, pour capitale. Vers
740, ce furent les Sarrasins qui firent de nombreuses incursions dans
la région. Grenoble eut à souffrir de lourds pillages.Au traité de 843,
la région se trouva intégrée au royaume de Lothaire. En 955, elle passe
à Charles de Provence. En 863, à la mort de ce dernier, Lothaire II
impose son autorité sur le comté de Vienne, mais quand il meurt (869)
Charles le Chauve et Louis le Germanique se partagent ses possessions
au traité de Meerssen (870), par lequel le comté de Vienne revient à
Charles. Celui-ci se proclama empereur en 875, à la mort de Louis II
d'Italie. Mais à la mort de son fils, Boson, gouverneur de Vienne, se
fit proclamer roi de Bourgogne. Avec le royaume de Provence se forma
alors le royaume d’Arles et de Vienne qui demeura indépendant jusqu’en
1032, date à laquelle il fut intégré au Saint-Empire romain germanique.
Cependant, l’éloignement du suzerain favorisa l’établissement de la
féodalité. Apparut alors dans la région une foule de petits États laïcs
et ecclésiastiques. La formation du Dauphiné fut alors l’œuvre des comtes
d’Albon, plus tard Dauphins de Viennois, qui eurent l’habileté de réunir
peu à peu sous leur autorité toutes les seigneuries voisines de leurs
domaines respectifs.
Ces comtes parvinrent en effet, au milieu du
chaos de la féodalité, à s’élever au-dessus des autres seigneurs et
à acquérir la supériorité sur la région. Leur histoire commence de manière
certaine en 1040 sous le règne de Guigues Ier le Vieux, seigneur
d'Annonay, qui possédait en outre Cheyssieu et le Champsaur. Sa puissance
augmenta considérablement lorsqu’il acquit une partie du Viennois, le
Grésivaudan et l'Oisans. L'empereur Conrad lui donna également le Briançonnais
tandis qu'Humbert, premier comte de Savoie recevait la Maurienne. La
Savoie et le Dauphiné se formèrent côte à côte. Celui-ci était alors
un État indépendant, faisant partie du Saint-Empire romain germanique.
À cette époque, les comtes prirent une décision importante pour l’unité
du royaume. En effet, ils choisirent Grenoble, ville de médiocre importance
en ce XIème siècle, pour capitale. Ils auraient pu céder
à la tentation de Vienne, l’ancienne métropole romaine. Ce choix fondamental
leur a cependant permis de garantir leur autorité à la fois sur le Bas
et le Haut-Dauphiné. Cependant, les territoires respectifs du Dauphiné
et de la Savoie se chevauchaient à cette époque (ainsi le Faucigny appartenait
au premier tandis que la seconde possédait Voiron et la Côte-Saint-André).
Cet enchevêtrement fut source de nombreux conflits entre les deux peuples.
Au XIIème siècle, les comtes d'Albon prirent le titre de
dauphins de Viennois. Le comté d'Albon prit alors le titre de Dauphiné.
Le dernier dauphin indépendant, Humbert II, parvint à assurer la paix
avec les savoyards. Il agrandit d’autre part la province avec l'acquisition
de Romans. Il tenta également sans succès de substituer son autorité
sur Vienne à celle de l'archevêque. Il créa d'autre part le Conseil
delphinal en 1337 ainsi que l'université de Grenoble. Il établit également
en 1349 le Statut Delphinal, sorte de Constitution garantissant les
libertés des Dauphinois.
 Toutefois, le dauphin prit goût à la vie
fastueuse et dépensa des sommes considérables, jusqu'à ne plus pouvoir
s'acquitter de ses dettes. Il se trouva d'autre part sans héritier,
son fils étant mort à l'âge de deux ans. Philippe VI tire alors profit
de cette situation et suite à de nombreux et longs pourparlers, le dauphin
céda le Dauphiné au royaume de France le 30 mars 1349, par le traité
de Romans, habilement négocié par son protonotaire, Amblard de Beaumont.
En contrepartie, le fils du roi de France devait dorénavant prendre
le titre de dauphin et la France reconnaître l’autonomie de la province. La cérémonie officielle a lieu à Lyon le 16 juillet
1349. Humbert remet à Charles de Normandie (le futur Charles V le Sage)
le sceptre, la bannière, l'anneau et l’ancienne épée du dauphin. À cette
époque, Humbert II portait également les titres de « prince du Briançonnais,
duc de Champsaur, marquis de Cézanne, comte de Vienne, d'Albon, de Grésivaudan,
d'Embrun et de Gapençais, baron palatin de La Tour, de la Valbonne,
de Montauban et de Mévouillon, qu'il transmet également à la France.
Dès lors, le Dauphiné est réservé à l'héritier du trône de France. Charles
V résida quelques mois à Grenoble et visita son nouveau territoire.
D'autre part, cette annexion entraîna la création des États du Dauphiné.
Cependant, à cette époque, le Dauphiné n'avait pas encore sa forme définitive.
Le Valentinois et le Diois étaient indépendants, la Savoie détenait
de nombreux territoires en Bas-Dauphiné, Vienne appartenait à l'archevêque
et à Grenoble même, l'autorité était partagée avec l'évêque de la cité.
La province recouvrait également des territoires extérieurs (le Faucigny,
Oulx, La Valbonne, Cézanne, Château-Dauphin). En 1355, un traité avec
la Savoie permit au Dauphiné de reprendre Voiron et la Côte-Saint-André
en l'échange du Faucigny. D'autre part, en 1378, le gouverneur occupa
Vienne et se fit prêter hommage pour le Valentinois (annexion définitive
avec le Diois en 1423).
Toutefois, le dauphin prit goût à la vie
fastueuse et dépensa des sommes considérables, jusqu'à ne plus pouvoir
s'acquitter de ses dettes. Il se trouva d'autre part sans héritier,
son fils étant mort à l'âge de deux ans. Philippe VI tire alors profit
de cette situation et suite à de nombreux et longs pourparlers, le dauphin
céda le Dauphiné au royaume de France le 30 mars 1349, par le traité
de Romans, habilement négocié par son protonotaire, Amblard de Beaumont.
En contrepartie, le fils du roi de France devait dorénavant prendre
le titre de dauphin et la France reconnaître l’autonomie de la province. La cérémonie officielle a lieu à Lyon le 16 juillet
1349. Humbert remet à Charles de Normandie (le futur Charles V le Sage)
le sceptre, la bannière, l'anneau et l’ancienne épée du dauphin. À cette
époque, Humbert II portait également les titres de « prince du Briançonnais,
duc de Champsaur, marquis de Cézanne, comte de Vienne, d'Albon, de Grésivaudan,
d'Embrun et de Gapençais, baron palatin de La Tour, de la Valbonne,
de Montauban et de Mévouillon, qu'il transmet également à la France.
Dès lors, le Dauphiné est réservé à l'héritier du trône de France. Charles
V résida quelques mois à Grenoble et visita son nouveau territoire.
D'autre part, cette annexion entraîna la création des États du Dauphiné.
Cependant, à cette époque, le Dauphiné n'avait pas encore sa forme définitive.
Le Valentinois et le Diois étaient indépendants, la Savoie détenait
de nombreux territoires en Bas-Dauphiné, Vienne appartenait à l'archevêque
et à Grenoble même, l'autorité était partagée avec l'évêque de la cité.
La province recouvrait également des territoires extérieurs (le Faucigny,
Oulx, La Valbonne, Cézanne, Château-Dauphin). En 1355, un traité avec
la Savoie permit au Dauphiné de reprendre Voiron et la Côte-Saint-André
en l'échange du Faucigny. D'autre part, en 1378, le gouverneur occupa
Vienne et se fit prêter hommage pour le Valentinois (annexion définitive
avec le Diois en 1423).
Pendand la Guerre de Cent Ans, la noblesse
dauphinoise prit part aux évènements, notamment lors des batailles de
Poitiers et d'Azincourt. La province fut également un enjeu de lutte.
Profitant en effet de l'anarchie du royaume de Charles VII, le duc de
Savoie Amédée IV et le prince d'Orange Louis de Chalon, de connivence
avec les Bourguignons et les Anglais, projetèrent d'envahir le Dauphiné
en 1430. Cependant, lors de la bataille d'Anthon en juin 1430 les troupes
dauphinoises, largement inférieures en nombre, remportèrent une victoire
écrasante face aux troupes du prince d'Orange. La province fut sauvée,
l’invasion échoua. Cependant, à cette époque, la population eut à souffrir
des incursions des Grandes compagnies, routiers et autres mercenaires.
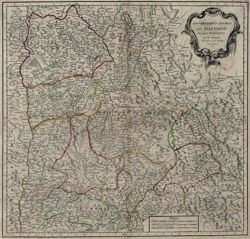
Louis XI fut le seul dauphin de France à résider dans sa province et à la gouverner faisant de cette période son école du pouvoir. Ce fut véritablement sous son autorité que le Dauphiné s'intégra à la Couronne. À son arrivée, c'était encore un petit État archaïque, où les affrontements entre familles féodales (les Commiers, les Allemans…) demeuraient fort récurrents. En arrivant en 1447, il se comporta en véritable souverain et renforça le pouvoir jusque là purement nominal du royaume de France. Il interdit les guerres privées entre féodaux et obligea les nobles à lui rendre hommage. D'autre part, il simplifia l'administration territoriale qui était alors un véritable puzzle de fiefs. Il transforma également le Conseil Delphinal en Parlement qui fut le troisième du Royaume après ceux de Paris et Toulouse. Il entreprit par la suite l'unité politique du Dauphiné. Après s'en être pris aux nobles, il força l'archevêque de Vienne à lui prêter serment. Il en fit de même avec les évêques de Grenoble et Valence et l'abbaye de Romans. Il acquit également Montélimar et la principauté d'Orange. Il développa en outre l'économie et l'industrie de la province, fit réparer les voies de communication, institua des foires commerciales dans différentes villes, encouragea l'exploitation des mines, du fer. Il attira également la main d'œuvre étrangère, prit la communauté juive sous sa protection et créa l'université de Valence pour attirer des intellectuels. Néanmoins, il chercha également à attaquer les libertés reconnues par le Statut Delphinal en instaurant par exemple la gabelle, alors inexistante dans la province. Il leva également d'autres impôts sans consulter les États, entraînant de vifs mécontentements. Finalement, face à la rébellion de plus en plus marquée de son fils à son égard, Charles VII envoya en 1456 une armée en Dauphiné pour chasser Louis XI du pouvoir. Ce dernier s'enfuit alors en Bourgogne. Le roi reprit alors l'administration de la province en main. Il souhaitait qu'on lui prête serment. Les États parlementèrent, sachant que leur autonomie était en jeu. Mais Charles VII insista et les États s'inclinèrent en 1457. Ils prêtèrent le serment demandé, marquant la fin de l'autonomie provinciale. Une fois encore, la noblesse dauphinoise participa activement aux conflits militaires du royaume c’est ainsi que trois cents d'entre eux combattirent à Marignan. Elle acquit alors une gloire immense mais fut terriblement décimée, ce qui lui valut le titre « d’écarlate de la noblesse française ».

Le plus célèbre de ses représentants fut
Pierre
Terrail de Bayard, chevalier Bayard (1476-1524), le « chevalier sans
peur et sans reproche », né au château de Bayard à Pontcharra. De nombreux
conseillers dauphinois participèrent également à l'administration des
territoires italiens conquis par les troupes françaises. Par sa situation
géographique, le Dauphiné fut également une étape et un cantonnement
militaire sur la route de l'Italie. À cette occasion Charles VIII, Louis
XII et François Ier vinrent régulièrement séjourner à Grenoble. Cependant,
le passage des armées fut une lourde charge pour la population, qui
connut également les pillages de la part des soldats. Parmi les gouverneurs
du Dauphiné au XVIème siècle, Gaston de Foix-Nemours (1509) s'illustrera
par la suite comme capitaine des armées d'Italie et Antoine de Bourbon-Vendôme
(1562), roi-consort de Navarre et père du futur Henri IV, remplacé à
sa mort (1562) par le duc de Nemours. Le Dauphiné a beaucoup souffert
du conflit entre Protestants et Catholiques en tant que foyer important
du protestantisme en particulier dans le Haut-Dauphiné. Le Gapençais
fut gagné par la nouvelle religion, tout comme Die, Corps, Mens ou la
Mure, qui devinrent des centres du protestantisme. D'importants noyaux
se formèrent également dans les grandes villes Grenoble, Vienne, Valence….
En 1562, le duc de Savoie Emmanuel-Philibert prit les armes contre les
calvinistes, qui dévastaient le midi de la France et menaçaient ses
États. Il nomma Charles de La Forest, baron de Rumilly, lieutenant général
en Dauphiné. À la tête d'un corps de troupes, ce dernier combattit François
de Beaumont, baron des Adrets, le chef le plus habile et le plus sanguinaire
du parti protestant, mais « fut tué les armes en mains, sous les murs
de Vienne, dans une rencontre avec les huguenots l’an 1565 ». Le
baron des Adrets se signala par ses cruautés et ses dévastations. Les
églises en particulier souffrirent de ses exactions. Il anéantit ainsi
nombre de chefs d’œuvre de l’art du Moyen Âge. À Grenoble, il fit détruire
les tombeaux des Dauphins et pilla la cathédrale. L’abbaye de Saint-Antoine
et la cathédrale Saint-Maurice de Vienne eurent elles aussi beaucoup
à souffrir et portent toujours les traces de leurs mutilations. En 1572,
lorsque la nouvelle du massacre de la Saint-Barthélemy se répandit,
elle provoqua de nouvelles exactions (août-octobre 1572). Toutefois,
le lieutenant général du roi Gordes protégea les protestants, limitant
le nombre de victimes dans la région. À partir de 1575, Lesdiguières
devint le chef unique des huguenots dans la région. Il parvint à défendre
Corps, à s’emparer de Gap mais il ne put empêcher la prise de la Mure
par les catholiques. Il s’empara également de Montélimar et d’Embrun.
L’accession d’Henri IV au royaume lui permet de s’allier à La Valette,
gouverneur du Dauphiné, et Ornano, Lieutenant-général de la province.
Ils durent cependant affronter la Ligue catholique. Ces derniers s’emparèrent
de Grenoble. Lesdiguières vint faire le siège de la ville et au bout
d’un mois d’escarmouches, il s’empara de la capitale dauphinoise en
1590. Briançon et Crest avaient déjà signé leur reddition, Vienne, la
dernière, le fit en 1591. Il devint le maitre de toute la province.
Les guerres étaient désormais finies mais elles avaient laissé le pays
épuisé et couvert de ruines. L’édit de Nantes donna aux protestants
des places de sûreté où ils pouvaient entretenir une garnison (Gap,
Briançon, Embrun, Grenoble, Die…). Lesdiguières fut reconnu par Henri
IV comme gouverneur du Dauphiné, devenant le maître incontesté de la
province, installé dans son hôtel particulier au bord de l'Isère. On
l’appelait le « petit roi dauphin ». Lors de la guerre entre le roi
de France et le duc de Savoie, Lesdiguières remporta de nombreuses victoires
sur les Savoyards. En 1591, il les battit à Pontcharra. En 1597, il
s’empara de fort Barraux tout juste construit par les Savoyards. Pendant
la construction, il disait alors : « Le roi a besoin d’un fort en cet
endroit ; je le prendrai sans canons, sans siège, et sans qu’il en coûta
un écu ». Il tint sa promesse. Il fut également un excellent administrateur.
Il agrandit considérablement Grenoble en construisant une nouvelle enceinte,
commença la construction de la Bastille, fit creuser un nouveau lit
pour le Drac, construire le Pont Lesdiguières. Son plus bel héritage
reste le château de Vizille qu’il fit construire pour son propre intérêt.
Il fit également refaire les voies de communication. À sa mort en 1626,
c'est son gendre Charles II de Créquy qui reprit la gouvernance et la
lieutenance général du Dauphiné. Des troupes nombreuses traversèrent
la province en 1628 pour se rendre en Italie. Une fois encore, l’armée
commit une foule de déprédations dans le Briançonnais. Le pays eut beaucoup
de mal à s’en relever. Cette année marque également la dernière réunion
des États du Dauphiné. C’est la fin des libertés delphinales : les impôts
seront payés désormais sans l’assentiment des représentants du pays.
C’est un signe du progrès de l’Absolutisme.
La révocation de l'édit
de Nantes en 1685 provoque le départ d'environ 20 000 protestants, ce
qui affaiblit l'économie dauphinoise, déjà fortement mise à mal par
les guerres d'Italie, de religion, et de celles du Roi-Soleil. Quelques
vallées, notamment celle du Queyras, virent leur population diminuer
de moitié. Grenoble perdit 3 000 habitants à elle seule. Il y eut des
mesures de rigueur contre les faux convertis et nombre de leurs biens
furent confisqués. Malgré les interventions des évêques de Grenoble
et Vienne pour mettre un terme à ses persécutions, les condamnations
demeurèrent jusqu’au XVIIIème siècle. En 1692, Victor-Amédée II de Savoie,
partie prenante de la Ligue d'Augsbourg contre la France de Louis XIV
envahit le Dauphiné par la région de Barcelonnette à la tête d'une armée
de 40 000 hommes. Gap, Embrun furent ruinés. Les troupes savoyardes
furent repoussées en Provence par Philis de La Charce. Le traité d’Utrecht
de 1713 modifia la frontière de la province du côté du Piémont ; la France
gagnait Barcelonnette et sa vallée mais perdait Oulx, Cézanne et Château-Dauphin,
soit environ les deux tiers du Briançonnais. Le XVIIIème siècle fut une
période de prospérité et de croissance économique pour le Dauphiné,
dont la bourgeoisie, qui en récolta les fruits, fut à la tête du mouvement
de contestation qui aboutit à la Révolution. L’industrie se développa
: ganterie de Grenoble, toiles de Voiron, draps de Romans, filatures
et tissage de la Soie dans la vallée du Rhône. Le commerce aussi est
actif ; des foires importantes se tinrent à Grenoble, Romans et Beaucroissant.
Le 21 août 1787, la province fut la première à réclamer la tenue des
États généraux. Le tournant décisif eut lieu l’année 1788. L’activité
économique de Grenoble dépendait alors fortement de son Parlement. Face
à la menace royale de chasser les parlementaires de la ville, la population
prit fait et cause pour les défendre. Il s’agit de la Journée des Tuiles
du 7 juin 1788. Suite à cet évènement se tint l'Assemblée de Vizille,
qui obtint la tenue des États généraux pour l'année suivante. La révolution
est en marche. Les députés dauphinois Antoine Barnave et Jean-Joseph
Mounier furent alors des acteurs importants de la Révolution française.
La deuxième réunion des États eut lieu le 9 septembre à Romans. La Grande
Peur sévit particulièrement dans le Bas-Dauphiné. Arrivant de Franche-Comté
et de Bourgogne, elle fut violente dans le Viennois (Bourgoin-Jallieu,
Crémieu, la Tour-du-Pin, les Terres Froides). Bourgoin en fut le centre
et de là, le mouvement gagna tous les environs. Le calme revint le 7
août. Au final, neuf châteaux furent détruits et une quarantaine saccagés.