La Corse

La Corse-Sardaigne (Corsica et Sardinia en latin) est une province romaine, vers 120 Les Phéniciens sont les premiers à fonder des comptoirs commerciaux en Corse et en Sardaigne : Caralis (Cagliari), Tharros (Torre di San Giovanni), mais les Grecs de Phocée les concurrencent avec leurs colonies d’Alalia (actuelle Aléria) en Corse (fondée vers -560) et de Terranova Pausania (Olbia) en Sardaigne. Les Carthaginois aidés des Étrusques vainquent les Phocéens à Alalia en -535. La Sardaigne, puis la Corse, passent sous le contrôle de Carthage.
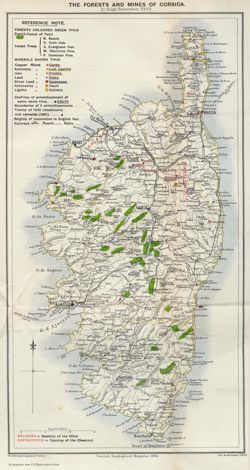
Lors de la première guerre punique, les
Romains attaquent la Sardaigne dès 259 avant J.C., mais ne s’en emparent
pas. Après la défaite de Carthage en 241 avant J.C., les mercenaires sardes
au service de Carthage se révoltent en 238 avant J.C. et demandent l’aide
des Romains. Ceux-ci déclarent à nouveau la guerre à Carthage
et envoient leur flotte de guerre. En 229 avant J.C., Carthage cède à
Rome la Corse et la Sardaigne, perdant ainsi deux places stratégiques
en mer Tyrrhénienne. Lors de la seconde guerre punique (218-201),
les Carthaginois tentent en vain de reprendre la Sardaigne.
Les Romains, maitres des côtes et des plaines, mettent près
d’un siècle à soumettre les populations indigènes de l’intérieur
des iles. En 27 avant J.C., la Sardaigne et la Corse, enfin largement
pacifiées, deviennent une province sénatoriale, mais l’insécurité
que fait régner le brigandage oblige à la transformer vers 66
en province impériale pour y envoyer des légions. Jugées peu
attirantes en raison de leur rudesse, la Corse et la Sardaigne
servent plusieurs fois de lieu de bannissement durant l’Empire
romain : En 19, Tibère envoie en Sardaigne plusieurs milliers
de juifs de Rome accusés de prosélytisme, afin qu'ils luttent
contre les brigands et travaillent aux mines. Sénèque le Jeune
est relégué en Corse entre 41 et 48. La Sardaigne est une des
provinces productrices de blé, qu'elle exporte vers Rome via
Ostie, comme en témoigne les représentations commerciales de
Karalis (Cagliari) et de Turris (Porto Torres) dans la place
des Corporations. Les Vandales, après avoir envahi l’Afrique
romaine, s’emparent de la Corse et de la Sardaigne, vers 456.
Ils les gardent jusqu’en 533, date de leur reconquête par Bélisaire,
général de l’empereur d’Orient Justinien Ier. Mais l’Empire
byzantin, n’ayant plus les moyens de conserver sa domination,
abandonne ces iles aux envahisseurs arabes.
Au dire de Pline,
les Romains divisèrent l'île en 33 civitates, civitas étant
une commune étrangère ; cité, municipe ou colonie, elle se composait,
en dehors de la ville quand il y en avait une, d'un territoire
plus ou moins étendu. Ce territoire renfermait des vici, bourgs,
des pagi, villages, des castella ou oppida, réduits fortifiés,
des fermes et des grandes propriétés, fundi, villa et prædia.
Cette dernière expression s'est conservée et, sous le nom de
presa, les Corses désignent la partie cultivée du territoire
par opposition à la portion réservée au libre parcours.
À
la chute de Rome, le déferlement des peuples « barbares » sur
l’Europe n’épargne pas la Corse. Les Vandales sont les premiers
à arriver, depuis le sud de l’Espagne, en passant par le Maghreb,
la Sicile et la Sardaigne. Ils ne sont à l’origine que de massacres,
terreur, incendies, famine. Les Corses se réfugient dans les
montagnes pour leur échapper. Les Vandales rapportent aussi
d’Afrique la malaria ou paludisme. Les Vandales sont chassés,
en 533, par les Byzantins dont les fonctionnaires vivent de
rapine, de corruption et de fraude. Puis les Ostrogoths s'aventurent
dans l'île. Enfin les Lombards, venus des Alpes, n’occupent
l’île que trois décennies mais parviennent à codifier l’usage
local de la « dette de sang », future « vendetta ». Lorsque
Charlemagne devient Roi des Lombards, en 774, il confirme une
partie de la donation de Quierzy que son père avait fait au
pape Etienne II. La Corse entre alors dans l’obédience du Saint-Siège,
sans effet réel et immédiat pour le successeur de celui-ci,
Adrien Ierer.
À partir du VIIIème siècle, les Sarrasins
d’Espagne et d’Afrique du Nord (Maures, Berbères ou Arabes)
multiplient les attaques sur les côtes corses et mettent les
ports à sac, coupant l’île du continent durant près de trois
siècles sans vraiment vouloir l’envahir. La population recule
à nouveau dans les montagnes et fait appel au pape, supposé
propriétaire de l’île. C’est la Marche de Toscane, déléguée
par le pape, qui vient à son secours.
Selon certains historiens,
le blason et le drapeau à la tête de Maure tireraient leur origine
de cette époque. Ces luttes pourraient être à l’origine de la
féodalité et de la noblesse en Corse. En effet, les déplacements
de population dus aux invasions (émigration, repli dans les
hauteurs) cloisonnent les Corses dans les hautes vallées. L’Église
officialise ces « pièves » (pievi), regroupements de population
plus ou moins isolés les uns des autres, et, vers l’an mil les
seigneuries se constituent sous l’autorité du pape : la gestion
insulaire est déléguée à un comte (le premier selon la tradition
est Ugo Colonna, à l’origine de la noblesse corse), qui nomme
des juges locaux. Les seigneurs dressent de petits châteaux
ou donjons, assurent la paix et la justice, prélèvent une redevance
(accattu). Les vassaux sont surtout liés à leur suzerain par
des liens d’amitié et de parenté (clienti) même si la pyramide
féodale tend à s’imposer. Certains comtes s’arrogent les droits
et privilèges des comtes carolingiens, comme Arrigo Bel Messere,
installé dans son « palais » de Poghju-di-Venacu. La disparition
de ce dernier marque l’émiettement du pouvoir féodal.
En
raison des rivalités que connaît la Corse, au XIème siècle, le
pape accorde à l’évêque de Pise l’investiture des évêques corses
et les Pisans commencent deux siècles de domination sur l’île.
Sous le gouvernement des juges et des seigneurs pisans, des
constructions sont édifiées (églises, ponts, etc.). Mais, Pise
perd la protection pontificale et des rivalités internes l’affaiblissent.
Gênes entre alors en conflit contre son ancien allié dans la
lutte contre les Sarrasins. En 1284, à la bataille navale de
Meloria, la flotte pisane est détruite. Plusieurs campagnes
de Gênes (1289-1290) lui rallient les féodaux, alors que les
Pisans renoncent à la Corse. La trêve signée par Pise en juillet
1299 accorde la domination totale de l’ile par Gênes. Celle-ci
devient génoise pour six siècles, en dépit du Saint-Siège, qui
tente en 1297 de confier la direction de la Corse à la maison
d’Aragon.
Les Génois doivent
cependant défendre leur nouvelle conquête face aux menaces des
Sarrasins (les tours qui ceinturent l’ile sont construites plus
tard dans ce but), des Aragonais, installés en Sardaigne, des
Français, pour qui la Corse est un avant-poste contre l’Espagne.
Mais Gênes fonde sa conquête sur sa puissance bancaire. Gênes
partage l’ile en dix provinces, elles-mêmes divisées en pièves
(les soixante-six pièves reprises du système féodal). Les Génois
construisent (urbanisation : Bastia devient siège du gouverneur,
ponts, routes, etc.), développent les vergers, importent de
Corse vins, huiles, bois, huitres, poix, mais imposent lourdement
la Corse et s’assurent la quasi-exclusivité du commerce avec
l’île. La langue et certains usages (religieux notamment) corses
sont grandement influencés par l’occupant. En 1297, le pape
Boniface VIII tente de réaffirmer son autorité sur la Corse
et la Sardaigne en y investissant Jacques II, roi d’Aragon,
et en 1305, le pape Clément V renouvele cette tentative. Les
Aragonais ne s’attaquent qu’à la Sardaigne pisane, dans un premier
temps. Les Génois, craignant de voir la Corse envahie, s’allient
aux Pisans pour lutter contre les Aragonais en Sardaigne. Mais
bientôt, Jacques II renonce à ses droits sur la Corse en échange
de la paix en Sardaigne, et s’y installe. Cependant, en 1346,
les troupes du roi d’Aragon Pierre IV débarquent vers Bonifacio,
et une guerre éclate entre les Génois et les Aragonais et leurs
alliés Vénitiens. Gênes sort victorieuse du conflit mais doit
alors faire face à la montée de la puissance de la noblesse
corse. La rivalité entre les féodaux corses, les clans génois
et le pape Eugène IV se conclut en 1453 par la cession du gouvernement
de l’île à une banque, l’Office de Saint Georges. L’Office bâtit
de nouvelles tours sur le littoral ainsi que des villes fortifiées
: Ajaccio (1492), Porto-Vecchio (1539). En 1553, les Corses,
menés par Sampiero Corso, alliés aux Français et aux Turcs d'Alger,
entament une révolution qui prend Gênes par surprise. Bastia
tombe en quelques heures, Corte se rend sans combattre, Saint-Florent
et Ajaccio ouvrent leur porte aux révolutionnaires. Bonifacio
et Calvi, peuplées de Ligures fidèles aux Génois, résistent
à l’abri de leur citadelle. La première tombe, la seconde n’est
jamais conquise. L’amiral génois Andrea Doria contre-attaque
avec une armada face aux Français, qui ont dégarni la Corse
après la victoire et le retrait de leurs alliés turcs. Le général
français de Thermes voit les villes tomber tour à tour : Bastia
tient huit jours, Saint-Florent résiste trois mois. Sampiero
récupère Corte et Vescovato. La Guerre de Corse s’enlise en
guerre d’usure : De Thermes et Sampiero sont écartés par la
France au profit du général Giordanno Orsini. Le moral des Corses
révoltés est entretenu par une suite de guérillas, malgré des
représailles jusqu’à la trêve de Vaucelles (5 février 1556),
quand Henri II de France rend à Gênes certaines places fortes.
Les Génois ne reprennent possession de l’île tout entière qu’avec
le traité du Cateau-Cambrésis (3 avril 1559). L’Office de Saint
Georges, qui reprend le commandement de la Corse, impose une
série de mesures jugées dictatoriales. La révolte du peuple
corse repart lors du débarquement de Sampiero, aidé par Catherine
de Médicis, au golfe de Valinco (12 juin 1564). Les insurgés
reconquièrent l’intérieur de l’île, laissant les villes côtières
aux Génois. Malgré les renforts envoyés rapidement, Gênes n’inflige
aucune défaite décisive à Sampiero. Des villages sont détruits,
Cervione brûlé, mais Corte se rend aux insurgés.

La République
doit faire appel aux Espagnols pour reprendre certaines places
(1566), tandis que les renforts envoyés par la France à Sampiero
s’avèrent inefficaces. Après nombre de trahisons et de désertions
dans les rangs insurgés, Sampiero est tué près de Cauro (guet-apens
d’Eccica-Suarella, 17 janvier 1567). Son fils de 18 ans ne continue
la lutte que deux ans avant de s’exiler en France (1er avril
1569). La République de Gênes exploite le Royaume de Corse comme
une colonie, moyennant des droits à payer à l’Office de Saint
Georges. L’administration est réorganisée autour de paroisses
démocratiques, une crise ravage l’économie, Calvi et Bonifacio
bénéficient de franchises et d’exemption pour leur fidélité
aux Ligures, le gouverneur de la colonie instaure un système
juridique corrompu. Les Statuts (décembre 1571) garantissent
un minimum de justice et le Syndicat défend, pour un temps,
les autochtones. Le maquis devient le refuge des condamnés par
contumace, mais l’insécurité est réduite par une redevance sur
les ports d’armes. Les impôts comme le commerce sont iniques
et les Génois se réservent des monopoles. Après 1638, une nouvelle
politique économique est alors instaurée : plantation d’arbres
et de vignes, accroissement du cheptel, etc. mais aucun Corse
ne peut accéder à la propriété. Les bergers corses sont chassés
peu à peu des plaines, les autochtones grondent. En 1729, éclate
la guerre d’Indépendance. Les émeutes spontanées de 1729 éclatent
à la suite de l'incident de Bustanico, à savoir le prélèvement
des impôts par le gouverneur en dépit de la décision de Gênes
d'arrêter leur levée. Elles se cristallisent sur le refus de
l'impôt, mais les causes profondes sont multiples : la pression
fiscale en général, taille et gabelle jugées excessives pour
le contexte économique de crise ; mais aussi, les abus des percepteurs
génois envers les Corses ; et enfin, l'insécurité exacerbée
par la disette, due à des bandits isolés ou à des bandes audacieuses.
Cette troisième raison entraîne la demande de rétablissement
du port d'armes, dans un souci traditionnel en Corse d'assurer
soi-même sa propre sécurité et de se faire sa propre justice.
Gênes interprète cette revendication comme un refus de payer
l'impôt de deux seini. Les premières émeutes démarrent en novembre
1729, dans la région du Boziu. La rébellion s'étend par la suite
à la Castagniccia, la Casinca, puis le Niolo. Saint-Florent
et Algajola sont alors attaquées, Bastia mise à sac en février
1730, et en décembre de cette même année, lors de la consulte
de Saint-Pancrate, la Corse élit ses généraux : Luiggi Giafferi,
Andrea Ceccaldi et l'abbé Raffaelli. Gênes fait alors appel
aux troupes de l'empereur Charles VI. Cette intervention impériale
de 1731 est repoussée une première fois mais quelques semaines
plus tard, de puissants renforts viennent à bout des rebelles.
En juin 1733, Gênes accorde au peuple corse certaines concessions
garanties par l'Empereur, mais jugées insuffisantes dans l'île.
La rébellion reprend quelques mois plus tard, sous le commandement
cette fois de Hyacinthe Paoli, le père de Pascal. Le 30 janvier
1735, est énoncé un règlement établissant la séparation définitive
de la Corse d'avec Gênes, et contenait les bases de la constitution.
Par son première article, la Consulta déclare: "Au nom de la
Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Sainte-Esprit, de
l'immaculée Conception de la Vierge Marie, sous la protection
de la Sainte Mère Avocate, nous élisons, pour la protection
de notre patrie et de tout le royaume l'Immaculée conception
de la Vierge Marie, et de plus nous décidons que tous les armes
et les drapeaux dans notre dit royaume, soient empreints de
l'image de l'Immaculée Conception, que la veille et le jour
de sa fête [8 décembre] soient célébrés dans tout le royaume
avec la plus parfaite dévotion et les démonstrations les plus
grandes, les salves de mousquetaires et canons, qui seront ordonnées
par le Conseil suprême di royaume. " En juillet 1768, à la suite
du traité de Versailles, la France rachète à Gênes ses droits
sur l'île. En fait, au départ il s'agit seulement d'une délégation,
la France est chargée d'administrer la Corse durant dix ans
et de la pacifier. Gênes étant dans l'incapacité de rembourser
à la France ses frais, l'île devint au bout de dix ans, propriété
de la France. Les troupes françaises occupent rapidement le
Cap Corse, et un mois plus tard, le marquis de Chauvelin débarque
avec de nombreuses troupes sous son commandement. Les Français
sont vaincus à la bataille de Borgo en octobre. Mais, au printemps
1769, le comte de Vaux débarque avec 24 000 hommes et bat les
patriotes le 9 mai à Ponte Novu. Près d'un mois plus tard, les
places fortes de haute corse étant conquises, et voulant bloquer
l'avancée Française dans l'au-delà des monts,
 Le Général Paoli tient le discours suivant devants le peu de
troupes qu'il lui reste:
Le Général Paoli tient le discours suivant devants le peu de
troupes qu'il lui reste:
"Enfin, mes braves compagnons, nous
voici réduits aux dernières extrémités. Ce que n'ont pu une
guerre de trente ans, la haine envenimée des Génois, et les
forces de diverses puissances de l'Europe, la soif de l'or l'a
produite. Nos malheureux concitoyens séduits et trompés par
quelques chefs corrompus sont allés d'eux-même au devant des
fers qui les accablent. Notre heureux Gouvernement est renversé
nos amis sont morts ou prisonniers ; et à nous qui avons eu
le malheur de vivre jusqu'à ce jour pour voir la ruine de notre
pays, il ne nous reste que la triste alternative de la mort
ou de l'esclavage. Ah! pourriez-vous vous résoudre, pour retarder
de quelque peu ce moment extrême que nous devons tous subir,
à devenir esclaves d'un peuple d'injustes oppresseurs? Ah! mes
chers amis, rejetons loin de nous cette honteuse pensée: L'or
ni les offres brillantes des Français n'ont pu m'éblouir, leurs
armes ne m'aviliront point. Après l'honneur de vaincre, il n'est
rien de plus grand qu'une mort glorieuse. II ne nous reste donc
qu'à nous faire un chemin vers la mer à travers nos ennemis
pour aller attendre ailleurs des temps plus heureux, et conservée
des vengeurs à la Patrie ou de terminer notre honorable carrière
en mourant glorieusement comme nous avons vécu."
Pascal Paoli
quitte la Corse le 13 juin 1769. Son départ met un terme à quarante
années de révolte armée contre la République de Gênes. Napoléon
Bonaparte naît deux mois plus tard, le 15 août 1769. En 1774,
les nationalistes se révoltent, mais sont réprimés dans le Niolo.
C'est le début d'une longue série d'amnisties (1776), dont Paoli,
alors à Londres, refuse de profiter. La Corse est gouvernée
par Marbeuf et devient pays d'États. Les États de Corse, assemblés
et composés de 23 députés de chacun des trois ordres, choisis
par élection indirecte, se réunissent huit fois entre 1770 et
1785. L'assemblée n'a qu'un rôle consultatif : toute décision
dépend des commissaires du roi, l'intendant et le commandant
en chef. L'administration confie peu de postes aux Corses sauf
dans les échelons subalternes de la magistrature. L'administration
des communes reste toutefois aux mains des autochtones. L'ordre
de la noblesse est créé, des titres sont accordés à plus de
80 familles (parmi lesquelles les Bonaparte). Les nobles ne
bénéficient pas de privilèges féodaux, mais peuvent obtenir
divers avantages : concessions de terres, places d'officiers
dans des régiments formés pour les Corses, bourses pour leurs
enfants dans les écoles du continent. Les tentatives de développement
agricole et industriel sont peu efficaces. Les impôts directs,
perçus dès 1778 en nature, pèsent surtout sur les pauvres. Les
premières routes sont construites (de Bastia à Saint-Florent,
et de Bastia à Corte) et le plan Terrier est mis en œuvre. Les
recensements démontrent un accroissement continu de la population.
En 1789, alors que la Révolution éclate en France, l'Assemblée
nationale, incitée par une lettre d'un comité patriotique de
Bastia, décrète que la Corse est désormais partie intégrante
de la monarchie française. Les Corses exilés sont alors autorisés
à rentrer en France. Le 15 janvier 1790, la Corse devient un
département avec Bastia comme chef-lieu et siège de l'unique
évêché.

En juillet 1790, les révolutionnaires français autorisent
le retour de Pascal Paoli sur le territoire insulaire. En septembre,
il est élu commandant en chef des gardes nationales corses,
puis président du conseil général du département. En juin 1791,
une émeute religieuse éclate à Bastia, après la déposition de
l'évêque qui refuse de prêter serment à la Constitution civile
du clergé. Paoli la réprime et, en 1792, transfère le chef-lieu
à Corte, s'attirant ainsi l'hostilité des Jacobins corses, dont
Christophe Saliceti et les frères Bonaparte. Le 1er février
1793, la Convention décide d'envoyer trois commissaires (dont
Saliceti) en Corse pour surveiller la conduite de Pascal Paoli.
Le même mois, ce dernier est tenu pour responsable de l'échec
d'une expédition contre la Sardaigne à laquelle participait
Napoléon Bonaparte. Le 2 avril, la Convention décrète son arrestation,
ainsi que celle de
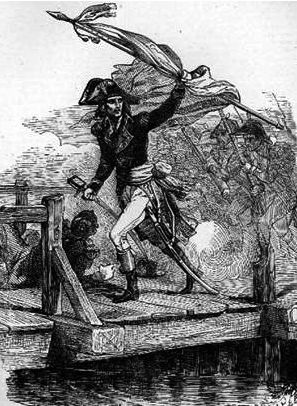 Carlo
Andrea Pozzo di Borgo : Lucien Bonaparte les accuse de despotisme.
Face aux menaces des Paolistes, les commissaires en Corse depuis
le 5 avril, hésitent cependant à exécuter l'ordre. Fin mai,
une consulte à Corte condamne le gouvernement français et proclame
Paoli Père de la Patrie. Ses partisans s'imposent à Ajaccio
et saccagent la maison Bonaparte. Avec l'appui de Napoléon Bonaparte,
les commissaires tentent d'attaquer Ajaccio par la mer, ce qui
se solde par un échec. Le 11 juillet 1793, la Corse est divisée
en deux départements, le Golo et le Liamone. Cette scission
sera effective en 1796. Pendant le même mois, la Convention
met Paoli et Pozzo di Borgo hors la loi, alors que la milice
Paolienne tient les troupes républicaines enfermées à Calvi,
Saint-Florent et Bastia. Paoli cherche appui auprès des Britanniques
qui envoient Sir Gilbert Elliot, accompagné de conseillers militaires,
en janvier 1794. Bientôt, des forces britanniques assiègent
et occupent Saint-Florent (février), Bastia (avril-mai), et
Calvi (juin-aout). Les patriotes et les députés, réunis en consulte
à Corte le 10 juin 1794, proclament le Royaume Anglo-Corse,
promulgue sa Constitution et élèvent Paoli au rang de Babbu
di a Patria (Père de la Patrie). Pourtant, Sir Gilbert est désigné
vice-roi, au mécontentement de Paoli. Ce dernier soulèvera alors
une émeute en 1795 dirigée contre Sir Gilbert et Pozzo di Borgo.
Mais il est rappelé en Grande-Bretagne où il s'exile le 13 octobre
1795. En avril 1796, des émeutes provoquées par le parti républicain
éclatent, Sir Gilbert reçoit l'ordre d'évacuer la Corse. Des
troupes de l'armée napoléonienne d'Italie occupent par la suite
l'île sans rencontrer d'opposition. Il est né le 15 aout
1769 à Ajaccio et deviendra Empereur des Français en 1804. En
1796, l'organisation des départements du Golo et du Liamone
créés trois ans auparavant est confiée à Christophe Saliceti.
En 1798, le clergé déclenche la Révolte de la Crocetta dans
le nord de l'île. En décembre, une coalition de Corses exilés,
royalistes, paolistes et pro-britanniques, suscitent un soulèvement
au Fiumorbu avec l'appui de la Sardaigne et de la Russie. Les
répressions sont sévères. En 1801, Napoléon suspend la Constitution
en Corse. Il y envoie Miot de Melito comme administrateur général.
Celui-ci mettra en place des concessions fiscales, les Arrêtés
Miot. Ensuite, le général Morand gouverne l'île avec une dureté
extrême. Le Décret impérial mis en place en 1810 permet de nouveaux
dégrèvements fiscaux. Puis l'ile est réunie en un seul département,
avec Ajaccio pour le chef-lieu. Le général Morand est alors
remplacé par le général César Berthier, frère du futur maréchal
Louis-Alexandre Berthier. L'exil de Napoléon à l'ile d'Elbe
provoquera des réjouissances à Ajaccio. Bastia accueillera alors
des troupes britanniques commandées par le général Montrésor.
En mars et avril 1815, des agents de Napoléon envoyés de l'île
d'Elbe réussissent à s'imposer en Corse. Durant les Cent-Jours,
l'ile est administrée jusqu'à Waterloo par le Duc de Padoue.
En février 1816, a lieu un dernier soulèvement bonapartiste,
la guerre du Fiumorbo, mené par le Commandant Poli. Malgré leur
importance et leur résolution, et après une farouche résistance,
les partisans de Napoléon, pourtant invaincus, mais assurés
de l'amnistie générale, quittent la Corse.
Carlo
Andrea Pozzo di Borgo : Lucien Bonaparte les accuse de despotisme.
Face aux menaces des Paolistes, les commissaires en Corse depuis
le 5 avril, hésitent cependant à exécuter l'ordre. Fin mai,
une consulte à Corte condamne le gouvernement français et proclame
Paoli Père de la Patrie. Ses partisans s'imposent à Ajaccio
et saccagent la maison Bonaparte. Avec l'appui de Napoléon Bonaparte,
les commissaires tentent d'attaquer Ajaccio par la mer, ce qui
se solde par un échec. Le 11 juillet 1793, la Corse est divisée
en deux départements, le Golo et le Liamone. Cette scission
sera effective en 1796. Pendant le même mois, la Convention
met Paoli et Pozzo di Borgo hors la loi, alors que la milice
Paolienne tient les troupes républicaines enfermées à Calvi,
Saint-Florent et Bastia. Paoli cherche appui auprès des Britanniques
qui envoient Sir Gilbert Elliot, accompagné de conseillers militaires,
en janvier 1794. Bientôt, des forces britanniques assiègent
et occupent Saint-Florent (février), Bastia (avril-mai), et
Calvi (juin-aout). Les patriotes et les députés, réunis en consulte
à Corte le 10 juin 1794, proclament le Royaume Anglo-Corse,
promulgue sa Constitution et élèvent Paoli au rang de Babbu
di a Patria (Père de la Patrie). Pourtant, Sir Gilbert est désigné
vice-roi, au mécontentement de Paoli. Ce dernier soulèvera alors
une émeute en 1795 dirigée contre Sir Gilbert et Pozzo di Borgo.
Mais il est rappelé en Grande-Bretagne où il s'exile le 13 octobre
1795. En avril 1796, des émeutes provoquées par le parti républicain
éclatent, Sir Gilbert reçoit l'ordre d'évacuer la Corse. Des
troupes de l'armée napoléonienne d'Italie occupent par la suite
l'île sans rencontrer d'opposition. Il est né le 15 aout
1769 à Ajaccio et deviendra Empereur des Français en 1804. En
1796, l'organisation des départements du Golo et du Liamone
créés trois ans auparavant est confiée à Christophe Saliceti.
En 1798, le clergé déclenche la Révolte de la Crocetta dans
le nord de l'île. En décembre, une coalition de Corses exilés,
royalistes, paolistes et pro-britanniques, suscitent un soulèvement
au Fiumorbu avec l'appui de la Sardaigne et de la Russie. Les
répressions sont sévères. En 1801, Napoléon suspend la Constitution
en Corse. Il y envoie Miot de Melito comme administrateur général.
Celui-ci mettra en place des concessions fiscales, les Arrêtés
Miot. Ensuite, le général Morand gouverne l'île avec une dureté
extrême. Le Décret impérial mis en place en 1810 permet de nouveaux
dégrèvements fiscaux. Puis l'ile est réunie en un seul département,
avec Ajaccio pour le chef-lieu. Le général Morand est alors
remplacé par le général César Berthier, frère du futur maréchal
Louis-Alexandre Berthier. L'exil de Napoléon à l'ile d'Elbe
provoquera des réjouissances à Ajaccio. Bastia accueillera alors
des troupes britanniques commandées par le général Montrésor.
En mars et avril 1815, des agents de Napoléon envoyés de l'île
d'Elbe réussissent à s'imposer en Corse. Durant les Cent-Jours,
l'ile est administrée jusqu'à Waterloo par le Duc de Padoue.
En février 1816, a lieu un dernier soulèvement bonapartiste,
la guerre du Fiumorbo, mené par le Commandant Poli. Malgré leur
importance et leur résolution, et après une farouche résistance,
les partisans de Napoléon, pourtant invaincus, mais assurés
de l'amnistie générale, quittent la Corse.
Napoléon Bonaparte
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025
