Comté de Provence
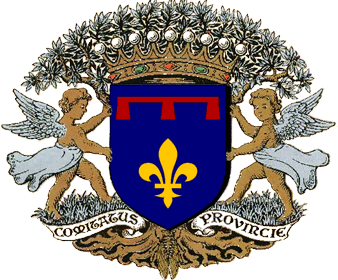
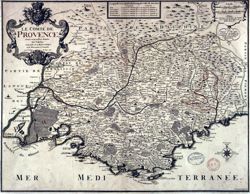
Le comté de Provence fut un des grands fiefs
du royaume rodolphien de Bourgogne. En 947, Boson d'Arles, comte d'Arles
fut investi du comté de Provence. À sa mort, ses deux fils - Guilhem
dit le Libérateur et Roubaud - se partagèrent en indivis le comté, indivision
que maintinrent leurs descendants. La branche issue de Guilhem a donné
celle des comtes de Provence, celle issue de Roubaud a donné, à partir
de 1054 les comtes de Forcalquier et les marquis de Provence.
En
972, à la suite de l'enlèvement de Maïeul de Cluny, abbé de Cluny, Guillaume
Ierer et Roubaud, avec l'aide de seigneurs provençaux et
du marquis de Turin, libérèrent la Provence des Sarrasins qui, depuis
leur forteresse du Fraxinet, pillaient la région. Cette campagne militaire
menée sans les troupes de Conrad III de Bourgogne, fut l'occasion d'une
mise au pas de la Provence, de l'aristocratie locale, des communautés
urbaines et paysannes qui avaient jusque là toujours refusé la mutation
féodale et le pouvoir comtal. Elle permit à Guillaume d'obtenir la suzeraineté
de fait de la Provence. Il distribua les terres reconquises à ses vassaux,
arbitra les différends et créa ainsi la féodalité provençale. Nommé
marquis en 975, Guillaume fait d'Arles sa capitale.
Rodolphe III
de Bourgogne n'ayant pas de postérité, il a institué Conrad II le Salique,
empereur romain germanique, pour héritier. À la mort de Rodolphe en
1032 le royaume de Bourgogne - et avec lui le royaume d'Arles dont le
comté de Provence faisait partie - fut rattaché au Saint-Empire romain
germanique. Toutefois la suzeraineté du souverain romain-germanique
sur la Provence ne fut que nominale et théorique.
En 1019, Emma, comtesse de Provence, se maria
avec Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, transmettant les droits
de la lignée de Roubaud à la maison de Toulouse. Le titre de marquis
de Provence passa définitivement à cette maison à compter de 1093. En
1112, Douce de Provence, héritière des droits de la ligne de Guilhem,
épousa Raimond-Bérenger III, comte de Barcelone, qui devient Raimond-Bérenger
Ier de Provence. Les maisons de Toulouse et de Barcelone entrèrent alors
en conflit pour le marquisat. Un traité fut conclu, en 1125, entre Raymond-Bérenger
et Alphonse-Jourdain de Toulouse : par celui-ci, le comté de Provence
fut divisé en un marquisat au nord de la Durance - attribué aux Toulouse
- et un comté au sud, attribué à Barcelone. Parallèlement le nord-est
du comté de Provence était devenu indépendant de fait autour du comte
de Forcalquier. En 1193, Alphonse II de Provence épousa Gersande de
Sabran, petite-fille de Guillaume II comte de Forcalquier, ce qui permit
au comté de Provence de récupérer le sud du comté de Forcalquier, tandis
que le nord de ce comté, autour de Gap et d'Embrun, passait sous suzeraineté
du Dauphiné. C'est ce fait qui explique la présence du blason au dauphin
dans l'actuel blason de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En
1245 mourut Raymond-Bérenger V de Provence, dont les quatre filles furent
mariées respectivement : Marguerite à Louis IX de France, Sance à Richard
de Cornouailles, Éléonore à Henri III d'Angleterre et Béatrix à Charles
Ier d'Anjou, frère de Saint-Louis. C'est cette dernière qui reçoit en
héritage les comtés de Provence et de Forcalquier, les transmettant
à la première maison capétienne d'Anjou. Accumulant les titres royaux
(Naples-Sicile, Jérusalem, Chypre, Acre, Thessalonique, etc.), les comtes
se firent appeler roi.

En 1382, à la mort de la reine Jeanne, s’achevait la première maison capétienne d'Anjou. Jeanne adopta Louis Ier d'Anjou, fils du roi de France Jean II le Bon, fondant ainsi la seconde maison capétienne d'Anjou-Provence. La capture et la mort de la reine Jeanne provoquèrent une période de troubles opposant les partisans de la seconde maison d'Anjou-Provence aux partisans de Charles de Durazzo, issu de la première maison d'Anjou-Provence, dont les partisans formèrent l'Union d'Aix (1382-1387). La défaite, surtout politique, de Charles de Durazzo assit définitivement la seconde dynastie d'Anjou sur le comté de Provence (1387). La Provence orientale, à l'est du Var lui étant seule restée fidèle, Charles ne put lui venir en aide et lui permit de se donner au seigneur qu'elle se choisirait, pourvu que ce ne fût pas un adversaire. Ceci entraîna, en 1388, la séparation de la viguerie de Nice, cité de Puget-Théniers et les vallées de la Tinée et de la Vésubie qui choisirent la dédition de Nice à la Savoie), se constituant en Terres neuves de Provence. La haute-vallée de l'Ubaye, autour de Barcelonette, passa également sous suzeraineté savoyarde. La France a annexé la région de Barcelonette en 1713 dans le cadre du Traité d'Utrecht et Nice en 1860 par referendum.
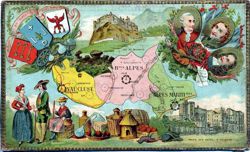
La seconde maison capétienne d'Anjou-Provence donnera, notamment, le célèbre Bon Roi René. Charles III du Maine légua la Provence, à sa mort en décembre 1481, au roi de France Louis XI. Le 15 janvier 1482, les États de Provence approuvèrent un document en 53 articles, souvent improprement appelé "constitution provençale", qui fit de Louis XI le comte de Provence et proclama l'union de la France et de la Provence « comme un principal à un autre principal ». Charles VIII succéda à Louis XI en 1483 et, en 1486, les États de Provence lui demandèrent l'union perpétuelle, accordée par le roi de France par lettres patentes rédigées en octobre 1486 et communiquées aux États en avril 1487, « sans que à icelle couronne ne au royaulme ils soient pour ce aulcunement sualternez ». Ce processus est souvent présenté de façon simplifiée comme l'intégration au domaine royal. En droit, pourtant, le comté de Provence restait indépendante, et l'est resté jusqu'à la Révolution française. Mais si il conserva bien des droits spécifiques, il fut de fait annexée par la France, bel et bien gouvernée et organisée comme une province française avec la création du Parlement de Provence en 1501. Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que les rois de France, y compris les monarques absolus comme Louis XIV, étaient tenus de respecter les droits et coutumes locaux. La Provence, à l'instar de la Bretagne, bénéficiait d'un certain degré d'autonomie, jalousement défendu, notamment en matière fiscale, même si l'indépendance relevait plus de la fiction juridique que de la réalité. En 1789, encore, les États de Provence rappelèrent qu'ils étaient de iure indépendants de la France.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025

