Le Berry
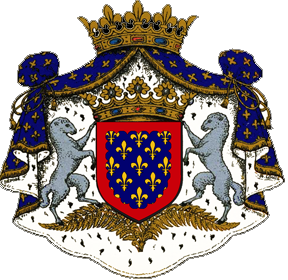
Le Berry, qui a formé le département du Cher,
était à l'époque gauloise habité par les Bituriges Cubi. Ce peuple,
dès les temps les plus reculés, fut un des plus puissants de la Gaule
et donna des rois à la Celtique, si l'on en croit Tite-Live, qui fait
remonter cette puissance des Bituriges au temps où le premier Tarquin
régnait à Rome. Au sixième siècle avant J.-C., les Bituriges et, à leur
suite, les Gaulois, envahirent l'Italie sous la conduite de Bellovèse
et les rives du Danube sous la conduite de Sigovèse.
Avaricum (Bourges)
était la capitale des Bituriges et l'une des villes les plus importantes
de la Gaule ; César, dans ses Commentaires, dit même que c'était la
plus belle ville de ce pays. D'autres villes existaient déjà du temps
des Bituriges, telles que Dun-le-Roi (ou sur-Auron), Châteaumeillant,
Mehun et Sancoins. Les Bituriges excellaient dans la fabrication des
armes et des vases d'étain, la construction des chars et le tissage
des tuiles à voiles


L'invasion romaine amena la ruine du pays. Pendant
la dernière période de la lutte héroïque que les Bituriges, avec les
autres peuples confédérés, soutinrent contre César, ils incendièrent
leurs villes et ravagèrent leur territoire pour affamer les légions
romaines. Avaricum, seule épargnée par eux, malgré les conseils de Vercingétorix,
fut assiégée, puis, après une défense héroïque, dévastée par César,
qui en massacra les habitants (52 ans avant J.-C.).
De belles routes,
appelées aujourd'hui voies romaines, relièrent Bourges à Tours par Mehun
et Vierzon, à Clermont par Allichamps, à Limoges par Châteaumeillant,
à la Loire vers le Château-Gordon (Saint-Satur), à Orléans par Allogny
et Neuvy-sur-Baranjon, etc.
La prospérité dont jouit le Berry pendant
les premiers siècles de l'occupation romaine disparut bien vite après
le quatrième siècle. Bourges, devenue en 367 la capitale de la 1re Aquitaine,
conserva ce titre jusqu'à la chute de l'Empire. Les Wisigoths, qui envahirent
la Gaule au milieu du cinquième siècle, s'emparèrent du Berry vers l'an
463 ; ils s'y maintinrent, malgré l'empereur Anthemins qui, en 458,
avait appelé dans le Berry 12 000 Bretons pour raffermir l'autorité
romaine ébranlée, et qu'ils battirent près de Déols.
A la suite
de la défaite d'Alaric, roi des Wisigoths, à Vouillé, en 507, Clovis
Ier se rendit maître du Berry. Depuis lors, ce pays, gouverné par des
comtes, fit partie du royaume d'Orléans ou de celui de Bourgogne. Sous
les Francs, les pays du Cher furent plus d'une fois troublés par la
guerre. Chilpéric, ayant attaqué son frère Gontran, fit envahir le Berry
par ses généraux, qui battirent les Berruyers dans les plaines de Châteaumeillant
(583).
Dès le troisième siècle, saint Ursin vint à Bourges prêcher
l'Évangile et y établit la première église dans une maison que lui donna
le sénateur Léocadius. Parmi ses successeurs, on remarque Sulpice Sévère
(sixième siècle) et Sulpice le Débonnaire (septième siècle). Les évêques
de Bourges commencèrent à prendre le titre d'archevêque et (huitième
siècle) de primat d'Aquitaine, titre qui leur donnait des droits de
suprématie sur une grande partie des évêchés du sud. Les grands monastères
fondés sous les deux premières dynasties royales sont : sous Clotaire
II, l'abbaye Saint-Sulpice, dans un faubourg de Bourges ; celle de Charenton
(620) ; celle de Massay (commencement du neuvième siècle) ; celle de
Dèvre, transférée en 926 à Vierzon.
Sous les Carlovingiens, le Berry
éprouva de grandes vicissitudes. Pépin le Bref le dévasta pendant la
guerre de huit années qu'il fit à Waïfer, duc d'Aquitaine, et à Hunibert,
comte de Bourges, adversaires des Francs du nord (760). La ville de
Bourges fut incendiée, le comte tué, et le pays ruiné. C'est à cette
époque que le Berry fut réuni à la couronne de France. Plus tard, Charlemagne
l'en détacha pour ériger l'Aquitaine en royaume en faveur de son fils
Louis (781). Les comtes de Bourges continuèrent à gouverner le Berry
au nom des rois d'Aquitaine. Parmi ces comtes, on cite Girard, qui,
dépouillé de son comté par Charles le Chauve en 847, prit les armes
contre son suzerain. Celui-ci marcha contre lui et ravagea le Berry.
Girard, ayant fait sa soumission, fut maintenu dans son comté. Le dernier
comte, Guillaume II, mourut en 927.
Les Normands, qui avaient envahi
la Gaule dès le neuvième siècle, occupaient les bords de la Loire ;
ils s'emparèrent de Bourges en 857 et en 867, et la pillèrent. Plus
tard, ils envahirent le Berry une troisième fois et s'avancèrent jusqu'à
Massay. Lorsque le comte Guillaume II fut mort sans héritier, le roi
Raoul réunit le comté de Bourges à la Couronne. Il n'y eut plus qu'un
vicomte de Bourges, qui reçut ce fief du roi en récompense de ses services.
Pendant toute la féodalité, le Berry fut organisé comme le reste de
la France ; mais un de ses fiefs, la principauté de Boisbelle (près
d'Henrichemont) offre une singularité notable : elle était enclavée
dans la vicomté de Bourges, et son seigneur, indépendant, se vantait
de ne relever que de Dieu.
En 1100, Eudes Arpin, vicomte de Bourges,
partant pour la Croisade, vendit son fief au roi pour 60 000 écus d'or.
Depuis cette époque, les pays qui forment le département du Cher demeurèrent
directement soumis à l'autorité royale. En 1102, Philippe Ier visita
son nouveau domaine, et établit à Bourges un bailli pour rendre la justice
en son nom. Le roi Louis le Jeune, voulant se faire pardonner la destruction
(1142) de la ville de Vitry-en-Perthois, prit la croix et convoqua à
Bourges, en 1145, une grande assemblée d'évêques et de barons. Godefroy,
évêque de Langres, y prêcha la Croisade, qui toutefois ne fut entreprise
qu'en 1147, après une nouvelle assemblée à Vézelay (Yonne), présidée
par saint Bernard.
En 1184, le comte de Sancerre, révolté contre
l'autorité royale, pillait les environs de Bourges, à la tête d'une
bande d'aventuriers appelés Brabançons. Le roi marcha contre lui et
dispersa ses bandes, à l'aide des Confrères de la Paix, association
formée au Puy en 1182, et qui s'était donné pour mission de rétablir
la paix dans le royaume.

Le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, de
retour de la Croisade de 1191, ralluma la guerre dans le Berry pour
forcer Guillaume, seigneur de Vierzon, à lui rendre hommage. Il envahit
ses domaines et s'empara de Vierzon, qu'il pilla. Le roi de France marcha
contre Richard, et la guerre finit par la mort de ce dernier, blessé
à mort au siège de Châlus (Haute-Vienne), en 1199.
La ville de Bourges
avait conservé une partie de son antique organisation municipale. Les
bourgeois administraient la ville et prenaient part aux assises bourgeoises
présidées par le bailli royal. Louis le Jeune leur accorda, en 1175,
une charte contenant des droits importants, ainsi qu'aux hommes de la
septaine, territoire étendu autour de la ville, et à ceux de la châtellenie
de Dun. Du reste, c'est vers cette époque que commença l'affranchissement
des serfs. Les premières communes affranchies furent Preuilly (1177),
Santranges (1178), Barlieu et Sancerre (1190), Chârost (1194), Mehun
(1209), Châteaumeillant (1220), Vierzon (avant 1248), Culan (1270),
les Aix-d'Angillon (1301), etc.
Le règne de saint Louis fut un temps
de prospérité pour le Berry comme pour le reste de la France. En 1234,
le roi acheta la suzeraineté du comté de Berry, qui appartenait à un
prince puîné de la maison de Champagne. Mais, pendant que saint Louis
était à la Croisade de 1240, des bandes innombrables de vagabonds appelés
Pastoureaux envahirent le nord de la France, l'Orléanais, le Berry et
pillèrent Bourges. Heureusement la mort de leur chef, tué par un boucher
de Bourges, désorganisa les Pastoureaux, qui furent exterminés à Villeneuve-sur-Cher.
En 1360, le roi Jean le Bon érigea le Berry, avec les terres de
Vierzon, de Lury et de Mehun-sur-Yèvre, en duché-pairie en faveur de
son troisième fils, Jean. Il y eut alors deux justices : celle du duc
et celle du roi, qui était représenté par le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier
; ce juge recevait les appels des justices inférieures et siégeait à
Sancoins. Après le désastre de Crécy (1346), le prince de Galles entra
dans le Berry, assiégea Bourges sans succès, mais prit Vierzon, sans
toutefois pouvoir réduire le château. Après la bataille de Poitiers
(1356), les Anglais envahirent de nouveau le duché, s'emparèrent d'une
foule de villes et de villages et notamment d'Aubigny, de Blet, de Saint-Amand
et du château de Montrond.
Jacques Coeur
Au quinzième siècle,
la guerre des Armagnacs et des Bourguignons exposa le Berry à de nouveaux
dangers. Le duc Jean de France, partisan des Armagnacs, fut attaqué
dans Bourges par le duc de Bourgogne (juin-octobre 1412). Pendant le
siège, les Bourguignons ravagèrent le pays, prirent Dun-le-Roi, Montfaucon
et d'autres places. Enfin les deux princes firent la paix, et Bourges
se soumit. Le comté de Bourges fut donné, en 1416, en apanage à Charles,
cinquième fils du roi Charles VI, qui y séjourna souvent, et que les
Anglais nommèrent par dérision le roi de Bourges. Bourges devint un
moment comme la capitale du royaume. Charles VII y reçut plusieurs fois
l'hospitalité chez son argentier, Jacques Coeur. En 1429, Jeanne d'Arc
y assembla un corps d'armée pour aller attaquer Saint-Pierre-le-Moutier
et la Charité. L'année suivante, elle partit de Mehun pour sa dernière
expédition. Charles VII mourut, en 1461, au château de Mehun-sur-Yèvre,
qu'il avait fait rebâtir.
Louis XI rétablit le duché-apanage du
Berry pour son frère Charles, et fonda l'Université de Bourges, qui
eut pour professeurs l'Italien Alciat (dont Théodore de Bèze, Amyot
et Calvin vinrent prendre les leçons), puis le Toulousain Cujas. C'est
à Bourges que se réunit, en 1428, une assemblée des États Généraux et
du clergé de la France pour l'acceptation des décrets du concile de
Bâle ; cette assemblée rédigea la fameuse déclaration appelée Pragmatique
Sanction, dans laquelle furent consignés les droits de l'Église gallicane
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025