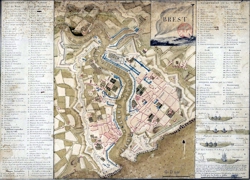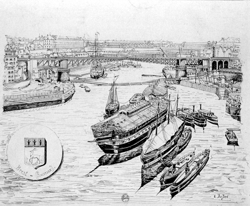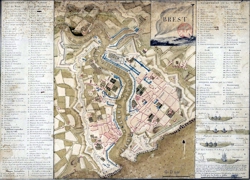
Carte de Brest

Brest
Brest ne paraît point être, comme on la prétendu,
le Brivates portus des Romains. Son nom vient de celui de Bristok,
chef celte du bas Léon, dans le Vème siècle ou à la fin
du IVème. Toutefois, on ne trouve point de mention historique
de Brest avant. le XIème siècle. En 1065, Conan le Tors
en fit réparer-le château, qui, d'après cette donnée, aurait été
déjà ancien à cette époque. Le nom de Tour de César, que porte une
des tours de l'ancienne forteresse, rappelle-t-il quelque construction
romaine sur les ruines de laquelle elle se serait élevée, ou cette
tour ne date-telle absolument que du XIIIème siècle,
comme l'affirme M. de Fréminville ? C'est une question difficile
à résoudre.
En 1239, un seigneur de Léon était en possession
de Brest, qu'il céda au duc. Les ducs de la maison de Dreux rebâtirent
le château presque entier, et y firent souvent leur résidence. C'est
ce qu'on appelle aujourd'hui le Donjon. On y voit les appartements
des ducs, la grande salle d'honneur, dont les fenêtres donnent sur
la place. Au-dessous sont d'affreux cachots sans air ni lumière,
d'où l’on descend, par d'obscurs et humides corridors en pente,
aux oubliettes celles-ci se fermaient au moyen d'une pierre plate
à coulisse. On y est descendu en 1824, et on y a trouvé des cheveux
et deux squelettes d'hommes.
Cette forteresse a soutenu cinq
sièges, de 1341 à 1387. Montfort la prit, augmenta les fortifications,
et fit entourer la bourgade d'une muraille. Du Guesclin, en 1372,
et Clisson, en 1386, l'assiégèrent inutilement. Les Anglais ne la
rendirent qu'en 1397.
On appréciait l'importance de la place,
et c'était un dicton que n'est, pas duc de Bretagne qui n'est sire
de Brest. Pourtant Brest avait alors moins d'importance que le petit
village de Recouvrance, situé de l'autre côté de la rivière de Penfeld,
et qui était le siège de la justice seigneuriale. Au-dessus de ce
village était une butte de terre artificielle, ou motte seigneuriale,
chef-lieu féodal de la seigneurie du bas Léon, appartenant à la
famille des Tanguy du Châtel, et appelée Motte-Tanguy.
Sur cette
bute s'élevait une forte tour ronde, dont les ruines ont de nos
jours été occupées par un forgeron. Le nom de ce village-venait
de la chapelle élevée, en 1346, en l'honneur de Notre-Dame-de-Recouvrance
; on y consacrait de nombreux ex-voto pour le retour et le recouvrement
des navires brestois.
Brest repoussa les Anglais en 1512 et en
1557. A la fin du même siècle, elle soutint un siège terrible contre
les Espagnols, ils avaient fait bâtir à l'entrée du Goulet, sur
la pointe de Roscanvel, un fort triangulaire pour priver la place
des secours qui pourraient lui venir par mer.

Brest, lancement du croiseur Duquesne - Le pont transbordeur
de Brest
Le gouverneur de Brest, choisi par Henri
IV, était Sourdéac, de la famille de Rieux, qui l'on doit le bastion
qui porte son nom. Le maréchal d'Aumont fit canonner le fort des
Espagnols, et, la brèche ouverte, un hardi Gascon, le capitaine
Romegon, s'y précipita, résolu de l'emporter ou d'y mourir il l'emporta
et fut tué (1594).
Brest recouvrée, les Anglais essayèrent de
se la faire livrer par Henri IV, en échange des secours qu'il avait
reçus d'eux. Henri IV refusa, et ne leur céda que Paimpol, ville
non fortifiée. Brest avait donc un fort château, et l'on voit que
l'attention commençait à s'y porter. Mais, comme port, comme ville,
elle n'avait aucune importance à peine comptait-elle 1500 habitants.
C'est seulement sous Richelieu que l'on songea à y fonder l'un grand
établissement, et c'est du XVIIème siècle que date la
grandeur de Brest. Richelieu voulait que la France eût une marine.
Le siège de La Rochelle terminé, il s'occupa de ce grand ouvrage.
Le Roux d'Infreville, homme très capable, fut chargé par lui,
dès le 31 mai 1629, de visiter tous les havres de l'Océan et de
choisir l'emplacement de trois arsenaux et, d'après son rapport,
l'ordonnance du 29 mars 1631 règle que les vaisseaux, qui, laissés
jusque-là à la garde des capitaines particuliers, se détériorent
par leur négligence, « seront tous réunis dans les ports de Brouage,
Brest et Le Havre-de-Grâce, entre les mains de trois commissaires
généraux de la marine, qui demeureront actuellement aux dits ports
et havres, lesquels auront soin de pourvoir à la conservation et
au radoub desdits vaisseaux, à l'entretien des matelots pour la
garde d'iceux, et de tenir tous leurs agrès et apparaux et tout
ce qui sera nécessaire à naviguer tellement prêt en des magasins,
que, quand l'on en aura besoin, lesdits vaisseaux puissent être
mis promptement à la mer. Un magasin et des hangars furent aussitôt
construits à Brest. On y mit 10 vaisseaux de ligne et 6 frégates
en construction. Cependant Brest n'était pas encore une grande place
maritime à la mort de Richelieu. Il était réservé à Louis XIV de
l'élever à ce rang. Chose singulière ; elle n'eut d'abord la faveur
d'aucun de ces deux gouvernements. Richelieu préférait Brouage ;
Louis XIV et Colbert, La Rochelle ou Rochefort.
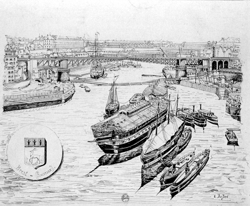
[Le pont tournant et l'arsenal
L'homme qui contribua le plus à créer Brest,
à y fixer l'attention du roi et du ministre, fut Duquesne. Ce grand
marin, qui avait' été donné à Richelieu par d'Infreville, partageait
la prédilection de ce dernier pour cet emplacement. Colbert envoya à
Brest, pour y faire un séjour fixe et y prendre la conduite des affaires
de la marine, un intendant nommé de Seuil, homme également capable et
hardi, avec l'ordre de consulter Duquesne en toutes choses ces deux
hommes éminents se mirent à l'œuvre en 1666, et Brest, fortifié aussi
par Vauban, devint bientôt un port militaire de première importance.
De Brest partit, en 1688, Château-Renault avec l'escadre qui conduisit
Jacques II en Irlande. De Brest partit aussi, en 1690, Tourville à la
tête de 75 vaisseaux de ligne ; c'est encore à Brest qu'il voulait,
deux ans plus tard, attendre l'arrivée du comte d'Estrées et de l'escadre
méditerranéenne, quand Louis XIV l'obligea de partir sans attendre ce
renfort ce qui fut cause du désastre de La Hague. Après ce revers, on
pensa que l'ennemi allait fondre sur Brest, qu'on crut perdue ; mais
Tourville y rassembla, dès 1693, 72 vaisseaux, qu'il emmena dans la
Méditerranée, et Vauban vint occuper la place l'année suivante. «
Votre Majesté, écrivait-il au roi, n'a rien à craindre tous les passages
qui sont sous le château sont à l'épreuve de la bombe. J'ai placé avantageusement
90 mortiers et 300 pièces de canon tous les vaisseaux sont hors de la
portée des bombes des ennemis, et toutes les troupes sont en bon ordre.
Il y a dans la place 300 bombardiers, 300 gentilshommes, 4,000 hommes
de troupes régulières et un régiment de dragons nouvellement arrivé.
Ces forces sont suffisantes pour repousser l'ennemi. » Une flotte
anglo-hollandaise, montée par 10,000 hommes, vint en effet en débarquer
3 000 près de Camaret, mais une résistance vigoureuse les repoussa et
la marée n'étant pas venue à temps pour les reprendre, on en tua 600
et on prit les autres. On frappa une médaille représentant Pallas auprès
d'un trophée naval, avec cette légende Custos auræ et Armoricæ; et
cet exergue Batavis et Anglis ad littus Armoricum cæsis, 1694.

Plan de l'arsenal
Depuis 1681, Brest avait un corps de ville et
des officiers municipaux ; son maire assistait aux états de Bretagne
l'épée au côté, et sa charge donnait la noblesse. La même année, un
édit du roi transféra à Brest le siège de la justice royale du canton,
établie jusque-là à Saint-Renan. Deux ordres religieux s'y étaient établis
dans le cours de ce siècle des carmes en 1651, et des jésuites en 1687.
La population, vers la fin du règne de Louis XIV, s'élevait à près de
15 000 habitants. Mais le séjour des soldats et des marins y avait attiré
des éléments fort impurs, et, dès 1691, le roi avait dû rendre un édit
qui ordonnait aux femmes de mauvaise vie de cesser leurs débordements,
sous peine d'être fouettées en place publique, marquées d'une fleur
de lis et ramenées dans leurs provinces.
Au XVIIIème siècle,
Brest ne fut pas négligée. Elle fut dotée alors du magasin général (1745)
et de la corderie en 1747 qui existent aujourd'hui. Le bagne fut construit
en 1751, la caserne des Marins en 1767, les bâtiments de la voilerie
en 1769; du côté de Recouvrance, trois bassins de construction en 1757,
les ateliers de la sculpture et de la mâture (1771). La plupart de ces
beaux travaux sont l'œuvre de l'ingénieur architecte Choquet de Lindu,
dont le nom peut être associé dans la reconnaissance des Brestois à
ceux de Duquesne et de Vauban. En 1769, le directeur du génie d'Ajot
construisit cette magnifique terrasse plantée d'ormes superbes et longue
de 620 mètres, qui s'élève au bord de la mer, dominant toute la rade,
et que l'on appelle le Cours d'Ajot. En 1776, Brest avait 22,000 habitants,
6,000 hommes de garnison et 2,000 ouvriers attachés à l'arsenal, sans
compter un nombre considérable, mais variable, de marins.
C'est peu
de temps après que la guerre de l'indépendance américaine fournit à
la marine française l'occasion de renouveler ses lauriers. Alors fut
livré à peu de distance de Brest, à la hauteur de l'île d'Ouessant,
le combat de ce nom en 1778, où la flotte française tint tête à celle
des Anglais. Alors s'illustrèrent les Kergariou, les Du Couëdic celui-ci,
dont on voit dans l'église Saint-Louis le monument funèbre élevé par
ordre du roi. La Motte-Piquet surtout fut à Brest, où il acheva sa vie,
l'objet d'une vénération particulière. La population se rangeait avec
respect quand le vieux marin sortait de chez lui, à de rares intervalles,
avec son modeste habit bleu, ses petites épaulettes, sa perruque à marteau,
sa longue canne, plus longue que lui de six pouces, et qu'il tenait
par le milieu, s'y appuyant à cause de ses blessures. Il mourut en 1791.
La Révolution trouva la population et la plupart des marins de Brest
disposés à l'accueillir. Les officiers firent exception presque tous
nobles, presque tous élèves de la marine, et pleins de mépris pour ceux
qui faisaient leur chemin tout seuls et qu'ils appelaient les bleus,
leur première pensée fut de se renfermer dans le fort et de canonner
la ville. Le peuple en fut instruit, et, se formant en garde nationale,
s'empara à temps des principaux postes. Déçus dans leur projet, les
trois quarts des officiers émigrèrent. Les autres continuèrent leurs
menées coupables pour entraîner les matelots à la révolte et correspondaient
avec TouIon, livrée aux Anglais. La municipalité, par une énergie soutenue,
réussissait à peine à les contenir dans le devoir. C'est alors que le
comité de Salut public envoya Jean-Bo -Saint-André et Prieur de la Marne
avec mission de sauver Brest et la flotte. Leurs mesures furent décisives
la plupart des officiers furent emprisonnés à Brest, ou envoyés à Paris
pour y être jugés. Des têtes tombèrent, et la guillotine fut en permanence
sur la place de la Liberté. On créa de nouveaux officiers ; on imprima
au réarmement des vaisseaux une activité extraordinaire. Pourtant on
n'essuya que des désastres, avec des équipages indisciplinés, des marins
sans instruction. Hoche, envoyé là à son tour, le comprit tout de suite.
Il se borna à une entreprise plus restreinte. Il s'agissait d'une descente
en Irlande, que les tempêtes firent échouer au moment de partir, deux
compagnies refusent de s'embarquer avant d'avoir reçu l'arriéré de leur
solde Hoche s'écrie « Je ne veux point d'hommes qui n'ont de mobile
que l'or, » et ordonne qu'elles se retirent sur-le-champ dans un village
à 15 lieues de Brest, privées de l'honneur de participer à l'expédition.
Repentantes, les deux compagnies implorent et obtiennent leur pardon.
Le premier consul n'aimait pas Brest, non plus que son ministre Decrès.
Dans une note dictée par lui le 22 nivôse an XII, il témoigne son mécontentement
du peu d'empressement des citoyens à faire connaître les espions et
les traîtres ; il défend qu'aucun étranger n'entre dans la ville ; il
ordonne que les citoyens de Brest ne pourront circuler dans les rues
après la chute du jour jusqu'au lever du soleil que munis de cartes
à cet effet. Le maire de Brest protesta noblement, au nom des Brestois,
contre ces soupçons.
Brest ne fut pourtant pas négligée sous l'Empire
en 1808, les ateliers occupaient 4,700 ouvriers, sans compter les forçats.
Brest fournit son contingent à l'expédition d'Alger et reçut, en récompense,
la pièce de canon la Consulaire, fondue en 1542, et longue de près de
sept mètres. Elle fut enlevée du môle d'Alger. Le commerce et l'industrie
de Brest, fort actifs, roulent presque uniquement sur l'armement et
la construction des vaisseaux.
Cette ville est, après Rennes et
Nantes, le point le plus éclairé de la Bretagne. Le collège Joinville,
aujourd'hui le lycée, fondé, en 1839, par la commune, et destiné surtout
à former des sujets pour l'école navale, la Société d'émulation, qui
s'occupe de répandre l'instruction nécessaire aux marins, sont des établissements
d'une grande utilité.
Brest est bâtie sur la rive septentrionale
d'une magnifique rade, qui a 22 kilomètres de longueur sur 11 de largeur
et 36 kilomètres de tour, dans laquelle pourraient mouiller 500 vaisseaux
de guerre. Cette rade qui communique à l'Océan par un goulet large de
1,650 à 3,000 mètres et long de 5 kilomètres, est défendue par de nombreuses
batteries. Le port militaire, défendu par le château, est situé sur
la Penfeld et à son embouchure dans la rade ; il comporte tous les établissements
les plus perfectionnés, les mieux organisés pour le prompt armement
d'une flotte de guerre. Il peut contenir 50 navires. C'est autour de
ce port que sont les casernes, les usines, les forges, les corderies,
les magasins généraux, qui forment un des plus beaux arsenaux, non seulement
de la France ; mais encore du monde entier.
La ville, à laquelle
on a annexé, en 1861, une partie de la commune de Lambezellec, est partagée
par la rivière de Penfeld en deux parties Brest, sur la rive gauche,
régulièrement bâtie avec de beaux édifices Recouvrance sur la rive droite
moins propre moins bien bâtie et principalement habitée par les ouvriers
et les artisans. Ces deux parties communiquent par un beau pont tournant
de 527 mètres de longueur, haut de 28 mètres. Ses églises datent du
siècle dernier, la principale est l'église Saint-Louis. Parmi ses autres
monuments ou établissements importants, citons l'hôtel de la Préfecture
maritime, l'Hôpital de la marine, le Musée d'histoire naturelle, avec
un Jardin des plantes ; l'établissement des pupilles de la marine l'École
navale ; l'École des novices ou apprentis marins, la Sous-Préfecture,
le Tribunal civil, le Lycée, le Théâtre, l'Hôpital civil et la Bibliothèque
communale, riche de 30,000 volumes et établie au premier étage des Halles.
Les principales promenades de Brest sont le cours d'Ajot, d'où l'on
jouit d'une belle vue sur la rade, et la place du Champ-de-Bataille.
Le Port de commerce est situé à l'est du Port militaire et au sud de
la gare du chemin de fer ; il a été l'objet de plusieurs améliorations
dont quelques-unes sont encore en cours d'exécution. Le commerce de
Brest embrasse tout ce qui intéresse les fournitures et les approvisionnements
maritimes. On y pêche la sardine, le maquereau il y a des corderies,
des fabriques de toiles imperméables, de chapeaux vernis, de chandelles,
des brasseries, des tanneries, etc. Les principales exportations consistent
en céréales, et les importations en denrées coloniales, en charbon,
en fourniture pour la marine.

Plan du site |
Moteur de Recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.