

Le texte suivant provient d’un ouvrage de
la BNF intitulé « En Bretagne » écrit par Monsieur Alexandre Nicolaï
et qui raconte sa promenade en Bretagne. Le livre est daté de 1893
et imprimé à Bordeaux par Gounoulhou – Editeur.
Promenade à Vitré
Pour peu que vous aimiez, dans les vieilles cités, les vieilles
rues tortueuses ou montantes, les vieilles maisons, les vieilles
inscriptions naïves, les vieilles figurines grotesques ou symboliques
sculptées aux têtes des solives, formes, répugnante aux uns, capable
d'inspirer une terrible passion aux autres, et que de tenir tout
le temps votre nez en l'air ne vous donne pas le torticolis, faites
comme moi allez à Vitré. Mais si, comme il m'est arrivé, vous y
tombez en pleine canicule, en cours de villégiature, choisissez
donc pour votre première promenade à travers les venelles l'heure
de quatre heures. La chaleur commence à baisser, mais pas encore
le jour ; partout, oblique et diffuse, la lumière se promène, adoucie,
dans tous les coins et recoins ; elle semble y fureter, elle s'accroche
à tous les reliefs, elle allume les verrières, elle fait scintiller
les ardoises en écailles des pignons, tandis que l'ombre devient
plus longue et enveloppante. Les peintres, qui connaissent bien
ce moment, savent le mettre à profit pour préparer leurs calmes
soirs d'été ; les dessinateurs le recherchent à cause des alternances
vives des parties d'ombre et des clairs, et l'archéologue qu'il
faut être dans une ville comme Vitré, dont l'histoire et les souvenirs
sont écrits et sculptés dans le bois ou sur la pierre, sait aussi
comme il pourra fouiller à son aise et saisir les détails infinis
qui l'arrêtent et le captivent à chaque pas sans crainte d'envoyer
à tous les diables le soleil aveuglant.
Quatre heures! Les écoliers
sont sortis de la classe par bandes, les bonnes femmes tricotent
au seuil des portes, les logis respirent par toutes leurs fenêtres
grandes ouvertes, les ateliers sont pleins de chants, ta journée
se termine comme elle a commencé, dans un regain de vie et de travail.
Cependant, comme vous avez débarqué du train dans une élégante gare;
qu'autour d'une grande place des bâtisses récentes, blanches, rehaussées
de briques rouges avec des toits d'ardoise, font figure du mieux
qu'elles peuvent; que des arbres plantés d'hier, marronniers ou
tilleuls, entourés de crinolines, mandés de poussière, souffreteux,
demandent de l'eau, de l'eau pour redonner un peu de vert à leurs
feuilles rôties, et qu'une fontaine Wallace s'offre à tout venant,
vous avez pu vous croire, dès en arrivant, dans une sous-préfecture
quelconque, banale et morte, mais où la municipalité aurai montré
le souci d'atteindre au convenable dans le genre moderne.
Deux
hôtels, placés dans un coin, porte à porte, se sont disputé votre
préférence, et pendant une minute vous avez pu vous demander par
quelle flânerie serait tué le temps jusqu'à l'heure de la table
d'hôte.
Voilà que cette perspective n'est qu'un faux nez que
l'on a mis à Vitré, qu'un affreux placard, et qu'à peine êtes-vous
engagé dans la première rue venue, votre étonnement commence. Ce
que vous apercevez, en effet, ne ressemble à rien : c'est un décor
moyen âge à peine soupçonné. Par un coup d'une baguette magique,
brusquement, sans transition, vous êtes transporté, avec un réalisme
d'une étrange intensité, à trois cents ans en arrière, et plus,
bien souvent. Ces pignons bizarres, ces avancements invraisemblables
des étages supérieurs qui surplombent, ces encorbellements superposés,
ces vastes toitures qui semblent écraser les maisons de tout leur
poids, ces lucarnes, ces auvents déconcertent au plus haut point
notre conception moderne d'une habitation.
Comment ces maisons
inclinées, ventrues, Irrégulières, posées de biais, avec des bosses,
des déviations qui les rendent monstrueuses, tiennent-elles leur
équilibre ? Miracle ! Mais voyez-les elles se poussent les unes
contre les autres et se prêtent un mutuel appui; les siècles leur
ont donné une fière chiquenaude, et pourtant elles résistent encore,
vaillants débris d'époques, d'âges, d'hommes, de faits mémorables,
qu'elles nous aident puissamment à restituer.
De temps à autre,
quelqu'une disparait, et c'est grand dommage; le bourgeois de nos
jours veut avoir, comme son ancêtre, pignon sur rue; mais, pour
cela, sur les fondations de la vénérable aïeule, il élève une correcte
bâtisse. Adieu lucarne en haut du toit, adieu les hauts combles
où les charpentes du pignon étaient un chef-d'œuvre d'agencement,
adieu les verrières, adieu la petite niche du saint ou de la sainte,
adieu le porche, adieu les belles poutres et les solives sculptées,
et les garguilles de zinc, de pierre ou de plomb! peu lui en chaut
cela, depuis longtemps, ne lui dit plus rien; il fallait à son ambition
une façade blanche, d'étroites fenêtres, un escalier de pierre.
Puis-je, après tout, lui jeter si fort le pavé, à ce Vitréen, mon
contemporain, moi qui ai si fort à cœur d'être de mon siècle, et
même du prochain. Evidement non ; mais ce que je sais, à n'en pas
douter, c'est que nos maisons, nos faubourgs, nos villes d'aujourd'hui
n'arriveront point à forcer, par ce côté du moins, l'admiration
des postérités futures.
De style, nous n'en avons que lorsque,
d'aventure, nous singeons les modèles du passé. Aussi ne puis-je
que déplorer la rapide ; disparition de ces reliques de la vieille
France. Leur conservation décrétée, leur entretien, leur restauration
seraient encore un pieux hommage à la mémoire des hommes qui passèrent
leur vie à conquérir leurs franchises et à lutter pour elles. Ils
eurent des énergies que nous ne nous sentirions guère, et souffrirent
héroïquement des maux que nous ne connaitrons plus. Il est curieux
de voir une âme sensible comme l'était celle de M'°'' de Sévigné,
qui, pourtant, s'efforçait bien d'être Bretonne aux Rochers, ne
pas trouver un cri du cœur à l'adresse de ces braves bourgeois de
son temps, qu'un gouverneur, Monsieur de Chaulnes avide et vindicatif
rançonnait, lorsque comme il arrivait à Rennes il ne les exilait
pas, avec leurs femmes et leurs enfants, par quartiers, lorsqu'il
ne les faisait pas rouer. Et ceux-là, qui, sous le grand roi, accablés
d'impôts, pillés par les troupes qui sans cesse sillonnaient la
province, trouvaient moyen de racheter par trois fois, à coups de
millions de livres, des édits qui leur étaient aussitôt rendus,
étaient les descendants des huguenots qui avaient traversé toutes
les horreurs de la Ligue, mais terribles, eux aussi, dans leurs
représailles, et des loyaux sujets du baron de Vitré, qui, vers
la fin des longs sièges, en lutte contre l'Anglais, le roi de France,
le duc de Bretagne lui-même ou les seigneurs voisins, venaient apporter
les pierres des murs de clôture de leurs courtils ou de leurs maisons,
alors que les engins manquaient pour rouler sur les assaillants
du haut des mâchicoulis des remparts et du château. Voilà ce que
médisent de leurs courageux habitants de jadis ces tant vieilles
masures aux formes déjetées, lasses de leur âge, décrépites et chenues,
qui demandent des étais en guise de béquilles.
Comment ne pas
songer à tout cela lorsque, dans une même rue, dans la rue Beaudrairie
par exemple, telle maison à pignon est du XVIIème autre
du XVIème, et tel hôtel chargé de sculptures par un artiste
de la Renaissance.
C'est assez dire que tous les styles sont
mêlés ; mais de là vient l'émerveillement des yeux. Avec du bois,
de la pierre, de la brique, voire même du torchis par endroits,
de vulgaires maçons ont fait, sans le secours d'architectes, sans
plans ni devis, en donnant simplement carrière à leur imagination,
des chefs-d'œuvre de charpente, trouvé d'audacieuses combinaisons,
réalisé des problèmes d'équilibre, tout en s'attardant aux détails
les plus minutieux du décor, car les façades sont à plaisir enjolivées
de moulures, de figurines, de bustes. Ils ont fait œuvre durable.
Mais ce qui parait surtout leur avoir tenu à cœur d'éviter, c'est
la monotonie, la régularité ; l'asymétrie est la règle, Ils en ont
fait une beauté. Et comment cela pourrait-il surprendre, alors qu'au
siècle de Lenôtre, sous le règne d cordeau, un poète écrivait qu'un
beau désordre était souvent un effet de l'art ? Cette diversité
surprenante, la plume la plus experte n'en pourrait même donner
une idée ; un crayon fidèle salirait seul donner sa physionomie
à cet échafaudage touffu de boiseries, d'auvents, de lucarnes, de
pignons aigus ou trapézoïdes, de toits, d'épis de faitière, et encore
la couleur n'y serait pas. La vieillesse des choses a pris des aspects
ravissants, le temps a mis amoureusement sur elle sa patine; les
toitures sont tapissées de plaques de mousses jaunes, leurs arêtes
de gramens et de girofles, où viennent s'abattre et picorer des
vols de pigeons sous la poussée des végétations, les ardoises se
sont soulevées dans un hérissement; vous n'imagineriez d'ailleurs
pas la place qu'elles tiennent dans cet ensemble de constructions
; elles couvrent es toits, revêtent les façades elles-mêmes, mais
ici elles sont taillées en losange, et ta elles sont de menues écailles
qui reluisent au grand soleil comme les pièces d'une cuirasse. La
rue Notre-Dame a moins de ce caractère, car elle se distingue par
ses vieux hôtels renaissance avec des piastres, des rinceaux, des
tournelles, des œils-de-bœuf, des meneaux, des linteaux finement
ciselés et fouillés, tandis que la rue Poterie vous amène aux pignons,
aux porches nombreux sous les encorbellements, aux cours resserrées.
Tout ici s'enchevêtre, tant on est à l'étroit ; les escaliers de
bois font saillie ; abrités sous un auvent, ils tournent dans une
cage à jour, envoyant à chaque étage un pont d'allée pour sa desserte
; les pignons, penchés, comme prêts à se laisser choir en avant,
tendent à se rejoindre de chaque côté de rue ; d'une fenêtre à l'autre
on pourrait se donner la main, et le touriste, qui muse et s'étonne
à chaque pas, se promène au travers d'on ne sait quel étrange musée.
Sur de petits balcons, il y a des fleurs, des œillets, des basilics,
des drapeaux, des linges, des oripeaux dont les couleurs vives égaient
les intérieurs sombres dans lesquels on plonge.
La population
ouvrière ou misérable de Vitré grouille dans les logis de ces vieux
quartiers, qu'elle transforme en une Cour des Miracles débordante
de friperie ; elle achève ce qui leur reste de poésie, gâte et dégrade
à plaisir. Le propriétaire lui-même s'est dit « Après tout, cela
tiendra tant que ça pourra. » Les plâtras tombent, les boiseries
sont à nu et pourrissent, les murs s'écaillent et s'effritent, les
ardoises se détachent, et le lamentable reste de la demeure qu'un
bourgeois cossu du XVème siècle éleva, attend patiemment
l'éventrement définitif : sunt-lacrymæ-rerum.
La rue Baudrairie,
la rue Poterie et la rue Notre-Dame, trois rues uniques, trois raretés
les plus difficiles, les plus indifférents ou les plus blasés n'y
sauraient redire. Mais ce n'est là qu'une partie de l'ancien Vitré;
il y a encore le faubourg des Moines et l'industrieux quartier du
Rachapt au pied des remparts et du donjon. A chaque maison, la clé
de voûte porte une date vénérable, souvent une inscription; le noble
ou le bourgeois l'a voulue selon son tempérament, prétentieuse ou
simple; j'aime celle-ci, très naïve, dans la rue d'en d’En-Bas :
PAX-HViC-DOVI-ET-HABITATIVBS AKT-IN-EA-1686
Ces quartiers,
encore admirables, ont été mutités horriblement ; du rempart qui
les enfermait et formait l'enceinte extérieure du vieux Vitré, il
ne reste plus rien, ou peu s'en faut ; à peine, de loin en loin,
un pan de courtine qui subsiste on se demande pourquoi et comment.
Les hygiénistes ont fait une enquête par ici et condamné le tout
en bloc; les trouées ont été pratiquées un peu partout, sous leur
contrôle, pour laisser pénétrer l'air, et les trois antiques portes
que l'on entrait à Vitré, et pourtant leur robuste vieillesse, les
remarquables détails de leur architecture eussent dû leur obtenir
une grâce qu'elles méritaient bien.
J'ai supposé que le touriste
tancé au travers des rues de Vitré, à la découverte du moyen âge,
n'a pu profiter que des dernières heures de son après-midi, en sorte
que la nuit était tombée et l'heure de la table d'hôte depuis longtemps
passée lorsqu'il s'est trouvé devant l'église Notre-Dame. Il s'est
résigné il a rebroussé chemin, remettant au lendemain sa visite
à l'église et au château.
Suite de la Promenade à Vitré
Vitré possède trois églises, dont la plus remarquable est, sans
contredit, l'église Notre-Dame une des productions les plus pures
de l'art gothique en Bretagne, qui en compte tant et de si belles
ce n'est pas que, plusieurs fois remaniée, reprise, agrandie, elle
ne porte en maints endroits la trace de ces ajouts divers, mais
cela encore offre un intérêt de plus au touriste, qui peut suivre
ainsi les transitions de l'art, comme il le ferait dans les pages
d'un livre, en même temps qu'il saisit le moment précis où se manifesta
l'art nouveau qui nous vint d'Italie. La Renaissance n'a pas, en
effet, laissé de poser sa griffe sur telle partie de Notre-Dame;
le résultat inévitable de son influence est cependant ici à peu
près négligeable, et ce qui reste de cet art breton du XVème
et du XVIème' siècle, qui fut vraiment national et le
demeura à une époque où les artistes français avaient perdu les
traditions des vieux maîtres du XIIIème siècle, édificateurs
de cathédrales, est de tous points admirable. Car la Bretagne, cette
réfractaire invétérée, le fut en art comme en politique; une des
dernières entrée dans ce mouvement de centralisation, dont se servit
si habilement la royauté pour uniformiser nos vieilles provinces,
elle multipliait ses calvaires, ses chapelles, ses abbayes, ses
clochers, ses églises incomparables, conservant dans sa splendeur
le type clunisien, alors que partout, et depuis longtemps déjà,
architectes et sculpteurs de la Bourgogne, de l'Ile-de-France ou
du Poitou en étaient aux ornementations précieuses, aux fioritures,
aux surcharges, aux miniatures de la Renaissance.
Fait peu commun,
et par suite à signaler l'église Notre-Dame n'a pas souffert davantage
des retouches modernes; sa flèche, réédifiée en 1858, est bien en
harmonie avec le caractère général de l'édifice. Elle a remplacé,
non sans hardiesse, la flèche primitive de 1420, définitivement
ruinée par un incendie en 1704, après d'innombrables vicissitudes.
Encore n'a-t-elle pas péri tout entière pour nous, puisqu'un vieux
tableau, dans la chapelle Sainte-Anne, nous en a gardé la très fidèle
représentation.

La nef principale, les latéraux, les deux bras
du transept, le chœur fourmillent de détails ou de motifs d'une
réelle et piquante originalité, les inscriptions aussi sont nombreuses,
et certaines, parfois, trop longues les unes perpétuent la mémoire
de donateurs généreux qui pensèrent, de cette façon, prendre soin
de leur âme, et les autres nous parlent de seigneurs et de nobles
dames trépasses depuis des siècles. C'est ainsi que de l'abside,
derrière le maître-autel une petite pierre tombale rappelle ce que
fut l'une des puissantes châtelaines de Vitré; l'épitaphe, creusée
dans la pierre en caractères du temps, n'est rehaussée que par un
écusson aux armes des maisons de Laval et de Retz. La voici dans
sa simplicité :
« CY-GIST MADAMME MARIE ; DAMME ET HERITIERE
DE RAIX ; JADIS EXPOVSE DE HAVLT ET PVISSANT MONSIEVR ANDRE DE LAVAL
EN SON TEMS SEIGNEVR DE LOHEAC ; DE LAUVEAVX ET DE GVERGOBLAY ;
MARECHAL DE FRANCE LAQVELLE DAMME TREPASSA LE PREMIER JOVR DE NOVEMBRE
DE LAN MIL IIII~ LVII »
Par ailleurs on trouve encore les
armes de Laval dans la chapelle Saint-Roch, celles de Bretagne et
de Pierre Landais aux clés de voute des chapelles de Saint Jean-Baptiste,
Saint-Sébastien. Le jubé date de 1491, les bénitiers de 1593, une
porte de sacristie, basse, en ogive; une crédence de belle dimension,
dont le sculpteur n'acheva pas le travail demeuré tel quel; des
grotesques, grimaçants aux chapiteaux, certains d'une curieuse conception,
attestent assez l'ancienneté de ce latéral gauche. Quant aux verrières,
d'où tombe sur les dalles une lumière tamisée et multicolore, elles
sont uniques. Une seule,«' intacte, qui représente l’entrée triomphale
de Jésus Christ à Jérusalem daté de 1537 éclate dans toute sa splendeur,
et combien vénérable par son ancienneté, combien riche par ses nuances
adoucies, combien poétique par les têtes et les attitudes naïves
de ses personnages maigres, émaciés, mystiques dans leurs tuniques
aux teintes vives. Morceau superbe qui fait assez regretter les
richesses perdues dont il reste par ailleurs de trop maigres fragments,
que ne réussiront pas à faire oublier les très beaux vitraux modernes
qui les ont remplacés.
Dans la chapelle Sainte-Anne, voici encore
un bijou de haute valeur un triptyque où, sur trente-deux émaux
d'une irréprochable fraîcheur, est retracée la vie du Christ et
de la Sainte Vierge. Il est l’œuvre d'un émailleur limousin du XVIème
siècle, Jean-Baptiste Perricaud, l’'un des fameux Perricaud. Artistes
de père en fils, ils se perfectionnaient et se livraient les secrets
de leur fabrication, et, comme des souverains, signaient Perricaud
I, Perricaud II, Perricaud III. Au dos de la boiserie de chêne qui
les encadre et les enferme, vingt-quatre rimes, qui ne durent pas
mieux valoir alors qu'aujourd'hui, nous font connaître le nom du
donateur, sieur Jehan Bricier, qui montra évidemment par là le souci
d'arriver, à sa façon, à ta postérité :

Donné céans fut ce
tableau
Par un nommé Jehan Bricier,
Qui escripvit cet escripteau
Et le dicta tel que voiez,
La veille de Noël, croiez,
Que
l'on disait mit et cinq cens
Quarante et quatre bien comptez
Et lui cousta cinquante francs.
Les histoires qui sont dedans
De Limoges en apporta ;
Et Robert Sarul, point ne mens,
Le
bois tailla et assembla ;
Puis, maistre Jacques l'étoffa
Qu'on
appelle de Loysonnière.
Mais savez-vous qui le ferra ?
Fut
Jehan Bernard Ragotière,
Si ce dicton vient à lumière,
Vous,
mes leurs qui le trourerez,
Je vous supplie faire prière
Pour
les âmes des trépassez
Que Dieu veuille pardonner ;
Car je
vous notifie tous
Quainsi pour les défunts prierez
Tous ainsi
l’on prira pour vous.
Amen maître Jehan Bricier, et qu'il
soit fait selon votre volonté !
Les statues, les tombeaux anciens
et modernes ne manquent pas dans les quatorze chapelles des bas-côtés;
ils témoignent, pour la plupart, de la reconnaissance des ouailles
de Notre-Dame pour leurs aumôniers et pasteurs, et ne se rapportent
que de loin, par suite, au côté plus spécial qui nous touche. Cette
visite à Notre-Dame, si rapide qu'on la veuille, n'est pas, on le
devine de reste, sans prendre quelque temps, surtout si t'en a laissé
travailler le crayon, qui a fort à faire, et cependant on ne peut
s'éloigner sans donner un coup d'œil aux façades. Celle du midi
est, en effet, particulièrement digne de retenir l'attention par
la succession de ses pignons, de ses contreforts surmontés de pinacles
très finement travaillés et non moins variés, et aussi par ses rosaces,
ses baies, ses balustrades ajourées, qui sont du meilleur gothique
flamboyant. On ne peut surtout passer auprès de la porte latérale
percée dans cette façade, sans admirer une chaire extérieure, qui
est un des plus curieux spécimens de ces sortes de tribunes en plein
vent, dont on ne compte pas, que je sache, plus de trois ou quatre
en France (1). Il en est qui prétendent qu'aux jours de grande fête
carillonnée, alors que la grande nef ne pouvait contenir la foule
du peuple, le prédicateur la haranguait sur la place publique, du
haut de son édicule. Selon d'autres, l'origine de ces chaires remonterait
aux époques troublées de la Ligue, où les prêches auraient été contradictoires
entre catholiques et huguenots.
Les deux prédicants traitaient
un sujet convenu, se mesuraient corps à corps dans une lutte toute
de casuistique, se jetant les auteurs sacrés et la Bible à la figure,
et terminant aussi par de grossières invectives, en guise de péroraison,
lorsque l'argument, démoli, ne les servait plus. Le grotesque frisait
le sublime couramment; mais on en vit d'autres du temps du sombre
Agrippa d'Aubigné et de l'auteur de la Satyre Ménippe.
Elégante
et fine, composée d’une caisse sobrement ornementée, supportée par
un pédicule octogonal et d'un dais en forme de pyramide surmonté
de crochets, d'aiguilles et de pinacles, cette chaire extérieure
ajoute, de façon aussi agréable qu'imprévue, au décor de cette façade.
Vite, je prends mon bloc de papier cançon, mon pinceau en quelques
minutes, j'ai une très satisfaisante impression à l'encre de Chine.
Une jeune fille, tentée comme je l’ai été, s'applique à en obtenir
autant à l'aquarelle ; elle pignoche encore que je m'apprête à lever
la séance, en quête d'un motif nouveau. Mais la place est bonne
; mon œil a rencontré, en l'air, suspendue, avançant, menaçante,
horrible, hérissée, gueule ouverte, une incomparable gargouille
en plomb repousse. Elle figure un chien chimérique, apocalyptique,
des airs de dragon au dos, un carcan fleurdelisé au cou; c'est sur-
tout quand il pleut et qu'elle vomit t'eau des dalles que l'on peut
dire « cave canem ». J'eus, à ce moment, le plaisir de la découverte,
car personne ne me l'avait signalée. Violet- le-Duc la relève dans
son Dictionnaire d’architectures où la reproduction qu’il en donne
n'est pas précisément d'une exactitude irréprochable. Cette guivre
est à l'angle sur rue d'un des vieux et beaux hôtels de Vitré, l’hôtel
Hardy, devenu hospice aujourd'hui. Il a fort grand air, et ne sent
certes point la ruine On compte, d'ailleurs, pas mal de ces anciennes
demeures, pleines de souvenirs, dans Vitré ; quelques-unes furent
même princières, comme celle de la princesse de Tarente, dont M"
de Sévigné a si souvent parlé dans ses lettres datées des Rochers
: l'habitation remparée de Pierre Landais, entre autres, et l’hôtel
de la famille de Laborderie, sur la place dit Manche, méritent d'être
cités. Les lucarnes, les tournelles et les hauts combles surmontés
de girouettes sont très intéressants, et j'en pris un sommaire croquis.
Le délabrement de quelques-unes de ces vieilles habitations navre,
tant sont pénibles à voir les ruines de leur ancienne splendeur.
Mais, à ce propos, une remarque qui trouve bien ici sa place, attendu
que je la fis sur les lieux mêmes., Il y a très peu d'années encore
que le moyen âge et les chefs d'œuvre qu’on nous a légués étaient
incompris, pour ne point dire méprisés. Ce dédain partait de très
haut les pontifes officiels de l'art le professaient ouvertement,
réservant toute toute leur prose laudative et leurs travaux de reconstitution
à la célébration exclusive d'antiquités qui nous touchaient bien
moins que les antiquités grecque et latine. Ils étaient une Église
en dehors de laquelle aussi point de salut. Les vieilles maisons
de nos aïeux ? taudis incommodes et enfumés, logis irrespirables
Leurs châteaux ? architecture surannée, sans caractère, négation
même du confort, repaires de brigands pleins d'ombre ! Seules, quelques
vieilles cathédrales trouvaient grâce devant ces classiques forcenés,
qui oubliaient qu'en fait de classique notre art national, dans
toutes ses manifestations et à toutes les époques, devait l'être
en premier. Enfumées, ces maisons à pignon ces hôtels Renaissance,
ces manoirs ! Excusez du peu, Messeigneurs ! Heureusement qu'une
pléiade de novateurs, qui ont été des révolutionnaires, est venue
mettre un « holà ! » qui s'était, hélas ! trop fait attendre, puisque
nombre de merveilles avaient déjà péri, alors qu'il était encore
à peine temps d'en sauver tant d'autres. D'un trait de plume on
avait ainsi biffé de nombreux siècles de notre histoire de l'art.
On avait jugé toute une époque, et avec elle une innombrable suite
d'artistes inconnus, d'après ces maisons à pignons, croulantes de
vétusté, noires dans les rues étroites, oubliant qu'elles étaient
bien les seules demeures que pouvaient avoir nos aïeux, dans les
faubourgs rétrécis qui se pressaient, à l'abri des enceintes, jusques
au pied du château d'où leur venait aide et protection. Mais encore
combien variées, combien ornées dans leur fruste robustesse, combien
durables aussi ! Partout des sculptures, des bustes, des feuillages,
des moutures, des rinceaux, des escaliers, des charpentes qu'on
ne fera plus. Mais, à côté de ces humbles, ne trouvons-nous pas
les beaux, les vastes, les splendides hôtels, construits en belle
pierre de taille, en granit même, avec de hauts combles, de larges
cours, des baies spacieuses, des salles commodes, bien disposées,
dont le luxueux aménagement étonne parfois ?
On avait surtout
péché par ignorance les Henri Martin, les Michelet, les Violet-le-
Duc, les Du Cleuziou, les Fustet de Coulanges, et bien d'autres
d'aussi bonne compagnie, vinrent donner à ces études du moyen âge
toute l'importance qu'elles devaient avoir ; la vieille Eglise n'est
pas morte, sans doute, mais la jeune grandit auprès d'elle. La Commission
des monuments historiques a fait, de son côté, de très bonne besogne
en peu de temps, et les effets de l'intervention de l'État se font
sentir un peu partout. C'est fort heureux, et c'est pourquoi ceci
méritait d'être dit en cet endroit.
Sur le côté d'une grands
place où nous débouchons au sortir du dédale d'étroites et sombres
venelles que nous suivons depuis te grand matin, le château nous
apparait tout à coup, énorme, massif, avec ses hautes courtines,
son Châtelet, son donjon et sa ceinture de tours rondes ou carrées,
dont les combles ardoisés pointent de tous côtés par-dessus les
murailles. Celte première impression n'est pas seulement saisissante,
elle est étrange ici, des pans de remparts écroutés, une brèche
béante ; là, un superbe ouvrage tout de neuf restauré, attestant
la persistante puissance de ce formidable repaire de barons, et,
comme partout, au milieu d'une poussière dorée par le soleil, des
escouades d'ouvriers travaillent la pierre, scient les. madriers,
portent la chaux ou le mortier, tandis que claquent les fouets,
piaffent les. percherons et se déversent les tombereaux avec un
grand bruit de cailloux froissés. Il semble que vous tombiez à l'improviste,
au lendemain même d'un assaut, dans une de ces rares trêves que
le seigneur employait à la réparation rapide de ses défenses endommagées.
Mais les fossés sont vides, les grenouilles n'y chantent plus à
la lune par les belles nuits d'été, la sentinelle ne veille plus
dans les échauguettes; dans les chemins de ronde le pas du touriste
résonnera seul désormais, et si, chaque jour, les manœuvres de ce
chantier au plein air s'attachent à faire disparaitre la ruine,
le bon château a assez guerroyé, subi de chocs, repoussé d'escalades,
il a fait jusqu'au bout son loyal service, et c'est un glorieux
et pacifique repos qu'on lui réserve, puisque sa vaillance se perpétuera
encore à travers les siècles. Comme aux vieux guerriers blanchis
sous le casque, on lui assure ses invalides pour que, longtemps
encore, le camarade des premiers jours et des héroïques luttes domine
sur ces toits qui se pressent et grouillent jusque dans son ombre,
sur ces faubourgs populeux qui grandirent sous sa protection jusqu'à
l'heure où, forte et débordante, la ville brisa l’étroit corset
que tes remparts faisaient à sa taille.
Une passerelle volante,
jetée sur le fossé en guise de pont-levis, donne accès sous une
poterne cintrée qui s'enfonce très basse dans toute l'épaisseur
de ce colossal ouvrage qui est le Châtelet. Avec ses deux énormes
tours jumelles coiffées de hauts combles pointus, Lardées de mâchicoulis
reliés au-dessous du chemin de ronde par un gracieux détail d'architecture,
gothique, ses tourelles, ses archères, ses lucarnes et ses cheminées,
cette défense, aussi forte qu'un donjon, présente un ensemble très
complet, aux proportions à la fois géantes et harmonieuses.
Sous la herse, au lieu et place du guichetier d'antan préposé au
service du pont-levis, un concierge bien moderne fouille déjà dans
son trousseau de clés, et, sans plus tarder, il nous fait gravir
à sa suite l'escalier en vis d'une tournelle qui dessert les trois
étages de cet ouvrage militaire du XIVème siècle, aujourd'hui
transformé en bibliothèque municipale et en musées. Il va sans dire
que des vénérables in-folio rangés dans un bel ordre, nous ne voyons
que les cotes dorées, presque confus de troubler le silence dans
lequel une demi-douzaine de travailleurs compulsent des archives
qui sont, parait-il, du plus haut intérêt. Mais nous voici bien
à notre affaire ; dans un pêlemêle qui n'est pas sans charme parce
qu'il est plein d'imprévus et de rapprochements inattendus, sont
disposés des émaux, des ivoires sculptés, des missels enluminés,
de vieilles serrures, des statuettes, des verreries, des vitraux,
des ornements religieux, des instruments de supplice effrayants
des chevalets, des coins, des pinces, des tenailles, des carcans
qui rappellent d'horribles pratiques de tortionnaires ; des arquebuses,
des cuirasses, tout un arsenal de pertuisanes, d'épées, de lances,
de mousquets, de coulevrines, de pierriers, de boulets des tapisseries
aux murs ; à terre, des dalles surchargées de blasons ou d'inscriptions
gothiques dont chacune parle d'un trait de l'histoire locale de
Vitré, des gargouilles, des épis de faitière, des bahuts admirables,
un entassement enfin de trésors archéologiques à donner la fièvre
quarte à un antiquaire. Et c'est, ma fois une très heureuse idée
qu'on a eu là de confier â cette séculaire gardienne de la ville,
encore que bien amoindrie, te dépôt de ses anciennes richesses.
Pour gagner l’autre tour, où sont aussi d'autres musées, nous nous
engageons sur le chemin de ronde pratiqué au couronnement du Châtelet.
Le passage y est périlleux ; par les trous des mâchicoulis qu'il
faut enjamber, le vide au-dessous est effrayant, la paroi de la
muraille glisse vertigineusement dans le fossé, qui paraît une simple
tranchée. C'est de là que tes assiégés du château envoyaient sur
les assaillants les blocs de pierre, les moellons, les projectiles
de toute natures emmagasinés dans les arsenaux supérieurs. Ils tombaient
à pic les uns sur les autres, après avoir heurté le pied des lices
extérieures, rebondissaient avec une violence accrue par la rapidité
même de la chute, décimant et déconcertant les hommes occupés aux
travaux d'approche. Au travers des étroites meurtrières qui nous
envoient un maigre jour, les arbalétriers lançaient leurs carreaux,
leurs traits, et l'ouvrage se défendait ainsi, par ses tirs plongeants
combinés, tant que les bombardes de l'ennemi n'étaient pas arrivées
à le rendre intenable par la destruction des hourdages. La hauteur
même de ce Châtelet et son commandement élevé sur les courtines
le protégeaient d'ailleurs efficacement contre les tirs à la volée
des lourdes et peu fortes pièces de l'artillerie du XIVème
et du XVème siècle, ce qui était d'autant plus nécessaire
que la poterne donnant entrée dans la seconde enceinte de la place,
et par laquelle nous sommes entrés tantôt, était à sa base. La première
enceinte a disparu aujourd'hui ; il n'en reste plus guère que des
vestiges sur lesquels chevauchent les toits et les maisons ; mais
quelque chose subsiste encore de la disposition militaire du château,
et la grande place ensoleillée sur laquelle nous plongeons était
la première cour intérieure, ce que l'on appelait la baille.
Là, le seigneur avait disposé les écuries, les dépendances, les
logis qui eussent encombré son dernier réduit ; mais l'œuvre des
démolisseurs a été complète, et lorsque, dans quelques années, les
maigres arbres déjà plantés auront grandi et développé leurs frondaisons,
les jolies filles de Vitré feront de ce nouveau mail leur promenade
favorite du dimanche, là où se livrèrent de terribles combats.
Car l'ennemi n'avait pénétré dans la baille qu'après de longues
semaines de siège, ses travaux stratégiques à peu près terminés,
une fois les avancées prises, les cavaliers enlevés, les fossés
comblés de fascines, les beffrois appliqués contre les courtines.
Lors- qu'il arrivait au pied du Châtelet, il se trouvait en présence
d'un second ouvrage fortifié, de remparts, de tours encore plus
puissantes que les premières, d'un fossé nouveau, en sorte qu'il
avait un dernier siège à entreprendre, toujours plus laborieux que
l'autre. Il ne pouvait plus se développer à l'aise, n'ayant d'espace
que celui de la baille tandis que toutes les forces vives du château
étaient concentrées en quelques points seulement, les plus vulnérables.
Mais l'investissement était complet, et à partir de ce moment la
famine devenait un des meilleurs adjuvants de l'assiégeant. Par
contre, les longueurs de l'opération pouvaient donner le temps à
un allié d'accourir et de délivrer le château, en forçant les troupes
d'attaque à lever précipitamment le siège, ce qui arrivait souvent.
Mais la brèche que l'on voit encore au flanc du château, tout en
démontrant le système stratégique en usage dans les sièges de l'époque
féodale, nous révèle combien le dernier assaut fut fatal.
Dans
les combles du Châtelet, ces salles où étaient accumulées en tout
temps les provisions de projectiles, comme en un arsenal sont empilés
de nos jours bombes et obus, vides maintenant, noires sous les charpentes
dénudées, prennent aussitôt à nos yeux un intérêt rétrospectif;
leur fonction se révèle à nous, et là où les grosses araignées recommencent
en paix leur toile de Pénélope, on se figure bien, un jour d'assaut,
le va-et- vient affairé des hommes d'armes, des arbalétriers qui
vont rejoindre leur poste auprès d'une meurtrière, munis de carreaux
et de sagettes, des servants disposant dans un bon ordre les blocs
sur le rebord des mâchicoulis, dans les baies des créneaux, sous
la direction vigilante du capitaine de la Tour.
Par une porte
pratiquée entre deux merlons à l'extrémité du chemin de ronde, nous
entrons dans une nouvelle salle convertie encore en musée. Il y
a des tableaux ici, des anciens et des modernes à l'avenant, de
riches tapisseries à peine protégées contre la lumière qui mange
leurs fines nuances, et la vermine qui les attaque plus sûrement,
avec, plusieurs endroits, de maladroites réparations qui sont autant
de sacrilèges. Entre cent vieilles gravures intéressantes, j'en
choisis une, point très compliquée d'ailleurs, dont j'essaie un
fac-similé. Sur un fond de bibliothèque s'enlève la caricature d'un
procureur qui ne devait précisément pas être tendre aux plaideurs
et que ses contemporains n'épargnèrent du reste point, si j'en juge
par le quatrain ci-dessous que j'ai fidèlement retranscrit avec
les quelques lignes de prose qui l'accompagnent, sans doute parce
que le vers fut encore trouvé insuffisant- ce qui m'induirait à
flairer là-dessous une petite vengeance personnelle de l'artiste :
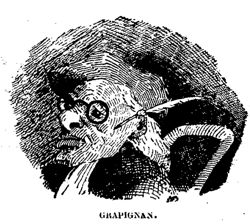
« Tu vois de Grapignan un portrait sans égal !
Des mauvais
procureurs il est vrai model.
Si sa mine à tes yeux parait sans
parallèle,
Dans l’art de bien pillé, il fut l’original.
» Et au-dessous
« Mr Roc de Grapignan successeur de la
Ruine de la friponnerie, grippe sur tout dans tout Lieu, Procureur
Général au Chatelet de Paris né en 1666 et mort trop tard 1741 ».
Pas mal de bibelots délicats à signaler dans ce beau désordre où
tous les genres et toutes les époques sont confondus; mais Dieu
me garde d'en essayer un catalogue. Je ne puis toutefois passer
sous silence quelques vitrines garnies de remarquables pièces de
vieille faïence; dans le nombre je distingue un grand plat, daté
et signé de 1762, dont l'origine de fabrication m'échappe. Le sujet
du milieu, très naïvement peint d'ailleurs, représente le martyre
de saint Sébastien, lié à un poteau, lardé de flèches, sa face est
pitoyable et; sans doute pour l'exalter dans sa souffrance, la Vierge
portant l'Enfant Jésus s'avance vers lui costumée en bonne paysanne
bretonne. Une légende complète le tout, et je m'attends à vers latin
ou une sentence en vieux françois, et voilà que je recueille la
singulière mais gauloise notice que voici, dans un mauvais jargon
« Bastien amleu Marie Simon quans il est à la maison il anbrase
Marion et quans il n’y est pas il senpas » Je n'ai vu que l’étrangeté
de la devise rapprochée du motif religieux et suis peut-être bien
passé à côté d'un rébus. J'ai toujours montré si peu de goût pour
ce genre d'exercice que nul autre peut-être n'y est plus maladroit
que moi, et je laisse, à qui voudra, le soin de trouver la solution.
D'une lucarne, Vitré nous apparait, mais nous n'en saisissons que
les fumées, les toits, les colombiers, les hauts combles ardoisés
des vieux hôtels, les pignons pressés les uns contre les autres
et puis des horizons de verdure sans fin, des vallonnements de coteaux
et, par-dessus les mille rumeurs qui montent dans l'air, de grands
vols d'hirondelles et de pigeons qui farandolent sans trêve. Dans
la cour où nous nous retrouvons après une descente de degrés aussi
fatigante que l'a été la montée, se dresse le donjon, la tour Saint-Laurent,
relié au Châtelet par de fortes courtines ; il n'a plus d'ici cet
aspect de masse écrasante que lui donne du pied même des remparts,
ou encore vu du faubourg du Rachapt, une élévation de cent quarante
pieds. Les proportions en sont néanmoins superbes, et la très complète
restauration qu'a subie cette défense du château lui à tout rendu
de son fier caractère d'autrefois. Les travaux qui s'y font encore
et les échafaudages qui barrent la poterne d'accès ne nous permettent
pas de la visiter intérieurement, à notre grand regret. Là, d'ailleurs,
comme dans le château somptueux du XVIIème siècle, hier
encore aménagé en prison, ce contre-temps nous épargne une désillusion,
car où sont les belles salles dorées dont nous parle Mme de Sévigné
dans une lettre que tout le monde a lue ? De ce grand bruit qui
s'y mena durant la tenue des Etats d'octobre 1689, de la bonne chère
que l'on y fi, des beaux discours qui s'échangèrent, des extravagances
que l'on y applaudit, rien plus ne reste qu'un charmant souvenir,
une gazette de cette aimable femme qui se croyait Bretonne pour
tout de bon aux Rochers.
Le donjon avait d'ailleurs connu d'autre
temps plus glorieux où certes on ne songeait point à hausser les
portes pour faire passer les pyramides de fruits. A son âge héroïque,
avant que fussent percées les grandes baies et les fenêtres aux
meneaux de pierre qui, dès le XVIème siècle, aérèrent
ses flancs en égayant sa façade, il était sombre et morose comme
le farouche baron qu'il abritait. Dernier repaire au moment où la
lutte était devenue suprême, il tenait bon au milieu des ruines,
des écroulements et de l'incendie, jusqu'à ce que son dernier défenseur
ait disparu dans les profondeurs ténébreuses du souterrain pratiqué
dans son infrastructure. Il était le nid de d’aigle. Rude et peu
commode la vie qui s'y menait ; bien restreintes les aises, bien
longues les heures.
Aussi, dans la pénombre du donjon, les châtelaines
fleurissaient-elles blanches comme les lys et sveltes comme eux
; dans ce refuge guerrier, elles étaient la seule chose humaine
et douce qui pénétrât et s'épanouit ; elles dévidaient et filaient
dans le maigre rayon de jour qui tombait des vitrières plombées,
pensives et sérieuses. Que de fois, au cours de ces voyages que
l'on fait dans le rêve, à travers les temps et les espaces, ne les
ai-je pas surprises, mouvements abandonnés au fond du grand fauteuil
de chêne, sous le dais armorié, ces cloitrées d'antan. L'une laissait
le missel enluminé s'échapper de ses doigts effilés ; l'autre, dans
le mouvement machinal du rouet, pensait au troubadour de t'année
d'avant dont le vers et la viole avaient charmé ses oreilles, quand
sa jeune image ne s'était pas gravée au plus profond de son cœur,
et celle-ci ne pouvait plus détacher sa pensée du chevalier qui
prit ses couleurs en quittant le château et lui jura de combattre
avec son souvenir toujours pour ange gardien. A côté de ces poétiques
figures effacées dans de gris lointains, mystiques autant que belles,
il y en a qui sont les pécheresses d'amour, les grandes passionnées
dévorées d'une soif jamais assouvie de dévergondages et de cruautés.
Pourquoi donc aucune de ces disparues ne nous a-t-elle laissé sa
chronique que je vous aurais contée aujourd'hui ?
Une fatalité
voulut que, par quatre fois en quatre siècles, les châtelaines de
Vitré, femmes de barons guerroyeurs en lutte constante avec leurs
voisins, l'Anglais, le duc de Bretagne lui-même et aussi le roi
de France dont ils bravèrent maintes fois les armées, laissassent
tomber la maison en quenouille. C'est ainsi que la baronnie passait
de la famille de Vitré aux Laval, des Laval aux Montfort-Laval,
puis et successivement aux Rieux, aux Coligny et, en dernier lieu,
aux La Trémoille.
L'histoire de Vitré est intimement liée à
celle de ses seigneurs, et nombreuses furent les vicissitudes des
uns et des autres sentinelle avancée aux marches de Bretagne, la
place forte reçut tous les chocs en ces temps troublés où la guerre
était à était permanent.
Chaque siècle cependant trouvait le
château plus formidable, la ville plus florissante ; les faubourgs
s'ajoutaient aux faubourgs, les collégiales remplaçaient les chapelles
; l’'église Notre-Dame, dès le XIVème siècle, élançait
bien haut dans les airs sa fine flèche gothique. Les barons, entre-temps,
étaient de toutes les croisades; plus tard, ils déciment les bandes
des Anglais, ils luttent avec les ducs de Bretagne pour l'indépendance
de la province, jusqu'au jour où, le sort des combats les abandonnant,
ils ouvrent, en 1488, les portes de Vitré au roi de France, après
la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.
Mais le XVIème
siècle arrive avec ses troubles et ses discordes fratricides, le
sang coule partout ; on est catholique ou huguenot un peu comme
souffle le vent. Un incident vient mettre le feu aux poudres Renée
de Rieux, plus connue sous le nom de Guyonne la Folle, a été divorcée
d'avec son mari et excommuniée ; de dépit, elle se fait protestante,
et la religion réformée entre dans Vitré ; les nobles, les bourgeois
dépendants de la maison se font huguenots avec leur châtelaine ;
des temples s'élèvent, des prêches sont partout institues, un synode
est même convoqué et réuni. Le château, assiégé par les forces de
la Ligue, et la ville sont à deux doigts de leur perte ; on est
à la veille d'une reddition, et les représailles eussent été terribles
sans l'arrivée de troupes de secours.
La chaire extérieure, devant
laquelle nous nous arrêtons dans la cour, date de cette époque;
la prédication s'y faisait. Elle est Renaissance ; mais, bien que
surchargée d'ornements, de frises, de moutures, de rinceaux, le
travail et le style en sont d'une remarquable pureté. Sur la caisse,
où sont trois fois répétées les armes des Laval, au centre d'un
médaillon très fouillé, il y a une inscription « POST TENEBRAS SPERO
LUCEM ». Le dôme trilobé qui la protège, revêtu de menues écailles
d'ardoise, est sur le calvinisme avait poussé des racines profondes
; on crut l'avoir extirpé en 1636, et l'on célébra un solennel Te
Deum. Au- XVIIème" siècle, le château chôma, les mœurs
s'étant adoucies ; il devint demeure princière; son histoire est
finie et notre visite aussi.
Six heures du Matin, 4 septembre.
Je n'ai pas voulu quitter Vitré sans voir le Val et contourner le
château dont les tours et les remparts dominent de ce côté, du haut
de roches escarpées, un petit faubourg des plus pittoresques. C'était
une heure délicieuse, et je l'ai notée. Le soleil, déjà haut, buvait
les rosées qui partout faisaient la perle ; dans la fraicheur du
matin, sous un ciel limpide, le paysage était reposé, comme lustré.
Par une poterne pratiquée dans la muraille, à peu près à la hauteur
de la place de la Mairie, j'étais sorti de la ville à peine éveillée,
et, sans transition, je m'étais trouvé en pleine campagne. D'un
côté, les pans lisses des courtines flanquées de tours ; de l'autre,
un précipice de verdure où le regard plongeait surpris, émerveillé
; dans les bas-fonds serpentait le mince et blanc filet d'une route
aperçue seulement au travers de rares trouées. De tous côtés, des
sifflements d'oiseaux auxquels se mêlaient des bruits de battoirs
venus de la Vilaine, le heurt métallique et régulier d'un marteau
sur une enclume dans quelque forge en travail ; c'était un concert
de rumeurs paysannes dans le calme de cette matinée de septembre.
Dans l'ombre, le rempart avec ses accidents semblait on ne sait
quel décor prodigieux, immensément haut ; à tous les interstices
où les mousses et les fougères avaient pu s'accrocher, il y avait
des touffes vertes, des plaques de velours ; sur les crêtes, elles
faisaient des aigrettes déjà léchées par le soleil. Bientôt la ville,
passant par-dessus la muraille, s'identifie avec elle ; les pignons,
les lucarnes, les galeries chevauchent sur elle ; ce sont des encastrements
audacieux, bizarres, et ces pygmées suspendus, accolés au flanc
de ces puissantes maçonneries, prennent les formes les plus invraisemblables,
les plus imprévues et aussi les plus romantiques. Mais, chemin faisant,
j'ai trouvé ce que je cherchais ; des boulets en- castrés dans la
pierre, proche la première tour, rappellent un des plus glorieux
épisodes de l’histoire du château. Dans les premiers mois de l’année
1589, le duc de Mercœur, à la tête des forces de la Ligue, était
venu poser le siège autour de Vitré. Les faubourgs étaient tombés
en sa possession ; la place, vivement canonnée était déjà mise à
mal les opérations cependant trainaient en longueur, grâce à l'héroïsme
des défenseurs commandés par te seigneur Du Bordage. Le duc voulut
frapper un grand coup ; le château lui parait vulnérable du côté
du Val ; il l'attaque vigoureusement la sape et la mine ébranle
une tour la brèche était faite ; mais ta Ligue n'entre pas encore.
Une forte armée de secours arrive sur ces entrefaites, et le duc
lève le siège en toute hâte. C'est cette mémorable défense que les
habitants de Vitré ont voulu perpétuer en plaçant sur la courtine
réparée l’inscription suivante :
« CESTE PLACE FVT ASSIEGEE
LE XXII DE MARS. LA PRESENTE BRECHE FVT FAITE XXIII DE JVING ; LE
DIT SIEGE FVT LEVE LE XIV AOVST PAR LA CRAINR DE HENRI DE BOURBON
PRINCE DE DOMME. LA DICTE BRECHE REFAITE LE …BRE PAR HENRY ROY DE
FRANCE ET DE NAVARRE.
Comme les boulets du duc avaient également
endommagé la cloche de Notre-Dame, une autre inscription commémorative
fut placée sur cette dernière, que l'on voit encore*.
Maintenant,
à mes pieds, la Vilaine, ainsi qu'un ruban d'argent, serpente entre
les lavoirs animés, les usines, les mégisseries et le double cordon
de peupliers gréles qui déjà jaunissent, mordus par les première
brumes d'automne.
Oh! la charmante impression que j’eus ce matin
là
Par une rapide descente, je retombe dans les faubourgs du
Rachapt et d'En-Bas; on travaille partout, c'est le quartier industriel.
Une délicieuse et svelte tour de guette le domine; j'en fais le
sujet d'un croquis qui sera le dernier souvenir emporté, car, dans
une heure, nous serons loin de Vitré.
ème ( le décryptage
de cette plaque et totalement illisible sur l’exemplaire entre mes
mains)