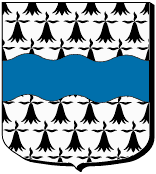Histoire de la Loire-Inférieure (Loire Atlantique)

Le département de la Loire-Inférieure était occupé dès la plus haute antiquité par un peuple appelé les Namnètes. Comme il y a eu des historiens qui ont fait descendre les Francs d'un Troyen appelé Francus, on en trouve aussi qui ont fait descendre les Namnètes d'un fils de Noé, appelé Namnès, personnage fort peu historique, comme on s'en doute bien, et qui aurait fondé Nantes. D'autres, avec aussi peu de certitude, marquent l'année 1620 avant Jésus-Christ pour la date de l'origine de cette ville. Ce sont des fables. Tout ce qu'on peut dire de certain sur ces époques reculées, c'est que le célèbre navigateur marseillais Pythéas, qui vivait vers 280 avant Jésus-Christ, cite Corbilo, un des ports des Namnètes, comme une ville comparable à Marseille ou à Narbonne, d'où l'on peut induire que ce pays prospérait déjà depuis longtemps. Que les Nantais n'aillent pas chercher plus loin ; ce sont là déjà d'assez beaux titres. La capitale des Namnètes était Contigwic, qui s'élevait au confluent de l'Erdre et de la Loire, à la place qu'occupe aujourd'hui Nantes ; les Romains donnèrent à ce nom une tournure latine, Condivicnum. Les Namnètes formaient une république, comme les autres parties de l'Armorique. Ils furent les alliés des Vénètes (Vannes) dans le combat naval livré à César. Soumis aux Romains, et compris d'abord dans la Gaule chevelue, puis dans la Ière, enfin dans la. IIIème Lyonnaise, ils virent Nantes devenir un des chefs-lieux les plus importants de l'administration romaine.

Vers 275, saint Clair vint prêcher l'Évangile
dans cette contrée et en fut le premier évêque. Deux jeunes
patriciens, Donatien et Rogatien, qui se convertirent des premiers,
subirent le martyre en 290 à Nantes, où ils sont appelés les
enfants nantais.
A la chute de l'empire, Clovis conquit ce
pays. Le système de partage qui divisa ses États entre ses fils
ayant atteint aussi la Bretagne, elle fut divisée en quatre
comtés, dont l'un était celui de Nantes, tributaire des rois
francs. Depuis lors, l'histoire du comté de Nantes présente
la lutte continuelle des comtes de cette cité et des ducs de
Bretagne, ceux-ci s'efforçant de ramener le comté dans leur
dépendance, ceux-là de l'en affranchir ; les ducs de Bretagne
finirent par l'emporter et résidèrent à Nantes mais ce ne fut
pas pour une bien longue durée, car les rois de France survinrent
avec une puissance irrésistible et englobèrent le tout dans
le royaume de France. Le comté de Nantes faisait partie de la
haute Bretagne, ainsi que la sirerie de Clisson, la baronnie
de Retz, etc.
Nantes

La ville de Nantes est dans une situation très avantageuse pour le commerce sur la ligne du chemin de fer de Paris à l'Océan, et sur le canal de Nantes à Brest. Elle est bâtie à l'extrémité d'immenses prairies bordées de coteaux, couverts de vignes, sur la rive droite de la Loire, qui s'y divise en plusieurs bras, au. confluent de l'Erdre et de la Sèvre Nantaise. Cette ville est, en général, très bien bâtie, bien percée , et remarquable par la régularité de ses places publiques; l'île Feydeau, le quartier Graslin, la place Royale, peuvent être comparés aux plus beaux quartiers de la capitale. Les quais surtout sont superbes. Le coup d'oeil frappant de la Loire, couverte de navires el de bateaux de toute espèce ; les îles et les prairies qui s'étendent le long du fleuve; les ponts au bout desquels on aperçoit, pour ainsi dire, une seconde ville ; le port de la Fosse, feront toujours l'admiration des étrangers. Les plus beaux quartiers de Nantes ont été bâtis, sur la fin du siècle dernier, par M. Graslin, riche financier, dont le souvenir toujours cher à ses compatriotes, se sont empressés d'éterniser son nom en le donnant à la plus belle de leurs places publiques.


L'origine de Nantes se perd dans la nuit des temps. Avant la conquête des Gaules par les Romains, cette ville était la capitale des Namnetes, et elle formait déjà une cité assez puissante pour secourir les peuples qui osaient résister à ces conquérants. César, Strabon, Pline et Ptolémée ont parlé des Namnetes, mais le dernier seul (nous a donné le nom de leur capitale, Condivincum, qui prit ensuite le nom du peuple Namnetes : c'est le Portas Namneium de la Table de Peutinger, laquelle fournit une route ancienne entre Juliomagus el Gesocrîbate, Brest, dont les mesures portent à Nantes pour Portus Namnetum.
En 445, Nantes soutint avec courage pendant
soixante jours un siège terrible contre les Huns. Le 24 juin
843, celle ville fut prise d'assaut par les Normands; l'évêque,
tout le clergé et une grande partie des citoyens furent passés
au fil de l'épée; la cathédrale fut pillée et presque entièrement
détruite. Les Normands s'en emparèrent une seconde fois en 853.
Quarante quatre ans après, ces mêmes Normands la prirent de
nouveau et la ruinèrent de fond en comble; mais ayant été vaincus
par Alain Barbetorte, ils furent enfin forcés de l'abandonner;
Alain fit rebâtir la ville, qui dut à son heureuse situation
de se repeupler bientôt.
Durant la période franque, le 1er
mai 1118, Nantes fut réduit presque entièrement en cendres
par accident. Son enceinte, qui était alors très resserrée,
s'agrandit considérablement. Les plus anciens bâtiments, tant
publics que particuliers, ne datent que depuis cette époque.

En 1213, Jean sans Terre, après s'être
emparé d'Oudon et d'Ancenis, vint mettre le siège devant Nantes.
Pierre de Dreux, qui avait mis cette ville en état de défense,
arriva à son secours et força Jean sans Terre à la retraite.
Pierre de Dreux agrandit Nantes et en fit sa résidence habituelle,
il fit creuser deux ports sur la Loire et rétrécir le lit de
l'Erdre à son embouchure. En 1236, le pape Grégoire IX fait
publier une croisade contre les juifs. Tous ceux qui habitaient
Nantes, l'un de leurs chefs-lieux, où ils avaient une synagogue
considérable, furent chassés, et on en massacra un grand nombre.
En 1342, le duc de Normandie, fils aîné du roi de France, s'empare
de la ville de Nantes. Il y fait prisonnier Jean de Montfort,
qui est conduit à Paris et enfermé dans la tour du Louvre.
En 1345, Edouard III, roi d'Angleterre, assiège Nantes.
Charles de Blois, qui défendait cette ville, opposa la plus
vigoureuse résistance. Edouard fut forcé de se retirer après
avoir fait démolir les faubourgs et incendier les environs.
En 1343, les Anglais s'emparent par surprise du château de Nantes.
Gui de Rochefort, aidé des habitants de la ville, reprit cette
forteresse et en fit passer les habitants au fil de l'épée.

En 1373, Duguesclin, après s'être emparé
de la Bretagne au nom du roi de France, vient mettre le siège
devant Nantes. Après plusieurs jours de siège, la ville se rend
par capitulation. En 1379 et 1380, la ville de Nantes est assiégée
sans succès pendant soixante-quatre jours par les Anglais commandés
par Buckingham. Olivier de Clisson, qui la défendait, les força
d'en lever le siège.
Le 25 octobre 1440, exécution à Nantes
du fameux Gilles de Retz,-maréchal de France, que ses crimes
et ses cruautés avaient rendu un objet d'horreur et d'effroi
dans toute la contrée. Jean V, duc de Bretagne, lui fit faire
son procès dans le château de Nantes; il lui donna pour juges
l'évêque, son chancelier, le président de Bretagne et le vicaire
du grand inquisiteur de France. Son procès dévoila des crimes
affreux. On compta jusqu'à cent enfants qui avaient été égorgés
dans ses châteaux de Machecoul, Chantocé, etc., après avoir
servi à ses infâmes voluptés ; d'autres disent afin d'avoir
du sang innocent pour servir à ses opérations alchimiques. Après
un mois de procédures, il fut condamné à être brûlé vif. Conduit
sur la prairie de la Madeleine, près de Nantes, le duc, qui
assista lui-même au supplice, commua sa peine. Il fut étranglé
avant d'être mis sur le bûcher d'où son corps fut retiré avant
d'être consumé, et inhumé dans l'église des Carmes.

En 1477, le 25 janvier, naissance d'Anne
de Bretagne au château de Nantes.
En 1485, Landais, favori
du duc François II, est condamné à mort et exécuté sur la prairie
de Biesse. Pierre Landais, homme de basse extraction, mais politique
adroit, avait été élevé par degrés jusqu'à la charge de trésorier,
dignité qui, en Bretagne, était la première de l'Etat. A l'abri
de la puissance ducale, il commit des injustices et des crimes,
et la fin tragique du vertueux chancelier Chauvin, qu'il fit
mourir de faim, de soif et de désespoir, dans le château de
l'Hermine, à Vannes, souleva contre lui le peuple, dirigé par
la noblesse, qui se servit du prétexte du bien public pour se
venger des humiliations que lui avaient fait éprouver cet orgueilleux
favori. D'un commun accord les seigneurs et le peuple se portèrent
sur le château de Nantes, qu'habitait le duc et son trésorier.
Celui-ci se réfugia dans la chambre de son maître ; mais le
peuple demanda à grands cris qu'on lui livra le ministre. Pour
éviter les excès qu'il se disposait à commettre, il fallut livrer
Landais, qui fut jugé, convaincu de plusieurs crimes, et pendu
à l'insu de François II, dont le courroux fut promptement apaisé.
En 1487, Nantes fut investi par les troupes
de Charles VIII, roi de France. Après un blocus de sept semaines,
les Français furent forcés de se retirer.
En 1487; les Français,
au nombre de 10 000 hommes, forment le siège de Nantes. Un renfort
de dix mille hommes, conduits par Dunois, joint à 500 habitants
de Guérande qui avaient pénétré dans la place malgré les efforts
des assiégeants, força ceux-ci à la retraite.
En 1488, mort
de François II, dernier duc de Bretagne. Anne; sa fille aînée,
est proclamée duchesse, sous la tutelle du maréchal de Bieux.
En 1491, le sire d'Albrel s'empare, par trahison de la ville
de Nantes et la livre à Charles VIII, moyennant 1 100 écus d'or.
Charles s'y rendit lui-même accompagné, d'un corps de troupes
pour en prendre possession, et y fit son entrée le 26 mars.
Pour assurer et légitimer les droits qu'il venait d'acquérir
par la trahison sur l'héritage de la duchesse Anne, Charles
VIII résolut de l'épouser. La proposition en fut faite aux états
le 8 octobre, et acceptée avec empressement. Mais on eut beaucoup
de peine à vaincre l'éloignement d'Anne pour cette alliance.
Il n'y eut que le désir d'en terminer avec les calamités d'une
guerre longue et sanglante qui la décida enfin à accepter les
offres de Charles VIIÏ. Le mariage fut célébré au château de
Langeais, le 6 décembre 1491, et la Bretagne fut ainsi unie
à la France. Dans le contrat, la reine Anne céda au roi tous
ses droits sur la Bretagne à titre de donation ; mais elle se
réserva celui d'y exercer seule l'autorité durant sa vie. Charles
VIII garantit aux Bretons la conservation des privilèges dont
ils avaient toujours joui sous leurs ducs, et que les princes,
à leur avènement à la couronne, avaient coutume de reconnaître
et de confirmer. Charles VIII mourut subitement au château d'Amboise,
en 1498. Louis XII, qui lui succéda, sentit que le moyen d'unir
irrévocablement la Bretagne à la France, était d'épouser la
jeune reine douairière. Anne y consentit, et le mariage fut
célébré le 8 janvier 1499, dans la chapelle du château de Nantes,
où cette princesse avait reçu le jour. La reine Anne joignait
à une physionomie séduisante un cœur sensible et généreux ,
un esprit vif et délicat, orné, de mille connaissances. Digne;
par ses vertus, d'être deux fois associée à l'un des premiers
trônes de l'Europe, Anne de Bretagne s'est acquis une réputation
et une gloire qui lui appartiennent en propre. Plusieurs historiens
lui ont donné un caractère fier et vindicatif ; mais le courage
avec lequel elle supporta à la mort de son père les plus grands
revers ; son habileté dans la direction des affaires de son
duché; la sagesse admirable avec laquelle elle gouverna le royaume
pendant les guerres d'Italie, et la protection qu'elle accorda
aux arts, aux sciences, à toutes les entreprises utiles, l'ont
placée au rang des femmes illustres, et ont fait passer son
nom à la postérité.

La mémoire de cette grande reine est
chère à la Bretagne, et en particulier à la ville de Nantes,
où son nom, qui rappelle de si nobles souvenirs, ne se prononce
qu'avec respect. Dans le temps où elle était au plus haut degré
de splendeur, elle mourut de la gravelle, au château de Blois,
le 9 janvier 1514, à l'âge de trente-sept ans. Née à Nantes,
elle témoigna toujours pour cette ville beaucoup d'attachement,
et exprima, en mourant, le vœu que son cœur y fût envoyé pour
être placé dans le tombeau qu'elle avait fait élever à son père
dans l'église des Carmes.
En 1532, Henri IV fit son entrée
solennelle à Nantes, accompagné de la reine Eléonore, sa deuxième
femme.
La ville de Nantes fut exempte des abominables massacres
de la St-Barthélemy, par la noble résistance du maire, Michel
Leloup-Dubreil. L'ordre du duc de Montpensier, daté de Paris
le 26 août 1572, portait d'imiter à Nantes la sanguinaire épuration,
comme le seul moyeu « de voir, par après, quelque assuré
repos en notre pauvre Eglise catholique, ce que nous ne pouvons
négliger- de moyenner autant que nous pourrons. »Le vertueux
Dubreil reçut avec indignation cette invitation de se parjurer;
et, avec un louable courage (Nantes marquait dans le parti exaspéré
contre les huguenots), il répondit au gouvernement dans le sens
du brave d'Orthès, commandant à Bayonne,- qui, dans la même
occasion, écrivit en cour : « J'ai communiqué vos ordres
à la garnison et aux bourgeois, j'ai trouvé parmi eux de braves
soldats, de bons citoyens, et pas un seul bourreau.» Gloire
soit à jamais rendue au digne magistrat qui, dans les circonstances
difficiles, sait sacrifier sa fortune et sa sûreté personnelle
à l'honneur et à la défense de ses administrés !
En 1598, le 13 avril, Henri IV fit son
entrée à Nantes et descendit au château. II y séjourna jusqu'au
6 mai. C'est dans cette ville qu'il rendit (le 30 avril) ce
fameux édit connu sous le nom d'édit de Nantes, par lequel les
calvinistes obtinrent le libre exercice de leur religion, et
le droit de posséder des charges et emplois civils et militaires.
Louis XIV, en révoquant cet édit, ternit son règne éclatant
et commit une grande faute, dont le contrecoup s'est fait sentir
jusqu'après la restauration. On remarque que l'on commença à
armer à Nantes pour la traite des nègres, l'année même de la
révocation de cet édit.
En 1622, Louis XIII, en guerre avec
les calvinistes, fait son entrée à Nantes le 9 avril. En 1661,
Louis XIV arrive à Nantes le ler septembre, en repart
le 6 du même mois pour Paris, après avoir fait arrêter le surintendant
des finances Fouquet, qui fut transféré à Paris et enfermé à
la Bastille.
Depuis ce temps il ne s'est passé à Nantes
aucun événement d'une grande importance jusqu'à l'époque de
la révolution.
Le 30 juillet 1830, les patriotes y prirent
l'initiative de l'insurrection contre les fatales ordonnances,
sans attendre les nouvelles de la capitale. L'autorité résista,
et il y eut de nombreuses victimes, auxquelles un monument funéraire
a été élevé dans le cimetière de la Miséricorde ; il est surmonté
d'une masse polygonale à dix côtés, sur chacun desquels on Lit
le nom de ceux qui succombèrent pour la défense de la liberté.
Ancenis
La position de cette ville, défendue
par un château qui commandait le fleuve et dont les flots venaient
baigner les murs, l'avait fait appeler autre fois la clef de
la Bretagne, du côté de l'Anjou. C'est une ville très ancienne
que Denis le Périégète et d'autres géographes font capitale
d'une colonie d'Alunites ancien peuple d'Italie, dont le pays
s'appelait Samnium. Le rôle historique d'Ancenis ne commence
que vers la fin du Xèmesiècle.
Tandis que Guerech
Comte de Nantes, était allé, en 982, à la cour du roi Lothaire,
Aremburge son épouse fit bâtir le château d'Ancenis, pour préserver
Nantes de l'attaque des comtes d'Anjou, alors rivaux de ceux
de Nantes et de Rennes.
Geoffroi Grise Gonelle, en effet,
prit ombrage de cette forteresse, et vint en former le siège
en l'an 987, mais il fut tué devant cette place. Henri II Plantagenet
s'empara d'Ancenis qu'il fortifia, et le conserva jusqu'à la
fin de la domination anglaise.
En 1230, Pierre de Dreux,
en guerre avec Louis IX, vit tomber successivement au pouvoir
de ce prince Oudon, Ancenis et Châteaubriant.
En 1468, Louis
XI, en guerre avec François II, duc de Bretagne, s'empara d'Ancenis
et de Chantocé, à la tète d'une armée de 40,000 hommes. Ce fut
dans cette ville qu'il signa avec le duc, le 27septembre, l'un
de ces traités de paix que la perfidie forçait si souvent les
ennemis de rompre. En effet, ce monarque ayant fait empoisonne
son frère le duc de Guyenne, l'an 1472, se hâta de tomber, à
l'improviste sur le duc de Bretagne affaibli par la mort de
l'un de ses alliés. Ancenis, Machecoul et la Guerche furent
pris par trahison, et rendus l'année suivante. Les dernières
années du règne de François II furent marquées par une guerre
cruelle que ce prince soutint contre la France. La Trimouille
assiéga Ancenis en 1488, et en détruisit les fortifications
et les remparts. Les habitants, chassés de leur ville ruinée
et réduite en cendres, se retirèrent à Nantes. Lorsque le duc
de Mercœur, saisissant le prétexte de la religion, se ligua
avec les Guise pour faire la guerre au roi, le prince de Dombes,
qui commandait en Bretagne pour Henri IV, fit le siège d'Ancenis,
alors sans clôture, et qui appartenait au duc d'Elbeuf, prince
lorrain. Le château en avait été fortifié et soutint les assauts
des Français, qui s'en rendirent maîtres. D'autres disent que
le siège fut levé par convention Les états de la province en
payèrent eux-mêmes la garnison, et dans tout le cours de la
guerre il n'en est plus fait mention que comme d'une place tenue
en neutralité par le duc d'Elbeuf. Ce fut cette circonstance
qui fit choisir Ancenis pour le lieu des conférences entre les
députés du roi et ceux du duc de Mercœur. La reine Louise, veuve
de Henri III et sœur du duc de Mercœur, se rendit elle-même
dans cette place, dans l'année 1594, afin de ménager la paix
entre le roi et son frère. Les députés des deux partis s'y rassemblèrent
Les hostilités ayant recommencé, le duc de Mercœur gagna celui
qui la commandait et cette place, neutre auparavant, tint pour
lui le reste de la guerre. Quand la paix fut conclue entre Henri
IV et le duc de Mercœur, conformément au traité passé entre
les deux princes, les fortifications d’Ancenis furent démolies
en 1599. En 1700, le château, tombant en ruines, fut reconstruit
mais sans fortifications.
Ancenis avait droit d'envoyer un
député aux états de Bretagne qui se sont tenus trois fois dans
ses murs, en 1620, 1630 et 1720.-
Durant les guerres de la
Vendée, cette ville fut le théâtre de plusieurs combats entre
les républicains et les royalistes. Le15décembre1793, Westermann
y dispersa les restes d'une armée formidable de Vendéens qui
tentèrent inutilement de traverser la Loire sur des radeaux
improvisés.
Saint-Nazaire
Ce bourg est situé sur l'Océan, dans
un territoire fertile et bien cultivé, à l'embouchure de la
Loire. Il est précédé de rades excellentes, abritées contre
tous les vents. On y construit en ce moment un bassin à flot,
d'une étendue de 12 hectares, entouré de quais de 1,730 m. de
développement et d'une profondeur d'eau de 4 m. 67 c. à 7 m.
50 c. Ainsi tous les navires pourront y être à flot, depuis
les bâtiments du petit cabotage jusqu'aux bâtiments de guerre
de la force des frégates de premier rang. Une communication
sera établie, entre le bassin à flot et la mer, par une écluse-à
sas et à double porte, d'une largeur de 100 m. et de 21 m. d'ouverture.
L'église est très-bien située et forme un très-beau point de
vue.
Toute la population de St-Nazaire se compose de marins,
de douaniers et d'un petit nombre de familles bourgeoises. Le
peuple y est bon ; la charité s'y exerce d'une manière admirable
: celui qui possède partage avec celui qui n'a pas, et il existe
dans ce pays une sorte de communauté de biens qui en éloigne
l'indigence.
C'est à St-Nazaire que résident presque tous
les pilotes lamaneurs qui dirigent l'entrée des navires dans
la Loire ; comme ils connaissent parfaitement les écueils el
les bancs de sable disséminés à l'entrée de la rivière, ils
savent les éviter, et conduisent les vaisseaux à Paimboeuf.
Les pilotes lamaneurs jouissent d'une véritable considération
dans le pays ; ils se distinguent par une petite ancre en argent,
attachée à la boutonnière de l'habit. Le nombre en est fixé
; on ne peut être admis à celle place que par la mort d'un de
ceux qui la remplissent.
Sitôt qu'un bâtiment paraît à l'entrée,
de la rivière, les intrépides pilotes se jettent à l'envi dans
de petites nacelles appelées yoles, et atteignent ainsi le navire
au milieu des vagues qui dérobent souvent leur frêle esquif
à la vue. Quand ils peuvent tenir la mer, ils ont. toujours
des chaloupes dehors pour aller à la rencontre des navires qui
veulent entrer dans la Loire. Ils vont ainsi jusqu'à la hauteur
de Belle-Ile.
A 2 k. au Nord Ouest de St-Nazaire, on trouve
un monument druidique, le plus entier, le plus considérable
el le plus curieux du département. Il se. Compose d'une pierre,
longue d'un peu plus de 3 mètres large de 1,66 mètres. et épaisse
de 40 c., supportée par deux autres pierres enfoncées en terre
et élevées de 2 m. au-dessus du sol. En creusant la terre sous
ce dolmen, on a trouvé des urnes, dès pièces d'or, d'argent
et de cuivre. « Avant de quitter ce monument, dit M. Ed. Richer,
on doit jeter un regard sur la Loire. Le point qu'on occupe
est assez élevé pour en distinguer les deux rives et l'embouchure,
et ce dolmen, qui a vu jadis ces mêmes flots couler sous tant
de lois différentes, qui a vu ces mêmes rivages s'agrandir insensiblement
par les alluvions du fleuve, est un siège digne du philosophe
et du naturaliste. De là, la rivière semble former une baie
depuis St-Nazaire jusqu'à Paimboeuf. Cette ville et le bourg
de Donges se distinguent comme deux points blanchâtres, au niveau
des prairies. Une multitude de navires traverse cette baie aussi
variée, aussi imposante que celle que forment les rivages de
Parthenope, mais qui n'a pas, comme celle-ci, les souvenirs
dé l'histoire pour les associer aux charmes, de la nature.
A l'ouest est un calvaire, renommé jadis, et tombé aujourd'hui
dans un oubli complet. Sur ce calvaire, il existait, de temps
immémorial, une croix que les marins saluaient autrefois de
toute leur artillerie en entrant en rivière.
Sur la droite
est la masse du bourg de St-Nazaire, dont toutes les maisons
rapprochées- groupent ensemble, et que les flots et le sable
cernent de tous côtés. A gauche, au contraire, sont les villages
dispersés de la Brière, sur les façades blanches desquelles
s'arrêtent les rayons du soleil qu'absorbe le vert uniforme
des prairies. Le bruit sourd de la vague vous accompagne dans
ce lieu solitaire, qui a vu peut être autrefois se rassembler
les vierges mystérieuses de Saine, les druides, qui venaient
couper le gui sacré dans les forêts armoricaines, et les bardes,
qui accompagnaient leurs voix des doux sons de la harpe. Quelquefois
des troupes d'alouettes marines s'abattent à vos pieds, et,
en poussant un cri mélancolique, qui s'unit au murmure des flots,
elles vont faire leurs évolutions rapides sur le rivage désert.
Tantôt elles descendent sur la plage, avec laquelle se confond
la couleur de leur plumage : elles sont "trop éloignées pour
que le mouvement les fasse distinguer, et les habitants ailés
semblent avoir disparu tout à coup ; tantôt elles s'élèvent,
et le rayon qui se réfléchit sous leurs ailes blanches vous
fait distinguer un nuage éclatant dont les formes varient comme
les facettes agitées du prisme.