Le Comté d'Aunis
:
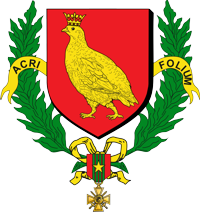
.

La Generalité de La Rochelle Comprenant le Pays d'Aunis, le Saintonge,
&c Divisée en cinq Elections Savoir La Rochelle, Saint-Jean-d'Angely,
Marennes, Cognac et Saintes. Dressée sur les Mémoires qui ont été
comuniquez et Dédiée à Monsieur Begon Conseiller du Roy en ses conseils
Intendant de Justice Police Finances en la même généralité et de
la Marine du Ponant / Par... I.B. Nolin...
Aunis (Alnetum), ci-devant province de France
qui forme maintenant la partie nord-ouest du département de la Charente-Inférieure.
Cette province, comprise sous l'empire romain dans la 2èmeAquitaine
passa successivement de la domination des Romains sous celle des Francs
et des Anglais elle ne fut entièrement affranchie du joug étranger que
lorsque Charles VII, secondé par les, grands capitaines de son siècle,
fut parvenu à chasser l'ennemi du territoire français.
L'Aunis avait
environ 60 kilomètres de long sur 70 60 kilomètres de large:
La Rochelle en était la capitale.
Son territoire, quoique sec en certains endroits, produit de très bon
blé et beaucoup de vins. Il s'y trouve des marais salants considérables
et de belles prairies entrecoupées de canaux où l'on nourrit beaucoup
de bestiaux. Legrand nombre de baies et de ports qui se trouvent sur
ses côtes favorise un commerce très-étendu.
Les îles de Ré et d'Oléron
faisaient partie de cette province : la Rochelle, Rochefort et Brouage
en étaient les principales villes

Un marais salant
L'Aunis fut enlevé en 1063 aux maisons de Mauléon
et de Châtelaillon par Guillaume VIII, duc d'Aquitaine. La province
devint anglaise en 1152 par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le
roi Henri II Plantagenêt, mais en 1224 le roi Louis VIII prit La Rochelle,
et l'Aunis appartint à la France jusqu'au traité de Brétigny signé en
1360, par lequel il fut rendu à l'Angleterre. Du Xème au
XIIème siècle, l’Aunis et la Saintonge bénéficient d’une
croissance démographique et d’un développement économique conséquent.C’est
le temps de la splendeur romane. En 1372 les Aunisiens chassèrent les
étrangers et rendirent au roi Charles V cette province qui fut définitivement
rattachée à la Couronne. C’est à cette époque que les moines, installés
dans le Marais Poitevin, commencent les premiers travaux d'assèchement
du marais. En effet, ces terrains envasés,en proie aux inondations,
n'intéressent guère les seigneurs locaux qui les concèdent aux moines
bénédictins et cisterciens. Du Moyen-Age au XIXème siècle,
l'Aunis tire une partie de sa prospérité de l'exportation du vin et
du sel. La Charente- Maritime est, à cette époque, le deuxième département
viticole de France après la Gironde, en quantité de vins distillés.
La vigne a donc recouvert une grande partie du territoire de l'Aunis
jusqu'à la crise du phylloxera dans les années 1870- 1880, qui détruisit
l’ensemble du vignoble. .

Le Siège de la Rochelle

Le siège de la Rochelle par le Duc d'Anjou
Richelieu dans ces Mémoires, raconte de quelle
manière il avait organisé une expédition destinée, à partir de Périgny,
à investir La Rochelle grâce à la prise de la porte Maubec, "laquelle
n'étant pas faite pour servir ordinairement, et restant murée en
temps de paix, l'on n'avait pas pris tant soin de fortifier comme
les autres."
Dès novembre 1627 il se renseignait auprès
de "quatre sauniers, qui n'avaient fait autre métier toute leur
vie que de travailler aux marais proches de Maubec, savaient tous
les chemins qui conduisaient à la porte et à la grille [qui fermait
le passage] et les détours d'un canal qui, entre les marécages,
s'allait rendre dans les fossés de la ville.." "…quant à la voûte
fermée d'une grille, ils disaient avoir conduit fort souvent des
bateaux sur le canal, qui, descendant des sources de Périgny le
long de la Moulinette jusque dans le fossé, entrait sous cette voûte
dans la ville, et, à quelques trois cents pas de là s'allaient rendre
dans le port, d'où le flux de la mer montait par ce canal jusque
dans le fossé, et bien loin au-delà." Après 2 mois de réflexion,
le cardinal mûrit donc son plan d'attaque : Il envoya chercher à
Paris des "pétardiers" parmi les plus habiles, et fit fondre des
pétards à Saintes. Il fallait en effet faire sauter la grille. Puis
il envoya en reconnaissance deux de ses gentilhommes, Feuquières
qui se fit prendre par les Rochelais et La Forêt qui se fit tuer.

Généralité de La Rochelle
Il se résolut finalement à lancer l'expédition
pour la nuit du 11 au 12 mars 1628.
"Sur les sept heures du
soir, le cardinal alla à Périgny, où il avait donné le rendez-vous
aux chefs pour prendre leur avis sur les occurrences, ordonner des
commandements, et voir en quel état étaient les pétards et machines
que l'on y avait apportés, comme au quartier le plus proche des
lieux de l'attaque, à laquelle on marcha selon cet ordre : à dix
heures du soir, Cahusac, Charmassé, Saint-Germain, La Louvière et
vingt autres gentilshommes de la maison du cardinal, avec nombre
de ses gardes et autres soldats choisis, s'embarquèrent dans cinq
chaloupes, sur le canal près de la Moulinette, pour conduire et
soutenir les pétards que Banneville et Beauregard avaient chargé
d'appliquer à la grille, laquelle étant de bois, on ne pouvait manquer
à rompre que si après le premier coup de pétard, il fut resté autre
chose à faire, nos gens en avaient quantité d'autres, et de toutes
sortes de tenailles, de marteaux et de haches pour faire promptement
le passage, lequel étant ouvert, ces cinquante premiers, bien armés
et fort résolus, devaient s'en rendre maîtres, et donner lieu aux
troupes qui suivaient d'entrer avec sûreté"…
Le cardinal ordonna
que ces cinquante hommes seraient soutenus par cinq cents, sous
les ordres de Marillac et par 1500 autres commandés par le Maréchal
de Schomberg. Quant à lui-même, il attendrait à la Porte de Cougnes
avec mille chevaux et quatre mille hommes de pied.
"Sur les
onze heures du soir, ledit sieur de Marillac s'avance avec Arnaud
et se met à faire deux ponts pour faciliter le passage dans les
marais et attendit longtemps les pétards sur le dernier pont à trois
cents pas de la contre escarpe."
Jusque là, tout se passait
donc comme imaginé par le cardinal.

Richelieu au siège de la Rochelle
"…mais le malheur voulut que Saint Ferjus,
destiné pour l'attaque de la porte Maubec avec Le Limousin et d'autres
pétardiers, étant partis de Périgny, entre onze heures et minuit,
avec tout l'équipage des pétards et machines, pour arriver au lieu
de l'entreprise entre les deux et trois heures du matin… se vit
abandonné de la plupart de ceux que le Maréchal de Schomberg avait
ordonné pour lui aider, et il lui fut impossible dans l'obscurité
de les retrouver". .
L'ineffable cardinal continue son récit
:
"De sorte que dans ce travail de chercher du secours, et de
faire porter par peu de gens ce qui en requérait quatre fois autant,
il employa cinq heures à faire le chemin qu'il eût pu faire en deux
fort à son aise, n'ayant à marcher qu'une demi lieue. Sur cela,
le sieur de Marillac, n'entendant rien de cette part, alla chercher
Cahusac qui avait conduit ses bateaux, deux heures avant le jour,
le long du canal de la Moulinette, à deux cents pas du fossé de
la ville, et si près, que les sentinelles l'eussent aperçu s'il
ne les eût rangés contre la rive, du côté où était ledit sieur Marillac,
lequel ne put les voir à cause qu'un ruisseau l'empêcha d'aller
sur le bord du canal…"
Bref, le jour se levant, Marcillac n'osa
pas attaquer et se replia en bon ordre cette fois et sans pertes.
Les Rochelais ne s'étaient aperçus de rien !
Le Cardinal s'en
félicita mais rejeta la faute sur Marillac "qui ne fut jamais hasardeux,
saigna du nez en cette occasion, et n'osa se hasarder d'entrer en
un lieu dont il ne voyait pas la sortie" et sur la volonté divine,
Dieu préférant finalement faire mourir de faim les Rochelais : "Dieu
voulut changer en une autre manière de châtiment plus convenable
à la malice des coupables, qui était si extrême qu'on ne leur pouvait
donner de bourreaux moins cruels et plus infâmes que les propres
auteurs, se faisant mourir eux-mêmes par la faim et toutes sortes
de misères."
Note :dans ses mémoires, le cardinal parle de
lui à la troisième personne
Epuisé au sortir de la guerre de Cent Ans, l’Aunis
subit, au cours de la première partie du XVème, un déclin
économique et démographique, aggravé par des épidémies de peste. Cependant,
la vie reprend avec une vigueur surprenante. Les paysans achevèrent
alors la mise en valeur des terres longtemps abandonnées. Au XVIème
siècle, les guerres de Religion dévastent l'Aunis.En 1568 La Rochelle
devient la capitale du protestantisme. Survient alors une période de
guérillas entre catholiques et protestants. Les églises de l’Aunis sont
pour un grand nombre d’entre elles endommagées. Enfin, en 1598, l'édit
de Nantes met fin à 36 ans de guerres civiles, dans tout le royaume,
mais les combats se poursuivent en Aunis pendant encore 30 années. En
juin 1621, l’armée royale marchant sur La Rochelle, bastion de la résistance
protestante, occupe La Jarrie et les environs.
Le Siège de la Rochelle

Le cardinal de Richelieu au siège de La Rochelle (Henri-Paul
Motte, 1881)
Le siège de La Rochelle s’intègre dans
la lutte menée par Louis XIII et Richelieu contre les protestants,
dans le désir de les soumettre à l’autorité royale et de les
empêcher de constituer un « État dans l’État ». Cette politique
conduit à une véritable guerre en 1627 et à l’investissement
de La Rochelle. Le port constitue l’ une des places de sûreté
accordées par l’édit de Nantes et permet au parti protestant
de communiquer avec les Anglais. Richelieu, avec le titre de
lieutenant général des armées, assiste en personne aux opérations.
Une tranchée de 12 kilomètres ceinture la ville. Pour empêcher
les assiégés d’être ravitaillés par la flotte britannique, qui
a opéré des débarquements dans l’île de Ré, le cardinal fait
construire une énorme digue de 1 500 mètres de long et de 8
mètres de large hérissée de pièces d’artillerie. Les Anglais,
que commande le Duc de Buckingham, essaieront en vain d’incendier
les murs. La résistance de La Rochelle va durer quatorze mois.
Elle est animée par le maire, Guiton, qui a fait le serment
d’enfoncer un poignard dans le cœur du premier qui parlerait
de se rendre. Une effroyable famine décime la population de
la ville. Bientôt, on ne compte plus que 5 000 survivants squelettiques,
à bout de forces, sur 27 000 habitants. Les cas de cannibalisme
se multiplient. L’assassinat de Buckingham, en ses quartiers
de Portsmouth, contribue au découragement des assiégés. Après
l’échec des tentatives de secours britanniques, les Rochelais
finissent par capituler à l’automne de 1628. Le 27 octobre,
six délégués de la ville se présentent devant Richelieu demandant
« un traité de paix et non un pardon et une grâce », mais le
cardinal reste inflexible et promet juste aux Rochelais « la
vie, la jouissance de leurs biens et l’exercice libre de leur
religion ». Les vaincus doivent signer le texte qu’il leur dicte.

Plan du site
| Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact
© C. LOUP 2025
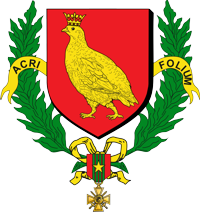 .
.




