Digne les Bains - Préfecture des Alpes de Haute Provence
Retour au Département
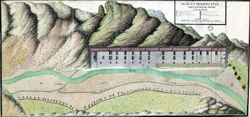

Digne est d'origine gauloise ; c'est l'antique
cité des Bodiontici, alliés ou dépendants des Adbicœ. Son nom se
compose de deux mots celtiques, din, eau, et ia, chaude; et, en
effet, il y a dans les environs de cette ville des eaux thermales
que les anciens paraissent avoir connues elles sourdent au pied
d'une montagne aux flancs déchirés, et dont le sommet décrépit ne
laisse voir aucune végétation.
Citée par César, Digna inter
montes posita ; comprise, sous Auguste, dans la province des
Alpes maritimes, Digne, sous Galba, fit partie de la Narbonnaise.
C'est l'une des villes qui eurent le plus à souffrir des invasions.
Vandales, Goths, Lombards, Sarrasins la pillèrent et la saccagèrent
tour à tour. Pour se mettre à l'abri de pareils visiteurs, les habitants
se réfugièrent sur la hauteur voisine, où ils bâtirent une autre
ville dont on voit encore les traces. Plus tard, quand l'épée de
Valentinus eut chassé les Sarrasins du territoire des Basses-Alpes,
des familles descendirent de la ville haute, et le bourg désert
se repeupla.
S'il faut en croire la tradition, vers le IVème
siècle, saint Vincent, venu d'Afrique avec saint Marcellin et saint
Domin, ses compagnons, prêcha, le premier, l'Évangile à Digne. Jaloux
des miracles et des conversions que Vincent y opérait, le diable,
ajoute la légende, s'en vengea en l'écrasant sous la chute d'un
roc, un jour que le saint apôtre, retiré au fond d'une grotte, s'y
livrait à la prière et à la contemplation. A Vincent succéda Domnin,
qui laissa de saints exemples et un nom vénéré dans l'Église. Plus
tard ses successeurs prirent le titre de barons. Au XIIème
siècle, Digne était sous la juridiction de son évêque, et, de toutes
les villes sous le joug épiscopal dans ces temps barbares, c'est
peut-être celle à qui ce joug fut le plus léger.
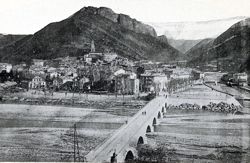
Pendant qu'à ses
côtés Valence, Gap et Embrun luttaient contre la tyrannie de leurs
évêques, Digne, en effet, vivait tranquille sous les siens. Il y
eut, en 1333, une éclipse totale. A Digne, la frayeur fut telle
parmi le peuple qu'on grava une inscription sur la porte de l'église
de Sainte-Madeleine, en mémoire de la grâce qu'on devait à Dieu
pour avoir échappé à cet accident. Voilà dans quel esprit la politique
des princes de l'Église élevait le peuple au moyen âge et le pasteur
de Digne n'était pas le plus mal partagé ; il avait la garde d'un
troupeau facile à conduire.
Digne passa aux comtes de Provence,
et dès lors finit la souveraineté temporelle de ses évêques. Raymond
Bérenger II y vint recevoir l'hommage des seigneurs. Au commencement
du XVèmesiècle, il s'y tint un concile. Alors cette ville
était l'une des plus importantes de la province. Depuis 1297, les
principaux bourgeois de Digne jouissaient du droit d'élire un consul.
Au XVIème siècle, elle possédait l'un des six tribunaux
qui rassortissaient au sénéchal d'Aix. Bientôt la guerre vint de
nouveau la ravager.
Prise par le duc de Savoie en 1562, reprise
par Lesdiguières, les protestants s'en emparèrent par escalade en
1574. Plus tard, en 1589, elle tomba au pouvoir des ligueurs, qui
la livrèrent, en 1591, au duc de Savoie. Alors Lesdiguières paraît
pour la seconde fois sous les murs de la ville. Après deux jours
de siège et plus de cinquante coups de canon tirés contre l'église,
il s'en rend maître et en chasse l'étranger.
Cependant, quoique
plusieurs fois pillée et saccagée, les malheurs de cette ville avaient
à peine commencé ; l'année 1629, de terrible mémoire, lui réservait
un de ces coups dont se relèvent avec peine les villes qui les subissent.
Jamais, en effet, peste n'exerça de plus cruels ravages que celle
qui s'abattit sur Digne cette année-là. De 10,000 âmes qu'on y comptait,
à peine en resta-t-il 1,500, le fléau passé. C'est au mois de juin
qu'il se déclara. Aussitôt le parlement d'Aix rendit un arrêt portant
défense à tous les habitants de Digne de communiquer avec les lieux
circonvoisins, et à toutes personnes d'entrer dans la ville pestiférée.
Arrêt fatal et imprévoyant, qui causa la plus grande partie des
maux dont cette ville fut accablée. D'abord il ne mourait que trois
personnes par jour, puis quinze. Au commencement de juillet, le
nombre des victimes s'éleva chaque jour à quarante, puis tout à
coup à cent soixante. Le fléau ne cessa qu'en octobre. Voici le
tableau qu'en trace Gassendi ; on croirait lire le sombre et lamentable
récit que fait Thucydide de cette peste qui, suivant l'expression
du poète,
Finibus Cecropiis funestos reddidit agros
,
Vastavitque vias, exhausit civibus urbem.

« Tant que le
fléau dura, dit le célèbre philosophe de Digne, pendant l'espace
de quatre mois, le ciel couvrit la terre d'épais brouillards; la
chaleur fut étouffante, et les orages et les pluies se succédèrent
fréquemment. On observa même une lueur ou météore lumineux, qui
passa sur la ville par un mouvement rapide. Pendant tout ce temps,
on ne vit aucun oiseau dans la ville ni dans les champs. Bien plus,
on ne vit, on n'éprouva pas d'autre maladie que la peste elle-même.
Une des choses les plus surprenantes, c'est l'effet que produisait
la violence de la maladie chez quelques individus. Un, entre autres,
grimpa comme un écureuil le long d'une muraille et, parvenu sur
le toit, se mit à lancer des tuiles qui pleuvaient comme des noix.
Un autre, monté également sur le toit de sa maison à l'aide d'une
échelle, y fit pendant quelque temps toutes sortes de gambades puis,
après en être descendu, se mit à courir devant lui jusqu'à ce que,
se précipitant au milieu des soldats commis à la garde de la ville,
il tomba, frappé d'un coup mortel. Un autre, s'imaginant qu'il pourrait
voler, étendit ses bras en guise d'ailes, se précipita d'un lieu
élevé et se brisa en mille pièces. Un autre, se figurant qu'il était
dans un navire battu par la tempête, se mit à jeter ses meubles
par la fenêtre, comme si c'étaient des marchandises. Enfin, un père
en vint à saisir son jeune enfant et à le précipiter tout vivant,
les bras tendus hors de la croisée, sur le pavé de la rue. Ajouterons-nous
maintenant que la nature de la maladie était telle que plusieurs
personnes ont survécu après avoir passé pour mortes pendant plusieurs
jours? Ajouterons-nous qu'il a dû nécessairement arriver que des
malades encore vivants aient été ensevelis ? car, tant que les fossoyeurs
purent suffire à leur tâche, ils s'empressèrent, sans laisser s'écouler
le temps nécessaire, d'enlever tous ceux qui leur paraissaient privés
de sentiment et de vie. Quelques-uns, revenant à eux pendant qu'on
les transportait, se précipitèrent hors du chariot sur lequel étaient
entassés les cadavres. Une jeune fille de vingt ans, déjà jetée
dans la fosse, donna des signes de vie et en fut retirée. Une autre,
âgée de vingt-cinq ans, après avoir passé trois jours, privée de
sentiment, dans un sillon de vigne, sortit le quatrième jour de
son état de léthargie. Une veuve resta six jours entiers sans avoir
conscience de son existence. Un malade, regardé comme mort, ne put
pas être enseveli parce que sa femme, qui avait creusé sa fosse
de ses propres mains, n'était pas assez forte pour l'y plonger elle-même
tout à coup il revient comme d'un profond sommeil, se met à courir
les champs, prédisant l'avenir, annonçant le jugement dernier et
exhortant à la pénitence tous ceux qu'il rencontrait, accablant
de malédictions ceux qui ne tombaient pas à ses genoux et faisant
mille choses bizarres. Les habitants des villages voisins en vinrent
bientôt à un tel degré d'endurcissement, ajoute Gassendi, qu'ils
restèrent complètement insensibles au malheur des Dignois. Quand
la désolation fut à son comble et que les cadavres ne purent plus
être ensevelis, il en resta plus de quinze cents sans sépulture.
On agita un instant la question, et on décida de détruire, par le
feu, la ville et ses habitants. Si cette résolution ne fut pas exécutée,
c'est qu'on apprit au même instant que la peste venait d'envahir
trois ou quatre villes voisines, et l'on comprit qu'en incendiant
la ville de Digne, il fallait aussi les anéantir. On se borna donc
à incendier une maison de campagne située dans un champ voisin de
la ville, et avec elle toute la famille de ses propriétaires, qui
s'y était retirée. Alors les magistrats de la ville se virent dans
la cruelle nécessité de relâcher d'abord, puis d'abandonner tout
à fait les rênes de l'administration ; la ville se trouva bientôt
sans consuls, sans juges, sans culte divin; les ouvriers, les employés
de la cité manquèrent à leur tour; l'horloge se tut, les fontaines
tarirent, les moulins s'arrêtèrent, les fours se refroidirent, le
marché resta désert, et on manqua des choses les plus nécessaires
à la vie. Ceux qui se rencontraient dans la rue ne se reconnaissaient
plus et se regardaient comme des ombres vivantes. Heureux celui
qui, dans ces temps affreux, pouvait pourvoir lui-même à ses besoins
et n'était pas obligé de recourir à l'assistance des autres ! Beaucoup
périrent, abandonnés dans les champs, et furent trouvés gisants
sur le sol où ils avaient rendu le dernier soupir. Parmi eux on
trouva une mère dont l'enfant suçait encore les mamelles glacées
par la mort. Quelques petits enfants vécurent du lait de chèvres
qui leur servirent de nourrices. Les pères qui avaient survécu ensevelissaient
leurs enfants ; les enfants inhumaient leurs parents, les époux
leurs femmes, et les femmes leurs maris. De tous ceux qui étaient
morts ou qui avaient survécu, on fit le compte que cinq à peine
avaient pu recevoir les soins et les secours nécessaires. Des familles
nombreuses avaient entièrement disparu »

Tel fut ce grand désastre.
Jamais Digne n'a pu s'en relever. Digne est divisée en tête, en
pied et en tête et en mitan, qui signifie milieu en provençal. Ses
vieilles rues ont conservé leurs noms originels et leur physionomie
primitive ; entre autres la rue Cocu, sur une montagne où l'on entend
chanter le coucou. Cette ville est généralement mal bâtie. Cependant,
« vue en face du bassin, dont elle occupe la hauteur ; assise, comme
une bergère des Alpes, sur la colline Saint- Jérôme, ses pieds baignés
par la Bléone, avec son vert boulevard pour ceinture et sa vieille
cathédrale pour couronne, elle est d'un aspect charmant. » (Lettres
sur Digne.) Elle s'élève en amphithéâtre au pied de hautes montagnes
qui s'échelonnent derrière elle, et dont les cimes superbes se dressent
à l'horizon, couvertes de neiges éternelles. D'autres montagnes
très escarpées flanquent la ville de chaque côté comme des remparts
et semblent l'oppresser ; elle s'échappe heureusement par la vallée
de la Bléone ; la rivière fait une large trouée dans les montagnes,
et c'est par là que Digne semble respirer. Ce qui reste de l'ancienne
ville n'offre rien de remarquable ; la nouvelle possède de belles
fontaines, deux belles promenades, le boulevard de Gassendi, ombragé
de platanes, et le cours ; un château d'eau, une bibliothèque, une
statue de Gassendi, par Ramus, sur le Pré-de- Foire un pont sur
la Bléone, des casernes, etc. Au centre de la ville s'élève l'église.
A part son clocher surmonté d'un dôme en fer, elle n'a rien qui
frappe les yeux du voyageur. Ce n'est qu'une lourde masse de pierres
sans unité, sans caractère, d'aucun style et d'aucune époque ; mais,
à une petite distance de la ville, au fond d'une étroite vallée,
on découvre l'église de Notre-Dame (ancienne cathédrale), grand
et bel édifice dont la construction remonte à une époque fort reculée,
à Charlemagne, dit-on. Une tour que l'on croit antérieure à l'église
lui sert de clocher. Ses fenêtres cintrées et ses petites colonnes
latérales sont d'un bon style. Deux lions accroupis et grossièrement
sculptés semblent garder l'entrée du lieu saint. Au-dessus du portail,
légèrement ogival et orné de colonnes élégantes, rayonne une magnifique
rosace encore toute garnie de ses vitraux. L'église a la forme d'une
croix latine. Ni le sanctuaire ni le fond du transept ne se terminent
en abside. Toutes les grandes lignes de cette architecture sont
droites, sévères ; la coupe de l'édifice est carrée ; les colonnes
qui ornent les deux arceaux du transept ont des chapiteaux d'un
style très simple et très pur. Cette église, l'une des plus belles
du Midi, récemment restaurée. Si la ville est peu agréable, les
environs en sont charmants.
« On suit, dit un voyageur, à l'est
de la ville, une vallée très étroite, qui vient déboucher dans celle
de la Bléone. Au fond de cette vallée est une petite rivière qu'alimentent
en partie les eaux thermales des bains. A droite et à gauche s'élèvent
deux hautes montagnes très escarpées. Celle de droite est boisée
sur son versant nord. Il y a des gorges cultivées et de petites
maisons de campagne qui doivent être de fraîches habitations d'été.
La vigne grimpe sur les arbres et va chercher quelques rapides rayons
de soleil. Le noyer robuste croît partout, au pied et sur les pentes
abruptes des montagnes, où il semble braver les frimas et les orages.
Les deux principales de ces montagnes vont se rattacher à une haute
chaîne qui est au fond et qui barre complètement la vallée. Celle-ci,
à une petite distance de Digne, est partagée en deux par une troisième
montagne qui s'élève entre les deux autres, et qui, par sa forme,
ressemble à une immense quille de navire amarrée aux rochers du
fond. C'est sur les flancs mêmes de ce vaisseau gigantesque qu'a
été taillé l'étroit chemin qui mène à l'établissement thermal. »
On passe le torrent sur un pont de bois, et l'on arrive à la maison
des bains par une voie creusée dans le roc. Au-dessus de la maison
s'élève un rocher « qui surplombe d'une manière effrayante ; mais,
quels que soient les feux souterrains qui le travaillent, il est
depuis des siècles immobile ; sur ses flancs décharnés rien ne croît,
si ce n'est çà et là quelques tiges rabougries de figuier sauvage
; rien ne vit, si ce n'est de hideux serpents que les tièdes vapeurs
des eaux attirent en assez grand nombre, et qui souvent tombent
engourdis aux pieds des baigneurs. » C'est de dessous le rocher
que sortent les eaux thermales sulfureuses déjà connues du temps
de Pline ; elles sont très efficaces et mériteraient d'être plus
fréquentées. Près de cette ville est le bourg de Champtersier, où
naquit, en 1592, le célèbre Gassendi. Chacun y sait l'histoire du
pauvre berger devenu par son génie l'un des rois de la science et
le rival de Descartes. Après avoir été professeur royal de mathématiques
à Paris, Gassendi mourut chanoine prévôt de la cathédrale de Digne.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.