Gap - Préfecture des Hautes Alpes
Retour au Département
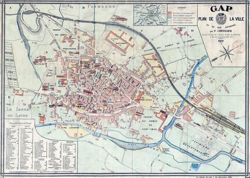

Gap (Vap, civitas Vapicentium,Vapigensis,
Vapium, Vappigum, Vapicum) ancienne ville située au pied des
Alpes, sur la rive droite du petit torrent de Luye.
On ignore
l'époque de la fondation de cette ville. On croit qu'elle fut bâtie
par les Caturigenses, peuple du Milanais, que des révolutions chassèrent
de leur pays et conduisirent dans ces contrées. D'autres lui donnent
une origine celtique. S'il faut en croire un savant archéologue,
mille ans avant l'ère chrétienne, la ville de Gap était bâtie sur
le flanc occidental du mont kapados (Saint-Main), où une petite
ferme a même encore retenu l'ancien nom de la montagne. Cité d'un
pagus celtique, puis gallo-grecque, plus tard capitale des Tricorii,
qui prirent part aux expéditions de Belovèse et de Sigovèse, elle
aurait eu pour armoiries une lionne, emblème de toutes les colonies
phocéennes. Du mont Kapados descendue dans la plaine, elle ne fut
point conquise par César. C'est du temps de Néron qu'elle subit
le joug romain. Alors Mansio, comme Brigantium et Caturigæ, comprise
parmi les cent quinze cités gauloises, lorsqu'on divisa cette vaste
région en dix-sept provinces, elle fit partie de la Narbonnaise.
Alors même son enceinte était plus vaste qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Ravagée par les Lombards et les Sarrasins, tour à tour aux Burgondes,
aux Francs, aux empereurs d'Allemagne, aux comtes de Provence, aux
comtes de Forcalquier et aux dauphins de Viennois, cette ville passa
enfin aux rois de France avec le Dauphiné. Son premier évêque fut
saint Démétrius, en 366. Avec le temps, le siège qu'il y fonda prit
de l'importance. Il suivit la fortune temporelle de la ville.
Au Vème siècle, il étendait sa juridiction sur les lieux
qui en relevaient. Cependant les successeurs de Démétrius étaient
loin d'avoir hérité de ses vertus. Hommes de guerre et de plaisir,
ils laissaient volontiers le bâton pastoral pour l'épée et l'Église
pour le monde. Nous avons dit la vie et la fin de Sagittarius. A
son exemple, Rupert, l’un de ses successeurs, commit de tels excès
que le clergé et le peuple s'en plaignirent au pape Alexandre II,
qui le déposa. Saint Arnoux le remplaça et consola, par sa sagesse,
cette Église si longtemps négligée. Ainsi que les seigneurs du Dauphiné,
les évêques gapençais surent se faire leur part dans le démembrement
du royaume de Bourgogne, et les empereurs, en leur octroyant des
titres et des privilèges, ne firent que sanctionner leurs usurpations.
Déjà princes vers la fin du Xème° siècle, ils se qualifiaient
de seigneurs et comtes de Gap. Ils possédaient treize châteaux avec
les régales; le droit de rendre la justice et le pouvoir de frapper
monnaie.
Le dauphin se reconnaissait leur vassal. Par une bulle
de 1178, l'empereur Frédéric condamna quiconque les troublerait
dans la possession de leurs droits et de leurs biens à leur payer
vingt livres d'or.
Cependant, de temps immémorial, Gap jouissait
de certaines franchises. Il avait, entre autres, le droit d'élire
ses consuls, dont la juridiction s'étendait sur la ville et sur
son territoire. De là des luttes d'autorité entre les consuls, le
dauphin et l'évêque. A la fin, la cour de Rome intervint, et par
sentence arbitrale du 5 septembre 1300, elle régla les droits du
dauphin, de l'évêque et de la cité. A l'évêque fut dévolue la garde
des clefs de la ville, ainsi que la police et le costeil ou carcan,
qui étaient auparavant sous la dépendance des consuls. De son côté,
la ville fut tenue de fournir au dauphin cent hommes de pied, armés
et équipés, lorsque des chevauchées auraient lieu dans le Dauphiné.
Cette sentence ne satisfit personne, et la guerre recommença jusqu'en
1378, que les habitants obtinrent de Jacques d'Artaud, alors évêque,
une charte d'affranchissement que ce prélat jura sur les saints
Évangiles, tant pour lui que pour ses successeurs, de respecter
et d'observer inviolablement. Mais les successeurs d'Artaud ne tinrent
point ses promesses.
Pendant le séjour de Louis XI en Dauphiné,
la ville de Gap avait pour évêque Gaucher de Césarée. C'était un
tyran. Près de sept cents familles, fuyant la proscription, s'étaient
réfugiées dans le Champsaur. Ayant fait dresser dans la ville des
fourches patibulaires, l'évêque voulut y faire attacher Jean de
Montorsier, le chef des feudataires et vassaux de Louis, qui méditait
d'étendre les franchises de la cité. Il fallut employer la force
armée pour le délivrer. Le parlement dauphinois cita l'évêque à
comparaître. Il refusa; mais le dauphin (Louis XI) s'empara de ses
châteaux, le soumit au tribut, se déclara souverain de Gap et établit
François de La Roche gardien et défenseur de ses droits. C'est ainsi
qu'il s'essayait à la royauté.
Plus tard, en 1511, Louis XII
se fit reconnaître comme souverain seigneur et justicier de Gap;
il confirma les privilèges de la ville et délia les habitants du
serment de fidélité qu'ils prêtaient aux évêques, dont les juges
d'appeaux perdirent le droit important de justice supérieure. Après
avoir longtemps souffert des guerres féodales, cette ville, tour
à tour huguenote et catholique, paya son tribut aux guerres de religion
qui ensanglantèrent le XVIIème siècle. Il y eut, en 1560,
un premier mouvement protestant. Déjà nombreux dans la ville, les
calvinistes y brûlèrent la croix du mont Calvaire et s'emparèrent
de l'église de Sainte- Colombe, où l'évêque lui-même, Gabriel de
Clermont, parut aux prêches, dépouillé de ses habits pontificaux.
Dix ans après, en 1570, la jeunesse catholique de Gap ayant fait
une sortie dans le Champsaur, sous les ordres du chanoine Lapalu,
elle y trouva Lesdiguières qui revenait de l'Embrunais. Un combat
s'engagea sur les rives du Buzon; la petite armée catholique fut
vaincue et passée au fil de l'épée. Alors Lesdiguières marcha sur
Gap et s'en empara sans coup férir. Chassé par les catholiques,
il y rentra par escalade au milieu du trouble d'une fête, et, pour
tenir la ville en respect, il fit reconstruire l'ancienne forteresse
sarrasine de Puy- More, qui la domine vers le nord-ouest. Cependant
les catholiques essayèrent de reprendre la ville. Après divers combats,
les deux partis signèrent une trêve. La veille du jour où elle devait
expirer, Lesdiguières, rencontrant des dames qui dansaient dans
la prairie de Camarguet, leur promit pour le lendemain des violons.
Des canons foudroyèrent la ville, qui s'empressa de lui envoyer
des otages. A l'avènement de Henri IV, elle se rendit enfin par
capitulation, le 24 août 1589. Alors Lesdiguières déclara, au nom
du roi, que toute guerre civile devait cesser. Le gouverneur de
la ville se retira, et la garde en fut confiée aux habitants. Plus
tard, Richelieu fit raser le fort de Puy-More; mais malheur à la
génération qui le verra se relever pour la troisième fois 1 car,
en 1546, un moine italien, prêchant sur la place Saint-Arnoux, fut
saisi d'une inspiration prophétique en apercevant le coteau de Puy-
More, et, les larmes aux yeux, il prédit qu'à trois reprises différentes
des fortifications y seraient élevées, que Gap aurait à en souffrir
les deux premières fois, mais qu'à la troisième il serait anéanti
de façon à laisser chercher ses traces. Après l'édit de Nantes,
il y eut à Gap un synode général de protestants. On y proposa de
déclarer que le pape était l'Antéchrist.
A la fin du XVIIème
siècle, cette ville fut prise par le duc de Savoie. Son armée y
séjourna deux semaines, commettant toutes sortes d'actes d'hostilité
,violant, brûlant les bastides et les gerbiers de la campagne, et
finalement la pauvre ville de Gap, qui ne trouva point de quoi lui
payer la contribution demandée. Déjà saccagée par les Vandales,
les Goths, les Lombards, les Sarrasins et les huguenots, dépeuplée
par la peste, en 1630, et par la révocation de l'édit de Nantes,
cette ville comptait à peine 8,000 âmes au commencement du XVllème
siècle.
Ce grand désastre réduisit la plupart de ses habitants
à se construire des chaumières dans des lieux inhabités ou à tendre
la main pour vivre. Cependant, grâce à l'industrie de sa population,
Gap se releva de ses ruines, et, depuis la Révolution, sa prospérité
n'a fait que s'accroitre.
Cette ville est située au centre des
Hautes-Alpes, au milieu d'une plaine environnée de collines. Au-delà
s'élèvent en amphithéâtre des montagnes chargées de neige.
Jadis
le territoire de Gap était un lac. Aucune ville n'a plus souffert.
Outre les ravages de la guerre et de la peste, Gap a éprouvé cinq
tremblements de terre en 1264, en 1612, où toutes les maisons furent
ébranlées; en 1644, en 1808 et en 1828. Il y eut, en 1777, un ouragan
extraordinaire qui emporta les toits et dévasta les campagnes. On
y trouve, à une profondeur considérable, non seulement des tombeaux
de brique ou de pierre, mais encore des portes en pierres de taille,
ce qui ne laisse aucun doute sur l'enfoncement du terrain
A la
préfecture, on admire le mausolée de Lesdiguières ; la masse du
sarcophage est en marbre noir du Champsaur, les bas-reliefs en albâtre.
Le connétable y est représenté revêtu de sa cuirasse et de sa cotte
d'armes. La statue est de grandeur naturelle, couchée sur un manteau
; la tête relevée s'appuie sur les premiers doigts de la main gauche.
Au-dessous, on voit des bas-reliefs où sont retracées les principales
actions de sa vie. On a conservé ses gantelets ; son casque percé
d'une balle et cette lance terrible qui frappa, dans ces contrées,
des coups si rudes. Ce monument fut érigé sous les yeux du connétable,
dans son château de Lesdiguières, en Champsaur. On dit que, mécontent
d'abord de l'œuvre du sculpteur, Jacob Richier, il le tint en charte
privée, menaçant de lui ôter la vie s'il ne remplissait promptement
ses vues.
Ce gisant fut donné, en l'an VI, au département des
Hautes-Alpes, par Madame Maugiron de Veynes, propriétaire du château
de Lesdiguières, ce mausolée fut déposé dans une chapelle de la
vieille cathédrale, édifice aujourd'hui démoli, d'où il a été transporté
à la préfecture. Il y avait autrefois à Gap une maison de templiers
près de la porte de Provence, et sur la route de Marseille une maladrerie,
sorte d'établissement fort commun dans cette contrée et fondée à
la suite des croisades. Aux environs est la Tour- Ronde, où l'on
avait placé sans doute, dans le moyen âge, un fanal qui correspondait
avec d'autres signaux dont on voit encore les débris sur les montagnes.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.