Tulle - Préfecture de la Corèze
Retour
au Département
Retour Ville d'Art et d'Histoire
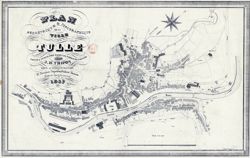

Tulle (Tutela Nevoricum Castrum Tutelense)
est une ville ancienne, chef-lieu de préfecture du département de
la Corrèze, est pittoresquement située entre plusieurs vallons étroits,
au confluent des rivières de Corrèze et de Solane, partie sur le
penchant et partie au pied d'une colline, dans un pays très montueux
et coupé de précipices. C'était primitivement un château d'origine
gauloise, désigné par les Romains sous le nom de Castrum Tullum,
Castrum Tulense, Tulla, Tutela. Ce nom s'est transformé au moyen
âge en celui de Tucle, d'où l'on a fait Tulle. Suivant une ancienne
légende, saint Martial, apôtre de l'Aquitaine, fit à Tutela sa première
prédication vers la fin du Ier siècle de l'ère chrétienne.
On rapporte qu'il fut flagellé dans la ruelle del Tour del Sente.
Une image expiatoire, qui n'existe plus aujourd'hui, rappelait autrefois
à la piété des fidèles ce fait plus ou moins authentique.
Les
antiquaires ont signalé les traces d'une voie romaine près des murs
de Tutela. Cette route, qui mettait Lucdunum, aujourd’hui Lyon en
communication avec l'extrémité de l'Aquitaine, traversait le département
de la Corrèze dans la direction d'Eygurande, Ussel, Lopleau, Fontmartin
et Brive elle passait près de Tulle, dont elle était séparée par
la Corrèze, et communiquait avec cette ville par le pont Chauzinet
ou du Péage ; un embranchement aboutissait à Uzerche en longeant
le faubourg de la Rivière. Sur cette route furent construits le
faubourg d'Alverges ou des Auberges et celui du Lion-d'Or par extension
de celui de Canton précédemment formé à la tête du pont. Les Romains
firent, dit-on, du château de Tutela un poste avancé, destiné à
protéger contre toute surprise leurs légions, qui cam paient à l'est,
vers-Naves et Tintiniac. Il est possible que Tulle doive, en effet,
son origine à une forteresse romaine.
Peut-être doit-elle plutôt
la rapporter au monastère qui s'élevait à l'extrémité de l'angle
presque droit formé par les deux rivières. C'était le célèbre couvent
de Saint-Martin, fondé, suivant la tradition, par saint Martin lui-même,
vers le milieu du IVème siècle. L'enceinte de Tulle était
percée par quatre portes principales : celle de Ia Rivière ou des
Moulins ; celle du pont Chauzinet ou de l'Évêché ; celle des Mazeaux
ou de la Barrière ; celle de Chanac ou de la Barussie. L'entrée
de ces portes était défendue par des tours. Le mur d'enceinte était
couronné par une galerie de circulation à laquelle on communiquait
par des escaliers placés de distance en distance. Il y avait, en
outre, deux petites portes ou guichets l'une au nord, au bout de
la rue qui en a gardé le nom l'autre au midi, près dit clocher,
à l'endroit qu'on appelait i>Lou pount dos Seignours . C'est par
là qu'on communiquait avec l'enclos du monastère, qui, bien qu'enfermé
dans l'enceinte générale, était encore séparé de celle de la ville.
Une des portes de Saint-Martin était au bas de la rue dite du Fort-Saint-Pierre,
à côté et au pied de la tour Maige.
Au commencement du Vème
siècle, les barbares franchirent le Rhin et ravagèrent toutes les
provinces de la Gaule. Pendant deux années (407-409), l'Aquitaine,
laissée sans défenseurs par l'impuissant Honorius, fut en proie
aux dévastations des Alains, des Suèves et des Vandales. Salvien,
dans son traité De Gubernation Dei, a tracé le sombre tableau de
cet effroyable bouleversement. Il nomme seulement les grandes cités
qui furent mises à sac et détruites par le feu. Il ne parle pas
de Tutela. On croit que cette ville n'avait pas encore acquis d'importance
et qu'elle dut son accroissement à la ruine d'une ville voisine
beaucoup plus ancienne, celle de Tintiniac. Tulle passa, ainsi que
le monastère, sous la domination des Wisigoths, qui fondèrent, en
419, le royaume de Toulouse. Elle suivit le sort de l'Aquitaine
et reconnut l'autorité des Francs après la victoire de Clovis à
Vouillé, en 507.
Dans ces temps reculés, son histoire est fort
obscure. On sait pourtant que le monastère fut pillé, auIXème
siècle, par les Normands. Pendant la guerre de Cent ans, Tulle fut
deux fois assiégée par Henri de Lancastre, qui s'en empara, après
une vigoureuse résistance, le 10 novembre 1346. La ville fut bientôt
délivrée par le comte d'Armagnac. Les Anglais reparurent en 1369
mais les habitants les repoussèrent, et Charles V, pour récompenser
leur courage, leur accorda d'importants privilèges par lettres patentes
du mois de mai 1370. Il anoblit six des principales familles bourgeoises
de la ville, savoir Durand de Lespicier, Jean et Guillaume de Bossac,
Jean et Raymond de Saint-Salvadour, et Guillaume de Labeylie. Au
XIVème siècle, survinrent les querelles de religion.
Henri, vicomte de Turenne, s'empara de Tulle en 1585, pour le roi
de Navarre, et y établit son lieutenant Lamaurie, en qualité de
gouverneur. Cet officier y passa l'hiver et se rendit odieux par
ses déprédations. Malgré ses prétentions au titre de capitale du
bas Limousin, que lui disputait Brive-la-Gaillarde, Tulle continua
d'être, jusqu'à la Révolution, une petite ville presque inconnue
des géographes et des historiens. C'était le siège d'une sénéchaussée,
d'un présidial, d'une élection et d'un évêché. Voilà tout ce qu'on
en peut dire. Le Voyageur Français de l'abbé Delaporte de 1761 en
parle avec un mépris peu déguisé, mais assurément peu mérité aujourd'hui.
Figurez-vous, dit-il, une ville mal située, mal bâtie, peuplée
d'ouvriers, d'écoliers et de suppôts de la justice, et vous n'aurez
encore qu'une faible idée de cet ennuyeux séjour, que je quitterai
le plus promptement qu'il me sera possible. »
Le collège
de Tulle, situé dans le vallon sur les bords de la Corrèze, fut
occupé par les jésuites depuis 1620 jusqu'à leur suppression, ensuite
par des théatins; c'était la seconde maison de cet ordre qu'il y
eût en France, après celle de Paris. En 1670, on bâtit l'hôpital,
au-delà de la rivière, sur l'emplacement d'un ancien couvent de
moines de Cluny. Il y avait autrefois dans la ville un couvent de
cordeliers, fondé en 1491. Ces moines furent remplacés, en 1601,
par des Pères récollets, dont la communauté se glorifiait d'être
la première qui eût été établie en France. Tulle possédait encore
un couvent de feuillants et plusieurs autres communautés religieuses.
Le principal édifice de la ville est la cathédrale. C'est l'église
de l'ancien monastère de Saint-Martin. Détruit en 846, ce monastère
fut entièrement rétabli vers 930. Le pape Jean XXII l'érigea, au
commencement du XIVèmesiècle en abbaye. L'abbé Arnaud
de Saint-Astier fut élevé à la dignité épiscopale et devint le premier
évêque de ce petit diocèse, formé par un démembrement de celui de
Limoges. Le monastère continua d'être occupé par des bénédictins,
qui conservèrent leur règle jusqu'en 1516 ; ils furent alors sécularisés
et remplacés par des chanoines. L'église était devenue cathédrale
depuis que l'abbé de Saint-Astier avait reçu le titre d'évêque.
Détruite par les Normands, au IVème siècle, relevée quelques
années après et réparée de nouveau en 1103, elle offre aux regards
des artistes et des archéologues de curieux détails d'architecture.
Une tour carrée forme le clocher. Cette tour est admirable par la
solidité de sa construction, par sa hauteur de 71 mètres, c'est
le monument le plus élevé de la Corrèze, et en même temps par son
élégance. Son rez-de-chaussée présente un porche percé de quatre
portes, trois qui s'ouvrent en dehors, et la quatrième dans l'église.
A une certaine hauteur, les quatre angles de cette tour sont occupés
par quatre tourelles qui se terminent en aiguille. Le corps principal
de la tour s'élève beaucoup plus haut et se termine également en
forme de pyramide. Dans un angle du porche, à l'entrée de l'église,
on voyait autrefois le tombeau de plusieurs vicomtes de Turenne.
Le cardinal de Bouillon le fit remplacer par une table de marbre
avec une inscription en latin dont voici la traduction « Sous ce
caveau sont renfermés les corps des anciens vicomtes de Turenne,
dont les tombeaux menaçaient ruine et gênaient l'entrée de l'église.
Le sérénissime prince Emmanuel-Théodore, cardinal de Bouillon, pour
conserver la mémoire de ses aïeux, a fait placer ici cette inscription.
» Outre l'église, monument historique, Tulle possède les restes
du cloître et de la salle capitulaire de l'ancienne abbaye de Saint-Martin.
Depuis la réorganisation administrative de la France et le changement
des provinces en départements, Tulle, érigée en chef-lieu de préfecture,
doit à ce titre une certaine importance officielle ; elle s'est
beaucoup embellie nous ne doutons même pas que, si l'auteur du Voyageur
Français pouvait la revoir aujourd'hui, il ne finirait par s'y plaire
et regretter son jugement passé ; quand les anciennes maisons auront
achevé de disparaître elle sera certainement un séjour agréable
et pittoresque. « On prétend, dit M. A. Hugo, que l'espèce de dentelle
nommée point de Tulle a été inventée à Tulle, et des ouvrages statistiques
très vantés, publiés de nos jours, répètent que cette ville est
encore le lieu central de cette fabrication ; nous pouvons affirmer
qu'il n'y existe, non plus que dans le département, aucun ouvrier
en tulle. » Il est même de notoriété publique que depuis un temps
immémorial on n'y a vu aucun métier de point de Tulle.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.