Dijon - Préfecture de la Côte d'Or
Retour au Département)

Dijon (Dibio, Divio, Castrum Divionense), Dijon tire son nom de deux mots celtiques div, deux ion, rivière; elle est, en effet, agréablement située au confluent des rivières d'Ouche et de Suzon, au pied du mont Affrique et dans une plaine d'une admirable fécondité. Quelques débris retrouvés et antérieurs à l'art romain prouvent que l'emplacement arrosé encore aujourd'hui par l'Ouche et le Suzon était de longue date le siège d'un établissement, le centre d'une agglomération de population, qui faisait partie de la confédération des Éduens.
Lorsque César pénétra dans les Gaules, il
établit d'abord son camp sur le mont Affrique puis, lorsqu'il se
fut assuré des dispositions des habitants de la plaine, il y descendit
avec ses légions et fonda le Castrum Divione, berceau de la cité
qui allait rapidement grandir quelque temps après. En effet, les
querelles entre les Séquanais et les Éduens exposant aux ravages
de la guerre le camp devenu ville, Marc-Aurèle répara son enceinte
et y ajouta quelques fortifications. On attribue aussi à ce prince
l'érection de temples en l'honneur de la Fortune, d'Apollon, dont
les druides avaient accepté le culte sous le nom de Mithra, et de
Jupiter, pour lequel les Gaulois avaient une vénération particulière.
C'est vers la même époque, sous le règne de Marc-Aurèle, que le
premier apôtre de la Bourgogne, saint Bénigne, reçut à Dijon la
couronne du martyre. La persécution ne servit qu'à augmenter le
nombre des nouveaux croyants on creusa des cryptes ou chapelles
souterraines pour les assemblées des fidèles, pour la célébration
des saints mystères. C'est ainsi que l'église de Saint-Étienne et
le baptistère de Saint-Jean furent fondés au commencement du IVème
siècle. Dijon, ville chrétienne, relevait de l'évêché de Langres
; les pieux prélats y venaient souvent, et saint Urbain, le sixième
évêque, y fixa sa résidence. La conversion des Bourguignons, avant
leur établissement définitif dans la Gaule, épargna aux villes épiscopales
une grande partie des calamités de l'invasion.
Les premiers rois
signalèrent leur prise de possession par de pieuses fondations.
En 506, Gondebaud encouragea et aida saint Grégoire, quinzième évêque
de Langres, dans la restauration de la crypte élevée sur le tombeau
de saint Bénigne. Lors des sanglants démêlés que suscita le partage
de l'héritage de Clovis, la sécurité de Dijon fut assurée par la
détermination que prit l'évêque saint Tétrique de refuser l'entrée
de la ville à Chramne, l'un des compétiteurs.

Grégoire de Tours, en racontant cet épisode,
fait une intéressante description de la ville, qu'il appelle encore
Castrum Divionense; il s'étend sur les charmes de sa position, la
fertilité de son territoire, la qualité de ses vins, il parle de
ses murs, de ses tours, de ses portes, mais il ne dit pas un mot
des faubourgs, qui, selon toute apparence, ne se formèrent que postérieurement.
Depuis les successeurs immédiats de Clovis jusqu'à l'avènement
des carlovingiens, Dijon fut la capitale d'une subdivision territoriale
et judiciaire désignée par les historiens du temps sous le nom de
pagus Divionensis, territorium Divionense, ou comitatus Divionensis,
parce que le titre de comte était donné aux officiers royaux ou
gouverneurs, spécialement chargés de rendre la justice. Ces comtes,
toutefois, ne doivent point être confondus avec les comtes héréditaires
de Dijon, qui ne datent que des successeurs de Charlemagne. Le premier
de ces seigneurs fut Manassès de Vergy, contemporain de Richard
le Justicier, qui, sous Louis le Bègue, fondait la première dynastie
des ducs bénéficiaires de Bourgogne. Ainsi que la plupart des fondateurs
de maisons féodales, Manassès dut son élévation et sa célébrité
à ses exploits contre les Normands, qui menaçaient incessamment
les environs de Dijon et la ville elle-même. Dijon servait alors
de lieu de refuge ; on y transportait les reliques, les trésors
qui n'étaient plus en sûreté dans les villes voisines.
Cette
réputation ne mit cependant pas la ville à l'abri des entreprises
de Boson, qui s'en empara pour en être chassé par Raoul, en 935.
Elle était réservée à de plus sérieuses épreuves lorsque la succession
du dernier duc bénéficiaire fut disputée par Othe-Guillaume et le
roi Robert. Nous avons vu ailleurs que l'arbitrage accepté par les
deux parties avait adjugé à Othe le comté de Dijon, échangé plus
tard contre le comté de Bourgogne. Du règne de Robert date donc
une ère nouvelle pour la capitale comme pour le duché tout entier.
Les ducs héréditaires de la première race royale vinrent y fixer
leur résidence ; une nouvelle population vint se grouper autour
de l'ancienne cité. En peu d'années, tout l'espace compris entre
le vieux Castruna et la rivière d'Ouche se trouva couvert de bâtiments.
Déjà il était question de fortifier ce vaste faubourg, lorsqu'un
incendie le détruisit au commencement du XIIème siècle,
ainsi que le reste de la ville. Les ducs profitèrent de ce sinistre
pour rebâtir Dijon sur un plan plus vaste, comprenant tous les anciens
faubourgs. Ces travaux n'étaient pas achevés lorsque les habitants
obtinrent du duc Hugues III que leur régime municipal fût modifié.
La célèbre charte de Soissons était alors un modèle sur lequel toutes
les populations ambitionnaient de voir calquer l'organisation de
leur commune.

Les Dijonnais obéirent à cet entraînement
général, et, non contents de l'acquiescement de leur seigneur, ils
demandèrent au roi Philippe-Auguste une confirmation qui leur fut
accordée en ces termes « Au nom de la sainte et indivisible Trinité,
ainsi soit-il. Philippe, par la grâce de Dieu roi des Français,
faisons savoir à tous présents et à venir que notre fidèle et parent
Hugues, duc de Bourgogne, a donné et octroyé à perpétuité à ses
hommes de Dijon une constitution sur le modèle de celle de Soissons,
sauf la liberté qu'ils possédaient auparavant. Le duc Hugues et
son fils Eudes ont juré de maintenir et de conserver inviolablement
ladite commune. C'est pourquoi, d'après leur demande et par leur
volonté, nous en garantissons le maintien sous la forme susdite,
de la manière qui s'ensuit Si le duc ou l'un de ses héritiers veut
dissoudre la commune ou s'écarter de ses règlements, nous l'engagerons
de tout notre pouvoir à les observer. Que s'il refuse d'accéder
à notre requête, nous prendrons sous notre sauvegarde les personnes
et les biens de bourgeois. Si une plainte est portée devant nous
à cet égard, nous ferons dans les quarante jours, et d'après te
jugement de notre cour, amender le dommage fait à la commune par
la violation de sa charte. »
Les garanties consacrées par
cet édit, en 1187, furent consolidées encore le siècle suivant par
une organisation nouvelle de la mairie, dans laquelle vint s'absorber
la vicomté de Dijon. Le vicomte-maire devint chef d'armes de la
ville ; le sceau de la commune le représentait à cheval comme les
princes et les chevaliers, avec la robe, la ceinture et le chaperon,
portant le faucon sur le poing et l'éperon au talon, et autour de
ce sceau on lisait Sigillum Communio Divionis dans le cercle,
en dehors de la légende, étaient gravés les bustes des vingt sénateurs.
La dignité de maire, qui demeura élective et qui était conférée
tantôt à des membres de la noblesse, tantôt à des bourgeois notables,
conserva toute son importance jusqu'à la fin du règne de Louis XIII.
Le dépôt des libertés dijonnaises fut défendu contre tout empiétement
et maintenu intact par ces dignes dépositaires. Depuis Eudes IV,
qui, en 1334, s'engagea par une loi spéciale, pour lui et ses successeurs,
à jurer publiquement à leur avènement au duché de garder les libertés,
franchises, immunités, chartes et privilèges de la capitale, tous
les ducs, et les rois après eux, lorsqu'ils sont venus à Dijon pour
la première fois, ont renouvelé le serment à Saint-Bénigne, et dans
les mêmes termes. On trouve dans Palliot l'acte de serment du roi
Jean, le 23 décembre 1361, et celui de Philippe le Hardi, son fils,
en 1364. Le duc Jean le prêta de même en 1404, Philippe le Bon en
1421, et Charles, dernier duc, en 1473. Après sa mort, Louis XI,
ayant réuni Dijon et le duché à la couronne, fit à Saint-Bénigne,
en 1479, le même serment, et reçut l'hommage des habitants. Louis
XII et François 1er confirmèrent leurs privilèges, ainsi
que Henri II, à son entrée à Dijon en 1548 ; Charles IX en 1564,
Henri IV en 1595, Louis XIII et Louis XIV en firent autant.
Sous les quatre ducs héréditaires de la seconde race royale, la
Bourgogne joua un rôle historique si important, qu'à côté de ces
grands souvenirs, les annales particulières de Dijon perdent beaucoup
de leur intérêt. La ville, cependant, ne pouvait pas ne pas avoir
sa part dans les prospérités et les splendeurs de sa maison ducale
; aussi de nombreux embellissements intérieurs datent-ils de cette
période. Philippe le Hardi fit transporter à Dijon, en 1383, l'horloge
de Courtray, le fameux Jacquemart, chef-d'œuvre de l'art mécanique
de cette époque.

La maison où le roi Charles VI fut reçu en
1389 était décorée d'une tapisserie fort célèbre dont le duc avait
aussi enrichi la ville. Une somme de 2 000 livres fut consacrée,
en 1391, au pavage des rues.
Les successeurs de Philippe ajoutèrent
à leurs libéralités un funeste présent ; ils établirent l'inquisition
dans leur capitale les bûchers se dressèrent, on livra au feu un
bâtard de Longwy et une prétendue sorcière, en 1471. Un Vaudois
et une jument furent brûlés ensemble aux fourches patibulaires par
le bourreau, les chroniques du temps disent le carnacier, nom significatif;
on coupait alors les oreilles à ceux qu'on bannissait.
Louis
XI, devenu possesseur du duché, rendit le parlement sédentaire à
Dijon et, redoutant une explosion des sympathies bourguignonnes
en faveur de la princesse Marie, héritière dépossédée ,il fit construire,
entourer de fossés et flanquer de quatre tours le château qui existe
encore aujourd'hui en partie, et qui, transformé, le siècle dernier,
en prison d'État, renferma dans ses murs la duchesse du Maine, le
comte de Mirabeau et le personnage énigmatique connu sous le nom
de la chevalière d'Éon. Ce château fut achevé par Louis XII, mais
dans des intentions moins hostiles à la population dijonnaise ce
prince donna, au contraire, des preuves nombreuses des sentiments
bienveillants dont il était animé pour sa bonne ville de Dijon.
Ayant échappé à une dangereuse maladie, il envoya par deux hérauts,
le 29 avril 1505, à la Sainte-Chapelle, la couronne royale de son
sacre, pour en orner le vaisseau de la sainte hostie. Il donna pour
gouverneur à la province un seigneur qui était très populaire, Louis
de La Trémouille, le même qui l'avait vaincu et fait prisonnier
à la bataille de Saint-Aubin, et à propos duquel il avait dit ce
mot devenu célèbre que ce n'était point au roi de France à venger
les injures du duc d'Orléans. Le choix du roi fut justifié et récompensé
quelques années plus tard, en 1513, dans une grave circonstance.
Les Suisses, traversant la Bourgogne pour aller faire jonction avec
les Impériaux, leurs alliés, avaient mis le siège devant Dijon.
La place, surprise par cette attaque, et dans l'impossibilité d'être
secourue, était dans un grand péril. Le gouverneur, sans négliger
aucun moyen de défense et sans laisser deviner à l'ennemi sa détresse
réelle, se rendit au quartier général des assiégeants, y fit apporter
en quantité des meilleurs vins du pays, et sut amener la négociation
sur un terrain tel, que les Suisses acceptèrent de lui un traité
de paix, et que, moyennant rançon, ils renoncèrent à leurs projets
sur Dijon. Cette délivrance parut si miraculeuse, que la population
en reporta sa reconnaissance sur la sainte Vierge, en l'honneur
de laquelle on célébra depuis chaque année, le 13 septembre, une
fête désignée sous le nom de Notre-Dame des Suisses. François 1er,
faisant probablement dans le miracle la part à la vaillante attitude
des habitants pendant le siège, leur accorda la faculté de posséder
des fiefs, quoiqu'ils ne fussent pas nobles, sans payer aucun droit
; et, pour les indemniser des pertes subies, faubourgs brûlés, vignes
saccagées, maisons de campagne ruinées, il les déchargea pendant
dix ans de l'imposition des marcs, leur donna 2 000 livres sur son
domaine et 2 000 sur d'autres fonds.
Une peste affreuse, qui
ravagea Dijon de 1500 à 1521 et obligea les corps constitués, parlement,
chambres des comptes et chambre de ville, à s'exiler dans les localités
voisines, est le seul événement notable qui ait précédé les guerres
de religion.
Une grande part de responsabilité dans les malheurs
de cette époque doit retomber sur quelques chefs fanatiques, qui
entraînèrent les habitants à des actes de barbarie auxquels ils
semblaient, peu disposés. Le duc de Mayenne et le comte de Tavannes
furent les principaux instigateurs de toutes les violences commises.
L'histoire oppose aux sanglants souvenirs qu'ils ont laissés celui
de l'immortel Pierre Jeannin, avocat et conseil de la ville, qui,
à la nouvelle des massacres de la Saint-Barthélemy, persuada au
comte de Charny que le roi n'avait pu donner de pareils ordres,
ou qu'il ne tarderait pas à s'en repentir. Au reste, les protestants
étaient peu nombreux à Dijon ; la terreur inspirée par les chefs
du parti catholique et le sentiment de leur impuissance les avaient
éloignés en grande partie ; aussi la ville demeura-t-elle au pouvoir
de la Ligue, dont le parti des modérés, dits les politiques, essayait
seulement de tempérer les excès.
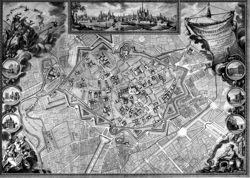
Enfin, le 7 juin 1595, Henri IV, vainqueur
à Fontaine-Française, fit son entrée dans la capitale de la Bourgogne.
Il y resta jusqu'à la fin du mois, s'occupant de concilier les esprits,
gagnant tous les cœurs et obtenant la capitulation de Mayenne ;
le 23, il alluma le feu de Saint-Jean le 24, il assista à l'élection
du maire, se défendant d'y exercer la moindre influence ; le 25,
il tira le coup d'honneur à l'arquebuse on montre encore le peuplier
auquel était attaché l'oiseau. Il partit le 3 juillet pour Auxonne,
et le 13 quitta définitivement la Bourgogne.
Le règne de Louis
XIII ne fut signalé que par la sédition du Lanturlu, occasionnée
par les craintes que conçurent alors les habitants sur le maintien
de leurs privilèges. Lanturlu était le refrain d'un vaudeville,
l'air battu sur les tambours, il devint la marche des révoltés,
et laissa son nom à la sédition. Louis XIII, venu en personne sur
les lieux, se montra d'abord irrité, puis céda aux larmes et aux
supplications du conseil municipal et à l'éloquence d'un avocat
nommé Charles Fevret, dont la harangue arracha des pleurs au roi
lui-même. Le 24 juin 1643, les drapeaux gagnés à la bataille de
Rocroy, qui fut le salut de la France, furent déposés à la Sainte-Chapelle
et portés à moitié traînants par les officiers municipaux en grande
cérémonie.
Le vainqueur de Rocroy, nommé gouverneur, fit son
entrée à Dijon le 29 janvier1647. La ville lui fit présent d'un
bassin plat en or. L'emprisonnement de Condé par Mazarin, son remplacement
au gouvernement de Bourgogne par le duc de Vendôme excitèrent quelque
émotion à Dijon mais un voyage du roi, en 1650, arrêta les progrès
de la désaffection. Le duc d'Épernon, toujours violent dans ses
moyens, eut recours aux bombes et à la mine pour débusquer du château
le commandant la Planchette, qui s'y maintenait obstinément. II
y eut quelques morts, quelques blessés, beaucoup de frayeur dans
la ville ; ce lut le seul épisode sanglant des troubles de la Fronde.
Une épidémie qui, en 1652, enleva un grand nombre d'habitants, le
passage de la reine Christine de Suède, le 21 août 1656 ; un premier
séjour du roi Louis XIV à Dijon en 1658; une seconde visite de ce
prince en février 1668, lorsqu'il partait pour la conquête de la
Franche-Comté, et un dernier séjour de la cour en 1674, lorsqu'une
seconde expédition contre cette même province fut nécessaire, tels
sont les derniers événements qui se rattachent à l'histoire de Dijon
sous l'ancienne monarchie.
Pendant la Révolution et depuis, la
population dijonnaise ne s'est signalée que par son dévouement aux
idées de progrès sur lesquelles repose l'avenir des sociétés modernes.
Son héroïsme devant les menaces de l'étranger a été aussi admirable
en 1814 et en 1870 qu'en 1792 nous avons dit, à propos de l'histoire
du département.
Les événements qui avaient intéressé Dijon pendant
la guerre de 1870-1871, nous n'y reviendrons pas ajoutons seulement
qu'elle a élevé un monument surmonté d'une statue de la Résistance,
par Paul Cabet, en l'honneur de la bataille du 30 octobre 1870.
Peu de villes, en France, semblaient avoir à perdre autant que Dijon
dans l'organisme départemental du territoire, et il en est peu,
au contraire, qui aient su tirer d'aussi puissants éléments de prospérité
et de développement dans les ressources que l'ère moderne offrait
au génie de la nation.
Les remparts, plantés d'arbres séculaires,
qui forment aujourd’hui de si magnifiques promenades, eurent pour
origine des palissades et des murailles telles que, les Romains
avaient coutume d'en élever autour des camps où les légions devaient
séjourner quelque temps; Marc-Aurèle ajouta à cette tours pour en
défendre les approches contre les Marcomans.
Les premiers rois
bourguignons entretinrent ces ouvrages avec un grand soin, mais,
sous leur règne, la ville s'étendit au dehors en de vastes faubourgs,
et l'espace occupé par le camp fortifié avait les mêmes limites
que celles de la paroisse actuelle de Saint-Médard. L'incendie de
1137, en déblayant le terrain, permit de dessiner une nouvelle enceinte
comprenant cette fois les faubourgs qui s'étaient groupés autour
des murailles du camp primitif ; ces travaux ne furent terminés
que vers le milieu du XIVème siècle, et la gloire de
leur achèvement appartient à Jeanne de Boulogne, mère et tutrice
du jeune Philippe de Rouvres. Les ducs de Bourgogne de la seconde
race, engagés dans des guerres continuelles, étaient trop intéressés
à entretenir les nouvelles fortifications pour en négliger la moindre
partie ; Jean sans Peur surtout se préoccupa du soin de mettre sa
capitale à l'abri de toute surprise. Il est permis de supposer que
cette sécurité contre les dangers du dehors ne contribua pas peu
au maintien des libertés communales. Le château, qui, dans tant
de localités, fut le grand obstacle à l'affranchissement, ne date,
comme nous l'avons dit, à Dijon que de Louis XI ; il n'eut pas de
caractère féodal, et des vues de politique générale présidèrent
à sa construction. En 1510, les remparts étaient flanqués de dix-huit
tours qui avaient chacune leur nom, et huit portes donnaient entrée
dans la ville. Plus tard, on démolit les fortifications et on convertit
les esplanades et les bastions en promenades.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.
