Saint Brieuc - Préfecture des Côtes d'Armor
Retour au Département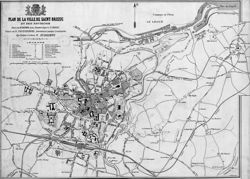

Saint-Brieuc, selon quelques savants, serait
l'ancienne Bidue ou Biduce; capitale des Biducassi, dont il est
question dans la géographie de Ptolémée. Mais il est reconnu aujourd'hui
que les Biducassi étaient un peuple de Normandie habitant les environs
de Caen. Aussi doit-on préférer l'opinion plus accréditée qui, dépouillant
Saint-Brieuc de cette superbe antiquité, place son origine seulement
au Vème ou même au VIème siècle. A cette époque
arriva d'Angleterre un saint homme nommé Brioc, en latin Briocus,
Briocius, Briomalcus.Ce vénérable personnage, que nous appellerons
désormais saint Brieuc, avait été disciple de saint Germain. Quel
saint Germain, Saint Germain d'Auxerre, qui vivait au Vème
siècle, ou saint Germain de Paris, qui vécut au VIème
? De la solution de ce problème insoluble dépend la date de la fondation
de Saint-Brieuc, fixée en 480 par dom Lobineau et en 556 par Albert
le Grand. Quelle que soit de ces deux dates la véritable, le saint
homme, ayant débarqué sur la côte septentrionale de l'Armorique,
se trouva en pays de connaissance. Le maître du lieu était aussi
un Breton fugitif, et de plus, le propre cousin de saint Brieuc
; il se nommait Rigwal ou Rivallon. La reconnaissance fut touchante.
Rigwal céda à son parent sa propre maison, située dans un lieu couvert
de bois, et appelée la Vallée Double, à cause des deux cours d'eau
du Gouët et du Gouëdic (Petit- Gouët), qui le traversaient.
Saint
Brieuc y bâtit un monastère et s'appliqua dès ce moment, avec ses
disciples, à détruire dans la contrée ce qui subsistait encore de
l'idolâtrie. La célébrité de ces pieux solitaires attira bientôt
autour d'eux de nombreux zélateurs, qui vinrent chercher sous les
murs de leur monastère une sécurité dont on ne jouissait guère,
à cette époque si troublée, qu'autour des églises et des couvents.
Des maisons s'élevèrent. La mort de saint Brieuc, loin de diminuer
le concours des fidèles, ne fit que l'augmenter par les miracles
qui éclatèrent sur son tombeau. Telle est l'origine de la ville
de Saint-Brieuc, qui ne pouvait porter à plus juste titre le nom
du saint personnage dont nous venons de raconter l'histoire. La
règle que saint Brieuc établit dans son monastère était celle des
grands moines d'Orient. Il l'avait sans doute apprise de saint Germain,
son maître, et l'avait imposée déjà au monastère de Grande-Lann,
fondé par lui en Angleterre avant son émigration. L'abstinence,
le travail des mains, la simplicité des vêtements, l'éloignement
du monde étaient les principales obligations de cette règle, que
les moines de Saint-Brieuc ne paraissent avoir abandonnée que pour
adopter, au VIIIème, ou au IXème siècle, celle
de Saint-Benoît, qui triomphait alors dans tout l'Occident.
On
a discuté beaucoup sur l'époque de la fondation de l'évêché de Saint-Brieuc.
Une inscription trouvée en 1210 dans la châsse du saint l'appelle
episcopus Britanniæ, et, d'autre part, la chronique de Nantes déclare
que l'évêché de Saint-Brieuc ne fut fondé qu'au IXème
siècle par Noménoë. Cette difficulté nous semble avoir été levée
par l'auteur des Annales Briochines. Selon lui, saint Brieuc ne
fut point évêque diocésain, mais, suivant un usage alors fort répandu,
principalement en Angleterre, il fut du nombre de ces évêques régionnaires
ou chorévèques, qui exerçaient les fonctions épiscopales par tout
le pays sans se renfermer dans une circonscription particulière.
Ainsi s'explique ce titre très vague d' episcopus Britanniæ et Noménoë
demeure le fondateur du diocèse de Saint- Brieuc, qu'il forma aux
dépens de celui de Dol, lorsqu'il voulut augmenter le nombre des
évêques de son domaine. C'est peut-être à cette époque que les moines
du monastère de Saint-Brieuc, las de la vie commune, adoptèrent
le partage des biens, et échangèrent le titre de moines contre celui
de chanoines, le froc contre l'aumusse. Il est certain que ce changement
était déjà opéré lorsque Juhel, archevêque de Tours, vint faire
sa visite en 1233. C'est sans doute en commémoration de l'ancienne
vie commune que l'évêque de Saint-Brieuc était obligé, au XVlllème
siècle, de donner un repas à ses chanoines aux quatre grandes fêtes
de l'année.

De bonne heure l'évêque de Saint-Brieuc eut la seigneurie
temporelle de la ville et de ses environs. Elle lui fut cédée ou
par Eudon, ce fondateur de la première maison de Penthièvre, qui
fut enterré dans la cathédrale, ou par Noménoë. Ce fief était dans
la catégorie des reguaires, qui tenaient un rang distingué parmi
les principaux fiefs du duché, où les évêques, comme pairs ecclésiastiques
du duc, jouissaient de la plupart des droits attribués aux hauts
barons. L'évêque de Saint- Brieuc, comme la plupart des évêques
de Bretagne, tenait à manifester sa puissance par la pompe déployée
le jour de son entrée dans la ville. « Le seigneur du Boisboixel
l'allait recevoir à la porte de la ville; là, on présentait au prélat
une haquenée richement caparaçonnée. Le seigneur du Boisboixel,
en qualité d'écuyer féodé, tenait l'étrier tandis que l'évêque montait
sur cette haquenée. Il la conduisait ensuite par la bride jusqu'au
palais épiscopal, et, lorsque le prélat était descendu, il prétendait
que la haquenée devait lui appartenir. Dans le festin de cérémonie
qui suivait cette entrée, le gentilhomme qui avait le titre de maître
d'hôtel féodé de l'évêque lui donnait à laver avant qu'il se mît
à table ; il lui versait à boire pendant le repas, et il prétendait
avoir aussi pour cela l'auguière, la serviette, la coupe d'or ou
d'argent dans laquelle le prélat avait bu, et ce qui restait de
viande dans le grand plat pour en manger ce qu'il voudrait. Le reste,
il devait le donner au maréchal ferrant ; celui-ci, après en avoir
aussi mangé autant qu'il voulait, allait aux prisons de l'évêque
inviter les prisonniers à faire bonne chère de ce qui restait. Le
maréchal ferrant était obligé de ferrer la haquenée et les prisonniers
de l'évêque, et avait droit de demander pour payement un parisis.
Le maître d'hôtel était obligé, et cette obligation subsiste encore
au XVIlIème siècle, de donner les hautbois, musettes
et violons, avec un jambon, le jour du mardi gras de chaque année,
sur la place du Martray à Saint-Brieuc, et tous les cabaretiers
de cette ville sont obligés d'apporter à la table du jambon, un
pot de vin ou de telle autre boisson qu'ils débitent. » (annales
Briochines.) Parmi les droits dont l'évêque de Saint-Brieuc jouissait
comme souverain temporel, il en était un fort singulier. Le jour
de la Saint-Jean, à l'heure des vêpres, un des propriétaires de
la rue nommée l'Allée-Menault était tenu de sortir de sa maison
un bâton à la main, et de dire trois fois « Renouessenelles (grenouilles),
taisez-vous, monsieur dort, laissez dormir monsieur ! »
Au
reste, si les évêques de Saint-Brieuc étaient fort puissants, ils
n'en étaient pas moins, la plupart du temps, des créatures de la
maison de Penthièvre, qui cernait de toutes parts leur diocèse de
ses terres et de ses châteaux forts et de qui ils tenaient leur
puissance. Quelquefois même il arrivait que c'était un cadet de
cette puissante maison qui occupait le siège épiscopal. Cette circonstance,
en diminuant leur indépendance, fut peut-être une des causes de
l'étendue de leurs droits. Lorsque, par exemple, au XIVème
siècle, le siège épiscopal de Saint-Brieuc était occupé constamment
par des cadets d'Avaugour, de Rohan et de Malestroit, parents et
amis des Penthièvre, il était impossible que des évêques si étroitement
liés aux puissants seigneurs du pays n'en tirassent pas quelque
avantage. Aussi le droit de régale, longtemps contesté, finit par
leur demeurer. Ce droit leur conférait la juridiction, la jouissance
des revenus de l'évêché pendant les vacances du siège, etc.

Au Xème siècle, l'évêque Jean, qui assista au concile de
Latran (1116) et à celui de Reims (1131), se fit remarquer par des
fondations nombreuses et par son application à faire disparaître
quelques désordres qui peignent l'époque et qui nous donnent occasion
de faire remarquer comment un certain ordre et une certaine police
prirent peu à peu possession de cette société bouleversée par le
chaos du Xème et du Xlème siècle.
Dans
le pays de Jugon, les habitants s'étaient accoutumés à enterrer
leurs morts au pied des croix placées sur les grandes routes. L'évêque
Jean consacra le cimetière de Notre- Dame-de-Jugon pour servir aux
sépultures à l'exclusion de tout autre lieu. Un autre abus, alors
très commun et que les papes et les évêques eurent beaucoup de peine
à déraciner, c'était la possession des biens ecclésiastiques par
des laïques, qui les avaient usurpés en grand nombre pendant les
deux siècles précédents. Ces biens étaient devenus héréditaires
dans les familles, qui les vendaient., les partageaient, les assignaient
comme douaires. On voit dans les cartulaires des ventes d'églises,
d'autels, de cloches, de calices. Jean obtint de certaines personnes
laïques qui possédaient ainsi l'église de Bréhand, qu'elles s'en
démissent entre ses mains.
Sous son épiscopat, un concile fut
tenu à Saint-Brieuc et présidé par l'archevêque de Dol.
Au temps
d'Erispoë, la piété des Briochins, alarmée des ravages des Normands,
avait fait transporter au monastère de Saint-Serge, à Angers, les
reliques de saint Brieuc. Les reliques des saints étaient à cette
époque de tels trésors qu'on ne s'en dessaisissait que dans une
nécessité extrême, et qu'on s'empressait de s'en remettre en possession
dès qu'elle avait disparu. Celles de saint Brieuc étaient pourtant
restées plusieurs siècles dans cet exil, lorsqu'en 1210 l'évêque
Pierre obtint des moines de Saint-Serge qu'ils lui en rendissent
du moins une partie, à savoir un bras, deux côtes et un petit peu
de la tête ou du cou, paruamper de cervice. Ce fut avec une
grande solennité et au milieu d'un concours de peuple extraordinaire
que se fit cette translation. Entre autres s'y trouva, dit la Chronique
de Bretagne, le très noble comte Alain, et il voulut lui-même porter
ces ossements vénérés depuis la porte de la ville jusqu'au chœur
de la cathédrale.
Un des évêques les plus fameux de Saint-Brieuc
est Guillaume Pinchon. Il appartenait à une famille noble du diocèse.
Il fut d'abord chanoine de Saint Gatien de Tours, d'où il fut rappelé
dans sa patrie pour y occuper le siège épiscopal. Opiniâtre défenseur
des prérogatives de l'Église, il soutint la lutte, au sujet des
droits de tierçage et de past Nuptiad, contre Pierre Mauclerc, qui
avait entrepris d'abaisser les évêques orgueilleux de la Bretagne.

Plutôt que de céder, l'obstiné prélat se fit chasser de son diocèse
par les commissaires du duc. Au reste, il paraît que la population
de la ville s'était jointe à eux. C'était le temps où les bourgeois,
plus hardis, commençaient à se lasser des exigences ecclésiastiques,
et c'en est un symptôme frappant que de voir Saint-Brieuc, une des
cités les plus arriérées au point de vue municipal, dans ces dispositions.
Pinchon se retira à Poitiers, où il fut coadjuteur de l'évêque.
Quand il lui fut permis de rentrer dans son diocèse, il s'occupa
de rebâtir son église cathédrale qui tombait en ruine. « Il n'eut
pas la consolation, dit un bon abbé historien, de voir la fin de
son entreprise. Dieu, content de sa bonne volonté, le retira de
ce monde au mois de juillet 1234 ». Le grand nombre de miracles
qui éclatèrent à son tombeau engagèrent le pape Innocent IV à le
canoniser treize ans après sa mort. Les offrandes des fidèles fournirent
abondamment de quoi achever l'église qu'il avait commencée, et ainsi
fut vérifiée cette parole qu'il avait dite plein de confiance en
la divine Providence que, « mort ou vif, il bâtirait son église.
»
Pinchon vivait encore lorsque Juhel, archevêque de Tours,
vint visiter l'évêché de Saint-Brieuc. Nous avons, sous le nom d'Acte
de Juhel, un règlement par lequel cet archevêque détacha du corps
de la cathédrale une paroisse pour laquelle il institua un vicaire,
Dans le même acte, il établit que les chanoines seraient astreints
à six mois de résidence au lieu de trois. Au XIVème siècle,
Saint-Brieuc eut un évêque célèbre dans la personne de Hugues de
Montrelais, chancelier de Bretagne il soutint avec énergie la cause
du duc Jean III contre le roi de France, Charles V, qui exigeait
l'hommage lige, et qui, vaincu par l'habileté du prélat, consentit
à recevoir l'hommage simple, le seul qui fût véritablement dû, comme
le prouva Hugues de Montrelais. Il se retira à la fin de sa vie
à Avignon et fut fait cardinal.
On s'étonnera que nous ne parlions,
à propos de Saint-Brieuc, que d'évêques et d'affaires ecclésiastiques.
C'est que l'histoire de cette cité est là presque tout entière.
Pourtant cette paisible existence fut troublée à la fin du siècle
où nous sommes parvenus. La guerre, dans les querelles de Jean IV
et de Clisson, vint tourbillonner autour de Saint- Brieuc et s'abattit
enfin sur elle. Les Briochins tenaient pour le duc. Clisson vint
les assiéger, ils se renfermèrent dans la cathédrale, que les évêques,
en leur qualité de souverains temporels, avaient fortifiée comme
une citadelle. Ils s'y défendirent quinze jours, et ne cédèrent
qu'après que le connétable eut fait avec ses machines plusieurs
brèches considérables à leurs murailles. Le duc, très sensible à
cette perte, accourut avec des forces supérieures et, ne pouvant
attaquer Clisson dans les murs dont il s'était emparé, l'attendit
durant six jours sur la grève d'Hillion. Clisson refusa le combat,
et bientôt l'intervention du roi de France fit cesser la lutte.
La guerre visita encore Saint-Brieuc deux siècles plus tard.
Près de la ville, et sans doute pour la défendre des attaques des
Anglais, avait été bâtie la tour de Cesson, au bord de la mer, sur
une falaise de 200 pieds de hauteur. La tour elle-même avait 100
pieds. On en attribue la fondation à Charles de Blois. En 1591,
Avaugour Saint-Laurent, lieutenant du duc de Mercœur, vint mettre
le siège devant cette tour formidable, qui tenait pour le roi. Une
armée royaliste, commandée par Rieux de Sourdéac, vint le forcer
de lever le siège, et, l'ayant fait prisonnier, l'enferma dans cette
même tour où il avait compté entrer en vainqueur. Le duc de lllercoeur
accourut pour venger son lieutenant, et força la place à capituler
après y avoir envoyé quatre cents volées de canon. Le maréchal de
Brissac la reprit en 1598, et Henri IV, qui démolissait partout
les forteresses de Bretagne, fit tomber celle-ci comme beaucoup
d'autres. On en voit encore d'imposants débris.

Le XVIIème
siècle eut une grande importance pour Saint-Brieuc. Cette ville
n'avait point eu, au moyen âge, ce mouvement municipal qui avait
fait la richesse et la force de la plupart des villes de France.
Aussi n'avons-nous vu à aucune époque la population briochine se
signaler par sa richesse, sa force et son émancipation. On a remarqué
que la ville n'était pas fortifiée. La cathédrale seule l'était.
En fait d'institutions municipales, nous trouvons bien des syndics,
mais dont l'établissement ne remonte pas au -delà du règne de Henri
II. Ce n'est que par un édit de 1692 que Saint-Brieuc obtint d'avoir
des maires et autres officiers municipaux. Ce n'est qu'en 1628 qu'elle
fut munie d'une enceinte fortifiée, dont il ne reste plus de traces
aujourd'hui, et que des milices y furent organisées. Ces milices,
destinées à la défense des côtes, se signalèrent en plusieurs occasions,
particulièrement à l'attaque d'une frégate hollandaise qui s'était
trop avancée sur les grèves et s'y trouvait à sec. Elles enlevèrent
d'assaut cette forteresse d'un nouveau genre malgré un feu bien
nourri, et le roi, en récompense, leur donna six des canons de la
frégate (1675).
Plus tard, à la bataille de Saint-Cast, on retrouve
encore honorablement les milices briochines. Ce n'est qu'en 1650
que Saint-Brieuc posséda une imprimerie. Elle fut établie sous la
direction de Guillaume Doublet. Pour favoriser un établissement
si utile, l'évêque, le chapitre de la cathédrale et la communauté
de la ville payèrent chacun une somme de deux cents livres. En 1601,
un collège avait été fondé et placé sous la direction du chapitre.
En 1664, l'évêque fonda aussi un séminaire dont il confia la direction
aux prêtres de la congrégation de la Mission, dite de Saint-Lazare.
Plusieurs couvents d'hommes ou de femmes s'élevèrent également
à Saint-Brieuc durant le XVème siècle, un couvent de
capucins en 1615, un couvent d'ursulines en 1624, un couvent de
bénédictines de la congrégation du Calvaire en 1626. Depuis 1503,
la ville avait aussi des cordeliers. Le XVIIème siècle
apporta quelques modifications aux règlements du chapitre, et particulièrement
au point important de la résidence. Le règlement de 1648, en autorisant
les chanoines à s'absenter trois mois pour leurs affaires, les obligea
implicitement à résider neuf mois. Plus tard, l'évêque Vivet de
Monclus confirma cette disposition et en ajouta quelques autres
également propres au maintien de la discipline. Un chanoine briochin
fit ce distique, où perce, à travers beaucoup d'admiration pour
les vertus du prélat, le peu de satisfaction que sa sévérité causait
au chapitre
Sic clero insigni, vivet, pietatis amator
Aurea connexit vincula, vincla tamem.
Puisque nous parlons
des règlements du chapitre, nous ne les quitterons pas sans en rappeler
quelques anciens articles, assez curieux par le détail où ils entrent.
Il en est qui ordonnent les bonnes mœurs, la régularité des vêtements
point de grandes manches, point de collerettes renversées, point
de gants ou de mitaines. « L'on doit entrer en cueur (au choeur)
humblement et révéremment, et ne doit-on point faire de station
ny de parlement en l'entrée dudit cueur, ny à l'issue. Et quand
on entre au grand autel, l'on se doit revirer et tourner pour faire
révérence audit grand autel. Et s'aucun en entrant ou en yssant
(sortant) trépasce ces choses devant dites, en le corrigeant et
remonstrant sa faute, on peut siffler sur lui, ou battre les chaeses
de chanoines en chanoines, de chapelains en chapelains, de bacheliers
en bacheliers. Item. Chacun ès festes doubles doit être, ébarbé
et tonsuré. Item. De ancienne coutume le vicaire perpétuel de Saint-Michel
est tenu au jour de Pâques bailler des esteurs (balles du jeu de
paume ou ballons), savoir, au prélat de ladite église cinq, et aux
dignitaires et chanoines de ladite église chacun trois, avec les
cabarets (raquettes) à les frapper à la manière accoutumée. »
Nous n'avons pas encore parlé des assemblées des états de Bretagne
qui furent tenues à Saint- Brieuc. Il y en eut quatorze jusqu'en
1768. La première que l'on connaisse est de 1567. En 1789, la noblesse
et le clergé, dont l'union avait toujours été étroite dans le diocèse
de Saint- Brieuc, protestèrent en commun contre la disposition qui
autorisait les ordres à envoyer séparément leurs députés, tandis
que d'après la constitution de Bretagne aucune représentation ou
délégation ne pouvait être envoyée au roi sans le concours des trois
ordres élisant par ordres et non par têtes. Au reste, la bourgeoisie
elle-même montra peu de sympathie pour les idées nouvelles, et ne
suivit que mollement l'exemple des autres villes de la province.
Les prêtres avaient la plus grande influence, et refusèrent presque
tous le serment de fidélité à la constitution. Néanmoins, le gouvernement
resta maître de Saint-Brieuc, qui n'eut à subir qu'une attaque des
chouans du voisinage. Ce fut en l'an VIII, dans la nuit du 4 au
5 brumaire ces insurgés, commandés par Mercier, dit la Vendée, se
jetèrent sur la ville pour délivrer leurs compagnons prisonniers,
et y réussirent. Cette cité, qui végéta si longtemps, a pris de
grands développements depuis la Révolution et s'est beaucoup embellie
dans ces dernières années. Chef-lieu d'un de nos départements les
plus peuplés, elle a doublé sa population, qui n'était alors que
de 6 à 7,000 habitants, et qui aujourd'hui est de 16,355 habitants.
Son clergé s'est mis plus au niveau de l'esprit moderne, grâce surtout
à l’influence de l'évêque Caffarelli sous l'Empire. Les états de
Bretagne, tenus à Saint-Brieuc en 1768, ont doté Le Légué d'un quai
magnifique qui en fait un des meilleurs ports de cette côte. Le
commerce d'exportation a pour principaux objets le lin, le chanvre,
l'huile de lin, le suif, le beurre, le cuir. L'aspect de la ville,
qui est à 88 kilomètres de Rennes et à 462 de Paris, n'est pas désagréable.
Ses rues, ses places, ses églises sont assez belles. La cathédrale,
d'un gothique un peu lourd, mérite l'attention. Les églises Saint-Michel
et Saint-Guillaume ont été rebâties, l'une en 1837, l'autre en 1866.
Parmi le monuments civils, on distingue l'hôtel de la préfecture
et son beau parc ; le palais épiscopal, ancien manoir de Quiquengrogne;
le grand séminaire, le lycée, le palais de justice entouré d'un
beau square; et dans la ville quelques anciens hôtels, notamment
l'hôtel de Rohan, des maisons curieuses du XIVème et
du XVème siècle et de belles casernes .Le Champ de Mars,
planté d'ormes, est une jolie promenade. Près de la ville il existe
une source d'eau ferrugineuse, et l'on trouve un beau granit qui
s'expédie à Paris. Une belle grève d'un sable uni et ferme, qui
s'étend au pied de la tour de Cesson, sert de théâtre à de brillantes
courses de chevaux fondées en 1801, et qui attirent de nombreux
spectateurs. Dans une partie de l'arrondissement de Saint-Brieuc
on parle le langage brezounecq ou bas breton, qui n'est autre
que l'ancienne langue celtique.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.