Chartres - Préfecture de l'Eure et Loir
Retour au Département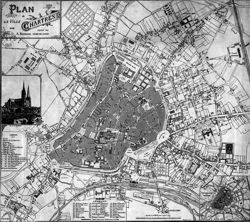
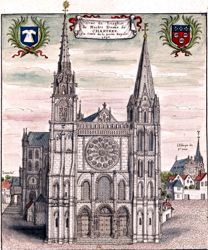
Chartres (Autricum, Ciroitas Carnutum) L'origine
de Chartres remonte à la plus haute antiquité les historiens romains
signalent l'existence d'une ville, capitale des Carnutes, à laquelle
ils donnent le nom d'Autricum, dérivé très vraisemblablement d'Autura,
qui était celui de la rivière d'Eure. La longue et obstinée résistance
de cette tribu gauloise fit donner plus tard le nom même du peuple,
Carnutes, Carnotes, à la cité dans laquelle se résumait en quelque
sorte la nationalité du pays, et avec le temps Carnute s'est transformé
dans le nom actuel de Chartres. L'importance que les Romains attachaient
à sa possession lui valut de nombreux embellissements pendant leur
domination son enceinte fut régularisée elle formait un vaste carré
qu'entouraient des faubourgs considérables. De somptueux édifices
furent élevés ; on construisit des aqueducs pour la conduite des
eaux; et deux voies principales y aboutissaient, se rattachant l'une
à Durocasses (Dreux), et l'autre à Suindinum (Le Mans).
Conquise
par les Francs avec le reste de la Gaule, elle fit partie du royaume
de Paris lors du partage de l'héritage de Clovis entre ses fils.
Pendant les guerres qui éclatèrent entre ces monarchies rivales,
Chartres fut assiégée en 600 par Thierry II, roi d'Orléans. Après
d'inutiles efforts pour prendre la place de vive force, ce prince
fit couper l'aqueduc construit par les Romains, et la ville, privée
d'eau, fut obligée de se rendre.
Aux agitations des guerres intestines
succédèrent bientôt les invasions des Normands. Chartres fut prise,
ravagée et incendiée par eux en 858 et en 872 les habitants durent
déployer une grande énergie pour réparer ces désastres, puisque,
en 911, nous voyons les attaques du fameux chef Rollon échouer devant
leurs murailles. Plus heureux, Thibaut le Tricheur, comte de Champagne,
s'en rend maître en 940, et ajoute le comté de Chartres à ses conquêtes
et à ses titres. A une époque beaucoup plus récente, Chartres eut
à subir l'invasion allemande ; elle fut occupée, le 21 octobre 1870,
par la 22ème division de l'infanterie allemande (3ème
armée), commandée par le général de Wittich.

Malgré les temples
élevés par les Romains aux divinités de l'Olympe, le druidisme,
réfugié dans de mystérieuses retraites ou dans les profondeurs des
forêts, comptait encore dans le pays de fervents et de nombreux
adeptes, quand le christianisme y fit sa première apparition. Ses
progrès eussent été sans doute plus lents et plus difficiles, si
les premiers apôtres n'eussent été aidés dans leurs prédications
par l'influence d'une légende populaire annonçant la venue d'une
Vierge qui devait enfanter. Le mystère de cette prédiction attribuée
à des druides morts depuis longtemps fut expliqué par les premiers
serviteurs du Christ. Saint Savitien et saint Potentien, envoyés
par saint Pierre dans les Gaules, vinrent de Sens à Chartres, pénétrèrent
auprès des druides, poursuivis et persécutés comme eux, ils en convertirent
un grand nombre, et lorsque, sous le règne de Constantin, il fut
enfin permis aux chrétiens de proclamer leur foi, la grotte souterraine
de Chartres où les druides dérobaient aux regards profanes les mystères
de leur culte devint la première église chrétienne, et le premier
autel que surmonta la croix fut cet autel même, élevé jadis par
les Gaulois encore païens Virgini parituræ; à la Vierge qui doit
enfanter. Notre-Dame de Chartres fut donc bien reconnue, selon
le naïf langage des vieilles chroniques, pour la Dame de la ville
et du Pays. Les évêques y exerçaient une autorité souveraine,
même avant la conquête de Clovis ; l'alliance des Gaulois avec les
apôtres du Dieu de la Judée avait été scellée dans le sang des-martyrs
des deux cultes.
Un gouverneur romain, nommé Quirinus, avait
fait précipiter convertisseurs et convertis dans un puits qui a
gardé le nom de puits des Saints-Forts. Les saints dont les noms
se rattachent à cette époque de lutte et de persécution sont saint
Potentien, qui rejoignit saint Savinien à Sens, et y fut évêque
après lui saint Altin et saint Éobald, qui parcourait l'Orléanais,
et saint Aventin, qui fut le premier évêque de Chartres, après avoir
été, dit-on, prêtre druide.
Clovis et ses successeurs de la
première race eurent une grande dévotion pour Notre-Dame de Chartres
et respectèrent les droits réels et l'autorité des évêques, même
lorsqu'ils se disputaient la souveraineté nominale de la province.
Toutes les terres et leurs revenus appartenaient à l'évêque à vingt
lieues à la ronde, autour de son clocher il en était de même des
tours, des murs de la ville et des lieux fortifiés, des halles et
des marchés. On retrouve encore quelques statues des anciens prélats
revêtues d'ornements moitié guerriers, moitié épiscopaux. Tenant
d'une main leur crosse et de l'autre l'épée, ils ont le casque en
tête et l'étole au cou. Ils conservèrent jusque sous la troisième
race le droit de battre monnaie.
Charles le Chauve avait ajouté
aux nombreuses et précieuses reliques constituant le trésor de la
cathédrale une chemise de la sainte Vierge que l'empereur Nicéphore
avait donnée en présent à Charlemagne. La métropole possédait, en
outre, les châsses de cinq de ses évêques canonisés, la main avec
laquelle saint Thomas toucha le côté de Notre-Seigneur, la tête
de sainte Anne et un grand nombre de meubles ou vêtements ayant
appartenu à Jésus-Christ et à sa mère. Le règne de chaque évêque
se perpétuait dans la mémoire du peuple par le souvenir de quelque
miracle.
C'est ainsi que, pendant le siège de Rollon le Normand,
l'évêque Gaucelin ayant exposé, dans une procession solennelle,
la chemise de la Vierge aux regards des assaillants, une terreur
subite s'empara des ennemis. Rollon lui-même qui rendit plusieurs
fois depuis témoignage du miracle, donna le signal de la retraite
et le pré dans lequel les Normands avaient campé conserva le nom
de pré des Reculés. Il y aurait une longue liste à dresser des évêques
qui ; par leur naissance, leur savoir ou leurs bienfaits ont illustré
le siège de Chartres nous n'avons voulu que donner une idée de la
persistance du sentiment religieux dans le centre de l'ancien druidisme,
et indiquer la face sous laquelle doit être étudiée la plus grande
partie de l'histoire de cette ville. L'usurpation de Thibaut le
Tricheur, l'avènement des comtes de Chartres eut en réalité moins
d'importance que l'énoncé du fait pourrait le faire supposer nous
ne voyons pas que ces seigneurs aient résidé dans la capitale de
leur nouveau comté ils se contentèrent, pour constater leur autorité
plus apparente que véritable, de s'y faire représenter par un vicomte,
qui n'avait droit qu'à quelques revenus casuels, et encore les évêques
opposèrent-ils à ces dignitaires la création de vidames, destinés
évidemment à leur disputer le peu de pouvoir qui leur était laissé.
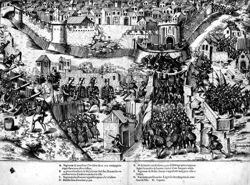
Malgré le rang élevé que gardèrent, dans la noblesse féodale, les
descendants de Thibaut, malgré l'illustration de leurs alliances
souvent princières, l'évêque demeura le véritable souverain de Chartres,
même alors que le comté devenait domaine royal, comme sous Philippe
le Bel, pour la première fois.
Aussi, presque tous les événements
qui touchent à l'histoire de Chartres ont-ils un caractère religieux:
de nombreux conciles y sont tenus le pape s'y réfugie en 1130, et
Henri ler d'Angleterre vient s'y prosterner devant lui.
Saint Bernard y prêche la croisade et entraîne en Palestine presque
toute la noblesse du pays. Saint Louis vient y conclure avec le
roi d'Angleterre une trêve qui lui permette de partir pour la terre
sainte, l'évêque de Chartres se contente d'aller guerroyer contre
les Albigeois. Pendant la période comprise entre le XIème
et le XVème siècle, nous aurions à raconter les querelles
intestines surgissant entre le pouvoir épiscopal, le chapitre de
Notre-Dame et les comtes de Chartres ou leurs représentants nous
verrions se grouper les premiers éléments de la commune et la bourgeoisie
profiter de la division des différentes puissances qui pèsent sur
elle pour revendiquer des droits conquis autour d'elle depuis longtemps.
Ce serait aussi la place de quelques détails sur l'attitude de Chartres
pendant la conquête anglaise, sur la sympathie constante de ses
habitants pour la cause française et sur l'héroïque dévouement des
deux bourgeois, Lesueur et Bouffineau, ouvrant les portes de la
ville à Longueville, Dunois, Boucicaut et La Hire, pénétrant dans
Chartres à la suite d'un détachement de soldats déguisés en marchands.
Nous retrouverions ce patriotisme et cette abnégation pendant la
lutte de François Ier contre Charles- Quint ; aucune
cité ne fut plus prodigue de son or, de tous ses biens et du sang
de ses enfants pour soutenir l'honneur de la France mais c'est surtout
pendant les guerres de religion qu'apparaît dans tout son éclat
l'inébranlable fidélité de la population chartraine aux traditions
paternelles.
Le schisme est partout, la Réforme triomphe dans
l'Ouest et dans le Midi, l’incendie gagne les provinces du centre,
la vieille cité des Carnutes n'en est pas atteinte. Henri III meurt,
le roi légitime vient en personne sommer la ville si fidèle, si
dévouée à la monarchie française la ville ne se rendra pas au huguenot.
Après un siège de six mois, le Béarnais verra ses portes s'ouvrir
devant lui mais c'est quand il viendra se faire sacrer dans la basilique
de Notre-Dame. C'est sur ce glorieux dénouement que peut se clore
le rôle historique de la ville de Chartres. Henri IV y avait été
sacré en 1594. Vingt-huit ans après, en 1622, une nouvelle organisation
diocésaine enlevait à l'évêché une grande partie de son importance
ce siège, qui étendait son autorité sur 1,700 paroisses, et qui
avait pu s'intituler primatc sedes Franciæ, était démembré, et de
ses dépendances l'évêché de Blois était fondé.

La puissance seigneuriale
grandissait en proportion de l'abaissement du pouvoir épiscopal
le comté de Chartres, érigé en duché, devenait apanage des princes
du sang la centralisation administrative achevait de substituer
aux derniers vestiges de l'existence provinciale le niveau d'une
vie empruntée au foyer de Versailles et de Paris.
La Révolution
vint plus tard compenser cette décadence politique et cette perte
d'influence religieuse par la conquête définitive de la liberté,
par l'extension du bien-être et une répartition plus générale de
la fortune publique aujourd'hui, que le prix de la moisson va plus
directement aux mains qui ont semé et labouré, Chartres s'est enrichie
de la richesse des fermiers des environs ; c'est le grand marché
de la Beauce, ce pays du blé. Il est peu de fortunes qui reposent
sur des bases aussi solides. Les industries qui se rattachent à
cette grande et importante production ont développé dans la ville
de Chartres un mouvement commercial moins fiévreux qu'ailleurs peut-être,
mais, à coup sûr, plus durable. La ville est bâtie en amphithéâtre,
sur une colline dont l'Eure baigne la base, et à laquelle les constructions
dont elle est couverte donnent la forme d'une vaste pyramide, couronnée
à son sommet par les flèches de la cathédrale les rues sont étroites,
sombres, irrégulières et grimpantes les maisons mal alignées, de
style gothique, avec leurs portes en ogive et leurs ornements, bizarres,
conservent l'empreinte des siècles passés. Sept portes donnent accès
dans l'intérieur ; la porte Guillaume avec ses deux tourelles reliées
par une courtine et quelques pans de vieilles murailles sont les
seuls débris qui subsistent de la période guerrière ; des sept paroisses
que comptait autrefois la ville, une seule a gardé sa pieuse destination,
c'est Saint-Aignan, devenu une succursale de Saint-Pierre.
La
rue des Ormes a été percée sur l'emplacement de l'église consacrée
jadis à saint Michel. Sainte-Foy a été transformée en salle de spectacle,
Saint-André en magasin à fourrages ; trois places ont été ouvertes
aux endroits occupés par Saint-Hilaire, Saint-Saturnin et Saint-Martin
le Normandier. L'église de Saint-Pierre, dépendant autrefois du
célèbre monastère de Saint-Père, dont la fondation est attribuée
à Clovis, a conservé de beaux vitraux et un aspect sombre et vénérable
mais la gloire de Chartres, c'est sa cathédrale.

Un premier temple
fut construit vers le règne de Constantin, sur l'emplacement même
occupé aujourd'hui par la magnifique basilique il eut le sort commun
à la plupart des édifices religieux de cet âge. Incendié en 858
par les Normands, lorsqu'ils pénétrèrent dans la ville sous prétexte
de recevoir le baptême et de rendre les honneurs de la sépulture
à leur chef Hastings, il fut réparé une première fois par l'évêque
Gislebert, puis incendié de nouveau, de 962 à 973, pendant la guerre
de Thibaut le Tricheur contre Richard, duc de Normandie; restauré,
puis détruit par accident, sous l'épiscopat de Fulbert, le 7 septembre
1020, la veille de la Nativité de la Vierge, il se releva sur de
nouvelles bases et d'après le plan que nous admirons aujourd'hui,
grâce au zèle infatigable du pieux et vénéré prélat qui sut intéresser
à cette œuvre glorieuse les personnages les plus considérables de
cette époque, tant en France qu'à l'étranger. A côté des rois, comtes
et barons, les bourgeois, marchands et corporations d'artisans coopérèrent
à la reconstruction du monument ceux-ci de leur participation aux
travaux, ceux-là des libéralités de leur bourse. Sur les vitraux,
à côté des armoiries de la noblesse, figurent les attributs des
corps d'état, témoignage touchant de l'alliance des forces et de
la communauté des efforts. Les principaux travaux furent achevés
en 1145. Quelques ouvrages de consolidation ont suffi pour défendre
le merveilleux édifice contre les ravages de sept siècles un volume
suffirait à peine à la description de ses beautés, contentons-nous
de citer les voûtes des porches chargées des sculptures les plus
curieuses, l'étonnante hardiesse des clochers dont l'un, haut de
124 mètres, dépasse de 60 mètres l'élévation des tours de Notre-Dame
de Paris, et se laisse apercevoir à une distance de douze lieues.
N'oublions pas le magnifique morceau d'architecture qui décore le
maître autel, chef-d’œuvre d'un artiste trop peu connu, Bridan,
et représentant l'Assomption de la Vierge. Signalons encore le seul
tombeau auquel une place ait été accordée dans l'église, celui du
baron de Bourdeilles, tué en 1568, en défendant la ville contre
les huguenots, après l'avoir préservée de la ruine et du pillage.
Une autre église souterraine règne sous presque toute la surface
de la cathédrale elle a pour première origine la grotte druidique
où fut trouvée la statue élevée par les prêtres Carnutes à la Vierge,
dont la divinité ne leur avait pas encore été révélée. Cette crypte
est encore le but de nombreux pèlerinages, et l'image sainte ; rétablie
dans l'église haute, est l'objet d'une dévotion particulière. Les
boiseries de l’autel sont tapissées d'ex-voto, qui attestent la
foi simple et naïve des paysans beaucerons. Les édifices modernes
offrent peu d'intérêt auprès de ces splendides monuments du passé
c'est toujours vers Notre-Dame que revient le voyageur, répétant
le vieux dicton populaire qui associe le monumentaux plus célèbres
gloires architecturales de notre pays :
Clocher de Chartres,
nef d'Amiens,
Chœur de Beauvais, portail de Reims.
Chartres,
au commencement du VIème siècle de notre ère, ne consistait
guère qu'en une bourgade occupant un assez petit terrain à l'extrémité
d'une plaine du côté de l'orient. Elle était composée d'une dizaine
de rues étroites et fangeuses dans lesquelles le soleil et l'air
ne pénétraient qu'avec peine. Aucune régularité, aucun plan d'alignement
ne se faisaient remarquer dans les habitations construites les unes
à côté des autres, suivant le goût, le caprice, les besoins des
habitants. La forme de la ville était alors celle d'un parallélogramme
borné au nord par la rue de Muret, laquelle tendait du bourg de
ce nom au chemin d'Orléans par le Grand-Pont ou pont du Château,
à l'orient par la rue Evière, qui partait de la rue Gabé, de la
rue Serpente, et se dirigeait vers Bonneval, Illiers et Courville
; au midi par la rue du Bœuf-Couronné, et à l'occident par la rue
du Cheval-Blanc.

Plus tard, quatre bourgs furent réunis à la ville ce furent le bourg de Muret, qui comprenait toutes les maisons qui avoisinent la porte Drouaise; le bourg du Château, que l'on nommait plus particulièrement le Bourg, situé aux environs du Grand- Pont ou pont de la Porte-Guillaume; le bourg de Saint-Sire, qui s'appelait simplement le Haut- Bourg enfin le bourg Châtelet, où est à présent la porte de ce nom. Cependant, quand il fut devenu nécessaire de défendre les villes en les entourant de murs, une partie des quatre bourgs qui s'étaient réunis à Chartres se trouva en dehors des fortifications que l'on éleva, et ils furent même presque entièrement détruits lors de la construction des fossés. « La première enceinte, faite vers le milieu du IXème siècle, commençait, dit Doyen, à la porte Saint- Michel, coupait le tertre du Mouton-Vert (depuis Saint-François) bornait le chœur de l'église de Saint-Aignan; de là à la porte Cendreuse, où depuis a été la chapelle de Saint-Vincent; de la porte Cendreuse au pied du château, à la descente de la Poissonnerie-de-Mer, jusqu'à l'endroit où se joignaient les rues du Bourg et de Muret, près de l'abbaye de Saint-Jean, jusqu'à la rue du Cheval Blanc, la partie depuis la porte Châtelet jusqu'à la porte Saint-Michel achevait cette enceinte. » Plus tard, cette enceinte fut encore augmentée par des additions successives, les murailles furent flanquées de tours, protégées par des fossés, et l'on pénétra dans la ville par sept portes dont une, la Porte Guillaume qui existe encore aujourd'hui, peut donner une idée de la force et de l'importance de ces fortifications.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.