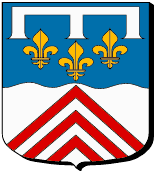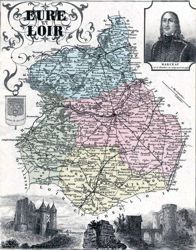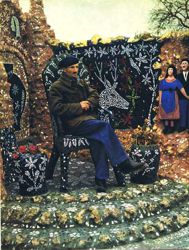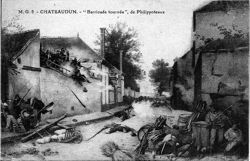Histoire de l'Eure et Loir

Le département d'Eure-et-Loir, souvent désigné, dans le langage vulgaire, sous le nom de Beauce ou de pays Chartrain, se présente aujourd'hui aux regards du voyageur ou aux souvenirs de ceux qui l'ont parcouru sous un aspect bien différent de celui qu'il eut autrefois. Dans ces plaines immenses couvertes de riches moissons, dans ces gracieuses vallées parsemées de riantes habitations, sillonnées de routes faciles, étalant les plantureux produits d'une culture intelligente et variée, il est difficile de reconnaître les épaisses et sombres forêts, les landes incultes et désertes, les marais fangeux inabordables, dont se composait le territoire des anciens Carnutes. Cette tribu de la grande confédération gauloise trouva, tout à la fois, dans la nature du sol qu'elle occupait et dans l'exaltation de ses sentiments religieux, les moyens d'exploiter le culte druidique à son profit.

C'est au fond de grottes ou cavernes cachées dans les profondeurs des bois, sur d'énormes blocs de pierre roulés dans les endroits les plus solitaires, et dont une terreur superstitieuse rendait les abords plus inaccessibles encore, que s'accomplissaient les mystères de Teutatès. Comme les prêtres de l'Inde et de l'Égypte, comme ceux de l'antique Cybèle, les druides de la Gaule trouvèrent bientôt dans l'ignorance et la crédulité populaires les éléments d'une domination souveraine près de leurs temples barbares, près de leurs grossiers autels, ils établirent des collèges où les adeptes étaient préparés à l'initiation. Cette province des Carnutes devint donc le centre religieux du culte druidique, et plus tard le dernier boulevard de la nationalité celtique pendant l'invasion romaine et les premiers envahissements du christianisme. Il existe encore dans le département.de nombreux vestiges des monuments de cette période historique.
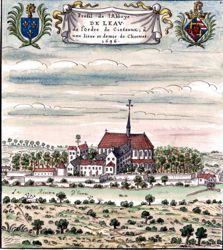
La Garenne de Poisvilliers conserve,
sur une éminence assez élevée, la trace de fossés larges et
profonds qui entouraient ce qu'on nomme encore dans le pays
le Vieux-Château, et ce que les archéologues reconnaissent pour
l'ancien collège des druides.
On a retrouvé à Dreux et à
Fermaincourt les ruines d'anciennes écoles, et dans la forêt
d'Ivry les assises d'un vaste édifice qu'on suppose avoir été
l'habitation du grand prêtre. Les environs de Chartres et la
commune de Lèves sont surtout riches en souvenirs de cette époque:
outre les galgals, dolmens et cromlechs, qui sont très nombreux,
on cite encore la montagne des Lienes, .la caverne qui s'ouvre
au levant sur les bords de l'Eure, près d'une fontaine qui passait
pour sacrée, la grotte de Chartres, creusée au sommet de la
montagne où s'élève la cathédrale actuelle enfin, les tumulus
de Goindreville et du Morancez, les autels encore debout aux
hameaux de Changé et de La Folie, les dolmens si célèbres de
Cocherel et de Quinquempoix, attestent à chaque pas le caractère
religieux de la contrée et l'importance que la nation des Carnutes
avait puisée dans cette espèce de concentration du pouvoir sacerdotal.
L'histoire manque de données positives sur la durée de ce régime
le bruit des armes romaines trouble pour la première fois le
religieux silence de ces mystérieuses forêts.
C'est aux clartés
de la civilisation qu'apportent avec eux les conquérants, qu'il
nous est donné de lire les premières pages de notre histoire
nationale. Les mœurs des Carnutes, leur costume, l'aspect du
pays, les cérémonies religieuses, ne nous sont révélés que par
leurs vainqueurs. Nous regrettons de ne pouvoir ajouter à notre
récit quelques pages sur l'organisation théocratique de cette
partie de la Gaule, sur les bardes, sur les prêtresses inspirées,
sur les barbares sacrifices inondant de sang humain ces pierres
levées, ces autels séculaires, que le lierre et la mousse recouvrent
aujourd'hui; nous voudrions pouvoir évoquer devant nos lecteurs
ces poétiques cérémonies, ces processions pompeuses qui, le
sixième jour de la lune de décembre, signalaient chez nos ancêtres
le retour du nouvel an, alors que, précédé de deux taureaux
blancs, entouré des prêtres, des sacrificateurs, des saronides
et de leurs élèves, suivi d'un long cortège de députés qu'envoyaient
chaque ville et chaque province, le chef des druides, avec ses
hérauts vêtus de blanc, une branche de verveine à la main, allait
couper le gui sacré avec sa serpette d'or. L'an 56 avant, J.-C.,
César pénètre dans les Gaules, apportant la vengeance de Rome
aux descendants de Brennus. Les Carnutes ne se laissèrent point
décourager par les premières victoires des légions romaines.
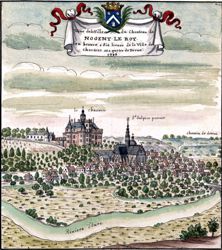
La mort de Clodius ayant rappelé César
en Italie, une vaste conspiration s'organisa dans le pays Chartrain
; les druides et leurs émissaires se répandirent dans la Gaule,
excitant les esprits au nom de la religion et de l'indépendance
nationale ; les provinces répondirent à cet appel ; l'Auvergne
se signala par l'entraînement de sa population presque entière.
C'est elle qui donna à l'insurrection son chef illustre Vercingétorix
; c'est au pied de ses montagnes que se livrèrent les grandes
batailles mais le foyer de l'incendie était dans le sanctuaire
druidique, et c'est du fond de leurs inaccessibles retraites
d'Eure-et-Loir que les prêtres dirigeaient le mouvement suscité
par eux. Leur influence, quoique affaiblie, survécut au triomphe
des Romains quelques siècles plus tard, nous voyons les superstitions
séculaires de la Gaule trouver dans le pays de Chartres leurs
derniers défenseurs contre les envahissements du christianisme.
La ténacité aux vieilles croyances, la fidélité au culte du
passé, tel est donc le caractère du pays dans cette première
période de son histoire nous verrons le sol se transformer,
les temples du Christ remplacer enfin les sanglants et grossiers
autels de Teutatès mais nous retrouverons dans les mœurs et
dans les annales de la contrée la foi plus pure, mais aussi
obstinée, le même fanatisme des traditions se transmettre de
génération en génération jusqu'à nos jours.
Le territoire
des Carnutes faisait partie de la quatrième Lyonnaise, lorsque
les Francs succédèrent à la domination romaine. Les terres furent
partagées entre les chefs vainqueurs et les ministres de la
religion qui avaient si puissamment concouru aux succès de Clovis
l'érection des comtés, l'établissement des évêchés, la fondation
des prieurés et des abbayes, sont les faits qui caractérisent
le règne des deux premières dynasties. Comme le reste de l'ancienne
Neustrie, les pays dont s'est formé ce département furent ravagés
par les Normands.
La formation des grands fiefs féodaux divisa
la contrée en quatre grands comtés du Perche, de Dreux, de Chartres
et de Dunois, dont les histoires spéciales constituent l'histoire
du département.. Le premier seigneur héréditaire du Perche fut
Yves de Bellesme, comte d'Alençon, qui mourut en 926. Il était
issu de la maison de Bellesme qui possédait viagèrement depuis
longtemps la petite province du Perche avant de l'obtenir de
Charles le Simple à titre héréditaire; la réunion dans la même
famille des comtés du Perche et d'Alençon met une certaine confusion
dans les annales de la contrée.
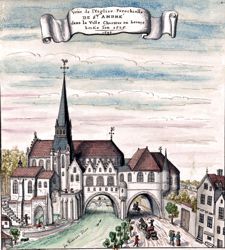
Saint Louis, en donnant en apanage à
son frère Pierre le comté d'Alençon, y joignit le comté du Perche,
d'où il résulta que les-puinés de cette branche royale portèrent
souvent le titre de comtes du Perche, comme on peut le remarquer
dans le célèbre procès intenté au duc d'Alençon, sous les règnes
de Charles VII et de Louis, XI. L'ancienne coutume du Perche,
qui a régi le pays jusqu'en 1789, avait été rédigée pour la
première fois en 1505, par autorité du roi, sous René, duc d'Alençon,
comte du Perche, et modifiée en 1558, sous Henri II.
La
province se subdivisait en trois cantons; Nogent-le-Rotrou en
était la ville la plus importante. Le Dunois, qui sépare le
pays Chartrain de l'Orléanais proprement dit, fut, dès l'origine
des temps féodaux, possédé par des seigneurs dont se rendirent
indépendants leurs lieutenants, les vicomtes de Châteaudun,
capitale de la contrée; le Dunois fut réuni par les comtes de
Blois à leurs domaines, qui passèrent au XIIIème
siècle à la maison de Châtillon. Gui II, le dernier héritier
de cette famille, vendit ses deux comtés, vers la fin du XIVème
siècle, à Louis de France, duc d'Orléans, frère de Charles VI.
Ce prince venait alors de recevoir du roi la vicomté de Châteaudun,
confisquée sur Pierre de Craon, assassin du connétable de Clisson.
Louis, devient ainsi possesseur de tout le Dunois, eut pour
héritier Charles d'Orléans, son fils ; celui-ci, fait prisonnier
par les Anglais, reçut pendant sa captivité, de son frère naturel,
Jean, des services qu'il récompensa par la cession du comté
de Dunois et de la vicomté de Châteaudun. Ce nouveau comte Jean
est le fameux bâtard de Dunois, qui s'acquit une si glorieuse
réputation dans les guerres de Charles VII contre les Anglais.
Il devint la tige de la maison d'Orléans-Longueville, dont onze
descendants possédèrent successivement la province de Dunois.
La famille s'étant éteinte au commencement du XVIIIème
siècle, dans la personne de la duchesse douairière de Nemours,
l'héritage échut à un fils naturel du comte de Soissons, oncle
de la duchesse; et la fille unique de l'héritier porta le comté
en dot dans la maison de Luynes où il est resté jusqu'à la Révolution.
Un des barons les plus habiles à exploiter l'agonie de la race
carlovingienne fut Thibaut le Tricheur ce surnom indique assez
de quel esprit rusé, cupide et envahisseur il était animé. Vers
l'an 920, ce seigneur, déjà comte de Tours et de Valois, s'empara
du comté de Chartres, qui avait été cédé au duc de Normandie
par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. La famille resta en possession
de ce fief jusqu'en 1286 il échut alors à la veuve d'un comte
d'Alençon qui le vendit à Philippe le Bel. Ce prince le donna
en apanage à Charles, son frère, comte de Valois, dont le fils,
Philippe, étant devenu roi de France, le réunit une seconde
fois à la couronne. En 1528, le comté.de Chartres fut érigé
en duché par François Ier, puis engagé par Louis
XII pour 250,000 écus d'or, à l'époque du mariage de sa fille
Renée avec Hercule d'Este, duc de Ferrare.
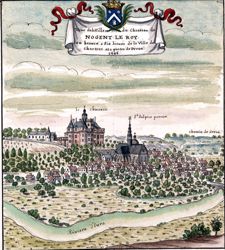
En 1623, le duché de Chartres fit encore
retour à la couronne, et fut compris dans l'apanage de Gaston,
duc d'Orléans, frère de Louis XII ; il fit ensuite partie de
celui d'un autre duc d'Orléans, Philippe, frère de Louis XIV,
dont la postérité l'a possédé jusqu'à la Révolution. Quoique
dépouillé de ses privilèges les plus essentiels, le titre de
duc de Chartres a été religieusement conservé dans la famille
d'Orléans ; Louis-Philippe, depuis roi de France, après l'avoir
porté jusqu'à la mort de son père, le transmit à son fils aîné
qui ne le quitta, à l'avènement du roi son père au trône, que
pour le titre de duc d'Orléans, attaché au chef de la famille.
Enfin, quoique le titre de duc d'Orléans ait été échangé depuis
contre celui de comte de Paris pour l'héritier présomptif de
la couronne, le second fils dit prince royal reçut et porte
le titre de duc de Chartres.
Le comté de Dreux, formé de
l'ancien pays des Durocasses, couvert autrefois de forêts comme
le pays Chartrain, a une histoire commune avec cette contrée
jusqu'à la séparation des grands fiefs. C'est en 1031 que nous
rencontrons les premiers documents constatant l'existence d'un
comté de Dreux. Ses premiers possesseurs furent les comtes du
Perche. En 1378, une dame de cette maison le vendit au roi Charles
V. Engagé plusieurs fois, dans les temps difficiles, ravagé
ou occupé par les Anglais, il ne rentra dans le domaine royal
qu'en 1551. Henri III le donna en apanage à son frère, le duc
d'Alençon ; à la mort de celui-ci, il passa à Charles de Bourbon,
comte de Soissons, qui le transmit à son fils Louis, tué à la
bataille de La Marfée, près de Sedan, en 1641. Enfin, sauf quelques
droits particuliers sur la ville de Dreux, le comté fut définitivement
et complètement réuni à la couronne vers la fin du XVIIème
siècle.
La longue lutte contre les Anglais, les guerres
de religion, quoique se rapportant à l'histoire générale du
département, trouveront leur place dans la notice consacrée
à chaque ville pr in- -cipale, à propos des épisodes dont elles
furent le -théâtre. Nous n'aurions rien à ajouter à cette courte
notice si les événements douloureux qui signalèrent la fin du
second Empire ne nous imposaient la tâche de rappeler brièvement
les derniers faits de l'histoire contemporaine.
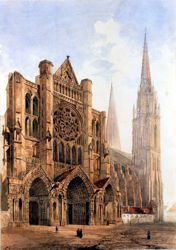
En effet, durant la guerre franco-allemande
de 1870-1871, le département d'Eure-et-Loir fut un des plus
éprouvés par le fléau de l'invasion. La plupart de ses villes
et bourgades eurent à subir la présence de l'ennemi, et des
combats sanglants furent livrés sur divers points de son territoire,
notamment à Châteaudun, aux environs d'Orgères, à Nogent-le-Rotrou
et à La Fourche. L'armée envahissante était commandée par le
prince royal Frédéric-Guillaume. Le 18 octobre, la 22ème
division d'infanterie allemande, la 4ème de cavalerie,
sous les ordres du général de Wittich, ayant reçu pour mission
de rallier l'armée au blocus de Paris, en passant par Chartres
et Dreux et en rejetant les troupes que l'on pourrait trouver,
arrivaient devant Châteaudun, ville défendue par les francs-tireurs
de Lipowski et par les habitants. Un violent combat s'engagea
et la ville fut en partie réduite en cendres. Le 20 octobre,
les troupes allemandes, qui s'étaient emparées de Châteaudun,
bombardaient et traversaient Illiers, continuant leur marche
sur Chartres, qu'elles occupèrent le 22. Parmi les localités
où l'ennemi s'établit, nous nous contenterons de citer : Maintenon,
Dreux, Nonancourt, Voves, Brou (25 novembre), Janville, Orgères
le 29 novembre, Bonneval et Courville. Les pertes éprouvées
par le département d'Eure et- Loir, pendant cette triste période
de notre histoire, se sont élevées à la somme énorme de 35,99,427
fr.
Quoi qu'il en soit, la paix dont a joui la contrée pendant
près de deux siècles a transformé son aspect une grande partie
de ses bois a été rasée le voisinage de l'Ile-de-France et de
Paris, ces grands centres de population, offrant aux céréales
un débouché assuré et avantageux, le sol défriché s'est couvert
de riches moissons et c'est à juste titre que la Beauce est
appelée le grenier de Paris. Plaines immenses livrées à la grande
culture, riantes vallées où chaque paysan a son verger, son
marais et sa vigne ; petites villes où se concentré le commerce
des campagnes environnantes, telle est la physionomie générale
d'Eure-et-Loir.
Quant au caractère des habitants, il participe,
comme partout, de la différence des localités. Les mœurs patriarcales
se sont conservées plus pures, plus austères chez les laboureurs,
vivant souvent encore d'une vie commune, maîtres et serviteurs
dans leurs grandes fermes isolées. L'habitant des vallées, le
Percheron surtout, est bien plus accessible aux influences de
la civilisation moderne son vieil esprit gaulois se prête merveilleusement
à l'intelligence des affaires il est spirituel, fin et quelque
peu rusé ; il y a un proverbe qui dit : il entend à demi-mot,
il est de Châteaudun. Mais le signe original qui se retrouve
encore dans la population des villes comme des campagnes, et
des plaines comme des vallées, c'est la dévotion et le patriotisme,
précieux héritage des Carnutes, leurs premiers ancêtres.
L’actuel département d'Eure-et-Loir correspond
à la partie centrale du territoire des Carnutes dont Chartres
était la capitale, sous le nom d’Autricum. Les Carnutes sont
célèbres surtout pour leur lien, réel ou présumé, à la religion
gauloise. C'est en un locus consecratus, dans la mythique «
forêt des Carnutes », que les druides auraient tenu leur réunion
annuelle. Au nord du département, le peuple gaulois des Durocasses
avait pour capitale Dreux. Au Moyen Âge, le territoire actuel
du département est dominé par la ville de Chartres. Elle se
développe grâce à la culture des riches terres de Beauce (marché
au blé) et à sa vocation religieuse due notamment à la présence
de la relique du Voile de la Vierge (don de Charles-le-Chauve
en 876). Sur l'impulsion de Fulbert de Chartres, elle sera le
berceau d'une renaissance intellectuelle avec la fondation de
l'École de Chartres. Au nord, Dreux, la vallée de l'Avre et
le Thimerais, de même que le Comté du Perche à l'ouest, constituent
des postes avancés des rois de France face aux ducs de Normandie.
Les terres d'Eure-et-Loir, par leur intérêt stratégique, sont
donc très tôt ancrées dans la mouvance capétienne et progressivement
rattachées aux anciennes provinces de l'Orléanais et de l'Ile-de-France.
Durant la guerre de Cent Ans, le territoire du département est
au centre de plusieurs conflits.
(dont la Journée des Harengs
à Rouvray-Saint-Denis), en raison de sa proximité avec Paris
et Orléans. Le traité de Brétigny, qui met fin provisoirement
à la guerre, y sera signé près de Chartres. À partir de la Renaissance,
l'Eure-et-Loir devient également une région prisée par les rois
de France pour y installer leurs favorites : Diane de Poitiers
(Anet), puis Madame de Maintenon ou encore la marquise de Pompadour
(Crécy-Couvé). Le département est également marqué par la présence
de Maximilien de Béthune, duc de Sully, décédé en son château
de Villebon et inhumé à Nogent-le-Rotrou.
Chartres
La devise en latin de Chartres est «
servanti civem querna corona datur » qui signifie « À celui
qui sauve un citoyen est donné une couronne de chêne ». Il s’agit
là d’une tradition de la Rome antique : la couronne de chêne
était décernée à tout citoyen ayant, sur le champ de bataille,
sauvegardé l’existence d’un de ses concitoyens. Cette devise,
figurant sur le blason de la ville dès le XVIème
siècle, se retrouve à la fin du XVIIIème siècle sur
des médailles frappées aux armes de la ville. En 1790, pour
avoir sauvé une chartraine, le maçon Halgrain et le menuisier
Brossier, conformément à la tradition antique, reçurent du maire
Asselin une médaille en argent frappée aux armes de la ville,
attachée à un ruban aux trois couleurs de la nation et portant
la fameuse devise.
On connait mal l’évolution urbaine de
Chartres entre le IIIème et le Xème siècle
: la cité antique semble s’être effacée au profit de petits
villages autonomes. Les premières installations de bâtiments
chrétiens, attestés par quelques textes, laissent supposer qu’à
la fin du VIème siècle nombreux étaient les établissements
religieux à Chartres, alors dirigés par l’évêque.

Au IXème siècle, les Normands
ravagent les terres environnantes à plusieurs reprises et, en
juin 858, détruisent la ville et probablement la cathédrale.
Celle-ci est reconstruite, tandis que les Chartrains érigent
les premiers remparts.
En 876, un don de Charles le Chauve,
le Voile de la Vierge, est à l’origine d’un important pèlerinage
qui fera la richesse de la cité et la puissance des institutions
religieuses locales.
Le 16 février 886, les Danois de Siegfried
attaquent sans succès la ville et perdent 1 500 hommes.
Lors d’une autre attaque, en 911, le
chef normand Rollon se heurte à la résistance qu’organise l’évêque
Gantelme. À l’approche des renforts, l’évêque n’hésite pas à
faire diversion. D’après un récit du XIIème siècle,
il fait fuir l’ennemi en brandissant la chemise de Marie, le
Voile de la Vierge, relique majeure de la cathédrale. Cette
victoire, attribuée à l’intercession de la Vierge elle-même,
ne fait qu’accroitre dans les siècles suivant le rayonnement
du pèlerinage, qui à la faveur des dons, facilite le financement
de la cathédrale actuelle.
Une autre source de cette puissance
réside dans la richesse de la Beauce où le chapitre de la cathédrale
possède de grands domaines. C’est de cette richesse et de cette
puissance que découleront les cathédrales successives.
Cet
éclat matériel se double alors d’une grande renommée intellectuelle.
L’évêque Fulbert de Chartres se trouve à l’origine du développement
de l’École de Chartres qui s’épanouit pendant près de deux siècles.
À côté de maitres célèbres comme Thierry de Chartres ou encore
Bernard de Chartres, il faut également noter la place de l’évêque
Yves de Chartres qui fut l’un des grands canonistes de l’Église.
Au Xe siècle, la présence de Thibaud le Tricheur dans son château
modifie la répartition des pouvoirs au sein de la ville. Le
renouveau économique autour des métiers de la rivière, soutenus
par le comte et l’évêque, jette les bases du développement urbain
à venir.

Dans le domaine politique et militaire,
le roi de France Louis VI le Gros réduit à merci, au prix d’une
longue lutte, le sire du Puiset, dont la puissance était un
défi à la monarchie. Durant la Renaissance du XIIème
siècle, à Chartres s'épanouit une pensée novatrice, nourrie
par la redécouverte du platonisme, qui fait la richesse de l'«
esprit chartrain » selon l'expression de Jacques Le Goff. Un
esprit qui découle directement de la rigueur grammaticale et
de la curiosité scientifique de l'enseignement de Bernard de
Chartres, basé sur les anciens, et dont les propos à ce sujet,
rapportés par Jean de Salisbury, sont devenus parmi les plus
fameux de l'histoire intellectuelle :
« Nous sommes comme
des nains juchés sur des épaules de géants, ainsi pouvons-nous
voir mieux et plus loin qu'eux, non que notre vue soit plus
perçante ou notre taille plus élevée, mais parce que nous sommes
soulevés en l'air et portés par leur hauteur gigantesque.»
Cette région, au centre de la France et au cœur des domaines
royaux, endure les conséquences de la guerre de Cent Ans. C'est
à Brétigny, petit hameau au sud de Chartres, qu'est signé le
8 mai 1360 un traité marquant une trêve entre les Anglais et
le roi de France Jean le Bon.
Plus tard, c'est au sud du
département que se joue l'épisode mémorable de la bataille des
Harengs. Un convoi de vivres venu de Paris et destiné aux assiégeants
d'Orléans fait l'objet d'une tentative de destruction, par les
assiégés de cette ville qui avaient fait une sortie hors de
leurs murs.
Châteaudun

Aux confins de la Beauce et du Perche,
la ville de Châteaudun est établie en grande partie sur le sommet
d'un coteau aux puissantes assises calcaires dominant la rivière,
ce qui lui confère un rôle défensif avant la conquête romaine
jusqu'à la Fronde. De ce fait, son appellation dérive de l'association
du mot cette « Dun » désignant un lieu en hauteur, et du mot
latin « castrum », signifiant un camp fortifié.
Evêque de
Chartres, Saint-Aventin aurait opéré un miracle en sauvant son
frère de la lèpre. Par cet acte, il permet la christianisation
du territoire voué au culte druidique et fait naître les trois
premières églises qui se multiplient par la suite.
Au lendemain
des invasions normandes, Châteaudun est administrée par des
comtes amovibles dont Thibaud V, Comte de Blois, Chartres et
Tours En 1197, une charte de communes est octroyée à Châteaudun.
Au début du XIIème siècle, une abbaye est installée
près du château comtal. Châteaudun est la capitale du Dunois
à cette époque.
Louis d'Orléans acquiert au XIVème
siècle les comtés de Blois et de Dunois et ce jusqu'au XVIIIème
siècle. A sa mort, son fils aîné Charles, le poète d'Orléans
hérite de son patrimoine. Détenu par les anglais lors de la
Guerre de Cent Ans, il cède à son demi-frère, Jehan de Dunois,
le comté et la vicomté de Dunois.
Il entreprendra alors la
construction d'une partie du château. Ses descendants les Longueville
y ajouteront l'aile du XVIème siècle. Jusqu'au XVIIème
siècle, le développement économique repose sur quelques industries
comme celles du textile : draps, serges, couvertures. Des moulins
sont installés près des grottes. Les tanneries prospèrent.
En 1723, un violent incendie lui ôte une partie de son tracé
médiéval (le quartier Saint-Lubin et le château ont pu être
préservés).
Un nouveau modèle urbanistique sobre et raffiné
est alors dessiné par Jules Michel Hardouin Mansart,. La ville
nouvelle s’ordonne autour de la place du 18 Octobre 1870, du
centre-ville actuel. Châteaudun n’échappe pas à la Révolution
qui occasionne la mutilation et la destruction d’édifices religieux.
Dreux

Ville frontière du domaine royal face
au duché de Normandie, Dreux a longtemps commandé l'accès au
royaume de France. Cela lui vaut d'avoir été convoitée par les
ducs de Normandie et les comtes d'Anjou à de multiples reprises
au fil de l'histoire. Elle fut assiégée vers l'an 1000 par Richard
II duc de Normandie La ville fut le chef-lieu d’un comté célèbre
: elle fut érigée en commune vers 1108, par Louis le Gros, ou
même, selon quelques-uns, dès 1092. Elle est confirmée par Robert
de Dreux en 1180, les bourgeois s’engageant alors à défendre
la place contre les ennemis du roi.
Cette place forte soutint
divers sièges remarquables. Elle fut assiégée en 1188 par Henri
II d'Angleterre puis en 1412 par les Bourguignons pendant la
guerre civile, en 1421 par Henri V d'Angleterre et enfin 2 fois
par Henri IV, en 1590, sans succès puis en en 1594 ou il la
démantela.
Au cours des guerres de religion, en décembre
1562, Dreux fut le siège d’une bataille entre l’armée catholique
et royale de Catherine de Médicis, régente et comtesse de Dreux,
et les troupes protestantes du prince Louis de Condé et de l’amiral
de Coligny. Les catholiques remportèrent la victoire, mais au
prix de 8 000 morts laissés sur le champ de bataille.
En
1816, la duchesse d'Orléans, fille unique du duc de Penthièvre,
et mère de Louis-Philippe Ier, fait ériger la chapelle
Saint-Louis sur la colline qui domine la ville suite au saccage
de la collégiale Saint-Étienne dont son père avait fait sa nécropole
familiale.
Le 30 septembre 1870, le ballon-poste Céleste
piloté par Gaston Tissandier s'envole de l'usine à gaz de Vaugirard
à Paris alors assiégé et termine sa course près de Dreux après
avoir parcouru 81 kilomètres.

Jusqu'au XVIème siècle, une
immense forêt couvrait l'essentiel de ce que l'on a plus tard
appelé le Perche (Pays de bois) et rendait la région de Nogent
difficilement accessible. C'est seulement au VIe siècle que
Saint Avit, Saint-Bomer, Saint Lomer et Saint Ulphace évangélisèrent
Nogent et sa région Durant le Haut Moyen Âge, la forêt du Perche
servit plusieurs fois de refuge aux armées.
Au Xème
siècle, le Perche était partagé entre les seigneurs de Chartres,
de Châteaudun, de Châteauneuf, du Corbonnais et de Vendôme .
Pendant ce temps, la ville, appelée Nogentum (« nouveau peuple
»), se développait lentement. Elle était protégée par un castel,
plusieurs fois détruit et à chaque fois reconstruit. En 955,
Thibaut le Tricheur, comte de Chartres, confia Nogent à son
fidèle vassal Rotrou, premier du nom. La seigneurie de Nogent
fut érigée en comté du Perche à la fin du XIème siècle.
Nogent connut une croissance urbaine forte à cette époque,
grâce à l'établissement de plusieurs bourgs autour du château,
à la construction d'un donjon au début du XIème siècle
et à la fondation par Geoffroy III en 1029 de l'abbaye bénédictine
de Saint-Denis, qui devint en 1080 un prieuré clunisien.
Rotrou III le Grand (1100-1144) étendit son autorité sur plus
de 500 fiefs grâce à une administration efficace et au prestige
que lui procurèrent ses performances militaires, face à son
rival Robert de Bellême ou lors de la première croisade. C'est
grâce à sa renommée que la ville fut ensuite appelée Nogent-le-Rotrou
.

En 1134 et 1135, Nogent-le-Rotrou fut
successivement détruite par des inondations puis par un incendie.
Les Rotrou étaient très pieux : Rotrou III et son fils Rotrou
IV, beau-frère du roi de France Louis VII, enrichirent le prieuré
de Saint-Denis et lui octroyèrent des privilèges sans cesse
plus étendus, Rotrou IV fonda la maison-Dieu (ou hôtel-Dieu)
en 1182, et son fils Geoffroy V établit la collégiale Saint-Jean
en 1194. Le château fut complété d'une enceinte au XIIème
siècle, tandis que l'on commençait à fixer par écrit les coutumes
du Perche.
La mort du dernier comte du Perche de la famille
des Rotrou, Guillaume, en 1226, entraina le rattachement au
domaine royal du Perche, qui fut gouverné pendant 200 ans par
une branche cadette de la famille royale. Un bailli fut alors
établi dans le Perche, dont la capitale se déplaça progressivement
vers Mortagne et Bellême.
Nogent-le-Rotrou fut fortement
affectée par les désordres qui touchèrent le Royaume de France
au XIVème et au début du XVème siècle.
Le monastère de Saint-Denis fut dévasté vers 1302 par les habitants
de Nogent, pour une raison inconnue. Les Anglais s'emparèrent
de la ville en 1359 après un violent combat sur le pont Saint-Hilaire,
avant de rendre la ville l'année suivante à la paix de Brétigny.
En 1427, Salisbury reprit la ville et incendia le château, qui
ne fut réparé qu'à la fin du siècle. Le XVIème siècle
vit le développement rapide de la production et du commerce
des serges et étamines de Nogent-le-Rotrou, exportées dans toute
l'Europe et vers le Nouveau Monde. On produisait également du
vin et du cidre dans les campagnes entourant la ville.
Nogent-le-Rotrou
connut un essor intellectuel et artistique important à la Renaissance,
et vit la naissance du poète de la Pléiade Rémy Belleau L'hôtel
de ville et les halles furent bâtis en 1533, et le pavement
des rues de Nogent commença en 1556. La Coutume du Perche fut
révisée en 1558, dans la grande salle du chapitre de Saint-Denis.
Mais les guerres de religion frappèrent Nogent, après que Louis
de Bourbon, seigneur de Nogent, a pris la tête du parti protestant.
La collégiale fut incendiée en 1568, et un chef catholique normand
fit pendre la garnison protestante du château quelques mois
plus tard. Plusieurs couvents et un collège furent fondés au
cours du XVIIème siècle à Nogent, tandis que la prospérité
du Perche était assurée par une proto-industrie textile et métallurgique
en plein essor.
Louis XIII et sa mère la régente Marie de
Médicis firent une halte dans la ville le 10 septembre 1614.
Maximilien de Sully, ministre protestant d'Henri IV, acquit
en 1624 la seigneurie de Nogent, mais n'y résida pas en raison
de l'opposition des moines de Saint-Denis; il y fut néanmoins
enterré à sa mort en 1641.
La révocation de l'édit de Nantes
entraina l'émigration de nombreux fabricants de tissus et le
début du déclin de cette industrie.
À partir de 1723, la
monarchie publia plusieurs arrêts visant à combattre la fraude
qui aggravait encore les difficultés de ce secteur. De 25 000
pièces en 1693, la production des étamines chuta à 7 000 pièces
en 1787 et 3 500 en 1802. Cette crise fut néanmoins compensée
par l'essor de l'élevage des chevaux percherons, recherchés
pour leur vigueur et leur endurance.
On commença au milieu
du XVIIIème siècle à assécher les marais du centre
de la ville.
La ville, durement affectée par les difficultés
économiques, fut le théâtre d'évènements précurseurs de la Révolution
: la population se révolta contre les corvées en 1780, et les
capucins se plaignirent en 1784 qu'ils étaient insultés par
les « gens du peuple »
La bataille de Châteaudun
Plan du site |
Moteur de recherche
| | Page Aide |
Contact
© C. LOUP 2025
.