Quimper - Préfecture du Finistère
Retour au Département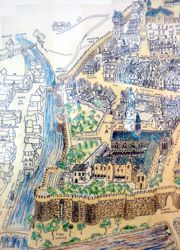

Quimper (Cornu Galliæ, Corisopitum, Vagositum
novum), Quimper, dont l'orthographe véritable est Kymper ou Kemper,
parait être l'ancienne Corisopitæna, capitale des Corisopites.Une
tradition absurde; mais que nous rapportons parce qu'elle appartient
à cette curieuse tendance du moyen âge à attribuer la fondation
des villes d'Occident aux héros trÓyens fugitifs, fait remonter
l'origine et le nom de Corisopitum à Chorinæus. Rien de positif
sur cette ville, où les Romains eurent un établissement considérable
les débris de briques et de poteries romaines qu'on retrouve en
abondance dans le quartier de Locmaria, à Quimper, semblent prouver
que c'est bien l'ancienne Corisopitum. A la chute de l'empire, la
ville prit le nom celtique de Kemper, qui veut dire confluent (kem,
avec; bera, couler), à cause de sa situation au confluent de l'Odet
et du Stheir.
On l'appela même plus particulièrement Kemper-Odet,
pour la distinguer de Kemper-Ellé.
Vers 375 après J.-C. naquit,
de parents chrétiens, le patron de Kemper. Corentin se consacra
de bonne heure au culte du Christ et s'établit au pied du Méné-Hom,
près d'une fontaine, au bord de la mer. Dieu prit soin de sa nourriture.
(Il lui envoya, dit Albert le Grand, un petit poisson en sa fontaine,
lequel tous les matins se présentait au saint, qui en coupait une
pièce pour sa pitance et le rejetait dans l'eau, où tout à l'instant
il se trouvait entier, sans lésion ni blessure. Un soir, que le
saint priait tout seul dans son ermitage, arriva avec un grand bruit
de cors, de chiens et de chevaux, le roi Gradlon, au milieu de sa
cour brillante d'or et de soie. Un pauvre homme comme Corentin devait
être fort embarrassé pour traiter cette troupe de chasseurs affamés
; mais le saint avait Dieu même pour pourvoyeur. Il alla à sa fontaine,
coupa un morceau du petit poisson, et l'apporta au maitre d'hôtel
du monarque. Celui-ci se mit à rire, disant que cent fois autant
ne suffirait pas pour le train du roi. Il consentit pourtant à accommoder
la maigre victuaille du pauvre ermite, et voilà que le petit morceau
de poisson se multiplia de telle sorte que le roi et toute sa suite
en furent rassasiés. Gradlon, émerveillé, rendit hommage à la sainteté
de son hôte, et lui donna la forêt de Nevet, ainsi qu'un château
qui devint un monastère. Bientôt après, les prédications de Corentin
ayant converti toute la Cornouaille, Gradlon le nomma évêque de
Kemper après l'avoir envoyé se faire sacrer à Tours par saint Martin.
Il lui donna son propre palais, et, pour laisser la ville libre
à Corentin, il transféra sa cour en la fameuse ville d'Is ; Kemper-Odet
fut appelé dès lors Kemper-Corentin.

Elle eut bientôt l'honneur
de devenir la capitale du royaume après la catastrophe qui engloutit
sous les eaux la ville d'Is. Le roi Gradlon vint s'y établir, et
la cathédrale a conservé jusqu'à la Révolution un monument qui rappelait
cet antique monarque. C'était sa statue équestre, placée sur la
balustrade de la plate-forme qui unit les deux tours, et peut-être
provenait-elle de la cathédrale primitive, ce qui en rend la perte
plus regrettable.
Cette statue équestre a, depuis, été remplacée
par une autre.
Quand les comtes de Cornouaille furent devenus
ducs de Bretagne, les évêques de Quimper devinrent, presque sans
réserve, les seigneurs de la ville. Vers le XIIIème siècle,
le duc ne levait plus sur la ville d'autres droits que la moitié
de la taille et les amendes du sang répandu, du larcin, des duels
et des délits de voirie. Sa juridiction était renfermée dans le
faubourg compris entre le Stheir et l'Odet, qui s'appelle encore
aujourd'hui Terre au duc. Dans le reste de la ville, toute juridiction
et souveraineté appartenait au prélat. En 1209, Gui de Thouars voulut
y faire quelques constructions malgré l'évêque ; aussitôt l'interdit
épiscopal tomba sur toute la Cornouaille, et l'archevêque de Tours,
consulté, obligea le duc à reconnaitre, par acte authentique, qu'il
avait agi injustement la construction commencée fut détruite et
les matériaux servirent à bâtir l'église de Guéodet. Plus tard,
sous Jean V, l'évêque, en habits pontificaux, se rendit sur le port
et excommunia, devant tout le peuple, les officiers occupés à lever
un impôt sur les vins que le duc voulait établir. Ce ne fut qu'en
1386 que, par une décision des états de Vannes, le prélat et son
chapitre se dessaisirent des clefs de la ville qu'ils avaient gardées
jusque-là et qu'ils refusaient de livrer au duc. Quand l'évêque
entrait dans Quimper, les seigneurs les plus puissants du pays lui
tenaient l'étrier, lui tiraient les bottes et le portaient sur un
fauteuil jusqu'à l'autel.

Les murailles dont Quimper fut environnée
par Pierre de Dreux lui donnèrent une grande importance militaire
dans la grande guerre de Bretagne. L'évêque s'étant déclaré pour
le parti de Montfort, Charles de Blois vint assiéger la place en
1344. Il ordonna de livrer l'assaut du côté de la mer. Le flux allait
monter, on le lui fit remarquer « Puisque nous l'avons choisi,
dit-il, nous ne le changerons point; et, par la grâce de Dieu, la
mer ne nous fera aucun tort. Et l'assaut se livra, et le flux
ne gêna point les assaillants; on cita ce miracle lorsqu'on songea
à canoniser Charles de Blois. Après un combat acharné de six heures,
la ville fut prise et inondée de sang. Quatorze cents habitants,
égorgés, furent entassés pêlemêle dans de larges et profondes fosses
creusées au pied de la tour du Chastel et, jusqu'en 1789, le clergé
de Quimper y alla tous les ans réciter des prières le jour des Morts
ce qu'on appelait la procession des trépassés. Il n'en faut point,
du reste, accuser Charles comme il entrait dans la ville, il fondit
en larmes à la vue d'un enfant mort qui tenait encore ses lèvres
au sein de sa mère égorgée ; sur-le-champ, il donna les ordres les
plus sévères pour arrêter ce massacre, surtout pour respecter les
prêtres.
Comme il voulait démanteler Quimper, il préféra abattre
la partie des fortifications qui lui appartenait plutôt que celle
qui appartenait à l'évêque. Ces procédés lui gagnèrent le cœur du
clergé ; il en fut bien récompensé, car, peu de temps après, Montfort
étant venu à son tour assiéger Quimper, l'évêque Alain se mit en
prières avec son clergé, et un débordement de l'Odet arrêta les
assiégeants.
Ce n'est qu'en 1364 que Jean IV devint maitre de
cette place après de nombreux assauts. Le clergé de Quimper était
si bien converti au parti de Blois, que l'évêque voulait tenir bon.
Mais quand il vit le roi de France lui-même abandonner ce parti
il convoqua les habitants, lesquels déclarèrent « qu'ils avaient
courageusement combattu tant qu'il y avait eu de l'espoir, mais
que c'était folie de persister à soutenir un parti qui ne se soutenait
plus lui-même; qu'ils avaient épuisé sur les assaillants leurs pierres,
leur huile bouillante, leur chaux vive, leurs falariques, leur sable
rougi, de telle sorte que la défense devenait impossible; qu'enfin
les autres places s'étaient rendues air bout de quelques jours,
et que c'était assez pour leur honneur, à eux bourgeois et ouvriers,
d'avoir résisté plus longtemps que les meilleures garnisons d'hommes
de guerre.» Cette déclaration des habitants amena une capitulation.
C'était l'habitude des habitants de Quimper de se bien battre. En
1594, ils tenaient pour la Ligue, moins cependant une partie de
la bourgeoisie, qui traita secrètement avec Lézonnet, gouverneur
de Concarneau pour Henri IV. Cet aventurier, qui servait le roi
après avoir servi Mercœur, partit à la tête de mille hommes et surprit
le faubourg de la rue Neuve; mais l'alarme ayant été donnée, les
habitants accoururent, élevèrent des barricades et les défendirent
vaillamment à l'une d'elles se trouvait un conseiller au présidial,
Tanguy de Bosmeur, un des plus fougueux ligueurs de la ville un
coup de feu lui cassa le bras droit et fit tomber son arquebuse;
il la ramassa de la main gauche, et la passant à un de ses amis
« Tiens, dit-il, décharge mon arquebuse sur ces gens-là et tiens
bon, je vais me faire panser.» Il se retira soutenant son bras
cassé. Quelques jours après, il mourut de sa blessure. Lézonnet,
ayant appris qu'un renfort entrait dans la ville par une porte opposée
à celle qu'il occupait, s'y porta rapidement ; il arriva trop tard,
et se trouva tout coup sous une grêle de balles qui tombaient des
remparts il en reçut une à la gorge « Ah! vous m'égratignez »,
s'écria-t-il en levant le siège moi, je vous écorcherai. Aussitôt
il alla chercher le maréchal d'Aumont, qui commandait dans la province
pour le roi.

Le maréchal arriva avec du canon et ouvrit la brèche.
Les habitants, qui pouvaient fournir 1300 arquebusiers bien exercés,
n'en furent point intimidés ils s'assemblèrent dans la cathédrale
et se montrèrent fort animés pour la résistance ; les gens de justice
seuls furent d'un avis contraire, « se souciant moins, dit le chanoine
Moreau, de la religion que de leurs intérêts. D'Aumont, qui
croyait enlever la place du premier coup, fut étonné de la résistance.
Comme il s'approchait des murs avec Lézonnet, il reçut plusieurs
balles dans sa cuirasse; ceci le mit tout à fait en colère «
Médieu ! s'écria-t-il, vous m'aviez dit qu'il n'y avoit dans la
ville que des bourgeois; vous êtes un affronteur, et, si vous me
fâchez, je vous ferai un mauvais tour.
- Monseigneur, sur ma
vie et mon honneur, il n'y a qu'une centaine de soldats, et tout
le reste ne sont qu'habitants.
- Médieu! reprit le maréchal, mais
ce sont gens de guerre que ces habitants ! »
La place finit
par capituler; mais le clergé conserva dans sa défaite encore de
la fierté et sut faire respecter ses privilèges. D'Aumont fit construire
une citadelle qui obligea de démolir l'église et l'hôpital de Sainte-Catherine.
Les bourgeois royalistes travaillèrent à cet ouvrage avec plus d'ardeur
que les maçons mêmes ; le chanoine Moreau, choqué de ce zèle, déclare
qu'ils moururent tous ou à peu près dans l'an et jour.
Toutes
les calamités fondirent ensemble sur Quimper vers cette époque.
Elle venait de supporter un siège opiniâtre ; elle essuya deux attaques
de Gui Eder de La Fontenelle, un féroce brigand. La famine, le mal
jaune, les loups s'y ajoutèrent. Le XVIIème siècle fut
employé par les Quimpérois à réparer tant de désastres. Leurs évêques
relevèrent leur palais épiscopal, qui tombait en ruine, et parcoururent
leur diocèse pour y remettre de l'ordre. Leurs officiers municipaux
firent nettoyer la rivière, qui se comblait, et élargir les quais
du port.
On est surpris de voir, à l'époque de la Révolution,
la vieille cité épiscopale au niveau des idées de l'époque ; la
bourgeoisie et même la noblesse étaient déclarées pour les nouveautés
; leurs cahiers pour les états généraux renfermaient les demandes
les plus hardies impôt progressif, taxe sur les objets de luxe,
concours pour tous les emplois, etc.
C'est Quimper qui émit le
vœu de la fédération bretonne, réalisée à Pontivy. Élevée au rang
de chef-lieu, cette ville fut le siège d'une administration énergique,
qui rencontra tout d'abord des rebelles dans le clergé. Le chapitre
de la cathédrale et les prêtres du diocèse essayèrent de soulever
les campagnes. L'administration du département plaça sous le coup
de l'arrestation les prêtres qui refuseraient le serment.
Plus
tard, à l'époque des troubles soulevés par la levée des trois cent
mille hommes, elle envoya de l'artillerie et neuf cents hommes pour
soutenir les troupes du gouvernement dans le Morbihan mais elle
se déclara, en 1793, pour les girondins, dont les principaux, Duchâtel,
Buzot, Pétion, Guadet, Barbaroux, Louvet, Riouffe, trouvèrent à
Quimper un asile qu'ils n'eussent pas dû quitter.
La ville porta
alors le nom de Montagne-sur-Odet. Quimper est mal bâtie. Sa cathédrale
est une masse imposante, mais elle a beaucoup souffert à la Révolution
; elle date de 1424. L'église des Cordeliers, plus ancienne de deux
siècles, n'est plus aujourd'hui qu'un atelier de sabotiers. Celle
du Guéodet n'existe plus, on y a conservé jusqu'en 1792 un cierge
allumé, dit-on, à l'époque de la ruine de la ville d'Is. Ce cierge
était placé dans une chapelle, au bord d'un puits qui devait, quand
il s'éteindrait, déborder et engloutir la ville. Or, en 1792, on
surprit deux audacieux enfants qui, curieux de vérifier la légende,
venaient d'éteindre le cierge, ils tenaient une chandelle toute
prête pour le rallumer s'ils voyaient monter l'eau du puits, on
chassa les deux petits sceptiques, mais le cierge était éteint,
et Quimper est encore debout. L'église Saint-Matthieu date des premières
années de la Renaissance, moins sa tour carrée, que sur monte une
flèche élégante et moderne. On voit une belle verrière représentant
les principales scènes de la Passion. A l'extrémité d'une belle
promenade qui borde la rive gauche de l'Ode, est le faubourg de
Locmaria, appelé dans d'anciennes chartes du XIIème siècle
Civitas Aquitæa.
Son église fut construite vers l'an 1030, pour
un prieuré de femmes désigné dans les anciens titres sous le nom
d'abbaye de Sainte-Croix. La préfecture, installée dans les bâtiments
de l'ancien hôpital Sainte-Catherine, l'hôtel de ville, le palais
de justice et l'hospice sont, avec le collège, les seuls monuments
publics de Quimper. Ce dernier a été fondé par les jésuites, sous
Louis XIV.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.