Auch - Préfecture du Gers
Retour
au Département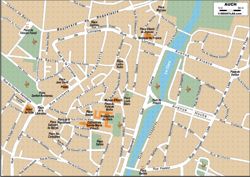

FAuch (Cliberris civitas ou Augusta Ausciorum),
Elle était autrefois capitale de l'Armagnac et de la Gascogne, chef-lieu
d'une généralité, intendance, présidial, sénéchaussée et élection.
Auch portait, avant la conquête romaine, le nom de Cliberris; elle
était la capitale des Auscïï ou Ausks, d'où lui vient son nom. Les
Romains, en effet, sous Auguste, établirent au sud-est de Cliberris
une colonie qu'ils appelèrent Augusta Ausciorum et qu'ils gratifièrent
du droit latin. Ces deux villes contiguës furent ensuite distinguées
par deux noms différents. L'ancienne était appelée Ville-Claire,
et la nouvelle Cité-Vallée-Claire. Sénat, forum, gymnase, thermes,
théâtre, Auch eut tout cela. Elle ne fut pas la moins favoriséedes
villes de la Gaule. La route de Toulouse à Bordeaux la traversait
et y avait une station. Une autre, venant de Saint-Bertrand-de Comminges
(Lugdunum Convenarum), y passait également. Ces conditions si favorables
y développèrent l'industrie, les arts, les études ; les villas s'élevèrent
aux alentours ; enfin cette cité jouissait d'une grande prospérité
quand survinrent les barbares. On dit pourtant qu'elle n'eut point
à souffrir de l'invasion, préservée, selon la chronique, par l'intercession
de l'évêque saint Orens. En effet, depuis la fin du IIIème
siècle, Auch avait reçu le christianisme ;et, au commencement du
IVème siècle, la série de ses évêques avait commencé
avec Citerius.
Supprimé quelque temps par les Wisigoths, l'évêché
d'Auch eut à se féliciter de la victoire des Francs. Clovis lui
donna de nombreuses terres et fonda sous les murs de la Cité-Vallée-Claire
l'église et le monastère de Saint-Martin qui fut pendant longtemps
la demeure de l'évêque. Auch fut deux fois détruite en deux siècles
en 732, par les Sarrasins en 834, par les Normands. En revanche
en 879, son évêché fut érigé en archevêché (pour suppléer, dans
le Midi, l'archevêché de Bordeaux, alors transféré à Bourges à cause
des ravages des pirates du Nord. Un autre fait non moins favorable
à l'avenir de la ville, c'est que le comte de Fezensac, Guillaume
Garcie, au IXème siècle, bâtit un château à la place
de l'ancienne ville, sur la hauteur ; les habitants de la ville
romaine quittèrent la plaine pour se mettre à l'abri sous les murs
de la forteresse féodale et s'entourèrent eux-mêmes d'une muraille.
Auch devint une ville forte, et ses prélats, placés à la tête du
clergé de Gascogne, exercèrent, même sur les seigneurs temporels
du pays, une influence considérable.
Ces puissants archevêques
trouvèrent pourtant des antagonistes dans de simples moines. Ceux
du monastère de Saint-Orens, fondé au Xème siècle, étaient
en possession de porter en terre tous les habitants de la ville,
car ils étaient maîtres du cimetière qui s'y trouvait. Ce profitable
monopole faisait grand bien aux moines; il n'est point en ce monde
de revenu plus assuré que celui des enterrements ,car il n'est personne
qui n'y contribue, bon gré mal gré. Or, en 1040, l'archevêque Haymond-Copa,
pour une raison ou pour une autre, s'avisa d'établir un cimetière
près de l'église de Sainte-Marie. Les moines réclamèrent, ne furent
point écoutés, réclamèrent encore, se plaignirent, s'indignèrent,
querellèrent le métropolitain, qui affronta le tout sans se laisser
ni fléchir ni ébranler. Plus d'une génération prit part à cette
querelle ecclésiastique. On bataillait en paroles depuis plus de
soixante-quinze ans, lorsqu’en 1119 le pape Calixte II condamna
par un bref les bénédictins de Saint-Orens. Au lieu de se soumettre
à cette haute décision, les indomptables religieux furent exaspérés
de ce qu'on leur avait donné tort dans une question si intéressante
et résolurent d'en appeler du pape à la force des armes. C'était
peu canonique, ils eussent dû en appeler à un concile mais l'esprit
malin égarait momentanément ces bons pères. Le 29 avril, jour où
l'archevêque Bernard de Sainte-Christine devait procéder avec tout
son clergé à la bénédiction solennelle du cimetière de Sainte-Marie,
l'évêque de Tarbes célébrait la messe en grande pompe dans la cathédrale
lorsqu'un grand tumulte se fit entendre aux portes, et les fidèles
virent avec effroi l'église envahie par les moines armés, furieux
et suivis de leurs partisans. Un désordre effroyable éclata ; les
flèches volaient sous les saintes voûtes ; les fidèles étaient renversés,
blessés plusieurs périrent ; l'évêque de Tarbes fut blessé au pied
; une flèche sacrilège alla même percer le corporal de l'autel.
Cependant des hommes sensés avaient fermé les portes de l'église,
espérant, sans doute, y prendre les moines, ou, du moins, les intimider.
On n'en eut point si facilement raison. Comme ils avaient porté
le fer dans la maison du Seigneur, ils y portèrent la flamme, comme
des Vandales ou des hérétiques, et, sans l'intervention du peuple,
l'église eût été consumée. Déférée au concile de Toulouse présidé
par le pape, la conduite des moines fut condamnée « par tous les
pères, qui virent avec indignation le corporal avec la flèche dont
il avait été percé. » L'établissement du cimetière de Sainte-Marie
d'Auch fut confirmé et consacré irrévocablement.br> Les archevêques
d'Auch furent souvent des membres de la famille d'Armagnac et ne
furent pas toujours pour cela plus d'accord avec elle. Bernard IV
essaya de déposséder son beau-frère pour donner l'archevêché à l’un
de ses fils. Il dévasta plusieurs fois l'église et le cloître, pilla
les meubles de son beau-frère abattit les tours des chanoines. Son
fils, Gérard IV, continua les hostilités, et le malheureux archevêque
fut enfin obligé de s'en aller en terre sainte, où il mourut.
Auch n'était pas seulement capitale de l'Armagnac et puissante métropole
ecclésiastique. C'était aussi une cité libre ayant conservé, comme
la plupart des villes du Midi, d'anciennes institutions municipales.
On ne trouve pas avant 1205 les dénominations de citoyens et de
république d'Auch ; mais le comte Arnaud, qui prête, à cette époque,
serment aux consuls, reconnaît l'antiquité des privilèges et coutumes
de cette ville ; antiquité encore mieux constatée en 1301, dans
l'acte arbitral passé entre le comte, l'archevêque, le chapitre
et le syndic de la commune, et qui, depuis, a servi de code aux
habitants jusqu'en 1789. Il y est dit formellement que la rédaction
par écrit des coutumes locales ne fait que les consacrer, les préciser,
les soustraire aux erreurs, aux variations, aux oublis, auxquels
sont sujettes toutes les lois dont la mémoire des hommes est seule
dépositaire.br> D'après cette charte alors rédigée en latin Auch
avait huit consuls annuels qui désignaient eux-mêmes leurs successeurs,
mais qui ne pouvaient être réélus qu'au bout de deux ans. Seulement,
par une singulière exigence, s'ils étaient réélus, ils ne pouvaient
refuser ces fonctions sous peine d'amende. Ils recevaient chacun
trente sols morlas, on appelait ainsi la monnaie fabriquée à Morlas,
en Béarn, et dont la valeur était triple de celle du sol tournois.
Plus tard, la solde des consuls fut augmentée elle était de deux
cents livres en 1730. En somme, la charte d'Auch, comme toutes celles
des villes du moyen âge, était un mélange confus de dispositions
relatives aux intérêts politiques et civils, à la pénalité, à la
propriété, au commerce, réparties en deux cents articles. Les Ausciens
se montrèrent toujours fort jaloux de leurs privilèges. Les comtes
d'Armagnac, à leur avènement, prêtaient serment de les respecter.
Quand les rois de France furent devenus maîtres du comté, ils ne
dédaignèrent point de rendre le même hommage aux libertés d'Auch.
Chaque nouvel archevêque, en entrant dans la ville, prêtait aussi
un serment analogue. Quand le comte Gérard V se soumit à l'hommage
envers Simon de Montfort, il stipula une exception pour la ville
d'Auch ; et Montfort, par une lettre adressée aux consuls, s'engagea
formellement à ne rien exiger de leurs compatriotes. La municipalité
d'Auch, si fière et si respectée, se donna une demeure en 1289.
C'est alors que fut bâti l'hôtel de ville, surmonté d'une mirande.
On y établit une prison avec sa geôle, un dépôt d'armes et un dépôt
des archives, en d'autres termes, pour employer ceux de la chronique,
« une arche ou coffre où furent mis tous les livres et papiers
des sieurs consuls et citoyens de ladite ville, relatifs à toutes
les affaires et ordonnances municipales. » Ces consuls ne furent
pas toujours en parfaite intelligence avec le clergé. Les chanoines
étaient possesseurs du moulin de Filère, et ils tenaient à leur
moulin presque autant que les moines de Saint-Orens à leur cimetière
car, si tout le monde meurt, tout le monde, avant de mourir, mange
du pain et fait moudre son grain. Or, au moyen âge, on le sait,
le nombre des moulins était limité, un moulin était un privilège.
Celui des chanoines était très lucratif, mais ils désiraient qu'il
te fût encore davantage. Le droit de mouture était jusque-là d'un
picotion sur trente ; ils l'augmentèrent. Le peuple, voyant sa nourriture
renchérie, s'irrita de cette conduite peu charitable, et les consuls,
se faisant les interprètes du mécontentement public, firent publier
à son de trompe une ordonnance qui mettait le moulin en interdit.
En fait d'interdits et d'excommunications, nul pouvoir ne fut jamais
plus prodigue que l'Église ; aussi, en échange de l'interdiction
du moulin, l'officiai lança sur la tête des consuls une belle et
bonne excommunication. Heureusement, les magistrats étaient des
gens aguerris ; ils soutinrent le feu sans reculer et maintinrent
leur précédente ordonnance. Il ne faisait pas bon mettre le pied
trop avant sur le terrain de la commune d'Auch.

En 1280, le
comte d'Astarac éleva sur la limite de son comté et de celui d'Armagnac,
à peu de distance de la ville d'Auch, une construction appelée la
Bastide de Pavie. Nos consuls querellèrent les habitants de Pavie,
leur firent un procès, et même on se battit. Ils avaient tort pourtant
; mais ils trouvèrent, environ quarante ans après, une occasion
plus légitime de se venger. Le bayle de Pavie s'avisait de faire
faire le guet jusque dans un faubourg d'Auch, appelé la Treilhe
de Saint-Martin. Après avoir réclamé plusieurs fois sans succès,
les consuls sortirent de la ville avec quatre mille hommes et allèrent
mettre le feu à l'hôtellerie du bayle, qui faillit être brûlé avec
ses sergents. Cette conduite un peu violente fit condamner les consuls
de l'université d'Auch, par le sénéchal de Toulouse, à une amende
de deux mille livres, que le roi du reste réduisit à trois cents
; les consuls eurent gain de cause pour la question du guet. Au
temps de la guerre des Anglais, les Ausciens se montrèrent des plus
empressés à se mettre en mesure de faire bonne résistance aux étrangers.
En 1337, au moyen d'une taxe établie sur certaines marchandises,
ils élargirent l'enceinte de leurs murs, qui enveloppa les faubourgs
du Pony, de Saint-Pierre de la Treilhe des Jacobins et du Barry.
Cette muraille, flanquée de tours, s'ouvrait par six portes principales
et de moins grandes, armées de mâchicoulis. Le château des comtes,
celui de l'archevêque avec le cloître, celui de la Treilhe et le
monastère de Saint-Orens s'élevaient, intérieurement, comme autant
de citadelles, sur divers points de l'enceinte murale. A plusieurs
reprises, dans le XIVème siècle, on voit les consuls
établir quelque taxe sur les denrées pour subvenir à l'entretien
des murailles, et plusieurs fois aussi les comtes y contribuent
en remettant aux habitants une partie de leurs redevances. Ainsi,
en 1372, le comte fait remise de douze livres qu'il percevait sur
chaque feu. Br>En 1472, Auch fut pourtant prise au siècle suivant
par les troupes de Louis XI ; elle était dépourvue de défenseurs.
Le comte Jean V avait rassemblé tous ses soldats dans Lectoure,
ce qui ne l'avait pas empêché d'y être pris et mis à mort.
Au
XVIème siècle, Auch eut un instant pour archevêque le
cardinal de Tournon. Cet illustre personnage n'y fit que peu de
séjour parce qu'un incident assez désagréable l'accueillit à son
arrivée. C'était un antique usage que le prélat, faisant son entrée
sur sa mule, fût conduit par le baron de Montaut et que ce même
seigneur lui servît d'échanson ; la mule et le service de table
de l'archevêque étaient sa récompense. Or, le cardinal, au lieu
d'or et d'argent, se servait d'une vaisselle de verre. Le baron
désappointé ne se comporta pas en gentilhomme dans sa fureur, il
tomba à coups de bâton sur la vaisselle modeste du prélat et la
mit en pièces à la vue de tous les assistants. Le cardinal, vivement
blessé, repartit sur-le-champ. C'est en 1562 que les calvinistes
d'Auch prirent les armes. Montluc entra dans la ville et y réprima
cette révolte. Il paraît que l'archevêque lui-même, M. de Chaumont,
n'était pas étranger aux nouvelles doctrines, car il fut excommunié.
Montgomery enleva Auch en 1569, et ses soldats n'y commirent point
de ravages; mais, par compensation, les calvinistes, ayant repris
la ville en 1587, après s'être laissé enlever, pillèrent les églises
de Saint Orens et des Jacobins.
Rien de remarquable à Auch au
XVIIème siècle, sinon la rivalité des consuls et des
membres du présidial, laquelle amena une collision dans la cathédrale
de Sainte-Marie devenue pour la seconde fois un champ de bataille.
Il s'agissait de préséance ; on se battit avec les cierges ; un
coup de pistolet fut cependant tiré. Puisque nous parlons de la
cathédrale, ce fut vers la fin du même siècle qu'elle fut achevée.
On n'y avait point travaillé depuis le XVème siècle,
alors que l'archevêque, M. de Clermont-Lodève, fit peindre par Arnauld
de Moles ces célèbres vitraux qui représentent des sujets de l'Ancien
Testament et qui font, ainsi que ses boiseries et ses sculptures,
l'admiration de tous les amateurs. L'église de Sainte-Marie, malgré
sa beauté, offre de singulières anomalies de style qui s'expliquent
par la différence des époques qui ont pris part à sa construction.
Au-dessus de ses fenêtres ogivales, on voit avec surprise une plate-forme
grecque à balustrade.
Le XVIIIème siècle fut pour
Auch, comme pour bien d'autres villes, une époque de rajeunissement
et de vivification. Elle se rajeunit par la destruction de ses murailles
flanquées de tours et de ses mai sons à tourelles qui rappelaient
les siècles de l'état de guerre féodal.
Elle fut vivifiée par
ces nombreux travaux d'utilité publique qui honorent cette époque
si occupée du bonheur de l'homme et de la prospérité sociale. Le
nom de l'intendant d'Étigny y est particulièrement attaché ; car
Auch, depuis 1715, était devenue le chef-lieu d'une généralité et
le siège d'une intendance. Auch n'avait ni industrie ni débouchés.
D'Étigny lui donna des manufactures de draps, de faïence, des filatures,
des minoteries, une vaste plantation de mûriers. Il la rendit abordable
par de larges routes ; il l'orna et la compléta à l'intérieur en
pavant et éclairant ses rues, en faisant construire un hôtel de
ville, des casernes, des halles, une salle de spectacle, des aqueducs,
des fontaines, des promenades. D'Étigny mourut en 1767 ; une statue
lui a été élevée sur le cours qui porte son nom. Auch adhéra à la
Révolution et paya, comme la plupart des grandes du Midi, son sanglant
tribut à la Terreur ; l'échafaud y fut, pendant un an, en permanence
sur la place de la Fraternité.
Le Consulat et l'Empire ajoutèrent
à la prospérité d'Auch. Un athénée, une école centrale, une société
d'agriculture, des filatures furent établis. Napoléon, passant par
cette ville en 1808, lui accorda trente mille francs pour la réparation
du lycée, de la cathédrale, des fontaines et des rues. A la chute
de l'Empire, Auch reçut sans résistance les Anglais après la retraite
du maréchal Soult. La réaction légitimiste se montra violente à
Auch par l'organe du comte de Freissac, président de la cour prévôtale.
Plus tard, en 1828, la Restauration vit éclater une émeute assez
violente à propos de l'autorisation donnée par le maire de vendre
la forêt de Lespou, appelée aussi le bois d'Auch, où les pauvres
avaient coutume d'aller faire leur provision d'hiver.

Auch a eu fréquemment à souffrir de deux fléaux : la peste, qui l'a décimée plus d'une fois au moyen âge et au commencement des temps modernes et les inondations, qui, à deux reprises, 1770 et 1836, ont exercé dans les quartiers bas de terribles ravages. La ville est bâtie sur le penchant d'un coteau très élevé, qui présente un aspect pittoresque. Elle se divise en ville basse et ville haute ; on communique de l'une à l'autre par l'escalier de la Poterne, Pousterlo, qui a plus de deux cents marches, et par une rampe accessible aux voitures. De la promenade d'Étigny, située dans la partie la plus élevée de la ville, on jouit d'un point de vue très étendu. La cathédrale, dédiée à sainte Marie, commencée en 1489, offre des sculptures sur bois et des vitraux dignes de l'attention des archéologues. Parmi les autres édifices de cette ville, nous citerons une chapelle qui faisait partie de l'antique église abbatiale de Saint-Orens, la tour carrée de César, monument de l'architecture ogivale ; l'archevêché, la préfecture, le palais de justice ; le lycée, ancien collège des jésuites, fondé en 1545; l'hôtel de ville, le séminaire, la bibliothèque municipale; l'asile des aliénés, un des plus beaux du sud-ouest de la France. Cette ville, où l'on rencontrait autrefois des fa briques de draps, fait aujourd'hui un commerce très étendu de vins, d'eaux-de-vie d'Armagnac et surtout de volailles et de pâtés de foie de canard très estimés au loin.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.