Châteauroux - Préfecture de l'Indre
Retour au Département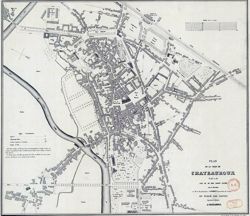

Châteauroux doit son origine, à Raoul le
Large, seigneur de Déols, qui, vers 950, quitta le bourg héréditaire,
berceau de sa famille et capitale de ses domaines, pour un château
qu'il fit construire et autour duquel vinrent se grouper des habitations
qui, plus tard, formèrent une ville.
Dès qu'elle eut acquis quelque
importance, on l'entoura de murailles, comme c'était l'usage dans
ces époques de guerres continuelles et de surprises. Un violent
incendie détruisit presque tout entière, en 1088, la cité à peine
construite. Ses ruines furent bientôt relevées, mais pour subir
d'autres assauts encore plus redoutables. Par le mariage d'Éléonore
de Guyenne avec Henri il d'Angleterre, Châteauroux, comme le reste
de la province, était passé sous la souveraineté étrangère ce ne
fut qu'à la suite de plusieurs expéditions, dirigées par Philippe-Auguste
lui-même, et après de nombreux combats dont quelques-uns furent
livrés sous les murs mêmes de la ville, que ce prince put la rattacher
à la couronne de France. Enfin, vers la fin du XIIème
siècle, elle fut rendue au sire André de Chauvigny, devenu son seigneur
par son union avec l'héritière de la famille de Déols. Nous trouvons,
en 1208, le premier acte d'affranchissement qui ait émancipé la
commune de Châteauroux ; il émana de Guillaume 1er de
Chauvigny, et ne coûta aux habitants qu'une légère redevance, l'article
de cette charte auquel ils paraissent avoir tenu le plus était l'obligation
du serment imposé à leur seigneur, qui ne pouvait exiger foi et
hommage de ses vasseaux de la terre de Déols sans avoir lui-même
préalablement juré le maintien des franchises communales. Heureux
et naïfs Berrichons qui croyaient encore au serment des princes.
Il paraît, au reste, que cette clause froissait l'orgueilleuse susceptibilité
des Chauvigny, car plusieurs fois, dans le cours du XIIIème
siècle, ils tentèrent de l'éluder ; mais ils furent chaque fois
rappelés par le parlement de Paris au respect de leurs engagements.
Les rivalités ambitieuses réveillées par la question de succession
au trône à la mort de Charles le Bel, et les longues guerres auxquelles
les prétentions anglaises condamnèrent le pays ne permirent pas
à Châteauroux d'utiliser les bienfaits de son affranchissement.
Parmi les seigneurs de la province qui embrassèrent la cause d'Édouard
était un seigneur de Mehin qui, comptant sur l'influence de ses
relations, s'était flatté de gagner au parti anglais le vicomte
de Bresse, fils du seigneur de Châteauroux. Le refus formel par
lequel il fut répondu à ses ouvertures excita chez lui un vif dépit
et le désir de la vengeance il appela le prince de Galles et son
armée tout l'ancien domaine de Déols fut ravagé ; Châteauroux fut
assiégé, pris et brûlé en 1328. Châteauroux avait largement payé
sa dette à tous les fléaux de la guerre civile et étrangère il semble
que le souvenir de tout ce qu'il avait souffert précédemment l'ait
protégé dans les longues agitations qui se succédèrent encore les
événements dont se compose le reste de son histoire ne sont plus
que des épisodes pacifiques. En 1487, la terre de Châteauroux est
érigée en comté en faveur d'André de Chauvigny, le dernier seigneur
de cette maison ; l'héritage, objet de longs débats entre les familles
de Maillé et d'Aumont, passe en 1612 aux mains de Condé, devient
duché-pairie en 1616, est racheté de Charles de Bourbon, duc de
Clermont, par Louis XV, qui le donne, avec son nouveau titre, à
une de ses maîtresses, la marquise de La Tournelle, et à sa mort
il retourne à la couronne, comme apanage du comte d'Artois frère
de Louis XVI, et depuis Charles X.
Si ces octrois de titres,
ces cessions de domaines sont les actes les plus soigneusement conservés
et mentionnés le plus longuement dans les archives officielles,
nous devons glisser, moins légèrement qu'elles, sur d'autres faits
qui nous semblent avoir une plus grande portée et un intérêt bien
plus sérieux. L'histoire nous montre la prospérité s'attachant toujours
et partout à tout pays libre et tranquille Châteauroux n'est pas
une exception à cette loi. Vers la fin du XIVème siècle,
à une époque qui correspond à l'apaisement des précédents orages,
un besoin de pacifique activité, un instinct de progrès, une vague
aspiration vers le bien-être, s'emparent des esprits ; la réalisation
de ces vœux indéterminés n'était chose facile ni dans ce temps ni
dans ce pays. Voici une description que nous en a laissée un conteur
consciencieux du XVIIIème siècle, l'abbé Delaporte «
L'élection de Châteauroux contient le terrain le plus stérile et
le plus ingrat du Berry. Il n'y a guère que les bords de la rivière
de l'Indre dont il soit possible de tirer quelque parti, et où l'on
puisse nourrir des bestiaux et des moutons. Le reste consiste en
forêts, en étangs, et en bruyères qui n'ont jamais été cultivées.
On y fait quatre ou cinq lieues sans trouver aucun village, et l'on
n'y voit des terres labourables qu'aux environs des lieux habités.
»
Que créer dans une ville épuisée par plusieurs siècles de guerres
et isolée dans des campagnes si peu fécondes ? La liberté et la
paix sont ingénieuses à trouver des moyens, à créer des ressources,
à tirer du génie de l'homme des idées, germes de prospérité et de
richesses. Le bois des forêts fut consacré à l'alimentation des
fourneaux de forges nombreuses, dont la plus considérable, en 1750,
était celle de Chavières, dans la forêt de Châteauroux les champs,
trop maigres pour être utilement semés en céréales, furent abandonnés
à d'innombrables troupeaux de moutons. On sait les importants développements
qu'a pris l'industrie du fer en Berry. Châteauroux fut jadis un
des centres de ce commerce. Quant à la laine des moutons, c'est
là qu'elle était apportée et vendue pour y être ensuite lavée, peignée,
filée et tissée ; les draps qu'on y fabriquait jouissaient d'une
grande renommée dans le XVème siècle, ils ont toujours
été recherchés plus particulièrement pour l'habillement de l'armée,
et, dès le commencement du XVIIIème siècle, on comptait,
tant à Châteauroux qu'aux environs, dix mille personnes occupées
à cette industrie. Ses foires et ses marchés étaient devenus, pour
un rayon fort étendu, le centre de transactions commerciales très
considérables pour l'époque, La Révolution trouva Châteauroux préparé
pour ses destinées nouvelles. Dans la division territoriale de 1790,
il a été choisi pour devenir le chef-lieu du département. Cette
faveur a aidé encore au développement des éléments précieux que
possédait Châteauroux, il a pu se laisser distancer dans une industrie
spéciale, la fabrication des draps, par Elbeuf et Sedan mais, comme
activité commerciale plus généralisée, comme extension plus large
de l'aisance individuelle, Châteauroux l'emporte autant sur ses
rivales que le bien-être de tous est supérieur à l'opulence de quelques-uns.
Pendant la Révolution, Châteauroux porta un instant le nom d'Inde-ville.
L'aspect de Châteauroux est d'une diversité moins confortable que
pittoresque dans l'ensemble de ses constructions ; depuis les rues
du centre, étroites, mal pavées, aux alignements capricieux, aux
maisons petites, sombres, irrégulières, jusqu'aux promenades extérieures,
ombragées d'arbres, bordées de somptueuses et élégantes habitations
construites dans le goût le plus moderne, on peut suivre siècle
par siècle, presque année par année, les phases de progrès que nous
avons signalées depuis les dernières dévastations du XIVème
siècle. Les monuments qui restèrent debout, et ceux qui plus tard
furent respectés par la Révolution, sont le château Raoul, qui,
grâce, à de nombreuses restaurations, est dans un assez bon état
de conservation, et dont on a fait l'hôtel de ville. C'est entre
les murs d'un manoir, connu sous le nom de château du Parc, que
subit une captivité de vingt-trois années Madame de Maillé-Brézé,
épouse du grand Condé, et que ce prince punit si sévèrement pour
une faute qui ne fut jamais complètement prouvée. Les églises de
Saint-Martial et de Saint-André ou des Cordeliers, qui datent du
XIIème et du XVème siècle, renferment toutes
deux quelques tombeaux dont la sculpture grossière s'harmonisé avec
l'architecture des édifices dans une chapelle de la première est
le monument élevé à la mémoire de la princesse de Condé, si longtemps
prisonnière, et morte en 1694. Les seigneurs de La Tour-Landry ont
été inhumés dans la seconde. Les membres des familles Chauvigny
et Aumont avaient leur sépulture dans le chœur de l'église des Cordeliers,
fondée en 1214, et dont la Révolution a dispersé les derniers débris.
Avant de dire adieu aux vieux souvenirs de Châteauroux, rappelons
un droit féodal fort curieux. La dernière veuve remariée de la rue
d'Indre devait se présenter chaque année à la porte du château,
en grand costume, ayant sur sa tête un pot rempli de roses et entouré
de rubans ; le seigneur, ou un de ses officiers, s'approchait et
brisait le pot solennellement. Cette cérémonie était le prix de
l'abandon du droit de cens que le seigneur avait fait aux habitants
de la rue d'Indre, sur le terrain de la prairie où la rue s'était
élevée. Cette rue offre une autre singularité, due à l'organisation
féodale elle relevait avec ses dépendances du comté de Blois, tandis
que le donjon ou la grosse tour de Châteauroux, dont il ne reste
aujourd'hui aucun vestige, relevait de l'archevêché de Tours. Châteauroux
s'étend sur une petite colline, près de la rive gauche de l'Indre
et sur un terrain légèrement onduleux ; elle est située au milieu
d'une plaine verdoyante et fertile dans les parties qui avoisinent
la rivière, mais sablonneuse et monotone au-delà ; une belle promenade,
qui longe le cours de l'Indre, relie la ville aux sites les plus
gracieux du paysage. On a construit en 1825, dans le voisinage du
vieux château, un beau et grand bâtiment où sont installés les bureaux
de la préfecture plus tard encore une salle de spectacle a été élevée
avec goût et en rapport avec l'importance de la ville ; citons aussi
la bibliothèque, le musée, le lycée, le jardin public et l'hôtel
où siègent les tribunaux.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.