Tours - Préfecture de l'Indre et Loire
Retour au Département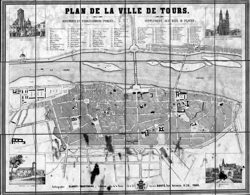

La même incertitude existe sur l'origine
de la ville et de son nom que sur celle des habitants. Laissons
de côté la fable de Turnus, en remarquant cependant la consistance
que cette fable avait prise à Tours au moyen âge, puisqu'on y représenta
le mystère de Turnus à côté de ceux des saints. La ville paraît
avoir eu peu d'importance quand vint César. Agrandie ou plutôt créée
par lui, elle porta son nom, Cesarodunum, qu'elle ne quitta que
vers la fin de l'empire romain pour reprendre celui de Ticronica
civitas, à l'époque où elle s'associa aux efforts des provinces
voisines pour reconquérir l'indépendance.
Où s'élevait la ville
celtique? où s'éleva la ville romaine Après beaucoup de discussions,
personne n'en sait rien. Les uns optent pour la rive droite et le
plateau de Saint-Symphorien, les autres pour la rive gauche et la
plaine. Vivifiée par l'administration romaine, si bien située sur
le plus vaste cours d'eau de la Gaule, sur cette Loire qui portait
les produits de la Gaule méridionale et de l'Italie à Nantes, à
l'Armorique, à la Bretagne, la nouvelle cité prospéra. Elle devint
même en partie romaine, car beaucoup de familles du Latium, attirées
par les gouverneurs de la province, vinrent s'y établir. Adrien
la visita et lui confirma le titre de ville libre, comme l'attestent
des débris de monuments élevés dans le pays en son honneur et retrouvés
plus tard. Elle eut ses décurions, son princeps senatus, son defensor,
son susceptor (percepteur), son irénarque (sorte de commissaire
de police). Elle eut sa basilique, qui servait de tribunal et de
bourse, ses thermes, son académie, son amphithéâtre, son palais
impérial, son ,temple. Tout cela a passé; on en cherche aujourd'hui
la place.
En 1828, des ouvriers, en creusant le canal de jonction
de la Loire au Cher, ont trouvé des urnes et autres objets funèbres
de même, en 1840, les fouilles faites à l'emplacement du palais
de justice que l'on allait construire amenèrent la découverte d'amphores,
cuillers, lampes, meules de moulins à bras, jouets d'enfants, et
surtout d'un miroir métallique aussi brillant que s'il eût été poli
la veille le tout au milieu des cendres et de débris calcinés, qui
nous parlent sans doute des Alains ou des Wisigoths.

Pauvre héritage
de la civilisation romaine. Mais Tours en avait reçu un autre, moins
fragile et moins éphémère, le christianisme. Saint Gatien donne
aujourd'hui son nom à la cathédrale, et on le considère comme le
premier patron de la ville, quoique son existence ait été mise en
doute par des hommes très savants et très pieux. Grégoire de Tours
l'a admis, après quelque hésitation. L'apôtre véritable, populaire
du christianisme dans la Touraine est saint Martin, l'un des propagateurs,
des défenseurs les plus ardents de l'orthodoxie contre l'arianisme
dans la Gaule. Né sur les confins de la Pannonie, Martin fut d'abord
soldat parce que son père était tribun militaire. Ses parents étaient
païens, mais lui se fit chrétien à dix ans. A dix-huit, déjà avancé
en grade, il rencontre un pauvre homme qui grelottait sur la route
il avait déjà tout distribué, hormis son manteau ; il le déchire
en deux et en donne la moitié au pauvre homme. La nuit suivante,
Jésus-Christ lui apparut au milieu des anges, lui disant « Voici
Martin qui m'a recouvert. » Le lendemain, Martin se fit baptiser
et entra dans les ordres. Il convertit sa mère, toute sa famille,
moins son père, vieux païen endurci puis il obtint du grand saint
Hilaire le petit terrain de Locociagum, Ligugé, près de Poitiers,
où il fonda le premier monastère qui se vit dans les Gaules. Quand
on lui offrit le siège épiscopale Cæsarodunum, devenu vacant, il
le refusa si obstinément qu'on fut obligé d'employer la ruse. Un
habitant de la ville l'alla trouver tout pleurant, lui dit que sa
femme se mourait et désirait le voir. Le saint partit dans sa charité
; mais quand il arriva, au lieu d'une femme mourante, il trouva
le peuple assemblé, qui le fit évêque malgré lui en 374. Il eut
bien dans l'Église quelques ennemis qui s'y opposèrent, sous prétexte
qu'il était sale sur sa personne et malproprement vêtu ; de quoi,
au contraire, le saint se glorifiait par humilité chrétienne. Il
fit un grand nombre de fondations religieuses entre autres, à trois
kilomètres de Tours, l'abbaye de Marmoutier (majusmonasterium),
dont il reste encore des ruines intéressantes. Il s'efforça de purifier
la religion naissante des superstitions et des erreurs qui pouvaient
la souiller.
Par exemple, près de Tours, les précédents évêques
avaient désigné à la vénération des fidèles un lieu où reposait,
disaient-ils, un martyr. Martin eut des soupçons sur l'authenticité
de ce martyr. Il se rendit au tombeau, pria Dieu de lui faire voir
l'homme enterré là. Alors une ombre apparut ; Martin lui ordonna
de parler, et les fidèles entendirent sa voix ; ils ne le virent
point, à la vérité, mais le saint le vit fort distinctement et reconnut
en lui un brigand fameux. Il désabusa le peuple de ce culte si mal
placé. Il faisait aussi une guerre courageuse aux restes de l'idolâtrie.
Un certain arbre, dans le voisinage, recevait les hommages impies
des prêtres païens et des paysans. Martin le fait couper ; mais
les paysans s'assemblent, le menacent, exigent qu'il soit lié à
l'arbre qui chancelle ; il y consent, et déjà l'arbre penche sur
lui, va l'écraser, quand une ardente prière sort de son cœur un
vent s'élève et pousse de l'autre côté l'arbre, qui écrase la moitié
des païens ; les autres se convertirent. Les fils des vêtements
du saint homme guérissaient les infirmes un jour il embrassa un
lépreux, et sa lèpre disparut ; une lettre de lui appliqueée sur
le sein d'une jeune fille la guérit d'une grosse fièvre quarte.
Tous ces faits nous sont attestés par Fleury. Aussi, l'on appelait
saint Martin le grand thaumaturge des Gaules. Ses restes furent
déposés près de Tours dans une église qui lui fut consacrée et qui
devint le centre de la ville nouvelle de Martinopolis (plus tard
Châteauneuf), réunie à Tours au XVIème,siècle. Quelques-uns
de ses disciples furent chargés de veiller sur ses reliques, et
ce fut l'origine du chapitre de Saint-Martin, qui compta jusqu'à
deux cents membres et dont plus tard le roi de France fut le premier
dignitaire. Sa renommée était telle que les Gaules l'adoptèrent
pour patron, et que de toutes parts les pèlerins accoururent apportant
de riches offrandes. Son successeur fut saint Brice, que les habitants
abusés expulsèrent, parce qu'il avait eu commerce, disaient-ils,
avec sa servante. Brice fit apporter l'enfant, qui n'avait que trois
jours, et lui dit « Suis-je ton père? » L'enfant répondit d'une
voix forte « Tu n'es pas mon père. » Pourtant Brice fut exilé et
ne rentra que plus tard, son innocence ayant été reconnue. Son corps
fut déposé dans une châsse d'argent, œuvre de saint Éloi, avec cette
épitaphe « In hac urna est positum sanctum et venerabile corpus
B. Bricii. Post XLVII episcopatus sui annum angelicamvitam agensvirgo
obiit. »
Tel fut le brillant début de l'histoire religieuse
de Tours, qui dut sa principale illustration, pendant presque tout
le moyen âge, à ses pieux évêques, et qui fut plusieurs siècles
comme la métropole catholique de la Gaule. Lorsque Clovis alla combattre
les Wisigoths, il passa à Tours, et, considérant le pays comme placé
sous la protection du grand saint Martin, il défendit à ses soldats
d'y prendre autre chose que de l'eau et de l'herbe. Un d'eux prit
du foin et prétendit que foin et herbe c'était même chose ; Clovis
lui passa son épée au travers du corps. Puis il envoya un autre
soldat porter des offrandes à la basilique du saint. Au moment où
le messager entra, on chantait cette antienne « Seigneur, vous m'avez
donné des forces pour combattre et vous avez abattu sous moi ceux
qui s'élevaient contre moi. » Clovis accepta ces paroles comme un
présage de victoire et vainquit à Vouillé. Il repassa à Tours pour
remercier le saint, et c'est là qu'il reçut la robe de pourpre,
la chlamyde et la couronne d'or que lui envoyait l'empereur Anastase.
Il donna au saint son cheval de bataille plus tard il voulut le
ravoir et envoya 100 pièces d'or le cheval refusa de marcher ; il
envoya encore 100 pièces d'or, et le cheval marcha « La protection
de saint Martin est puissante, dit-il, mais elle coûte cher. » Vers
la fin duVème siècle avait été tenu à Tours un premier
concile, dont on n'a pu déterminer la date précise. En 566, il s'en
tint un autre, auquel assistèrent des évêques considérables de la
Gaule, et remarquable par plusieurs canons, dont l'un condamne certaines
pratiques païennes encore subsistantes, comme la célébration du
jour des calendes de janvier et les offrandes de viandes aux morts
le 18 du même mois. Un autre ordonne que l'évêque marié soit toujours
accompagné de clercs, même dans sa chambre, et tellement séparé
de sa femme que celles qui la servent n'aient aucune communication
avec ceux qui servent les clercs. C'était un acheminement vers le
célibat des prêtres. L'époque la plus glorieuse et la plus agitée
de Tours sous les Mérovingiens est celle où le célèbre Grégoire
fut son évêque. Il était d'une noble famille d'Auvergne qui avait
déjà fourni plusieurs prélats à cette ville. Entré dans les ordres
à vingt-cinq ans, il était déjà connu au loin par son savoir et
ses vertus lorsqu'il fut appelé au siège épiscopal de Tours, à trente-quatre
ans. Il devint, malgré sa jeunesse, malgré la faiblesse de son tempérament,
comme le patriarche de la Gaule entière. Il était le principal et
presque le seul représentant de la science et de la littérature,
si bornées, si pauvres à cette époque. Son Histoire ecclésiastique
des Francs, où les temps se reflètent si bien, et par la peinture
naïve qu'en fait l'auteur, et par son langage même, mélange de rudesse
barbare et de rhétorique de décadence, est le seul monument que
nous ayons sur cette période des Mérovingiens. On l'a surnommé le
Père de l'histoire de France, comme le premier qui l'ait écrite.
Il a laissé encore différents traités De la Gloire des martyrs,
Des Miracles de saint Julien, De la Gloire des confesseurs, Des
Miracles de saint Martin, Des Vies des Pères. Au milieu de tous
ces travaux, il fut fort mêlé à la politique, et la position était
difficile à tenir, à cette époque, pour l'évêque d'une ville disputée
sans cesse entre les rois d'Austrasie et de Neustrie. On vit, pendant
son épiscopat, un des plus curieux exemples du respect qu'imprimait
aux hommes les plus puissants et les plus violents le caractère
inviolable de l'Église. C'est lorsque Mérovée, fils de Chilpéric,
ayant épousé et délivré Brunehaut, vint chercher un refuge contre
la colère de son père dans la basilique de Saint-Martin. Les églises
avaient droit d'asile. Anathème sur qui arrachait du pied de l'autel
le fugitif innocent ou coupable. Les droits de l'État n'étaient
rien devant ceux de l'Église. Même chose avait existé chez les païens,
qui n'osaient arracher un suppliant de l'autel. Chilpéric marcha
avec une armée mais eût-il amené 100,000 hommes ou un seul, c'était
même chose devant l'inexpugnable rempart de la majesté du saint.
Il lui écrivit une lettre qu'un diacre alla déposer sur son tombeau
il lui demandait la permission d'aller arracher de son sanctuaire
Gontran Boson, ministre de Brunehaut, qui s'y était également réfugié.
Mais, au bout de trois jours, le papier blanc déposé pour recevoir
la réponse ayant été trouvé intact, Chilpéric jugea impossible d'avoir
Mérovée, ni Gontran. Quelque temps après, tous deux s'échappent,
sont arrêtés près d'Auxerre, et, cette fois, c'est à Saint-Germain
d'Auxerre que Mérovée demande protection. Même inviolabilité. II
s'échappe encore et rejoint Brunehaut en Austrasie. La haine des
leudes l'ayant forcé de quitter le pays, il se décide, en désespoir
de cause, à retourner auprès de Saint-Martin comme au lieu qui offre
le plus de sûreté. Malheureusement Chilpéric averti avait fait garder
tous les abords, et, traqué de toutes parts, Mérovée se fit donner
la mort par un de ses serviteurs.

Tours était alors gouvernée
par le comte Leudaste, ce personnage curieux dont M. Augustin Thierry
a mis en lumière, avec son grand talent, la romanesque histoire.
C'était un Gaulois, devenu un serf royal, puis favori de la reine,
comte des écuries, enfin comte de Tours. Avide, impudique, plein
de tyrannie pour ses administrés, il flattait Grégoire, mais préparait
en dessous les moyens de le perdre. II l'accusa auprès de Chilpéric
d'avoir mal parlé de la fidélité de Frédégonde. Grégoire se justifia
aisément dans le concile de Braine, et Leudaste, ayant pris la fuite,
erra longtemps dans les bois. L'intrigant eut pourtant l'adresse
de se faire encore rétablir dans son comté ; mais enfin il succomba
sous la vengeance de Frédégonde. Grégoire de Tours mourut lui-même
en 595, âgé de cinquante-quatre ans. Après Martin et Grégoire, il
était réservé à l'Église de Tours de posséder encore un des grands
personnages de l'histoire ecclésiastique et littéraire de la première
moitié du moyen âge. C'est Alcuin, l'ami, le confident des grands
projets de civilisation de Charlemagne, qui lui donna de nombreuses
abbayes, entre autres celle de Saint-Martin de Tours. Pas plus que
ses deux fameux prédécesseurs, Alcuin n'était natif de cette ville,
c'était un Anglais que Charles s'était attaché; mais il y établit
sa résidence et y ouvrit, en 797, une école fameuse. Il écrivait,
vers 798, ces lignes qui donnent une idée médiocre de l'importance
matérielle de Tours à cette époque « Que dirai-je de toi, ville
de Tours ? Crois-tu que l'on vienne pour toi, dont l'enceinte, petite
et peu imposante, n'est grande et digne de tous nos respects que
par le patronage de saint Martin ? N'est-ce pas à cause de sa bienheureuse
assistance que tant de chrétiens affluent dans tes murs ? » Pourtant,
il était fort attaché à cette ville ; si peu imposante. Charlemagne,
y étant venu faire ses dévotions et ayant été retenu quelque temps
par la mort de sa femme Luitgarde, voulut à son départ emmener l'abbé
de Saint-Martin vers les palais dorés de Rome, lui reprochant de
s'enfouir parmi ces murailles enfumées. Alcuin le supplia de laisser
à ses derniers jours le repos et la retraite, et, en effet, il acheva
sa vie à Tours en 804 et fut enseveli dans l'abbaye de Saint- Martin.
Il avait fait de vaines tentatives pour améliorer les mœurs fort
corrompues des moines de Saint-Martin ; un grand concile fut convoqué
à Tours en l’an 813, en partie pour cet objet ; parmi les canons
de cette grande assemblée, on en remarque un qui enjoint aux évêques
de faire traduire leurs homélies en langue romaine rustique et en
tudesque, afin qu'elles soient comprises de tous ; ce qui prouve
que le latin n'était plus parlé du peuple.
Tours, gagnant chaque
jour en importance religieuse, fut érigée en archevêché en 815.
Vers le milieu du même siècle prit naissance un long, bien long
procès de hiérarchie. Noménoé, en se faisant couronner roi de Bretagne,
voulut affranchir les évêques bretons de la suprématie que les évêques
et archevêques de Tours avaient sans cesse exercée sur eux comme
résidant dans l'ancienne capitale de la troisième Lyonnaise, et
il érigea Dol en archevêché. Pendant trois siècles et demi, les
archevêques de Tours réclamèrent, et ce ne fut que sous Innocent
III que les prétentions de Dol furent formellement condamnées et
Tours rétablie dans ses droits. La malheureuse ville était bien
maltraitée pendant ce temps par les Normands. Rien n'était respectable
pour ces païens. Ils incendièrent la ville et l'abbaye, qui ne sortirent
de leurs ruines que par les soins de Charles le Chauve, à qui le
pape Adrien II écrivait « Il sera juste désormais d'appeler la ville
Carlodurum et non plus Cæsarodunum. » Au reste, les habitants avaient
eu la prudence d'emporter bien loin les reliques du saint, jusqu'à
Auxerre, où elles furent confiées à la loyauté de l'évêque. Mais
ce fut toute une affaire pour les ravoir. Un nouvel évêque siégeait
à Auxerre ; il prétendait ne pouvoir dépouiller son église du précieux
trésor dont il l'avait trouvée en possession. Ses refus formels
excitèrent la vaillance des Tourangeaux. Leurs gentilshommes prirent
les armes, et bientôt six mille guerriers marchaient, comme en croisade,
vers Auxerre. Le dépositaire infidèle n'osa résister davantage,
et rendit les reliques, qui revinrent en triomphe, répandant partout
joie et santé. Deux mendiants estropiés, qui vivaient de leur infirmité,
se sauvèrent à leur approche, de peur d'être guéris. Mais l'influence
salutaire du saint les atteignit ; ils furent guéris malgré eux
et se résignèrent à venir offrir leurs béquilles à saint Martin.
Tours subit, comme toute la France, l'influence rénovatrice de l'an
1000. Partout on bâtissait des églises. Le trésorier de l'abbaye
de Saint-Martin, Hervé, homme très riche fit construire sur le tombeau
de Luitgarde, la tour qu'on appelle aujourd'hui Tour de Charlemagne,
et à l'entour s'éleva une splendide basilique, dont il ne reste
rien. Peu après, Eudes II, devenu comte de Touraine en 1037, dota
la ville d'un pont de pierre dont on voyait encore trois arches
en ruine, il y a quelques années. Il se composait de deux parties
distinctes appuyées toutes deux sur l'ile qui existe au milieu du
fleuve, à peu près au lieu où se trouve aujourd'hui le pont de fil
de fer. Le comte l'avait déclaré exempt de tout péage ; mais, quand
la Loire couvrait l'ile, alors beaucoup plus basse, un bac transportait
les passagers d'une partie à l'autre du pont moyennant une redevance
qui revenait à l'abbaye, et que la ville racheta plus tard après
de longs démêlés.
Passée, au siècle suivant, avec la Touraine,
sous la domination du roi d'Angleterre Henri II, Tours reçut de
lui beaucoup d'embellissements. Il fit construire, sur les fondements
des anciens murs de la ville, un château fort de forme carrée et
flanqué de tours à tous ses angles. Ce moment est un des plus prospères
de la ville de Tours au moyen âge.
C'est dans son sein que le
pape Alexandre III, chassé de Rome par Frédéric Barberousse, vint
convoquer un concile, 17 cardinaux, 124 évêques, et parmi eux Thomas
Becket, 414 abbés, une foule d'ecclésiastiques et de seigneurs y
furent admis. L'affluence était telle que Louis VII fut obligé d'adresser
aux habitants une ordonnance où il disait « Nous avons appris qu'il
n'y a ni ordre ni mesure pour le prix des logements qu'on loue pendant
le concile il est donc de notre devoir de corriger cet abus c'est
pourquoi nous vous mandons et ordonnons que les logements les plus
chers ne s'élèvent pas à plus de six livres, et par cette somme
on jugera par approximation ce qui doit être payé pour les autres
objets. » Le concile excommunia Barberousse et rendit dix canons
dont le principal objet était de combattre la simonie. A l'occasion
de cette grande réunion de l'Église, on appela Tours la seconde
Rome. Ce n'est pas fort longtemps après que fut définitivement rétablie
sa suprématie sur les évêchés de Bretagne. Quand l'archevêque Hugues
d'Étampes entra dans la ville en 1151, il se fit porter, de Saint-Martin
à la cathédrale, sur les épaules de huit barons de la Touraine,
qui le servirent à table. « Le baron de Sainte-Maure était chargé
de l'assister en qualité d'écuyer lorsqu'il traversait la ville
à cheval, et obtenait pour récompense la monture du prélat. Le seigneur
de Marmande veillait à la préparation des mets et gardait pour lui
tous les ustensiles qui avaient servi à cette préparation celui
d'Amboise mettait en ordre sur la table tous les plats et après
le repas emportait avec lui la Vaisselle d'or et d'argent. Le seigneur
de Preuilly, qui remplissait l'office de panetier, disposait de
la desserte. Le seigneur de La Haye (aujourd'hui La Haye-Descartes),
échanson, gardait la coupe dans laquelle avait bu l'archevêque.
Le seigneur de L'Ile-Bouchard lui versait de l'eau sur les mains
et recevait son anneau. Le prévôt de Larçay veillait à la porte
de la salle sans avoir droit à aucun cadeau. Le seigneur de Bridoré
avait mission de servir au prélat de l'eau dans la salle et dans
l'intérieur du palais, avec une aiguillière d'argent qui lui revenait.
Enfin, celui d'Ussé, chargé des fonctions d'écuyer tranchant, devenait
possesseur des couteaux. » On voit combien était puissante l'autorité
ecclésiastique dans la cité de saint Martin. Mais la concorde n'y
régnait pas toujours entre les membres de l'Église ; depuis 995,
le chapitre disputait à l'évêque le droit de juridiction, et ce
ne fut qu'au XVIIIème siècle qu'un arrêt du parlement
termina la querelle en subordonnant le chapitre à l'évêque. La ville
s'agrandissait en conséquence de sa renommée et de son grand rôle.
Autour de l'abbaye, l'ancienne Martinopolis, reconstruite, après
un incendie, sous le nom de Castrum novum, Châteauneuf, s'était
peuplée d'une bourgeoisie que le voisinage des moines et le passage
continuel des pèlerins enrichissaient plaisir. Un chroniqueur de
Marmoutiers nous les montre, au XIIème,siècle, vêtus
de pourpre, de riches fourrures, habitant des maisons surmontées
de tourelles et pleines de meubles brillants d'or et d'argent, menant
joyeuse vie et passant le temps à faire ripaille et à jouer aux
cartes et aux dés ; du reste, charitables, bienfaisants, pleins
de bonne foi. Mais la richesse engendra l'orgueil ou parlons-en
mieux une noble fierté. Les bourgeois de Châteauneuf, qui relevaient
des moines, voulurent, comme tant d'autres de leur époque, secouer
un peu la servitude féodale. Ils se rassemblèrent, vers 1120, dans
une chapelle de l'église Saint-Martin, sous le nom de confrérie
de Saint-Éloi, et formèrent le dessein de faire administrer leurs
affaires communes par des magistrats élus. Le chapitre annula la
décision, et bientôt le débat, grandissant, fut porté jusque devant
le pape. Condamnés par toutes les autorités supérieures, par le
pape Lucius, par le roi Philippe-Auguste, les bourgeois de Châteauneuf
imaginèrent un plaisant stratagème ils firent, une nuit, irruption
dans le cloître, forcèrent les portes du trésorier et enlevèrent
tout l'argent qu'ils y trouvèrent. Les moines, éplorés, demandèrent
merci, et une transaction fut conclue Châteauneuf paya 300 mares
d'argent et 100 livres tournois aux chanoines, mais conserva sa
commune, confirmée par saint Louis en 1258, abolie par Philippe
le Bel en 1305.

Ainsi, le débat communal entre le peuple et le chapitre
souverain, qui en tant d'autres lieux était sanglant et tragique,
n'eut à Tours qu'un caractère héroï-comique, qu'il est assez piquant
de remarquer dans le pays de Rabelais. Ces nouveaux avantages donnèrent
le plus rapide développement à la ville de Châteauneuf, qui semblait
marcher à la rencontre de Tours et, en effet, les deux villes, de
plus en plus rapprochées, furent, sous Jean le Bon, réunies dans
une même enceinte. Le roi de France sentait alors la nécessité de
se faire, des places du bord de la Loire, une barrière contre les
Anglais venant de la Guyenne, comme le fit plus tard Charles VII
contre les Anglais venant de la Normandie. Il fit don aux bourgeois,
pour leurs ouvrages de défense, de la coupe de dix arpents de bois
de la forêt royale de Teillay, et bientôt tous, travaillant avec
une vive émulation, s'entourèrent d'une forte muraille flanquée
de tours nombreuses ; la grande tour de Charlemagne, au centre de
l'abbaye, dominait l'ensemble, et sa plate-forme était le poste
d'un guetteur qui observait au loin la campagne afin d'éviter les
surprises.
Sans perdre notre temps à énumérer tous les princes
que Tours reçut au moyen âge et au XVIème siècle nous
rappellerons seulement que Philippe le Bel y tint, en 1308, les
seconds états généraux de la monarchie, dont il obtint la condamnation
des Templiers; au siècle suivant, le malheureux Charles VII, dépossédé
faisait alternativement de Tours, Loches et Chinon sa résidence.
Mais arrêtons-nous devant la sombre image de Louis XI et du PIessis-Iès-Tours.
Soit par tradition paternelle, soit afin de trouver sur la rive
gauche de la Loire un lieu sûr contre ses deux grands ennemis, le
duc de Bourgogne d'abord, celui de Bretagne ensuite, Louis XI acheta,
en 1463, de son chambellan, Audoin de Maillé, la terre de Montils
moyennant 5,500 écus d'or et y fit bâtir le château du plessy-les-Tours.
Ce château si fameux occupait, à un kilomètre environ au sud-ouest
de Tours, une petite hauteur d'où la vue s'étend sur les belles
plaines de la rive gauche de la Loire et sur le gracieux coteau
de Saint-Cyr, sur la rive droite. Protégé de ce côté par la Loire,
il l'était de deux autres par le Cher et par un petit bras de rivière
qui les fait communiquer, sans compter la forte ville de Tours en
avant. En outre, le parc du château était entouré de murailles et
de fossés, et le château lui-même se composait de deux enceintes
où l'on ne pénétrait que par des ponts-levis. La première franchie
présentait un aspect sombre et militaire les Écossais étaient là,
et un piquet de cavalerie toujours à cheval et prêt à partir au
premier ordre. On entrait par un pont-levis et un portail gothique
dans la seconde enceinte, où s'offrait une cour d'aspect bien plus
riant arcades, statues autour des fenêtres, festons taillés dans
la pierre, tout autour les appartements du roi et de sa famille.
C'est là que Louis XI passa sa vie soucieuse, là que cette forte
tête combinait ses plans, là que cet esprit soupçonneux exerçait
sa méfiance terrible, sa cruauté implacable et c’est là que fut
placé en sa cage de fer le cardinal de La Balue, dans un cachot
que l'on montre encore aujourd'hui; là que le vieillard superstitieux
appela d'Italie saint François de Paule pour écarter de lui la mort,
en même temps qu'il envoyait à l'abbaye de Saint-Martin, pour la
châsse du saint, une grille d'argent de 17,000 marcs, que plus tard
François Ier enleva et fit fondre, malgré les cris des
religieux de ce lieu enfin nul n'approchait sans terreur, car, si
l'on en croit la tradition, ce n'étaient aux alentours qu'arbres
chargés de pendus, que pièges, que chausse-trapes, et quiconque
se hasardait trop près, le soleil couché, voyait s'abaisser vers
lui l'arquebuse des Écossais qui veillaient sur les créneaux. La
Révolution a détruit ce séjour de sinistre mémoire, et l'on ne voit
plus du Plessis qu'une tour octogonale accolée à un corps de bâtiment
converti en habitation moderne. Louis XI aimait fort à sentir en
avant de sa résidence, comme une cuirasse, sa bonne ville de Tours,
mais il n'aimait point qu'elle fût trop libre ; aussi lui retira-t-il
définitivement le droit de se gouverner en commun, c'est-à-dire
par elle-même, pour y substituer un maire et des échevins. En revanche,
il promettait « la noblesse pour les maires, échevins et leur lignée
et postérité nées ou à naître en loyal ménage la protection et sauvegarde
du roy pour les bourgeois, manants et habitants de Tours, avec leurs
femmes, enfants, famille, et tous et chacun leurs biens, meubles
et immeubles, etc. Surtout il leur fit un présent inappréciable
en établissant dans leur cité des manufactures d'étoffes de soie,
de draps d'or et d'argent, en y appelant les meilleurs ouvriers
de Gênes et de Florence, qu'il affranchit de toute taille et impôt
; établissements qui devinrent si prospères que François Ier
reconnaissait, cinquante ans plus tard, que Tours fournissait d'étoffes
de luxe tout le royaume et y retenait ainsi une grande partie de
l'argent que l'industrie étrangère attirait auparavant au dehors.
Ce dernier prince songea même à lui donner une importance considérable,
à faire presque une capitale de cette ville qui venait de voir,
en moins d'un demi-siècle, se réunir dans ses murs trois assemblées
d'étals généraux celle de 1468, par qui Louis XI fit retirer la
Normandie à son frère; celle de 1483, sous Charles VIII, l'une des
plus importantes qui aient eu lieu avant 1789; enfin celle de 1506,
qui annula les traités désastreux signés à Blois par Louis XII.
Cette prospérité ne périt point dans les guerres de religion, bien
que la ville fût alors témoin de cruautés affreuses et presque les
seules qu'offre, dans toute leur histoire, le caractère doux des
habitants. Les protestants avaient pillé l'abbaye de Saint-Martin
; les catholiques, plus nombreux, se précipitèrent sur eux et les
noyèrent par dizaines attachés à des perches. L'édit de Nantes ayant
assuré le repos des protestants et beaucoup des artisans de Tours
l'étaient devenus, on compta à Tours, sous Richelieu, 20 000 ouvriers
en soie, plus de 40 000 personnes employées au dévidage, à l'apprêt
et au tissage ; 8,000 métiers, 1 700 moulins, 3 000 métiers pour
la rubanerie. Toute l'Europe recherchait les soieries de Tours comme
les plus belles. La révocation de l'édit de Nantes tua sur le coup
cette magnifique industrie ; au bout de quinze ans, Tours n'avait
plus que 33 000 habitants, au lieu de 80 000, 4 000 ouvriers et
1 200 métiers. Au XVIIIème siècle, Tours fut encore frappée.
En 1772, on lui retira son atelier monétaire, qu'elle possédait
depuis le temps des Romains, et qui avait pour marque la lettre
E, cet atelier d'où étaient sorties ces fameuses pièces connues
sous le nom de livres et sols tournois. On lui retira sa collégiale
de Saint-Martin, son intendance, son présidial ; on ne lui a laissé
que son archevêché. Aujourd'hui, quoiqu’elle ait encore des fabriques
de soieries et de rubans, tout ce qui lui reste de prospérité tient
à la beauté du pays qui attire une foule d'étrangers, à la beauté
aussi de la ville qui, dans certaines parties cependant, vaut moins
que sa renommée. Par exemple, arrivez par cette magnifique avenue
de Grandmont; traversez, en deçà de la grille de l'octroi, cette
vaste demi-lune, à droite et à gauche de laquelle s'étendent les
majestueuses allées du Mail; parcourez cette rue Royale, droite,
large, uniformément construite arrivez en vous inclinant devant
la statue de Descartes, à ce pont admirable de 15 arches, long de
434 mètres, large de près de 15, parfaitement horizontal, qui fut
construit de 1765 à 1777 vous serez émerveillé vous le serez également
si vous visitez, le long du Mail, et dans les rues adjacentes, les
charmantes habitations modernes qu'occupe l'aristocratie du pays
; vous admirerez encore ou bien le bel embarcadère du chemin de
fer, au-delà du Mail, œuvre de l'industrie moderne, et dont l'attraction
semble devoir déplacer la ville; ou bien l’œuvre du moyen âge, la
vieille cathédrale de Saint-Gratien, commencée sous le roi d'Angleterre
Henri II, continuée avec activité en 1430, achevée enfin seulement
en 1507, alors que fut posé le couronnement de ses deux belles tours,
si imposantes et si riches de sculptures ainsi que l'atteste cette
double inscription qui se lit sous la clef du petit dôme de la tour
septentrionale
L'an MDVII fut fait ce noble et glorieux édifice,
A Domino facfum est istud et memorabile in oculis nostri
. Mais si vous descendez, à droite et à gauche de la rue Royale,
dans les quartiers voisins de la Loire, vous retrouverez la vieille
ville aux rues tortueuses et étroites, aux vieilles maisons, aux
antiques mas, ires', et vous serez tenté de dire de findolènte et
paisible cité Desinit in piscem, ,etc.
Outre sa cathédrale,
monument historique, Tours possède l'église Saint-Julien, remarquable
par Son clocher du XIèmee siècle, l'église Notre-Dame-la-Riche,
habilement restaurée de nos jours; l'église Saint- Saturnin, qui
date du XVème siécle,; l’ancienne église Saint-Clément,
rangée parmi les monument historiques. De l'ancienne et célèbre
abbaye de Saint- Martin, il ne reste plus que deux tours la tour
Charlemagne et la tour de l'Horloge ; espérons que le projet de
sa reconstruction, dont il était question avant la guerre de 1870,
sera repris et mis à exécution.
Signalons encore les ruines d'un
amphithéâtre romain, la tour de Guise, l'archevêché, le théâtre,
la bibliothèque, la fontaine de Beaune, le palais de justice, le
pénitencier, l'hôpital général, le musée ; enfin, parmi les habitations
particulières l'auberge de la Croix-Blanche, l'hôtel Jehan Gallan,
la maison de la Cordelière, l'hôtel Gouin, bâti en 1440 pour Jean
Xaincoings, contrôleur général des finances, etc.
Nous avons
dit que, pendant la guerre de 1870- 1871, Tours devint le siège
du gouvernement de la Défense nationale mais vers la fin du mois
de décembre, le 21, les têtes de colonne du général allemand Woigtz-Rhetz
arrivèrent devant Tours. Un coup de feu fut tiré du pont sur les
uhlans d'avant- garde alors une batterie allemande s'établit sur
le haut de la Tranchée et lança ses obus sur la rue Royale. Un des
projectiles atteignit la mairie, un autre emporta la tête d'un journaliste
de la ville ; le maire fit alors arborer le drapeau blanc ; la ville
se rendit, mais elle ne fut pas occupée par l'ennemi, qui se contenta
de faire des réquisitions.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.