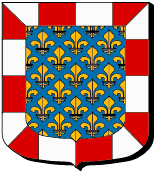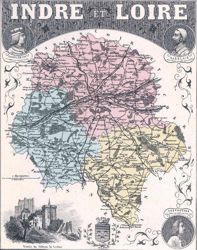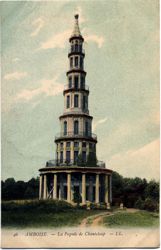Histoire de l'Indre et Loir
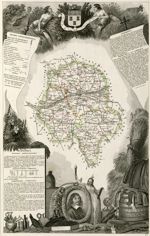
Le département d'Indre-et-Loire comprend
les quatre cinquièmes de l'ancienne Touraine, dont la capitale
est devenue son chef-lieu. Ce beau pays n'a pas eu, comme quelques
autres plus énergiques et plus rudes, une histoire intérieure
fort agitée si sa tranquillité a été troublée, c'est en général
par le contre-coup des secousses qui remuaient les pays voisins
ou même toute la France.
Le caractère de ses habitants est
plus propre au repos qu'à la guerre ; une certaine indolence
se remarque aujourd'hui chez eux, et les témoignages de tous
les temps s'accordent sur ce point Turoni imbelles, dit Tacite
; mais les Tourangeaux réclament et demandent qu'on lise rebelles.
»Una nuper cohors rebellem Toronium (profligavit),dit
Silius Italicus. Rebellem! s'écrient les Tourangeaux avec fierté.
Oui, mais una cohors, une seule cohorte les a vaincus. Bella
timentes Turones, dit Sidoine Apollinaire. « Mais ceci, répond
M. Stanislas Bellanger (de Tours), n'est point une preuve irréfutable.
» Enfin, le Tasse, énumérant les peuples accourus à la croisade,
écrit sur les guerriers de Tours et de Blois ces vers charmants
Non è gente robusta o faticosa.
La terra molle, e lieta,
e dilettosa,
Simili a se gli abilator produce.
« Ce
n'est pas un peuple robuste et fait pour supporter les fatigues
;
cette terre, qui respire la mollesse, la joie et les délices,
donne le jour à des habitants qui lui ressemblent. »
Que les Tourangeaux sachent se borner ; qu'ils se contentent
de la réputation d'esprits fins, caustiques, prenant la vie
par le bon côté, et parlant notre langue avec plus de pureté
qu'aucune autre province de France, ce qu'on attribue, à tort
ou à raison, au long séjour de la cour dans leur pays. Dans
le temps qu'on se faisait grand honneur' d'une antique origine,
les Tourangeaux ont eu comme bien d'autres peuples du reste,
la manie de se rattacher aux temps héroïques de la Grèce. Turnus
aurait été le père des Turoni, et, au XVIème siècle,
on montrait encore près d'une des portes de Tours une grosse
pierre carrée qu'on disait être son tombeau. D'autres voulaient
qu'une troupe de Gaulois fût allée au secours de Troie et, la
trouvant déjà conquise, en eût ramené des Troyens qui se seraient
fixés aux bords de la Loire. Il en est qui font venir Turonide
qui signifie en grec, fils du ciel. Une étymologie moins flatteuse
est celle qui fait dériver leur nom du celtique tur, turon,
qui tourne, qui change, épithète qui désignerait l'instabilité
de leur caractère. Les Turoni, à parler sérieusement, étaient
des Celtes et tenaient leur place dans la confédération des
Andes, des Carnutes, des Sénones, des Lingons, des Vénètes.
Ils formaient une des civitates si nombreuses que César trouva
en Gaule. Ils étaient gouvernés de même, avaient la même religion,
les mêmes lois, les mêmes armes. Plusieurs dolmens encore debout
et quelques débris d'armes trouvés dans le département, une
pointe de lance et des haches en bronze, un fragment d'une hache
en silex, un casse-tête, un caillou tranchant pour dépouiller
les animaux, des pointes de flèche en silex, des fragments d'armure
en bronze, en témoignent suffisamment.
Sur des médailles
ornées de figures du sanglier symbolique des Gaulois ou d'autres
animaux bizarres qu'on suppose être l'urus ou auroch, on lit,
outre la légende Turonos, les noms de Cantocix et de Triccos,
qu'on croit avoir été deux chefs du pays à une époque inconnue.
Les Turoni ne se firent que faiblement remarquer dans les grandes
expéditions des Gaulois hors de leur pays et dans la résistance
nationale aux armes de J. César. Soumis avec toute la Gaule,
ils fournirent de la cavalerie au conquérant et furent compris
dans la Celtique qui, sous Auguste, reçut le nom de Gaule Lyonnaise.
Un peu plus tard, leur pays fut démembré, et sa partie méridionale
fut attribuée à l'Aquitaine. Quand il y eut quatre Lyonnaises,
ils firent partie de la troisième, qui comprenait la Touraine,
la Bretagne, l'Anjou et le Maine. Dans la décadence de l'empire
lorsque déjà les Wisigoths occupaient le sud de la Loire, les
Bretons, les Andécaves (Anjou) et les Turones formèrent la Ligue
armoricaine dans le but de ressaisir leur antique indépendance.
Mais Aétius les vainquit et établit chez eux les Alains mercenaires
qui, de la rive droite de la Loire, où ils se fixèrent, ne cessèrent
d'aller ravager la rive gauche et la Touraine méridionale. Ils
ne s'arrêtèrent que devant les armes des Wisigoths, qui ne voulaient
pas les laisser empiéter sur leur royaume d'Aquitaine.
Ce
fut, depuis lors, le sort de la Touraine d'être cruellement
disputée par ces ennemis acharnés. Entre la Seine et la Loire,
et par conséquent en partie chez les Turones, subsistait le
dernier débris de l'empire romain en Gaule. L'un des plus habiles
et des derniers chefs de ce petit État romain perdu au milieu
de l'invasion barbare fut Ægidius, qui refoula les Wisigoths.
Mais il mourut empoisonné après sa victoire en 464, et les Wisigoths,
après la chute de l'empire survenue en 476, se précipitèrent
sur la Touraine, qu'ils réunirent à leur royaume au sud de la
Loire. Ainsi finit en ce pays la domination romaine après y
avoir subsisté 535 ans.
Pendant cette longue période de civilisation,
le christianisme y avait été introduit vers la fin du IIIème
siècle par saint Gatien, premier évêque et patron de Tours,
mort en 304. Saint Martin acheva son œuvre.

Quand les Wisigoths eurent conquis la
Touraine, ils voulurent y établir leur religion, l'arianisme,
en même temps que leur domination, et ce fut ce qui leur fit
perdre cette province. Les habitants, persécutés par Alaric
II, accueillirent favorablement les Francs, qui, après avoir
fait une première incursion dans le pays en 473, y reparurent,
convertis et orthodoxes, avec Clovis à leur tête, en 504. Par
l'entremise du roi des Ostrogoths, le grand Théodoric, les deux
rivaux, Clovis et Alaric, eurent une entrevue amicale au milieu
de la Loire, dans l'île d'Or, aujourd'hui île Saint-Jean, en
face d'Amboise, tous deux se touchèrent la barbe et se jurèrent
amitié à l'occasion de quoi furent frappées des médailles dont
nous possédons quelques-unes. On prétend aussi voir des monuments
commémoratifs de cette réconciliation dans les deux énormes
tumulus de Sublaines, entre Loches et Amboise, qui sont plus
vraisemblablement les tombeaux de quelques anciens chefs gaulois.
Cette réconciliation fut bien éphémère ; car, bientôt après,
s'engageait près de Poitiers la bataille de Vouillé, qui chassa
les Wisigoths de la Gaule et livra à Clovis la Touraine, l'Aquitaine,
etc.
Après sa mort, la Touraine fit partie du royaume d'Orléans
et fut un objet de querelles pour les quatre rois frères. Lors
de l'invasion du midi de la France par les Sarrasins (732),
la Touraine fut sauvée avec toute la monarchie franque par la
grande victoire de Charles-Martel gagnée, dit-on, à trois lieues
de Tours, dans la plaine qu'on appelle aujourd'hui les Landes
de Charlemagne. On sait q\1f:! Charles- Martel fut appelé Magnus
comme son petit-fils, et que d'ailleurs l'imagination populaire
mis sur le compte du premier empereur d'Occident bien des exploits
qui ne lui -appartient pas. Charles-Martel laissa la Youraine
à Eude, duc d’Aquitaine ; mais, en 736 il l’enleva à ses héritiers,
et bientôt, d'ailleurs, il commença la soumission de l'Aquitaine
même par ces terribles expéditions que Pepin le Bref et Charlemagne
continuèrent.
Ce dernier donna le gouvernement de la Touraine
au comte Hugues avec une d’autorité plus étendue que celle des
précédents gouverneurs.
Ce seigneur fut, peu de temps après,
envoyé en ambassade auprès de Nicéphore, Empereur d'Orient.
C'est à cette époque, par les soins de Charlemagne, puis de
Louis le Débonnaire, que fut commencé l'endiguement de la Loire
ce n'est pas d'aujourd'hui que ce fleuve est redoutable par
ses débordements ; son nom Liger, suivant l'étymologie celtique,
veut dire ravageuse aux eaux froides.
D'autres ravageurs
désolèrent la Touraine au IXème siècle comme tous
les pays voisins, elle souffrit des incursions des Normands
que combattit avec tant de valeur Robert le Fort, comte de Touraine,
d'Anjou et de Blois. En 940 commence la série des comtes héréditaires
; c'est-à-dire le régime féodal, en Touraine. Thibaut le Tricheur,
déjà comte de Blois, de Chartres, de Beauvais, de Meaux et de
Provins, s'empara, par la force, de la Touraine et la posséda,
ainsi que son fils Eudes 1er (978). La Touraine devint alors
le théâtre d'une lutte opiniâtre, qui est à peu près l'événement
le plus saillant de la pâle histoire de cette époque. Les comtes
de Blois et Champagne étaient les plus puissants seigneurs de
la France du centre et de l'est, qui, par l'acquisition de la
Touraine, semblait vouloir envahir la France occidentale. Mais
celle-ci résista, personnifiée dans les puissants comtes d'Anjou.
L'un d'eux, Foulques Nerra ou Faucon Noir, célèbre par son caractère
intraitable et par son âpre énergie, s'empara d'une partie de
la Touraine, après une lutte violente. Son fils Geoffroy Martel
assiégeait Tours lorsque, menacé par une armée ennemie, il leva
le siège. Une bataille, livrée près de Montlouis le 22 août
1044, fut fatale à l'héritier légitime de la Touraine, Thibaut
III, qui signa, dans la prison de Loches, l’abandon de son fief
à la maison d'Anjou. La Touraine suivit dès lors les destinées
de l'Anjou, fut réunie à l'Angleterre en 1152, enlevée en 1204
à Jean sans Terre par Philippe-Auguste et rattachée alors à
la couronne de France. Pour gagner l'affection des seigneurs
du pays, Philippe rendit la dignité de sénéchal héréditaire
en faveur de Guillaume des Roches et créa cinquante-cinq chevaliers
bannerets, qui eurent le droit de faire porter leur bannière
à l'armée du roi, sous condition de fournir leur contingent.
La Touraine fut séparée du domaine de la couronne, d'abord
par Philippe de Valois qui l'érigea en duché-pairie en faveur
de Jeanne de Bourgogne, sa femme en 1328, puis par le roi Jean,
qui, après la bataille de Poitiers, la donna en apanage à son
fils Philippe le Hardi, mais la lui retira ensuite pour y substituer
la Bourgogne.
Parmi les ducs apanagistes qui succédèrent,
il faut remarquer Louis 1er, duc d'Anjou et roi de
Naples, à partir duquel les armoiries de la Touraine, qui étaient
de gueules, au château d'argent, furent augmentées de la bordure
componée de Jérusalem et de Naples-Sicile.
Le dernier duc
apanagiste fut François d'Alençon, fils de Henri II, qui mourut
en 1576. La Touraine cessa dès lors de servir d'apanage aux
princes du sang.
Jusque-là tranquille et prospère, la Touraine
se vit troublée au XVIème siècle par la conspiration
d'Amboise et par les guerres de religion mais elle eut surtout
à souffrir de la révocation de l'édit de Nantes, qui, en forçant
un grand nombre de chefs d'industrie protestants à s'expatrier,
provoqua la ruine de ses fabriques de rubans et d'étoffes de
soie. Avant 1789, la Touraine formait un des 32 gouvernements
et donnait son nom à l'une des 35 généralités du royaume. Cette
généralité comprenait, en outre, l'Anjou, le Maine, le bas Poitou
et venait immédiatement après celles de l'Ile-de-France, de
la Normandie et du Languedoc. Sa population était de 1,338,700
âmes et payait 30 millions d'impôt. Si, pendant la Révolution,
il ne se passa, en Touraine, aucun événement important, il n'en
fut pas de même à la chute du premier et du second Empire. C'est
là, sur les bords de la Loire, que l'armée française, à la suite
du désastre de Waterloo, opéra sa retraite, et c'est là aussi,
dans la ville de Tours, que vint résider, au mois d'octobre
1870, le gouvernement de la Défense nationale ; mais, à l'approche
des armées allemandes, il dut quitter Tours pour aller siéger
à Bordeaux. Le département fut occupé pendant les premiers mois
de 1871, jusqu'à la signature des préliminaires de la paix ;
et cette occupation de l'une des plus belles et des plus paisibles
contrées de la France lui coûta 4,456,535 francs.
Tours

Dès l'époque gauloise, les Varennes entre
Loire et Cher, riches terres des Turones, sont fortement peuplées
et desservies par la Loire qui la relie aux iles de Touraine
en aval. Sous l'autorité romaine, au Ier siècle,
une cité est fondée : elle est nommée « Caesarodunum » (« colline
de César »). Ce nom évolue au Bas-Empire après le IVème
siècle en s'associant celui du peuple des Gaulois, elle prend
le nom de « Civitas Turonorum » puis par altération de « Tours
». C'est aussi au Bas Empire qu'est construit l'amphithéâtre
de Tours, l'un des cinq plus grands de l'Empire. La ville devient
la métropole de la province romaine de Lyonnaise troisième vers
380-388, dominant la vallée de la Loire, le Maine et la Bretagne.
Une des figures marquantes de l'histoire de la ville est saint
Martin, deuxième évêque après le mythique Gatien. Martin est
un ancien militaire devenu officier romain. Épris du message
chrétien, il partage son manteau avec un démuni à Amiens, puis
se fait moine. Inlassable prédicateur d'une foi modèle dans
les assemblées chrétiennes, il y épouse la condition des plus
modestes et acquiert une renommée légendaire en Occident, faisant
des émules et créant le monastère de Marmoutier. Cette histoire
et l'importance post-mortem de Martin encore plus grande dans
l'Occident chrétien médiéval firent de Tours une ville de pèlerinage
majeure au Moyen Âge et notamment une possible étape détournée
sur le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle, qui file par
Amboise. Le monastère Saint-Martin a bénéficié très tôt, dès
le début du VIème siècle, de libéralités et de soutien
des rois francs, Clovis le premier a attribué la victoire des
Francs sur les Wisigoths à l'intercession du vénérable saint
ancien soldat, et accru considérablement l'influence du monastère
et de la ville en Gaule.
Au VIème siècle, Grégoire
de Tours, jeune lettré vient s'y faire soigner d'un mal présumé
incurable. Guéri, il y reste et parvient à s'y faire nommer
évêque. Cet écrivain mérovingien, auteur des Dix Livres d'Histoire,
marque la ville de son empreinte notamment en restaurant la
cathédrale détruite par un incendie en 561.
Au IXème
siècle, Tours est l'un des foyers privilégié de la Renaissance
carolingienne, notamment du fait de l'élévation l'abbatiat à
saint Martin d'Alcuin, ancien prieur anglo-saxon du monastère
de Cormery. Tours repousse une première attaque du chef viking
Hasting. En 850, les Vikings s’installent aux embouchures de
la Seine et de la Loire qu'ils empruntent et contrôlent. Toujours
menés par Hasting, ils remontent à nouveau la Loire en 852 et
mettent à sac Angers et le Maine. Tours et l’abbaye de Marmoutier
tombent dans les mains des pillards en 853.

Durant le Moyen Âge, Tours est constituée
de deux noyaux juxtaposés, parfois concurrents. La « Cité »
à l'est, héritière du premier castrum, remodelée après 265,
est composée de l'ensemble archiépiscopal (cathédrale et résidence
des archevêques) et du château de Tours, siège de l'autorité
comtale (tourangelle puis angevine) et royale. À l'ouest, la
« ville nouvelle » ou Martinopole structurée autour de l'abbaye
Saint-Martin qui contrôle le prestigieux pèlerinage s'émancipe
de la cité au cours du Xème siècle érigeant une première
enceinte vers 918 et devient le « Châteauneuf » ; cet espace,
organisé entre Saint-Martin et la Loire, devient le centre économique
de Tours. Entre ces deux entités subsistaient des espaces de
varenne, de vignes et de champs peu densément occupés, à l'exception
de l'abbaye Saint-Julien installée en bord de Loire.
Les
deux noyaux sont unis par une enceinte de réunion au cours du
XIVème siècle. Tours est un modèle de la ville double
médiévale. Tours est la capitale de la Touraine, ce territoire
sous le nom de comté de Tours est âprement disputé entre la
maison féodale blésoise et la maison d'Anjou, qui emporte la
mise en 1044 sous forme d'un fief.
Prenant acte de la déchéance
continentale des Plantagenets, Philippe Auguste, roi suzerain,
récupère par la force la Touraine après 1204. La Touraine devient
une véritable capitale de la France entre 1450 et 1550, séjour
continuel des rois et lieu des fastes de la cour. En particulier,
Louis XI s'installe au château des Montilz-lèz-Tours nommé encore
Plessis-du-Parc-lèz-Tours après sa reconstruction en mars 1472,
à La Riche, dans l'actuelle banlieue ouest de Tours. Louis XI
épris de Tours et de sa contrée, la développe et introduit maintes
activités, parmi lesquelles en 1470 l'industrie de la soie,
du murier au défilage des cocons. Les décisions du pouvoir royal
en faveur de la Touraine continuent une longue tradition d'implantation
d'activités, favorisées par le passage des compagnons du tour
de France, ateliers d'art et imprimerie sous Charles VII, qui
se perpétuent avec la passementerie sous François Ier.
L'intolérance religieuse et de subites guerres marquées de spectaculaires
massacres, closent cette période heureuse.
Le pouvoir royal est impuissant à rétablir
l'ordre. Charles IX passe dans la ville lors de son tour de
France royal (1564-1566), accompagné de la Cour et des Grands
du royaume : son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre, les
cardinaux de Bourbon et de Lorraine. À ce moment, les catholiques
ont repris les choses en main à Angers : l’intendant s’est arrogé
le droit de nommer les échevins. Le massacre de la Saint-Barthélemy
qui prend une ampleur démesurée à Paris fin aout 1572 n'a pas
cours en Touraine. Le responsable royal a préféré s'éloigner
de la ville, plutôt que de compromettre les paix longuement
négociées avec les réformés. Quelques bourgeois protestants
sont emprisonnés par les échevins de Tours, par précaution pour
leur éviter l’extermination. Tours, qui possède un présidial
depuis 1551, devient en 1577 le siège d'une généralité, qui
contrôle seize élections sur la Touraine, l'Anjou et le Maine.
L'archevêché de Tours couvre sous son égide un territoire similaire.
Avec la reprise en main autoritaire du pouvoir, la cour royale
des Bourbon revient de façon permanente à Paris ou dans ses
environs, en attendant de fuir à nouveau Paris pour la proche
Versailles. Ce retour marque le début d'un déclin lent mais
permanent. Pourtant, les intendants du Roi favorisent à nouveau
Tours, en la dotant d'une route moderne, de magnifiques ponts
alignés sur la nouvelle voie de passage. Tours, capitale de
la subdégation de Touraine, peut plus que jamais conserver sa
prééminence de marché d'approvisionnement, redistribuant les
grains, les vins, les fruits et légumes, les produits laitiers
et de bassecour.
Le premier arbre de la liberté est planté
le 17 juin 1792. Tours, promue préfecture, est une ville en
ébullition révolutionnaire après 1791. Guillaume Le Métayer
dit Rochambeau (1763-1798), célèbre chef chouan de la Mayenne
est fusillé à Tours le 8 thermidor an VI.
Chinon

Dominant la Vienne, le plateau de Chinon
finit en éperon, presque à toucher la rivière. Cet éperon, fortifié
dès les Romains, connait pendant dix siècles une histoire confuse
et tragique. En 845, Chinon est pillée par le chef viking Hasting.
Trois maitres dans l'art des fortifications ont surtout
laissé leur empreinte sur le château fort actuel, deux rois
d'Angleterre, Henri II et Richard Cœur de Lion, un roi de France,
Philippe Auguste. C'est en l'an 1205, après un siège de huit
mois, que ce dernier a enlevé la place aux Plantagenets.
Le 27 aout 1321, 160 Juifs accusés d'avoir empoisonné des puits
sont brulés vifs. La cour du roi de Bourges Avec Charles VII
débute une page d'histoire. Le Royaume de France est dans une
situation très grave. Henri VI, roi d'Angleterre, se dit aussi
« roi de Bretagne » ; Charles VII n'est que le « roi de Bourges
» quand, en l'an 1427, il installe sa petite cour à Chinon.
L'année suivante, il y réunit les États Généraux des provinces
du Centre et du Sud encore soumises à son autorité.
Les États
dépensent 400 000 livres pour organiser la défense d'Orléans,
assiégée par les Bretons. Chinon reste le siège de la cour jusqu'en
l'an 1450, puis on l'abandonne. Toutefois, le château retrouve
un éclat furtif en l'an 1498, quand le roi Louis XII y reçoit
le légat du pape, César Borgia, venu lui porter la bulle de
son divorce. Louis XII se sépare sans regret de Jeanne de France,
la fille de Louis XI. Il n'avait que 14 ans quand ce dernier
la lui avait fait épouser.
Une double bosse, la hanche coxalgique,
un aspect simiesque expliquent le peu d'empressement de son
époux durant les vingt-trois années de leur union. Quand meurt
Charles VIII, Louis XII doit, selon le testament du défunt,
épouser sa veuve Anne de Bretagne. Il a pour elle une vive inclination
et ce nouveau mariage conserve la Bretagne à la couronne de
France ; double raison pour que le roi célèbre par des fêtes
magnifiques l'arrivée de la bulle libératrice.
Chinon est
à la tête d'un Pays d'élection au sein du Bailliage de Tours.
Le cardinal Richelieu jette son dévolu sur Chinon et, non sans
peine, en devient possesseur. Le château reste dans sa famille
jusqu'à la Révolution.
Loches

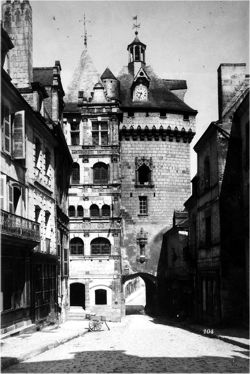
Loches est un petit bourg relais de la
vallée de l'Indre sur le vieux chemin marchand d'Amboise à Poitiers
qui a longtemps concurrencé la voie commerciale d'Aquitaine
partant de Tours ou de Langeais. Très tôt, ce relais semble
avoir été fortifié. Un important chemin saint Jacques emprunte
cette voie commerciale au XIIéme siècle. Loches devient
une petite ville médiévale surmontée du plus ancien donjon d'Europe
construit vers l'an mil par Foulques III Nerra. Le déclin de
cette route du Sud révèle la voie de passage la plus antique
qui emprunte simplement, par l'eau et la terre, la vallée de
l'Indre. La bourgade primitive de Loches est citée par Grégoire
de Tours sous le nom de Lucca ou vicus Loccae.
Le site sous
la dénomination érudite de castrum luceae est déjà occupé par
les Romains qui ont placé la petite cité à la frontière de la
province d'Aquitaine. L'aqueduc romain de Contray, dont des
piliers sont encore debout, témoignent d'une exploitation agricole
antique; enfin le bénitier de la Collégiale saint Ours provient
d'une colonne gallo-romaine dédiée aux dieux de l'Olympe. La
christianisation est marquée par l'établissement au Véme
siècle, d'une église dédiée à sainte Marie-Madeleine, par Saint
Eustache, évêque de Tours. En 491, Ursus de Cahors connu sous
le nom de Saint Ours, implante un monastère dans la partie nord
de l'actuelle cité médiévale et construit un moulin sur l'Indre
pour les moines. À sa mort en 508, Senoch lui succède à la tête
du monastère, il a donné son nom à un village voisin: Saint-Senoch.

Dès l'époque mérovingienne, le toponyme
se simplifie en Lochiae ou lociae, qui engendre la forme tardive
Loches. La bourgade est un centre religieux qui bénéficie d'immunités
régaliennes. Elle semble ainsi disposer très tôt d'un atelier
monétaire. En 742, les maires du palais, Carloman, le fils de
Charles Martel, et Pépin le Bref, qui devient roi des Francs
de 751 à 768, livrent bataille contre Hunald, duc des Gascons
et des Aquitains et s'emparent de Loches.
En 840, Charles
le Chauve nomme Alalande, un de ses lieutenants, gouverneur
de Loches. En 886 a petite-fille Roscille se marie avec Foulque
Ier d'Anjou, apportant notamment Loches en dot au
comté d'Anjou.
Au Xéme siècle, les querelles incessantes
qui opposent les comtes de Blois aux comtes d'Anjou, sont à
l'origine de l'essor du château de Loches qui joue désormais
un rôle prépondérant dans cette lutte de pouvoir. Le comte angevin
Geoffroi Grisegonelle s'établit à Loches et fait reconstruire
l'église collégiale de Saint-Ours. D'abord conçue dans un plan
romano-byzantin, elle adopte des caractères romans au fil des
deux siècles de construction. Son fils Foulques Nerra fait construire
un énorme dominium attestant sa puissance sous la forme d'une
grande tour carrée. Loches faisait partie d'un dispositif militaire
angevin de fortifications encerclant la ville de Tours, objet
de ses convoitises.

C'est son fils, Geoffroi II Martel, qui
mène à terme la construction de cet imposant édifice. En 1195,
après la mort d'Henri II Plantagenêt, seigneur d'Anjou et roi
d'Angleterre et profitant que Richard Cœur de Lion soit retenu
prisonnier en Autriche depuis son retour des Croisades, Philippe
Auguste intrigue avec Jean sans Terre, le frère de Richard Cœur
de Lion et se fait donner Loches. Dès qu'il est libéré, l'impétueux
Cœur de Lion accourt et reprend le château de Loches. Dix ans
après, en 1205, Philippe Auguste prend sa revanche. Le siège
dure un an.
Loches est désormais une place-forte royale qui
peut servir de prison et les rois capétiens qui la confie à
Dreux de Mello, seigneur de la Touraine s'efforcent de la rendre
inexpugnable. En 1249, la seigneurie de Loches passe définitivement
au Domaine royal français après que Saint Louis l'achète avec
celle de Châtillon-sur-Indre pour 600 livres. Jusqu'à la fin
de l'ancien régime, les rois de France ont donné le titre de
lieutenants du roi aux gouverneurs de la place forte de Loches,
et notamment la dynastie des Baraudin, qui se sont succédé tout
au long du XVIIIéme siècle. Les villes de Loches
et de Beaulieu, séparées sur leurs rives respectives gauche
et droite, par de nombreux bras de l'Indre formant une vaste
zone humide, cultivent une féroce rivalité économique. Fin mai
1429, après sa victoire à Orléans, Jeanne d'Arc vient rencontrer
Charles VII pour le convaincre de se faire couronner : «
Noble Dauphin, ne tenez pas davantage tous ces conseils, si
nombreux et si longs, venez donc au plus vite à Reims prendre
la couronne à laquelle vous avez droit. »
Au XVéme
siècle, Agnès Sorel, favorite de Charles VII, habite souvent
dans les châteaux aménagés de Loches et de Beaulieu de 1444
à 1449. Elle abandonne la cour de Chinon, où le Dauphin le futur
Louis XI, lui a créé bien des difficultés. En effet, ce dernier
ne supporte pas la relation d’Agnès avec son père le roi Charles
VII. Il estime que sa mère est bafouée et a de plus en plus
de mal à l'accepter. Un jour il laisse éclater sa rancœur et
poursuit, l’épée à la main, l’infortunée Agnès dans les pièces
de la maison royale. Agnès Sorel se réfugie à Loches et Charles
VII, courroucé par tant d’impertinence, chasse son fils de la
Cour et l’envoie gouverner le Dauphiné.

Après avoir servi de résidence royale,
le château de Loches devient prison d'État sous Louis XI. Le
clergé séculier, du diocèse de Tours, fonde à Loches un collège
en 1576. Vers 1640, ce collège est repris par les Barnabites.
La ville de Loches connaît son âge d'or au XVIe siècle,
la Chancellerie finie en 1551 et l'hôtel de Ville bâti par les
bourgeois de la ville avec l'accord de François Ier
en témoignent. objet de ses convoitises.À cette époque de la
Renaissance, Loches est « égale en dignité à Tours et à Chinon
». Toutefois il faut attendre quelque temps avant la naissance
d'une première vie communale. Charles IX émancipe les bourgeois
et habitants de la tutelle directrice des chanoines de Loches
et accorde à la ville un statut de municipalité désormais dirigée
par un maire et trois échevins. À la veille de la Révolution
française, Loches est en déclin, en partie à cause du Pont royal
de Tours qui a détourné le trafic vers Tours. La population
chute en deçà de 4 000 habitants. En 1789, la prison royale
de Loches ne compte plus que trois prisonniers. Le mouvement
révolutionnaire est suivi par la bourgeoisie et le clergé local.
En 1791, le chanoine Pothier fait brûler la sinistre cage de
La Balue. L'année suivante, la commune élit son premier maire,
le citoyen Picard-Ouvrard. Sous la Convention, la prison lochoise,
considérée comme la plus sûre du département d'Indre-et-Loire,
connaît un regain d'activité : on doit réquisitionner le Logis
royal et les maisons des chanoines, en plus des cachots du donjon,
pour loger tous les détenus.
Selles-sur-Cher
Selles-sur-Cher, situé à 18 kilomètres
au sud-ouest de Romorantin doit son origine à un pieux solitaire
nommé Eusin, qui, dans les premiers temps de l'établissement
du christianisme, se construisit un chétif ermitage en cet endroit.
Le roi Childebert, se dirigeant vers l'Espagne et traversant
cette partie de la Sologne, entendit parler du saint vieillard.
Il alla à lui et lui demanda de prier pour le succès de l'expédition
qu'il projetait.
Childebert fut vainqueur, et ; attribuant
à l'intercession de l'ermite une part dans ses victoires, il
voulut aller lui en témoigner sa reconnaissance. Eusin était
mort. Le roi ne crut pas sa dette acquittée. Sur le tombeau
du saint, il fit construire une belle église à laquelle il ajouta
la fondation d'un monastère. D'autres habitations ne tardèrent
pas à se grouper autour du nouvel établissement et formèrent
avec le temps une petite ville. Les fabriques de draps y eurent
de bonne heure une certaine importance, puisque nous avons vu
l'industrie de Romorantin puiser les premiers éléments de sa
prospérité dans l'émigration des fabricants de Selles.
Les
bâtiments du monastère, occupé d'abord par des bénédictins,
puis par des chanoines et en dernier lieu par des feuillants,
ont été divisés et transformés pour de nouvelles destinations
depuis la révolution de 1789. La vieille église a été respectée,
ainsi qu'un fort beau château, construit à l'une des extrémités
de la ville par Philippe de Béthune, frère du grand ministre
Sully. Ces deux monuments sont les seuls que Selles puisse offrir
à la curiosité du voyageur; mais les grâces du paysage, les
riants aspects des rives du Cher mériteraient séuls une excursion
vers cette intéressante petite ville.
Richelieu

Richelieu, n'était qu'un pauvre village lorsque le cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu, qui y était né le 9 septembre 1585 résolut d'en faire une ville digne de porter son nom. Il confia l'exécution de ses projets à l'architecte Lemercier, et bientôt château, église, rues tirées au cordeau, jardins et fontaines s'élevèrent comme par enchantement. Mais à peine le redoutable ministre eut-il fermé les yeux que la solitude, le silence et plus tard la ruine vinrent envahir cette création splendide, pour l'édification de laquelle il avait fallu détruire des châteaux forts, des villages, une ville même. Tous les trésors entassés dans cette royale demeure furent dispersés par les héritiers mêmes du cardinal, et plus tard la bande noire détruisit le château devenu désert.