Grenoble - Préfecture de l'Isère
Retour
au Département
Retour Ville d'Art et d'Histoire
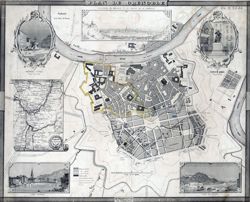

Grenoble C'est l'ancienne Cularo, fondée
en 121 par les Romains, sur les confins des Allobroges, comme le
prouvent
1 - son nom Cularo, lieu reculé
2 - les itinéraires
romains ;
3 - deux inscriptions trouvées sur une des anciennes
portes de la ville.
Cularo, comme toutes les villes du pays des
Allobroges, se gouvernait par ses propres lois. Après la conquête
romaine, les habitants de cette ville furent inscrits parmi ceux
de la tribu Voltinia, à Rome. Alors, quoique fort obscure, elle
avait droit de cité, c'est-à-dire de nommer elle-même ses magistrats,
dont le premier portait le nom de dictateur. Ses finances et celles
de son ressort étaient administrées par un questeur et trois triumvirs
veillaient à l'entretien des routes, dont l'une se reliait à Vienne
et par Vienne à Suse, où elle se rattachait à la grande voie romaine
d'Italie en Gaule ; un messager impérial était chargé de la publication
des décrets. Résidence du tribun militaire de la première légion
Flavienne, Cularo rendait un culte public à Mars, à Mercure, à Vulcain,
à Diane, à Isis, à Juventus et autres divinités que les Romains
lui avaient fait adopter.
Après avoir fait reconstruire les murs
de cette ville, l'an 288, les Romains l'ornèrent de plusieurs édifices.
L'an 379, l'empereur Gratien passa dans les Gaules et dans le voisinage
de la province viennoise où se trouvait Cularo ; il agrandit considérablement
cette ville, à laquelle il donna son nom. Il y fonda un siège épiscopal.
Alors Gratianopolis acquit une certaine importance comme position
militaire. Ses remparts avaient 4 à 5 mètres d'épaisseur sur 7 mètres
de hauteur ils étaient flanqués, au dehors, de tours demi-circulaires
très rapprochées ils commençaient au nord, près de l'Isère, vers
le pont de bois; ils embrassaient la place Notre-Dame, la cathédrale,
dont le chœur est assis sur un fragment de ces murs la place des
Tilleuls, les jardins du Doyenné, le couvent de Sainte-Claire, l'extrémité
nord de la rue Pertuiserie, la rue des vieux Jésuites, l'extrémité
sud de la grande rue de l'hôtel de ville, où l'on voit encore une
de leurs anciennes tours. Quant aux quartiers situés sur la rive
gauche de l'Isère, il paraît qu'ils n'avaient de murailles qu'aux
deux extrémités, où étaient les portes de Saint-Laurent et de la
Perrière
Sous la domination des Bourguignons, cette ville subit
les vicissitudes de la guerre. Assiégée, en 570, par les Lombards,
elle dut sa délivrance à Mummol, chef bourguignon. Après la chute
du royaume de Bourgogne, elle passa au pouvoir des Francs. Charlemagne,
allant en Italie au secours du pape Étienne, traversa Gratianopolis
; il y fit bâtir le palais épiscopal et une église. Retombée sous
le joug des Bourguignons, prise, vers 954, par les Hongrois, délivrée
par l'évêque Isarn, elle devint la capitale d'un petit État indépendant,
dont le premier souverain fut Isarn. Sous la suprématie de cet évêque,
un conseil de magistrats élus par le clergé, le peuple et l'armée,
gouvernaient la seigneurie, qu'Isarn transmit avec tous ses droits
royaux, en 976, à l'évêque Humbert. Celui-ci ajouta à ses domaines
plusieurs autres possessions ; mais son successeur Mallenus s'en
laissa dépouiller en partie, dans l'anarchie féodale qui suivit
la mort de Rodolphe, par un seigneur connu sous le nom de Gui le
Vieux, comte d'Albon, plus tard comte de Graisivaudan et prince
de la province de Grenoble en 1050. Cependant, malgré cette déchéance,
les évêques, sous les dauphins, conservèrent une ombre de souveraineté
temporelle. C'est ainsi que le seigneur de Sassenage et le comte
de Savoie relevaient de leur siège ; le dauphin lui-même rendait
hommage à l'évêque pour tout ce qu'il tenait dans sa ville et dans
son territoire en fief et en juridiction commune.
Il y avait
à cette époque, dans la vallée, près du Bourg-d'Oisans, un lac qui
en occupait toute la superficie et s'étendait même, suivant la tradition,
jusqu'aux montagnes de Venosc. Ce grand lac avait été probablement
formé des eaux de la Romanche en 1219, il inonda en se dégorgeant
la ville de Grenoble et ses environs. Ce fut le 15 septembre, au
commencement de la nuit, que, suivant l'expression de Jean de Sassenage,
arriva ce déluge. Ainsi surpris par le fléau, les habitants se réfugièrent
dans les églises, sur les tours, les clochers et les toits les plus
élevés. D'autres coururent vers le pont de l'Isère ; mais, comme
la porte en était malheureusement fermée, le plus grand nombre y
périt submergé par les eaux qui se jetaient sur la ville. Après
qu'elles se furent retirées, l'Isère, dont elles avaient interrompu
le cours, le reprit, mais avec une impétuosité telle qu'elle renversa
le pont et la plus grande partie des maisons de la ville.
C'est
aux avantages de sa position militaire que Grenoble devait son rang
de capitale du Dauphiné; car Vienne et Valence y avaient plus de
droits qu'elle par leurs souvenirs.
Colonie romaine d'abord,
puis fortifiée par les empereurs ; rendez-vous ordinaire des papes
et des rois francs lorsqu'ils eurent à conférer sur les affaires
de l'Église et de l'empire ; résidence de l'empereur Lothaire, en
847 ville forte au moyen âge, elle était gouvernée par une curia
communis, choisie conjointement par l'évêque et le comte. Humbert
II, en 1339, en réorganisa l'université et y fixa le siège du conseil
judiciaire d'abord établi à Saint-Marcellin. En 1349, Après la cession
du Dauphiné à Charles, petit-fils de Philippe de Valois, ce prince
vint à Grenoble, et y jura sur les saints Évangiles de maintenir
les privilèges de la province.
Avant ce temps, il y avait eu
de grands débats entre les évêques et les dauphins; et comment en
eût-il été autrement, ayant chacun leur juridiction? Cependant Humbert
II avait essayé de remédier à cet état de choses en établissant,
par un statut de 1337, une cour de justice qui mit tout le Dauphiné
sous une même loi. A peine cette cour instituée, l'évêque protesta,
se plaignant qu'elle anéantissait sa juridiction et constituait
le dauphin arbitre général de toutes les justices des seigneurs
et de celle de sa ville épiscopale en particulier. On passa outre
; mais les évêques, non moins attachés à leurs prérogatives temporelles
qu'à leur siège, ne cessèrent de réclamer et d'entraver le pouvoir
civil. En 1378, Rodolphe Chissay, entre autres, ayant accusé de
concussion Bouville, gouverneur du Dauphiné, celui-ci y répondit
en faisant attaquer la maison de l'évêque. Rodolphe parvint à s'échapper
et à gagner la Savoie.
C'est à Grenoble que Louis XI fit comme
Charles V, l'apprentissage de la royauté. Il y réorganisa les états
; il en fixa le siège dans cette ville, et en déféra la présidence
à l'évêque, à son défaut à l'abbé de Saint-Antoine. Il reconstitua
la municipalité et octroya aux habitants de nouveaux privilèges.
Par édit du 18 juillet 1453, il déclara qu'ils « ne pourroient jamais
être distraits de la juridiction de leur juge particulier, pas même
pour cause de crime. » Il régla la composition du conseil de ville
les quatre consuls sortants, deux députés du tiers, deux gentils
hommes, deux députés du clergé, deux juges politiques, l'avocat
et le procureur de la ville, tels étaient les membres de ce conseil,
qui devait se renouveler chaque année par voie d'élection. Il les
exempta des tailles pendant la durée de leur magistrature.
Ainsi
déjà se révélait cette politique qui devait abaisser la noblesse
au profit du tiers état. Ce prince fit plus : sujet à des crues
subites, le Drac avait souvent submergé la plaine et la ville, il
fit construire des chaussées destinées à le contenir, il jeta, enfin,
les fondements du palais de justice. Cependant, l'état d'hostilité
dans lequel il vivait avec son père le forçant à être sur le pied
armé, il voulut, pour solder ses troupes, prélever sur chaque feu
une taxe de deux gros. De là murmure, et par suite révolte du peuple.
Alors, éloigné de sa capitale, le dauphin, d'intelligence avec l'évêque,
essaya d'y rentrer par surprise ; mais sa tentative fut vaine. Apprenant
que le comte de Dammartin, lieutenant du roi, s'avançait contre
lui en Dauphiné, il se retira en Savoie.
Plus tard, quand il
monta sur le trône, il se souvint de ses amis et de ses ennemis,
et Jean Bayle, président du parlement grenoblois, fut exilé.
Dans le voyage qu'il fit en Dauphiné au commencement du XVème
siècle, l'empereur Sigismond séjourna dans cette ville avec sa suite.
Visitée par Charles VIII en 1489 et en 1494, par Louis XII en 1502,
1507 et 1511, par François Ier en 1529, par Henri II
en 1548, le 20 janvier 1515 elle avait reçu solennellement le chevalier
Bayard à son retour des guerres d'Italie. Le peuple s'était porté
à sa rencontre, et des coups de canon furent tirés en signe de joie.
Le 30 avril 1524 le chevalier Bayard meurt près de Rovasenda., toute
la ville le pleura « et pendant un mois, dit Expilly, les fêtes
cessèrent. » Son corps fut transporté à Grenoble, où il fut enterré
dans l'église des Minimes.
Après avoir obtenu du pape Benoît
XII la fondation d'une université à Grenoble, Humbert II, par l'édit
de 1339, avait statué qu'on y enseignerait le droit civil, le droit
canonique, la médecine et les arts. Humbert, par le même édit, octroyait
aux élèves certains privilèges, entre autres l'exemption du service
militaire et la suppression de toutes les forges qui existaient
dans un rayon de trois lieues aux environs de la ville, afin de
prévenir par-là, disait-il, renchérissement du bois ; clause singulière,
au sujet de laquelle Chorier fait remarquer que le froid est ennemi
des fonctions de l'esprit. « Jusqu'en 1546, dit Berriat-Saint-Prix,
les professeurs grenoblois, quoique réduits aux rétributions des
grades, continuèrent seuls ce qu'on nommait les lectures ; mais,
cette année, ils éprouvèrent un obstacle singulier, qui donne une
idée des mœurs du temps. C'est dans le grand réfectoire et dans
l'une des chapelles des cordeliers que se faisaient ces lectures,
ceux-ci les ayant cédés à la ville à titre de prêt; mais, ajoute
le même auteur, comme chaque année ces religieux, sous prétexte
de pauvreté, demandaient au conseil de la ville et en obtenaient
une aumône, le conseil pensa sans doute que le prêt du réfectoire
et de la chapelle était, au fond, un louage dont il avait le droit
de requérir l'exécution et, de leur côté, les cordeliers ne voulaient
pas admettre ce droit. » A la Saint-Luc, c'est-à-dire au 18 octobre,
que rouvraient alors les études, les membres de l'université se
présentèrent aux portes du réfectoire et de la chapelle qu’ils les
trouvèrent fermées. Vainement les avocats et les consuls vinrent
prier les cordeliers de les ouvrir, les moines s'y refusèrent obstinément.
Alors le conseil arrêta qu'on irait sur-le-champ occuper, par force
ou autrement, le grand réfectoire. Aussitôt peuple et escholiers
'se portent en foule au couvent et forcent l'entrée du réfectoire.
Les cordeliers quoique surpris se défendent en gens de cœur les
bancs et la chaire volent en éclats ; les escholiers se battent
bravement, mais les moines restent maîtres du champ de bataille.
Alors les assaillants retournent au conseil, disant que les moines
ont fait grande résistance tant de parole que de faict, et ung cordelier
nommé frère Fiquet s'est touvés saignant par le front, ne sait-on
pas quel moyen. Peu touché de la blessure de frère Fiquet, le
conseil soumit l'affaire au parlement ; mais les parties s'étant
rapprochées, les moines rouvrirent leurs portes, et l'université
rentra en possession de sa chaire. Cependant sa fortune déclina
rapidement dans les guerres civiles qui l'agitèrent.
Un édit
de 1565 la réunit à l'université de Valence, qui, grâce à la protection
de Montluc et aux savantes leçons de Cujas et de Scaliger, jouissait
d'une grande renommée.
Après les guerres féodales, les guerres
religieuses. On sait que le massacre de Vassy survenu le Ier
mars 1562 fut le signal du soulèvement des protestants en Dauphiné.
Cependant, s'ils étaient en majorité à Valence, ils étaient en minorité
à Grenoble. C'est dans la maison d'un notaire et d'un marchand qu'avaient
eu lieu les premiers prêches. A la vue des progrès que les idées
nouvelles faisaient dans la ville, les consuls et les membres du
parlement, presque tous catholiques, avisèrent le parlement fit
dresser, dans les rues, sur les places et dans les carrefours, des
potences pour contraindre les calvinistes par la terreur ; mais
les succès du baron Adrets dans le Midi, dans le Vivarais et dans
le Viennois changèrent la face des choses. Des Adrets, étant à Valence,
fit signifier aux consuls de Grenoble d'avoir à « s'absenter de
la présente cité dans les vingt-quatre heures, sous peine d'être
pendus et estranglés. » Mais les consuls avaient déjà prévenu cet
ordre par la fuite. Bientôt l'un des capitaines du terrible baron,
Pierre de Theys, fit son entrée dans la ville les protestants se
ruèrent sur les églises ; ils n'épargnèrent ni la cathédrale ni
la chapelle delphinale de Saint-André les autels furent abattus,
les tombeaux des anciens dauphins de Viennois violés, les statues
des saints brisées jusqu'à l'image de saint Christophe qu'on traîna
par les rues de la ville, suivant l'expression d'un témoin oculaire,
irrévéremment et avec plusieurs insolences. Quant aux vases d'or
et d'argent, on les envoya, par ordre de des Adrets, à Valence,
pour y être fondus en testons du roi morveux, sorte de monnaie ainsi
appelée vulgairement à cause d'un trait que l'effigie du roi Charles
IX avait au-dessous du nez. Cependant Maugiron, lieutenant général
du Dauphiné, se fit ouvrir les portes de la ville, en 1562 ; mais
des Adrets ne tarda pas d'y rentrer à la tête de six mille hommes
qu'il logea chez les habitants. Il défendit aux catholiques l'exercice
de leur culte, et força le parlement à assister au prêche, sous
peine, pour chacun des membres, d'une amende de 1,600 livres. Plusieurs
eurent le courage de la payer, mais le plus grand nombre se rendit
au prêche, c'était les mettre dans une trop pénible alternative.
Deux lieutenants de Maugiron essayèrent, mais en vain, de reprendre
la ville. Maugiron lui-même y échoua en 1565. Cependant la paix
le remit la place sous la main du roi.
A la reprise des hostilités,
les protestants cherchèrent à s'en emparer de nouveau mais cette
fois ils furent moins heureux, quoique sous la conduite de deux
vaillants chefs, Montbrun et Lesdiguières. Après la mort de Montbrun,
Lesdiguières prit le commandement de la province et continua les
hostilités.
Catherine de Médicis tenta vainement de le gagner
: dans une entrevue qu'elle eut avec lui à Grenoble, en 1579. A
la mort de Henri III, Lesdiguières s'empara de Grenoble, où la Ligue
avait trouvé un parti puissant. Après avoir fait triompher dans
tout le Dauphiné la cause de Henri IV, et pacifié le pays par sa
sage administration, ce grand capitaine mourut en son château de
Vizille, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Cependant, la révocation
de l'édit de Nantes vint porter un coup mortel à cette ville, en
la dépeuplant d'un tiers de ses habitants.
Sous le règne de Louis
XV, le parlement dauphinois se signala par sa résistance aux édits
royaux, en défendant les libertés et les privilèges de la province.
Cœurs généreux, esprits fiers, caractères indépendants, noble race
entre toutes, tels étaient les Allobroges, tels sont encore leurs
descendants. C'est, en effet, dans les luttes nationales qu'à l'exemple
de leurs ancêtres les citoyens de Grenoble se signalèrent par leur
courage. Ils prirent, en 1788, l'initiative de la Révolution.
Après le célèbre lit de justice où les parlements furent supprimés,
et la cour plénière rétablie, les premiers ils s'armèrent pour la
défense des lois et des libertés publiques. C'était le 7 juin 1788,
les membres du parlement grenoblois venaient d’être arrachés de
leurs sièges par la force armée. Aussitôt les habitants s'insurgent
et livrent combat aux troupes massées dans les rues, pendant que
d'autres, du haut des toits, font pleuvoir sur elles une grêle de
tuiles, Déjà l'hôtel de ville est en leur pouvoir, quand, toutes
les cloches sonnant le tocsin, les habitants des faubourgs et les
montagnards arrivent et se joignent aux insurgés. Bientôt les soldats
refusent d'agir, et le commandant lui-même est contraint de capituler.
Telle fut cette journée, prélude du i4 juillet, et qu'on appela
la Journée des tuiles.

Plus tard, Napoléon, revenant de l'île d'Elbe,
trouva près de Grenoble la route barrée par sept ou huits cents
soldats, avant-garde d'un corps de six mille hommes que le gouvernement
royal rassemblait dans cette ville. « Napoléon, disent Messieurs.
Ferrand et Lamarque dans leur Histoire de la Révolution française,
envoya un de ses officiers d'ordonnance vers la colonne royale,
avec l'ordre de le faire reconnaître ; mais celui-ci dut se retirer
devant la menace qui lui fut faite de tirer sur lui, s'il insistait.
Alors Napoléon descendit de cheval et, s'avançant vers les troupes
royales « Soldats du 5ème de ligne, s'écria-t-il, s'il
en est un parmi vous qui veuille tuer son général, son empereur,
il le peut, me voilà 1 ! » A ces mots, il n'y eut qu'un cri parmi
les deux troupes. Après s'être réunies, elles se mirent en marche.
Napoléon entra dans Vizille, salué par les acclamations des habitants
et des paysans accourus des campagnes voisines. De Vizille il se
dirigea sur Grenoble. A la nouvelle de son approche, l'autorité
avait fait fermer les portes de la ville ; mais le peuple les fit
voler en éclats, et vint en offrir les débris à l'empereur. Son
entrée dans cette ville fut un véritable triomphe. Après Waterloo,
le 6 juillet 1815, assiégée par les armées alliées, Grenoble leur
opposa une résistance héroïque. C'est ainsi qu'elle eut la gloire
de tirer le premier et le dernier coup de canon pour l’indépendance
nationale, dans cette grande et mémorable campagne de 1789 à 1815.
Après tant de vicissitudes, la cité dauphinoise commençait à
reprendre son calme et sa prospérité, quand tout à coup, dans la
nuit du 4 au 5 mai 1816, éclata la conspiration bonapartiste qui
avait pour chef Paul Didier. Cette conspiration échoua, ceux des
insurgés qui furent pris comparurent devant la cour prévôtale, qui
les condamna à être passés par les armes, au champ de Mars. Didier
fut exécuté le 10 juin sur la place Grenette. Depuis ces journées
sanglantes, rien n'est venu troubler le repos de cette belle et
intéressante ville.
Grenoble est dans une situation charmante.
Propre, assez bien bâtie, elle s'élève dans la vallée de Graisivaudan,
au pied de hautes et belles montagnes, et sur l'Isère, qui la divise
en deux parties inégales l'une très resserrée entre la rivière et
la montagne, et ne formant qu'une seule grande rue ; l’autre, sur
la rive gauche de l'Isère large, spacieuse, quais magnifiques, rues
pavées en dalles elle s'étend dans la plaine et se nomme le quartier
de Bonne, du nom du connétable de Lesdiguières, qui l'agrandit,
l'embellit et la fortifia en 1191. Sa maison sert aujourd'hui d'hôtel
de ville ; la façade sur les jardins en est fort belle. La plus
ancienne église de Grenoble est celle de Saint Laurent sa cathédrale
Notre-Dame n'a pas de caractère : c'est un produit de toutes les
périodes archéologiques. Par sa position au confluent de deux rivières,
l'Isère et le Drac, cette ville ne pouvait que devenir considérable.
Au XVIème siècle, elle avait pour citadelle la Tour de
Rabot et la Bastille ; elles subsistent encore, mais tellement agrandies
et fortifiées, qu'elles font de Grenoble une place inexpugnable.
C'est le boulevard de la France du côté des Alpes. Cette forteresse
couronne la montagne qui domine la ville elle s'élève à 200 mètres
au-dessus de l'Isère, se compose de plusieurs étages de casemates
et de batteries, et couvre un mamelon séparé du mont voisin par
de profondes tranchées.

De ce point on peut prendre une idée
juste de la situation de la ville avec ses dix portes, dont deux
sur la rive gauche de l'Isère, la porte Saint-Laurent et la porte
de France, et les autres sur la rive droite celles de Créqui, Bonne,
-des Alpes, Très-Cloître, des Adieux, etc. L'œil plonge dans les
environs et même sur toute la vallée du Graisivaudan il suit le
cours de l'Isère et du Drac à travers les campagnes qu'ils fertilisent
il les voit se joindre au-dessous de la ville, qui se déploie dans
la vallée au pied de montagnes couronnées de rochers chargées de
neige. Par-dessus leur sommet s'élève la majestueuse cime du mont
Blanc.
A l'extrémité de la ville, sur le bord de l'Isère, on
remarque l'Arsenal, qui forme une autre espèce de citadelle. Sur
la place Grenette jaillit une fort belle fontaine elle se compose
d'un triple rang de bassins, dont le second, d'un seul bloc de marbre
de Sassenage, est soutenu par quatre groupes d'Amours portés par
des dauphins, œuvre du sculpteur dauphinois Sappey. Celles de la
place de la Cathédrale et de la place Saint-Louis ne sont pas moins
remarquables la dernière est ornée d'un obélisque supporté par quatre
sphinx d'un très bel effet.
Sur la place Saint-André s'élève
la statue de Bayard mourant. Citons encore la statue de Vaucanson
sur la place de ce nom ; le palais de justice, élevé par Louis XI
sur une partie de l'emplacement de l'ancien château des dauphins
le palais épiscopal, l'hôpital général.; le cours du Mail, promenade
charmante plantée de marronniers, dont le plus gros porte le nom
de Lesdiguières; le Jardin des plantes, le Jardin de ville, l'hôtel
de la préfecture; la bibliothèque, riche de 80 000 volumes et de
4 200 manuscrits; le musée, l'un des plus beaux de province; etc.
Avant la Révolution, il y avait près de cette ville un monastère
connu sous le nom de Montfleury, fondé pour des religieuses dominicaines
par le dernier dauphin, Humbert II, en 13-42: Ce prince leur abandonna
un de ses châteaux, dont elles firent leur habitation. Dans l'origine,
elles étaient toutes nobles, et le nombre fut porté jusqu'à cent
au XVIème siècle, il fut réduit à soixante-dix. Aujourd'hui,
ce couvent est occupé par les Dames du Sacré-Cœur.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.