Mont de Marsan - Préfecture des Lande
Retour
au Département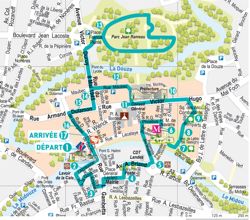

Mont de Marsan (Martianum, Mons Martiani)Les
débris d'un vieux temple de Mars, qui se voyaient sur la colline
qui domine le confluent de la Douze et de la Midou, out fait
donner le nom de Mont-de-Marsan à la ville qui s'éleva en cet
endroit. Cette ville doit son origine à Charlemagne, d'après
une vieille charte romane manuscrite. A son retour de sa malheureuse
expédition d'Espagne, ce monarque, passant par le pays des Landes
et voulant établir sa puissance dans ces contrées récemment
bouleversées, y créa, sous le nom de proconsulies, plusieurs
divisions administratives.La charte dit « Il forma aussi
la proconsulie de Marsan et lui bâtit une capitale le long de
la Douze et de la Midou, sur les ruines du temple ou de la citadelle
de Mars.» Charlemagne avait fortifié Mont-de-Marsan et l'avait
remplie d'hommes de guerre. Sans doute son dessein était de
l'opposer, comme une défense, aux attaques qui venaient soit
des Pyrénées, soit de l'Océan.
En 841, les Normands remontèrent
l'Adour et la Midouze, probablement plus navigable alors qu'aujourd'hui,
et assiégèrent la place. Le seigneur Déodat de Lobanner s'y
était enfermé avec des troupes nombreuses. Il fit avec succès
plusieurs sorties et brûla la flotte des pirates. Mais ceux-ci
finirent par s'emparer de la ville, la détruisirent, en dispersèrent
les débris et promenèrent la charrue à la place qu'elle avait
occupée. Au reste, leur victoire, déjà si vaillamment disputée,
fut encore payée cher par eux pendant la retraite, et il faut
convenir que peu de provinces de France déployèrent autant de
courage contre les terribles enfants de la Scandinavie. Attaqués
en chemin par le fils de Lobanner, puis par le duc de Gascogne
et le comte de Bigorre, ils perdirent une partie de leurs guerriers
et de leur butin.
Mont-de-Marsan avait disparu pour trois
siècles. Des forêts sauvages recouvraient son territoire, et
les ravages des brigands qui s'y réfugiaient avaient fait donner
à ce lieu le surnom de Maïï-Pas(mauvais pas). La famille de
Lobanner s'était retirée au château de Roquefort, et ce ne fut
qu'en 1141 qu'elle eut enfin l'idée de reconstruire la ville
anéantie par les Normands. Un certain Bérenger de Cantaloup
était en possession du territoire, et Pierre de Lobanner fut
obligé d'en acheter la cession, comme l'atteste un contrat écrit
en langue romane et dont voici la traduction :

« Moi, vicomte, dit Pierre de Lobanner,
j'ai résolu de rebâtir le chef-lieu de la vicomté, et cé serait
vraiment une honte si cet établissement avait lieu sur d'autres
terres que celles qui ont été désignées par l'empereur Karl.
Je viens donc à vous, requérant la vente des terres du Cap-de-Mards,
c'est-à-dire toute l'étendue du terrain d'en bas, depuis les
paroisses de Nonères, de plus le terrain de Bésart, compris
entre les rives de la Douze et du Midou, à droite et à gauche
jusqu'à leur jonction avec les jardins les trois habitations
qu'ils renferment, les ruines de la citadelle de Mards, que
les Normands ne purent enlever; en y ajoutant les terres au
midi, de l'autre côté du Midou, avec les grandes fontaines,
les cinq habitations, les jardins dans le bas, depuis l'extrémité
du terrain de Bésart, au nord des rigoles du Mont-Saint-Pierre;
y' compris encore les terres d'en bas de l'autre côté de la
Douze, exposées au midi, depuis la fontaine de la Dreyre jusqu'à
la jonction de la Douze et du Midou. »
A quoi Cantaloup
répond « Nous faisons serment que, n'étant en rien ni contraint,
ni déçu, ni trompé, ni foué, ni trahi, ni par crainte, ni par
mauvaise circonvention, ni machination à ce faire amener ni
conduit ; mais de notre spontanée liberté et science certaine
le faisons, et cela pour tous nos hoirs à venir, nos successeurs
et toute notre lignée pour les siècles des siècles, et ainsi
avons laissé, abandonné, résigné, et à vous, notre vicomte,
transporté aujourd'hui en légale donation lesdites terres de
Mars, et à votre mandement, notre puissant seigneur, nous vous
en faisons possesseur. »
En prenant possession du territoire
concédé, Pierre de Lobanner prononça ces paroles solennelles
« J'atteste votre âme, ô empereur Karl, que, voulant réédifier
cette ville au même lieu où vous l'aviez bâtie, en faveur du
premier de notre race, je le fais par gratitude et en votre
honneur, comme bienfaiteur de notre lignée. Que le Dieu tout-puissant
tienne aussi votre âme en sa paix, notre auteur Déodat de Lobanner
nous attestons que voulons rebâtir cette cité dans l'endroit
même où la renommée vous proclamera dans tous les siècles, à
cause de vos travaux merveilleux dans les terres étrangères
qui possèdént vos os. Les larmes de vos fils ne les accompagnèrent
pas au tombeau, mais votre lignée et les hommes de Marsan les
auront en mémoire éternelle. Soyez en paix, Déodat ! » Et
tous les habitants, le genou en terre, se sont écriés Soyez
en paix, Déodat « Cela dit, nous avons jeté dans les airs,
en signe de saisine, quatre poignées de terre, la première au
levant, l'autre au midi, la troisième au couchant et la dernière
au nord. Puis, dans les parties qui furent incendiées, nous
avons creusé la terre et nous y avons mis des pierres, des charbons,
des monnaies marquées, des réaux d'or et d'argent, ainsi que
des vicomteaux noirs, et le tout de nos propres mains aplani.
»

Peu de villes ont été fondées ou rebâties avec plus d'authenticité et de solennité. Celle-ci recruta ses habitants parmi ceux des bourgs de Saint Pierre et de Saint-Genès, qui descendaient eux-mêmes de l'ancienne population de Mont-de-Marsan. Cette émigration amena une rivalité entre l'abbé de Saint-Sever et l'évêque d'Aire. L'abbé, de qui dépendait le bourg de Saint-Genès, prétendait à la possession de l'église de Mont-de-Marsan ; l'évêque y prétendait en vertu de ses droits épiscopaux. Ils s'accommodètent tous deux au concile de Nogaro, où l'évêque se désista moyennant 130 sols morlâs. En même temps qu'il rebâtissait la ville, Pierre de Lobanner restaura l'ancienne abbaye de Saint-Jean de-la-Castelle. Il éleva aussi un fort pour protéger le Maii-Pas, qui cessa dès lors de mériter son nom.
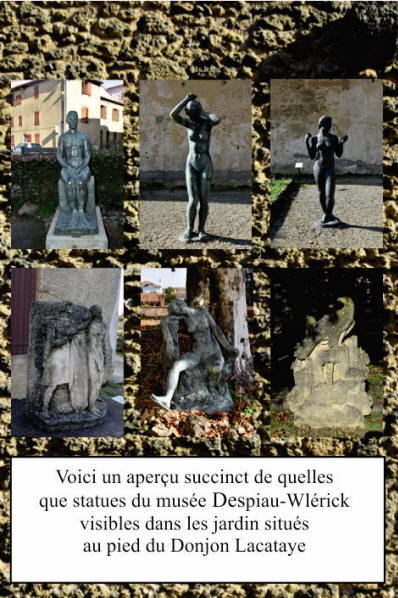

Installé depuis 1968 dans le « Donjon
Lacataye », ancienne "Caserne Lacaze [du nom d'un maire de notre
ville Antoine Lacaze (1803-1891) qui fit don, en 1860 de cette
bâtisse pour y loger une caserne], le musée porte le nom des
deux plus célèbres sculpteurs montois : Charles Despiau (1874-1946)
et Robert Wlérick (1882-1944).
Plus de 600 œuvres des artistes
de l'entre-deux-guerres font de ce musée la référence française
de la sculpture figurative.
Le bâtiment d'accueil du musée
(une ancienne chapelle), lui aussi édifié en pierres coquillières,
fait apparaître, sur sa façade orientale, une superbe rosace,
et il est décoré de verrières dues au maître-verrier d'Anglet,
Jean Lesquibe (1910-1995).
Plus tard, Gaston-Phoebus, comte de Béarn,
héritier des Lobanner, en fit construire un autre pour contenir
l'humeur, à ce qu'il paraît, trop remuante des habitants et
le baptisa Nou li bos (Tu ne l'y veux pas), à peu près
comme Anne de Bretagne nomma sa fameuse tour Quiquengrogne.
C'est lui aussi qui fonda, en 1270, de concert avec sa femme
Amate, le couvent de Beyries ou de Sainte-Claire, auquel il
concéda de nombreuses redevances sur la ville et le pays environnant.
L'histoire de Mont-de-Marsan est peu féconde en faits importants.
En 1268, il s'y tint une assemblée de seigneurs et d'évêques
qui ratifia et fit exécuter les donations promises à Constance,
fille de Gaston, lorsqu'elle avait épousé Henri d'Allemagne.
Au XVIème siècle, François Ier vint à
Mont-de-Marsan c'est là, le 6 juillet 1530, dans l'église du
couvent de Sainte-Claire, qu'il épousa Éléonore de Portugal.
C’est là que ses enfants, retenus en otage par Charles-Quint,
lui furent rendus, là enfin qu'il connut Mademoiselle d'Heilly,
si célèbre plus tard sous le nom de duchesse d'Étampes. Mont-de-Marsan
eut dans le même siècle une autre visite royale Jeanne d'Albret,
qui se rendait dans le Béarn pour y aller faire ses couches,
s'arrêta dans cette ville en 1553. Les habitants lui offrirent
une barrique de vin. Plus tard, se souvenant de ce bon accueil,
elle leur accorda toutes sortes de franchises et confirma leurs
coutumes, qui les exemptaient de tout impôt que les états n'auraient
pas consenti.
Ce n'était pas là le seul avantage que ces
coutumes procurassent aux citoyens de Mont-de-Marsan. Leurs
maires et leurs jurats avaient eu de tout temps la connaissance
des crimes et exerçaient, la justice haute, moyenne et basse.
Leur charte, publiée en 1604, leur reconnaît le droit de faire
des règlements de police, de convoquer les habitants sans attendre
le commandement du roi et du vicomte, afin de s'imposer à volonté.
Les calvinistes étaient-nombreux à Mont-de-Marsan. De bonne
heure ils prirent les armes, brûlèrent les croix et les images
et détruisirent les couvents.

Les religieuses de Sainte-Claire, voyant
leurs murs escaladés, n'eurent que le temps de se sauver avec
les reliques et les objets sacrés. Leur monastère fut brûlé
et démoli. Quand la paix de 1563 fut rompue, ce furent les catholiques
qui prirent l'avantage sous la conduite du seigneur de Ravignan.
Les protestants furent emprisonnés. Relâchés peu de temps après
par le lieutenant du roi, ils recommencèrent leurs violences,
si bien que le sénéchal Flamarens vint en personne occuper le
château. Pour faire-cesser les querelles religieuses, Henri
de Navarre, dès 1578, donna aux habitants un règlement conforme
aux principes de tolérance d'après les quels il donna plus tard
à toute la France l'édit de Nantes. « Ayant égard, y est-il
dit, au nombre des habitants d'une et d'autre religion, ordonnons
que les principaux d'entre eux, convoqués par le maire et les
jurats, éliront trente personnages des plus idoines, capables
et qualifiés qui se trouveront en ladite ville, tous natifs
et originaires d'icelle, si faire se peut, dont les vingt seront
catholiques et les dix de la religion réformée, lesquels trente
seront qualifiés conseillers de la ville et feront l'office
des affaires qui se traiteront à la maison commune, leur vie
durant. Ces conseillers présenteront douze candidats, dont huit
catholiques et quatre protestants ; les jurats nommeront parmi
eux le maire, mais il doit être confirmé par le roi. » Ce
règlement fut renouvelé en 1584 avec quelques dis- positions
nouvelles. L'une d'elles établissait que le père et le fils,
le beau-père et le gendre, les deux frères ne pouvaient siéger
ensemble parmi les jurats, une autre condamnait à vingt sols
d'amende le maire et les jurats qui ne se rendraient pas exactement
à l'assemblée au son de la cloche.
Le dernier acte des guerres
religieuses, sous Louis XIII, fut fatal à Mont-de-Marsan comme
à bien d'autres villes. Les protestants s'en étaient emparés.
Les troupes royales arrivèrent et se rendirent maîtresses du
château, qui fut démoli par l'ordre du roi. Au reste, les habitants
tenaient peu, ce semble, à la force de leur cité, car ils prêtèrent
eux-mêmes leurs bras à ce travail et remplacèrent leur citadelle
par une promenade. Ils furent encore entraînés un instant dans
la révolte pendant la Fronde ; mais, dès que le comte de Raillac
parut dans leur ville, ils jurèrent fidélité à la cause royale.
Bientôt ils accueillirent dans leurs murs le monarque, dont
l'autorité triomphait par toute la France. Louis XIV revenait
de Saint-Jean-de-Luz accompagné de Marie-Thérèse, dont il venait
de recevoir la main.
Au commencement du XVIIème
e siècle, la vicomté de Mont-de-Marsan était devenue pays d'états,
et l'assemblée se réunissait à Mont-de-Marsan. Outre ce changement
tout à son avantage, cette ville en subit quelques autres dans
sa constitution. Ceux qui furent opérés sous Louis XIII ne paraissent
pas avoir été dirigés contre les libertés municipales. Au contraire,
le maire devint électif et annuel; les officiers municipaux
ne purent être réélus qu'après quatre ans d'intervalle, dispositions
qui ne sembleraient pas indignes d'une république du moyen âge
et qu'on ne rencontre pas sans quelque étonnement sous le gouvernement
de Richelieu. Mais il faut reconnaître que Richelieu ne s'attaqua
guère qu'aux choses qui menaçaient le pouvoir royal d'un véritable
danger, l'indépendance des seigneurs et des provinces, les murs
des villes et les châteaux forts. Il se montra moins hostile
aux inoffensives institutions municipales, dont la royauté n'avait
rien à craindre.
Louis XIV alla plus loin son pouvoir n'ayant
plus d'ennemis sérieux à combattre à l'intérieur, il poursuivit
par instinct, jusque dans le moindre détail, tout ce qui offrait
quelque apparence de liberté et mit sous sa main tout ce qui
n'émanait pas directement de sa puissance. C'est ce qu'il fit
à Mont-de-Marsan lorsqu'il transforma en charges vénales et
héréditaires les fonctions jusque-là temporaires et électives.

Le dernier acte de l'ancienne municipalité
de Mont-de-Marsan dont nous ayons connaissance est la demande
qu'elle fit au gouvernement d'être autorisée à détruire ses
murs, dont l'étroite enceinte ne pouvait plus contenir aisément
sa population augmentée. Ce fut le maréchal de Montrevel qui
fut chargé de répondre, et nous avons sa lettre datée de 1726.
« Votre ville, messieurs, écrivit-il, est trop ouverte de tous
côtés pour que le service du roi puisse être intéressé en vous
permettant de faire l'ouverture que vous demandez depuis la
tour du château jusqu'au jardin du sieur de Prugne, puisque
cela pourra contribuer à diminuer les maladies que le défaut
de promenades pour prendre l'air vous procure, à ce que pensent
trois médecins et vos habitants. Vous pouvez donc vous donner
ce soulagement. » Les murailles furent ouvertes aussitôt, et
l'on fit des plantations qui formèrent la gracieuse promenade
connue sous le nom d'Allées Montrevel. C'est dans ces allées
que fut célébré, le 14 juillet 1790, autour d'une immense table
en fer à cheval, le banquet patriotique en l'honneur de l'anniversaire
de la prise de la Bastille. Mont-de-Marsan était devenu alors
le chef-lieu du département des Landes.
Pittoresquement situé
au milieu de bois de pins et de landes, au pied d'un coteau
sur lequel s'élève la gare, Mont-de-Marsan est le centre commercial
du pays, comme il l'était autrefois. Aujourd'hui, comme il y
a deux siècles, c'est l'entrepôt des vins et des eaux-de-vie
de l'Armagnac, et une route nouvelle a même facilité ses communications
avec ce pays. Elle reçoit aussi les vins et les blés de la Chalosse,
les bois et les résines des Landes. Par la Midouze, dont le
lit a été amélioré de nos jours, et surtout parle chemin de
fer, elle communique avec Bordeaux, Dax et Bayonne ; par ses
belles routes plantées d'arbres de haute futaie, avec Roquefort,
Tartas, Aire et Saint-Sever. On s'étonne après cela qu'une ville
si avantageusement partagée ne compte pas beaucoup plus de 9,310
habitants. D'un autre côté, on se demande comment une ville
si peu peuplée a pu se pourvoir de si nombreux établissements
d'utilité publique, qui en font une des villes importantes du
Midi. L'hôpital, l'église, la halle, la préfecture, la place,
le tribunal, les casernes, les prisons, les ponts sont autant
de constructions modernes fort convenables. La promenade appelée
Pépinière est un délicieux labyrinthe de verdure auquel la Douze
sert de ceinture. Il est fâcheux que les pins qui bornent l'horizon
empêchent le regard de s'égarer au loin sur les vastes landes.
Du reste, à part quelques tours carrées romanes, point d'antiquités
à Mont-de-Marsan ; ni vieux châteaux, ni vieilles églises. Il
paraît que lorsque l'on démolit le château on trouva dans l'épaisseur
d'une muraille de vieilles chartes écrites sur parchemin en
latin, en français et en gascon. Après en avoir extrait ce qu'on
put lire, on les mit dans une urne bien scellée, qui fut placée
dans les fondations de l'hôtel de la préfecture.
Promenade à Mont de Marsan

Si Mont de Marsan, comme beaucoup de villes de nos provinces, non pas un patrimoine historique remarquable, il n’en demeure pas moins que ces villes ont le charme désuet de nos provinces et se sont des lieux où la vie trépidante des grandes cités n’ont pas cours. La douceur de vie, un calme serein règne tout au long de nos promenades. Ce que l’on remarque surtout à Mont de Marsan se sont les multiples statues qui agrémentent nos promenades et que capture l’objectif de l’appareil photos. Des statues on en trouve partout, sur les places, sur les ponts, et même dans certaines rues.
L’explication en est toute simple, Mont de Marsan peut s’enorgueillir de possédé le musée Despiau Wlérick. Une des grandes figures du statuaire français. C’est ainsi que de très nombreuses œuvres de différents sculpteurs sont présentent dans la ville. L’une des plus surprenante est cette plongeuse qui du haut du pont Gisèle Halimi plonge dans les eaux de la Midou. Ce n’est qu’une parmi tant d’autres que le promeneur découvre aux fils de ses pas dans cette ville où règne un calme paisible. Une initiative intéressante de Mont de Marsan, c’est que chaque statue comporte un bref descriptif de l’œuvre, ainsi qu’une notice succincte de l’auteur.
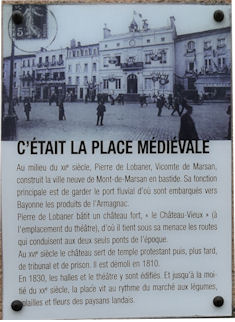
Sinon l’architecture
de mont de Marsan ne présente rien de bien exceptionnelle, ont
remarquera surtout le donjon Lacataille, qui abrite le musée
Despiau Wlérick et son jardin où sont installées de nombreuses
statues, les berges de la Midouze, un lieu de verdure avec de
nombreuses promenade que l’on découvre sur la passerelle du
Donjon. Les berges du Midou sont également un lieu de promenade
agréable. A découvrir dans ce lieu le curieux lavoir en retonde,
où de braves lavandières venaient échanger les derniers potins
de la commune.Autre lieu de promenade, l’ancien hôtel
de Ville sur la place Charles de Gaulle où se situait au Moyen
Age le « Château Vieux », forteresse destinée à protéger le
port et les ponts sur la Midouze, voie navigable jusqu’à Bayonne
permettant le transport des produits de l’Armagnac. Sur cette
place le château à disparu laissant la place à l’ancien hôtel
de ville et au théâtre. Au passage, n’hésitez pas à pénétrer
dans l’Eglise de la Madelaine dans laquelle vous découvrirez
de superbes peintures. A voir également la place Joseph Pancaut
une belle statue de Condorcet .
Remarque : A mont de Marsan
deux cours d’eau circulent et se rejoignent à l’aval du pont
des Droits de l’homme : La Douze et le Midou, à eux deux ils
donnent naissance à la Midouze, qui en allant grossir le cours
de l’Adour crée une voie navigable jusqu’à Bayonne.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.