Cahors - Préfecture du Lot
Retour
au Département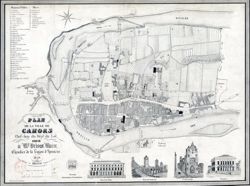

Cahors (Divona Cadurcorum) était déjà célèbre
avant l'arrivée des Remains. Les Celtes l'appelaient Divona, c'est-à-dire
la divine fontaine (Diw, divine, wonan, fontaine). Ce nom, que d'autres
villes portaient également (Bordeaux, entre autres, au témoignage
d'Ausone) lui venait, pense-t-on, d'une fontaine tout proche de
la ville et qui a pris le nom de fontaine des Chartreux, depuis
que des moines de cet ordre s'y sont établis au temps passé. Il
faut entendre l’enthousiaste d’un habitant de Cahors qui a décrit
la ville et le département : rien n'est pur, rien n'est limpide,
comme cette belle fontaine, qui, après avoir fait tourner les quatre
roues d'un moulin, va verser sa transparente émeraude dans les eaux
souvent fangeuses du Lot et rien n'est imposant, rien n'est sombre
et poétique comme les rochers énormes qui forment au-dessus de son
bassin une voûte : pleine de ténèbres. « Quel dommage, s'écrie
cet admirateur ; que la belle Laure n'ait pas habité le chef-lieu
du Quercy au lieu de résider à Avignon, de célébrer la fontaine
de Vaucluse, Pétrarque aurait fixé son séjour à Cahors, il aurait
chanté la fontaine des Chartreux » Cette fontaine, en effet,
n'est point au-dessous de pareils éloges, et elle est tout à fait
digne d'avoir donné son nom à l'antique cité des Cadurques.
Après avoir pris part à la résistance nationale, les habitants de
Cahors se soumirent à César, qui récompensa leur courage du surnom
d'Eleuteri libres. Déjà industrieux avant la conquête romaine, ils
se trouvèrent tout à coup placés dans des conditions bien plus favorables
pour développer leur activité ingénieuse. On vanta par tout l'empire
la finesse et la beauté des toiles qu'ils fabriquaient l'élégance
et la commodité de leurs meubles ; ces lits de plumes dont ils sont
regardés comme les inventeurs, ces rubans de lin qu'ils avaient
su, les premiers, teindre de couleurs éclatantes ; surtout ces poteries
que les potiers cadurques façonnaient avec tant de délicatesse et
qui portaient le nom de Caduræ. Le gouvernement impérial traita
Cahors comme il convenait de traiter une ville si précieuse pour
les jouissances des maîtres du monde. Il l'éleva au rang de municipe,
et elle fut du nombre des soixante villes qui élevèrent un autel
à Auguste au confluent du Rhône et de la Saône. Quatre voies romaines,
à peu près dans la direction des quatre points cardinaux, la mirent
en communication avec Toulouse, Bordeaux, Périgueux, et Lyon par
Rodez. Un vaste aqueduc, que l'on croit avoir été construit sous
Constantin par l'architecte Polemius, et qui se prolongeait jusqu'à
six lieues de la ville; un forum, un pont, des thermes, consacrés
à Diane par Auguste et son gendre Agrippa, et dont il reste un portique
appelé par les habitants temple de Diane; un théâtre qu'on nommait
le cirque des Cadurques, également de l'époque d'Auguste, et dont
il ne subsiste plus rien depuis 1867 tels sont les différents ouvrages
dont fut ornée la Divona des Cadurques, désormais appelée Cadurcum.
Vers le milieu du IIIème siècle de l'ère chrétienne,
Cahors entendit prêcher l'Évangile par Genulfus, ou saint Genou,
qui fut son premier évêque. Il fit de nombreux miracles. Dès son
arrivée, il délivra des obsessions du démon le fils d'une veuve
qui lui avait offert une généreuse hospitalité. Un peu plus tard,
il ressuscita la fille d'un Cadurcien nommé Agilbert. Déjà il comptait
plusieurs prosélytes, lorsque le gouverneur de la ville, Dioscorus,
dont le devoir politique était de réprimer les chrétiens, fit appeler
devant son tribunal l'intrépide confesseur de la foi, le fit battre
de verges et jeter dans un four ardent avec plusieurs de ceux qu'il
avait convertis. Ce n'était pas la première fois que Dieu retirait
sains et saufs ses fidèles d'une si cruelle situation. Saint Genou
et ses disciples sortirent du four comme ils y étaient entrés. Cet
événement miraculeux ouvrit les yeux au peuple qui, par ses menaces,
obligea le gouverneur à respecter désormais des hommes si manifestement
protégés du ciel. Lui-même, Dioscorus, frappé bientôt d'une douleur
cruelle par la mort subite de son fils, et, se croyant sans doute
puni de ses rigueurs envers le saint, le supplia de ressusciter
son enfant. Saint Genou voulut lui rendre le bien pour le mal et
lui dit « Prends le cadavre par la main droite et pose-le sur
ses jambes. » A peine redressé, le cadavre marcha. Dioscorus
se convertit avec sa femme, ses parents, ses amis. Saint Genou,
après avoir installé le christianisme d'une manière si éclatante
à Cahors et avoir fondé, dit-on, la première église de la Daurade,
s'en alla prêcher l'Évangile dans le Berry avec le même succès,
et y mourut.
La cathédrale de Cahors s'est enrichie depuis de
plusieurs reliques de saint Genou, rapportées au XVIIème
siècle par des chanoines de la ville qui avaient fait un voyage
dans le nord de la France. On dit que le successeur de saint Genou
dans le siège épiscopal de Cahors fut ce fameux Exupère, rhéteur
de Bordeaux, célébré par Ausone. L'évêché de Cahors, après que Constantin
en eut réglé la circonscription, eut à peu près la même étendue
qu'autrefois le territoire de Divona et plus tard la province de
Quercy ; le Lot le partageait presque en deux parties égales. L'évêque
prit de bonne heure à Cahors, comme dans tous les municipes, une
grande importance qu'il est utile de remarquer parce qu'elle ne
cessa de croître jusque dans le moyen âge. Les révolutions politiques,
les guerres désastreuses, les changements de domination n'arrêtèrent
point ce progrès. Les Francs de Clovis se substituèrent aux Wisigoths.
Les rois rivaux qui se partagèrent son royaume se disputèrent les
armes à la main le midi de la France Cahors fut même prise, brûlée,
et ses murailles détruites par Théodebert en 573. On n'en voit pas
moins l'autorité épiscopale sortir de ces orages aussi ferme et
aussi respectée. Sous Dagobert, l'Evêque Rusticus fut assassiné
dans une émeute ; mais, dès l'épiscopat de son successeur, qui était
aussi son frère, saint Didier ou saint Géry (629-655), l'expiation
du crime fut imposée à la corporation des bouchers, soupçonnée de
l’avoir commis ; il fut établi que tous les ans, le jour consacré
à saint Étienne, patron de la cathédrale, deux bouchers placeraient
deux haches de bois aux angles du maître-autel et assisteraient
à l'office en restant tout le temps à genoux. Cette pénitence était
assez douce, il est vrai mais il fallait encore de la puissance
à l'évêque pour pouvoir imposer à une corporation redoutable une
humiliation qui s'est perpétuée pendant des siècles. Au reste, saint
Géry jouissait d'un crédit particulier à la cour du roi Dagobert
; ses richesses étaient si considérables qu'elles suffirent à relever
les murs de la ville, à y fonder des monastères, des édifices publics
et qu'il put encore laisser par testament à l'église cathédrale
; dix bourgs ou villages qui lui appartenaient dans le Quercy. Les
Normands ravagèrent Cahors. Elle passa aux comtes de Toulouse, leur
fut disputée par les rois d'Angleterre et leur demeura enfin. Dans
le court espace de temps pendant lequel Henri II en -fut possesseur,
il y établit pour gouverneur son chancelier, le fameux Thomas Becket,
qui fit environner la ville de murailles aujourd'hui détruites.
Au milieu de ces troubles et de ces tiraillements dont souffrit
la province disputée sans cesse entre les maîtres de la Guyenne
et les comtes de Toulouse, Cahors fut érigée en un comté particulier,
et son évêque, s'affermissant de plus en plus dans son pouvoir temporel
et prenant rang dans la hiérarchie féodale, s'en mit en possession.
Au temps de la croisade des Albigeois, Guillaume de Cardaillac était
évêque de Cahors. Il prêta serment à Simon de Montfort, combattit
sous sa bannière et, lorsque celui-ci fut assiégé dans Castelnaudary,
courut pour le délivrer. Mais le comte de Foix le mit en déroute,
et il fallut que Montfort sortît de la place et chargeât avec la
garnison pour rétablir la fortune des croisés en 1511. Ce fut, au
reste, ce même Guillaume qui, en cette même année, ayant renoncé
à la suzeraineté du comte de Toulouse pour se reconnaître l'homme
lige de Philippe-Auguste, prit publiquement les titres de comte
et baron de Cahors, et, comme signe de son pouvoir séculier dont
il venait de donner des preuves si belliqueuses, il adopta l'usage,
que ses successeurs perpétuèrent, de faire déposer sur l'autel,
près de l'évangile, toutes les fois qu'il officiait, une armure
complète d'homme d'armes: casque, cuirasse, brassards, glaive, cuissards,
gantelets, etc. Un autre usage, qui ne flattait pas moins l'orgueil
des prélats de Cahors, était celui qui, à l'entrée de chaque nouvel
évêque, obligeait le baron de Cessac, l'un des quatre barons vassaux
de l'évêque, à conduire sa mule par la bride jusqu'à la cathédrale,
nu tête, en camisole blanche, la jambe gauche vêtue et la droite
nue, puis à lui servir à boire à table ; ce seigneur, en récompense,
gardait pour lui la haquenée du prélat toute caparaçonnée et le
buffet qui avait servi à son repas de cérémonie, et qui devait valoir
3 000 livres.
L'évêque trouvait des sujets moins dociles dans
les bourgeois de Cahors, où le régime municipal se réveillait alors
comme dans toute la France. Les villes du Midi surtout, comme les
républiques italiennes, retrouvaient, sous les débris des institutions
romaines, toutes les traditions d'une antique industrie, qui étaient
pour elles des éléments de puissance tout préparés. Aussi leurs
bourgeois arrivèrent promptement à la richesse et à l'importance
politique. C'est un riche marchand de Cahors, Raymond de Salvanhac,
qui prêta de l'argent à Simon de Montfort pour la croisade. Dès
le siècle précédent, les seigneurs du voisinage, absolument comme
en Italie, sollicitaient le droit de bourgeoisie dans Cahors. La
population urbaine avait dans ses consuls, des magistrats qui défendaient
ses intérêts et la représentaient vis-à-vis de la puissance féodale
de l'évêque. En 1225, un différend s'éleva il y avait une cloche
que les consuls prétendaient avoir le droit de faire sonner sans
permission. L'évêque leur contestait ce droit. Ce débat paraît ridicule
au premier abord ; il n'en faut point rire pourtant, car il n'a
rien de commun avec le lutrin ; avoir une cloche au moyen âge, c'était
avoir une voix pour convoquer, au besoin pour soulever le peuple.
Raymond VII, qui venait de recouvrer ses États, passant à Cahors
cette même année, les consuls lui soumirent l'affaire. Naturellement
mal disposé pour les évêques qui depuis si longtemps empiétaient
sur les droits des comtes de Toulouse, il donna raison aux bourgeois
et profila de l'occasion pour ressaisir plusieurs des usurpations
épiscopales. Un autre conflit s'éleva en 1251. Les consuls eurent
le dessein fort légitime de faire construire un pont sur le Lot.
L'évêque Barthélemy s'y opposait, objectant que cette construction
lui ferait perdre les revenus de son bac. Il fallut, pour en finir,
lui accorder un droit de péage sur ce pont, qui fut achevé en 1283.
C'est celui qui est à l'est de la cathédrale et qu'on appelle encore
aujourd'hui Pont neuf, quoiqu'il soit le plus ancien de la ville.
Une autre question de pont mit encore aux prises l'évêque et la
municipalité. Si l'on en croit l'historien Cathala-Couture, que
M. Mary-Lafon déclare « être au-dessous de la critique, » mais dont
les assertions semblent justifiées en cette circonstance par l'inspection
que le savant archéologue Didron a faite du pont de Valentré, ce
pont remonterait à la seconde moitié du XIIIème siècle.
Ce serait ce même évêque Barthélemy qui l'aurait fait construire,
comme pour rivaliser avec les consuls. Dès l'an ,1254, il se serait
fait autoriser, par le pape Marlin IV, à prélever deux cents marcs
d'argent, sur les amendes imposées à tous ceux qui exigeaient de
leurs débiteurs au-delà de 20 pour 100 par an ceux-ci étaient nombreux,
en effet, et l'on connaît la célébrité des usuriers cahorsins au
moyen âge. Néanmoins l'expédient fut insuffisant, et l'évêque en
employa un autre dont les seigneurs et les rois ne se faisaient
point faute à cette époque il altéra les monnaies. Mais la population
cahorsine ne supporta point en silence ce vol déguisé à l'instigation
de ses consuls, elle se souleva et contraignit l'évêque à rétablir
l'ancien titre de la monnaie. Toute cette histoire tomberait dans
l'eau si l'on adoptait l'opinion contraire à celle de Cathala-Couture,
et qui veut que la construction du pont de Valentré ait été décidée
seulement en 1306, dans l'assemblée générale de la commune, commencée
en 1308 et achevée en 1378. Quoi qu'il en soit, le pont de Valentré
fut bâti tel qu'on le voit encore aujourd'hui. Il est en dos d'âne,
comme tous les ponts du moyen âge, l'arche du milieu formant le
point culminant. Trois tours canées, sous lesquelles on passe, s'élèvent
aux extrémités et au milieu. Il porte tous les caractères de l'architecture
du XIIIème siècle, et il frappa tellement Michelet, lorsqu'il
passa dans le Quercy il y a une cinquantaine d'années, qu'il pressa
vivement M Bazin, alors professeur de rhétorique au collège de Cahors,
de protéger ce monument auprès du conseil municipal : « Faites tous
vos efforts, lui dit-il, pour que ce pont, qui est réellement un
joyau historique, soit, par des soins intelligents, transmis intact,
de génération en génération. » Le pont de Valentré porte le nom
de l'architecte qui l'a bâti ; mais on l'appelle aussi le Pont du-Diable,
par suite d'une légende bizarre. On raconte que cet architecte,
ne pouvant venir à bout de son œuvre, eut recours à Satan et fit
un pacte avec lui. Satan s'engageait à l'aider par tous les moyens
et à lui obéir ponctuellement, quelque ordre qu'il en pût recevoir.
Le travail fini, l'âme de l'architecte en devait être le prix ;
mais si le démon, pour une cause quelconque, refusait de continuer
son assistance jusqu'au bout, il perdait tous ses droits sur le
prix en question. La besogne marcha vite avec un tel manœuvre. Pierres,
ciment, matériaux de toute espèce arrivaient par enchantement Satan
n'y épargnait point ses ailes et ne laissait point chômer les ouvriers.
Quand le pont fut presque fini « Çà, se dit en lui-même l'architecte,
voici le moment de songer à notre âme, afin que nous n'ayons point
fait un sot marché. » Et il s'arrêta à la ruse que voici. Il porta
un crible à son formidable associé « Ami, lui-dit-il, je t'ai trouvé
docile jusqu'ici, et tu sais que tu dois l'être jusqu'au bout. Prends
ce crible, laisse-le tel qu'il est et l'emploie à puiser l'eau que
tu porteras aux maçons pour délayer la chaux. » Le diable se mordit
les lèvres de dépit il tenta pourtant l'expérience, elle échoua
vingt fois : tout roi des enfers qu'il était, et tout rapide que
fût son vol, jamais crible n'a gardé l'eau, même celle du Lot, et
le sien était tout sec quand il arrivait. Confus, il vint avouer
sa défaite, mais jura de se venger de la malice humaine. A quelque
temps de là, en effet, lorsque les maçons eurent presque achevé
de construire la tour du milieu du pont, ils en trouvèrent l'anale
supérieur nord-est abattu. Étonnés, ils le reconstruisirent. Le
lendemain, il était encore renversé. Ils eurent beau faire, impossible
d'achever cette tour, encore incomplète aujourd'hui. Tous leshommes
du métier admirent la dureté du ciment employé à la construction
du pont de Valentré ; il surpasse le ciment romain c'est évidemment
un ciment de l'autre monde.
De nouveaux démêlés éclatèrent,
en 1287, entre les consuls et l'évêque Dieudonné de Barsal, qui
voulait leur enlever le droit de sceau, la garde des clefs, etc.
Ils résistèrent, alléguant qu'ils possédaient ces droits par suite
d'une concession royale : un arrêt du parlement de Paris leur donna
raison. Mais Philippe le Bel, qui intervenait à son profit partout
où des conflits éclataient suivant en cela l'habile politique des
premiers Capétiens, se tourna du côté de l'évêque, dès que celui-ci
(c'était le successeur de Barsal) lui eut offert de partager ses
droits sur la ville. On dressa, en 1306, un acte qui fut appelé
acte de pariage, et qui associait, en effet, la royauté à tous les
droits de l'évêque. Le sceau porta désormais la double empreinte
du roi et du prélat. Les consuls continuèrent d'exister, quoiqu'il
n'en fût point fait mention dans l'acte de pariage ; au reste, les
viguiers royaux, depuis lors présents dans la ville, apaisèrent
en général, par leur intervention pleine de conciliation et d'autorité,
les anciens différends près de recommencer. Cahors eut, à cette
époque, l'honneur d'envoyer un de ses enfants sur la chaire de Saint-Pierre
Jacques d'Ossa ou d'Euse, né à Cahors en 1244, fils de gentilhomme,
selon les uns, et de savetier, selon les autres, s'étant distingué
au service de l'archevêque d'Arles, obtint une chaire de jurisprudence
à l'université de Toulouse. Un fils de Robert d'Anjou, roi de Naples,
était alors évêque de cette ville, il remarqua le jeune Cahorsin
et le fit arriver aux évêchés de Fréjus et d'Avignon, puis à la
chancellerie du royaume de Naples, enfin au cardinalat. Le trône
pontifical étant devenu vacant en 1316, Jacques d'Euse fut désigné,
dans le conclave de Lyon, pour le remplir, et devint pape sous le
nom de Jean XXII. Il l'occupa jusqu'en 1334. Pendant tout son pontificat,
il ne cessa de donner à son pays natal des témoignages de son souvenir
et de sa prédilection, à ce point qu'il songea, dit-on, à y transférer
le Saint-Siège, que le schisme avait fait passer en France. Il fit
cardinaux plusieurs de ses compatriotes. Il acheta, moyennant deux
mille cinq cents florins d'or de Florence, les biens que les templiers
avaient possédés à Cahors, et y fonda, en 1328, le couvent de la
Chartreuse, où s'établirent aussitôt après un prieur et douze religieux,
venus de la Grande Chartreuse de Grenoble. En 1231, il fit bâtir
l'église de Saint-Barthélemy, et, la même année, il fonda à Cahors
une université composée des quatre Facultés de théologie, droit,
médecine et arts ou belles-lettres. Cette université subsista avec
éclat pendant quatre cent vingt-ans ; de savants théologiens et
de grands jurisconsultes en occupèrent les diverses chaires ; Roaldès,
Govea, Cujas, Jean Lacoste, Dominicy, etc. Elle comptait seize cents
élèves lorsqu'on la supprima en 175i, en la faisant rentrer dans
celle de Toulouse. Ses étudiants jouissaient de tous les mêmes privilèges
que ceux des universités de Paris et de Toulouse. La tour du pape
Jean XXII, appelée aussi tour Èze (Euse, par corruption), perpétue
aujourd'hui le souvenir du pontife né à Cahors. Elle s'élève au
bout de la rue qui traverse le faubourg de la Barre, en face de
la caserne ; ses petites fenêtres ogivales à colonnettes indiquent
son époque. Occupée successivement par les parents d'un pape, des
moines, des religieuses, elle a eu aussi le triste avantage de loger
le bourreau. Le prince Édouard s'y établit en 1360, après que le
traité de Brétigny eut cédé le Quercy à l'Angleterre. Choquée de
la dureté des Anglais, et particulièrement du gouverneur Jean Chandos,
Cahors se révolta. Comme elle ne reçut alors de la France aucun
secours, elle fut obligée de céder et de laisser rentrer les Anglais
; mais au siècle, en 1428, suivant elle les chassa définitivement.
Obligés de se retirer non seulement de la ville, mais des châteaux
de Concorès et de Mercuès, ils capitulèrent et rendirent la place
moyennant une pièce de damas et une faible somme d'argent. Cahors
rentra définitivement sous la domination française et fut réunie
au domaine de la couronne en 1471, après la mort du duc de Guyenne,
frère de Louis XI. Elle était au nombre des soixante-quatre villes
dont les députés assistèrent au couronnement de ce roi. Cahors,
qui avait donné le jour à un pape au XIVème siècle, vit
naître, à la fin du XVème une illustration d'un autre
genre, un poète célèbre. Clément Marot naquit en 1495, d'un père
normand, Jean Marot, de Caen, poète lui-même, et d'une mère probablement
cahorsine, du moins parlant la langue d'oc. Plus tard, en prison,
il écrivait
A bref parler, c'est Cahors en Quercy
Que
je laissay pour venir querre ici
Mille malheurs, auxquels ma
destinée
M'avoit submis. Car, une matinée,
N'ayant dix ans,
en France fus mené
Là où depuis me suis tant pourmené
Que
j'oubliai ma langue maternelle
Et grossement apprius la paternelle,
Langue françoise, ès grands cours estimée,
Laquelle enfin quelque
peu s'est limée.
L'existence de Marot fut agitée, comme
il s'en plaint. En il prit part à la bataille de Pavie, et fut fait
prisonnier par les Espagnols. A peine libre, il fut enfermé au Châtelet
comme suspect d'hérésie. Il dit quelque part que sa mie, avec laquelle
il s'était légèrement brouillé, l'accusa d'avoir fait gras en carême
et que c'est cela qui le conduisit en prison. Il y retourna un peu
plus tard pour avoir voulu délivrer un malheureux que les archers
emmenaient. Enfin, quoiqu'il protestât contre toute accusation d'hérésie
….. point ne suis luthériste,
Ne zuinglieu et moins anabaptiste
Bref celui suis qui croit, honore et prise
La saincte, vraye
et catholique Église,
Il n'en fut pas moins obligé, à
la fin, de se réfugier à Ferrare, à Venise, à Genève. Sa traduction
des Psaumes de David, à l'usage des Églises réformées, avait attiré
sur sa tête un dernier orage. Il mourut à Turin dans la misère,
en 1546. Jamet, un de ses amis et de ses imitateurs, fit pour lui
cette épitaphe remarquable, malgré son emphase :
Icy devant
au giron de sa mère
Gist des François le Virgile et l'Homère
Cy est couché et repose à l'envers
Le nonpareil des mieux disans
un vers;
Cy gist celuy que peu de terre cœuvre,
Qui toute France
enrichit de son œuvre,
Cy dort un mort qui toujours vif sera,
Tant que la France en français parlera ;
Brief, gist, repose
et dort en ce lieu-cy
Clément Marot de Cahors en Quercy.
Une rue de Cahors, celle qui joint la place au Dois ou place
de la Daurade à la cathédrale, porte aujourd'hui le nom de Clément
Marot. Si le poète cahorsin pencha vers les doctrines protestantes,
ce n'est point sa ville natale qui lui communiqua ce penchant. Les
réformés ayant voulu, pendant les guerres de religion, établir un
prêche à Cahors, dans la maison d'un certain d'Oriolle, le peuple
s'ameuta et y mit le feu. Ils n'y reparurent plus, depuis, que les
armes à la main, à la suite de Henri de Navarre, le futur Henri
IV. Ce prince avait épousé, en 1572, Marguerite de Valois, sœur
de Charles IX, dont la dot comprenait la ville de Cahors.
Depuis
son mariage, Henri n'avait point encore pu se faire ouvrir les portes
de cette cité. Il résolut de s'en emparer par surprise, et, dans
la nuit du 29 mai 1580, pendant un orage qui empêchait les habitants
de voir et d'entendre rien au dehors, il se présenta avec 1,500
hommes d'élite, devant le Pont-Neuf que défendaient deux tours,
une chaque extrémité. Des pétards appliqués aux portes de ces deux
tours les firent successivement tomber, et Henri, avec ses huguenots,
se précipita dans l'intérieur de la ville. Disons, en passant, que
depuis lors on donne souvent au Pont-Neuf le nom de Pont Henri IV.
Une résistance terrible attendait les envahisseurs. Le vaillant
baron de Vesins, sénéchal du Quercy, se présente avec 40 gentilshommes
et 300 arquebusiers. On se battit à bout portant, au milieu de l'obscurité
et des éclats de l'orage, Les catholiques virent tomber leur chef,
et ils allaient lâcher pied, quand une troupe de bourgeois survint
et ranima la lutte. Ce fut le tour des huguenots de céder. Déjà
ils repassaient le pont et on pressait le roi de Navarre de remonter
à cheval, quand celui-ci, indomptable, fit appeler du dehors le
capitaine Chouppes qui venait d'arriver avec de vieilles bandes,
après avoir fait quatorze lieues d'une traite. Chouppes ramena les
fuyards à coups d'épée, se précipita sur une barricade élevée par
les assiégés, l'enleva et marcha sur l'hôtel de ville qui tomba
en son pouvoir. Les Cahorsins se ralliaient devant le collège Pélegry
; il y courut ; mais toutes les rues étaient hérissées de barricades
; un feu terrible partait des fenêtres ; en deux jours on ne gagna
que de dix pas devant le collège ; enfin le quatrième on prit ce
bâtiment, et il fallut encore enlever ensuite quatorze barricades
défendues pied à pied. Malgré la présence du bon Henri, la tradition
raconte que pendant sept jours le sang coula dans la place escarpée
du palais de justice comme dans les rigoles d'une boucherie. Ses
lettres attestent, il est vrai, qu'il s'efforça ensuite de réparer
le mal, de bien approvisionner Cahors, et d'y empêcher la démolition
des monastères qu'on avait entreprise contre son intention. Toutefois,
on ne voit point qu'il ait réussi à s'attacher bien fortement les
Cahorsins, puisque, en 1589, à la sollicitation des députés du parlement
de Toulouse, ils se déclarèrent pour la Ligue. Avec ses troubles,
son existence agitée, Cahors perdit depuis ce moment sa prospérité
du moyen âge. On lui retira le privilège d'entrepôt pour les vins.
Le coup le plus rude fut la suppression de cette université qui
venait cependant de voir sortir de ses écoles un disciple bien illustre,
Fénelon. Une place plantée d'arbres porte aujourd'hui à Cahors le
nom de Place Fénelon. Une colonne s'y élève surmontée d'un buste
de ce grand prélat. Cahors n'est plus aujourd'hui une ville bien
importante, si ce n'est par les souvenirs. Sa cathédrale, dédiée
à saint Étienne, en est le monument le plus remarquable. On y trouve
la trace de bien des époques, non pas cependant du vil, siècle,
comme l'ont prétendu quelques-uns car il est probable que de l'église
primitive bâtie en ce lieu il ne reste plus rien dans l'édifice
actuel. Les traces d'architecture romane et particulièrement les
deux coupoles que l'on voit à l'intérieur paraissent être du XIème
siècle, époque où l'édifice aurait été bâti. On y voit, en outre,
du gothique du XIIIème et du XIVème siècle.
Le cloitre appartient au style gothique du XVIème siècle,
dont il a l'ornementation gracieuse et délicate.
L'église Saint-Urcisse,
qui date du XIIème et du XIIIème siècle, et
Notre-Dame qui ne remonte qu'au XIVème siècle, sont les
autres églises remarquables de Cahors. Les autres monuments du temps
passé sont le palais de Jean XXII et sa tour carrée dont nous avons
parlé plus haut ; le Château Royal, qui sert de prison, plusieurs
vieilles maisons fortes, la maison Roaldès ou de Henri IV, ainsi
que le collège Pélegry, datant du XVème siècle, la tour
de la Barre et les restes des anciens remparts. Il ne faut plus
chercher de traces du théâtre antique, elles ont disparu il y a
plusieurs années mais le pont Valentré, aujourd'hui rangé parmi
nos monuments historiques, a été restauré ; et non loin de là on
peut encore visiter la fontaine des Chartreux qui valut à Cahors
son nom gallo-romain de Divona. Sur le cours Fénelon s'élèvent les
statues de deux des plus intrépides généraux de Napoléon Ier
Joachim Murat et Bessières. Parmi les monuments modernes, nous citerons
la tour du lycée, les halles, les abattoirs, le pont Louis-Philippe
et le monument récemment élevé à la mémoire des mobiles morts pendant
la guerre de 1870-1871.
Cahors fait un commerce important des
vins de son territoire, qui, au temps de Henri IV, jouissaient d'une
grande réputation, et encore d'eaux-de-vie, de truffes noires, de
noix et d'huile de noix, de pommes et de tabacs.
Aux portes
de la ville et près du pont de Valentré, sur une colline d'où l'on
a une vue magnifique, la propriété dite de l'Ermitage offre aux
curieux une jolie chapelle, une galerie pavée de mosaïque et des
peintures murales.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.