Saint Lô - Préfecture de la Manche
Retour
au Département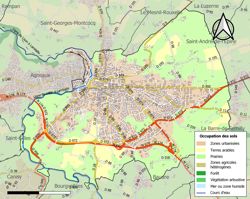
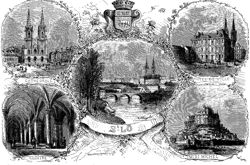
Saint-Lô (Briovera, Sanctus Laudus),
Sur le territoire où est actuellement Saint-Lô existait un château,
celui de Briovire ou Briovère, qui devait son nom à sa situation
sur une pointe de terre dominant un cours d'eau. Auprès de ce château
se groupèrent quelques habitations qui, après l’établissement du
christianisme, prirent le nom de Saint-Étienne, puis celui de Sainte-Croix.
Saint Laud (sanctucs Laudus), par contraction saint Lô, cinquième
évêque de Coutances, affectionnait ce séjour et lui donna son nom.
Charlemagne fit réparer le château et entoura la ville de murailles
pour la mettre à l'abri des incursions des pirates du Nord. Les
Normands, en effet, assiégèrent cette ville ; repoussés une première
fois, ils revinrent en 890. Leur chef Rollon, désespérant d'emporter
la ville de vive force, fit couper un aqueduc qui fournissait de
l'eau à la place les habitants, pressés par la soif, furent obligés
de capituler ; on leur promit la vie et on les massacra au moment
où ils sortaient des murs, l'évêque fut au nombre des victimes,
et les Normands rasèrent les fortifications.
Saint-Lô, sans jouer
un rôle bien important dans l'histoire des guerres féodales, prospéra,
grâce à son industrie et à son commerce, et sa population, enrichie
par la fabrication du drap, se montait à 9 000 âmes quand Édouard
III, roi d'Angleterre, s'en empara en 1346. Quoique la ville démantelée
ne lui eût opposé aucune résistance, il la pilla, la ruina en un
instant, en emportant un riche butin consistant surtout en une quantité
considérable de draps.
Sous Charles V, ce fut à Saint-Lô que
se réunirent les troupes rassemblées par le roi de France pour châtier
Charles le Mauvais, roi de Navarre, et réduire les châteaux que
celui-ci possédait en Normandie. En 1417, la ville se rendit au
duc de Glocester. Les Anglais la possédèrent jusqu'en 1449 et elle
leur fut reprise cette année par le connétable de Richemond.
A l'époque de la Réforme, Saint-Lô, qui avait prospéré depuis l'expulsion
des Anglais et acquis une certaine importance, fut livrée de nouveau
à tous les malheurs de la guerre. La ville se prononça en partie
pour les idées nouvelles ; et, en 1562, les calvinistes y saccagèrent
les églises, dévastèrent les maisons de leurs adversaires, et relevèrent
les fortifications de la ville pour en faire, dans le Cotentin,
leur principale place de guerre. A la fin de la même année, les
Bretons, sous la conduite du comte d'Étampes, les en chassèrent
et exercèrent de cruelles vengeances contre les habitants.
Le
comte de Montgomery reprit Saint-Lô l'année suivante ce fut pour
la malheureuse cité le commencement de nombreuses et sanglantes
représailles. Rendue au roi par un édit de pacification, Saint-Lô
échappa aux horreurs de la Saint- Barthélemy, dont le gouverneur
de la basse Normandie, Matignon, sut préserver les villes de la
contrée. La ville fut reprise par Montgomery, qui, craignant d'y
être enfermé, s'en échappa de nuit, laissant le soin de la défense
à son lieutenant Briequeville-Colombières. Le siège dura six semaines
Montgomery, après avoir vainement essayé de tenir la campagne, avait
été obligé de capituler. Amené par Matignon sous les murs de Saint-Lô,
le prisonnier essaya vainement de déterminer Colombières à se rendre.
Celui-ci, lui reprochant cette faiblesse, répondit qu'il mourrait
à son poste. Il repoussa neuf assauts des troupes royales, réparant
la nuit les brèches que l'artillerie des assiégeants y avait pratiquées
pendant le jour, entraînant par son exemple les habitants et jusqu'aux
femmes à la défense de la place. Tout se disposait cependant dans
l'armée royale pour un dernier assaut ; Colombières se prépara à
y mourir, et amena près de lui sur la brèche ses deux jeunes enfants
armés tous deux d'un javelot « J'aime mieux, dit-il, qu'ils meurent
impollus et pleins d'honneur que de les abandonner aux mains des
infidèles et des apostats. » Malgré l'héroïque résistance des protestants,
la brèche fut emportée, Colombières tué d'un coup d'arquebuse ;
ses deux enfants furent épargnés et protégés par Matignon, mais
la ville fut livrée à toutes les horreurs de la guerre, et d'une
guerre de religion. Épuisée par ce massacre, elle s'effaça pendant
quelque temps mais, au XVIIème siècle, l'esprit indépendant
de ses habitants se manifesta de nouveau par des soulèvements causés
par l'excès des impôts.
Lors de la révocation de l'édit de Nantes,
les calvinistes de Saint-Lô furent cruellement persécutés ; une
grande partie s'échappèrent et réussirent à quitter la France. On
cite le jugement curieux qui condamne deux sœurs protestantes, Louise
et Madeleine Pezé, qui, arrêtées au moment où elles fuyaient la
persécution, furent condamnées à faire amende honorable en chemise,
à genoux, la torche au poing, conduites par le bourreau à demander
pardon à Dieu, au roi, à la justice, disant que, par opiniâtreté,
elles avaient voulu professer une prétendue religion. Elles furent
ensuite séparées et enfermées pour toujours.
Au XVIIIème
siècle, sauf quelques persécutions religieuses que le fanatisme
n'excusait plus, Saint-Lô jouit d'une grande tranquillité.
A
la fin de la Révolution, le chef-lieu du département, qui avait
d'abord été à Coutances, fut transféré à Saint-Lô.
Cette ville
est la patrie du cardinal Du Perron, qui joua un rôle important
sous Henri IV. Élevé dans le calvinisme, il l'abjura et dut sa haute
fortune à cette conversion autant qu'à ses talents comme diplomate
et à ses connaissances littéraires. Quoiqu'il ait publié un assez
grand nombre d'ouvrages de controverse, il est difficile de croire
au sérieux des convictions d'un homme qui faisait sa lecture habituelle
de Montaigne et de Rabelais. On peut penser du reste que les calvinistes,
qui l'ont traité d'intrigant sans foi et sans mœurs, avaient contre
lui de trop naturelles préventions pour être toujours justes à son
égard. Dans le piquant pamphlet de d'Aubigné, la Confession de Sancy,
Du Perron est fort maltraité. Saint-Lô est aussi la patrie du grand
astronome Le Verrier ; elle lui a élevé une statue sur une de ses
places. Pendant la Révolution, cette ville porta le nom de Rocher
de la Liberté.
Saint-Lô s'élève sur une colline rocheuse d'environ
33 mètres d'altitude, qui domine à l'ouest la rive droite de la
Vire ; sur l'esplanade qui termine la colline sont la préfecture,
la cathédrale, le nouvel hôtel de ville, le musée, la bibliothèque
et les plus belles habitations. La rue principale est celle du Neufbourg
; d'autres rues tortueuses gravissent les pentes de la colline.
Cette ville possède deux églises ; l'ancienne cathédrale Notre-Dame,
qui date du XVème siècle, où l'on remarque une statue
de la Vierge dite du Pilier, objet d'une grande vénération dans
le pays, et à droite de l'abside une chaire extérieure en pierre
très délicatement sculptée, qui semble dater du XVème
siècle ; elle servait à annoncer au peuple, réuni dans le cimetière,
tous les actes de la juridiction épiscopale. Cette église, qui s'annonce
au loin par ses deux belles flèches est rangée au nombre de nos
monuments historiques. L'autre église, celle de Sainte-Croix, de
style roman, est toute moderne elle a été batie en 1860 elle a remplacé
une antique abbatiale fondée, dit-on, au temps de Charlemagne, et
dont les bâtiments monastiques, agrandis et réparés, sont occupés
par le dépôt d'étalons.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.