Vannes - Préfecture du Morbihan
Retour au Département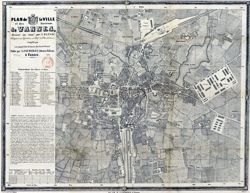

Vanne (Gwenet, Wennet, la Blanche, la Belle,
comme l'appelèrent les Celtes, aujourd'hui chef-lieu du département,
au fond du golfe du Morbihan, à 46 kilomètres de son embouchure.
Elle est disposée en amphithéâtre sur une colline au pied de laquelle
coule la petite rivière du Lizier. Pour savoir si elle jouissait
d'une grande importance avant la conquête romaine, il faudrait avoir
décidé si Dariorig, la capitale des Vénètes, était situé à Vannes
ou à Locmariaquer, qui se disputent cet honneur sansqu'on ait pu
jusqu'ici trancher cette difficulté. Soumise aux Romains avec toutes
les cités des Vénètes, Vannes fut entourée de fortifications et
mise en communication par quatre grandes routes avec, Locmariaquer,
Corseult, Redon, Rieux, Nantes, Port-Navalo.
Deodatus y prêcha
le christianisme au IVème siècle. Conan Mériadec passe
pour y avoir établi le premier évêque, Judicaël. Selon d'autres,
ce n'est qu'au siècle suivant que l'église épiscopale de Vannes
prit naissance par l'installation de Paterne, à l'occasion de laquelle
Perpetuus, évêque- de Tours, convoqua à Vannes un concile en 465
(398).
Elle resta ainsi soumise aux souverains de la Bretagne
jusqu'au milieu du VIème siècle, à la mort d'Hoël 1er.
Depuis ce moment, elle eut des comtes particuliers qui tantôt indépendants
et tantôt obligés de reconnaître les rois francs, souvent en lutte
avec leurs voisins, se signalèrent en général par un caractère de
barbarie mêlée de violence et de perfidie. Warroch, l'un d'eux,
après avoir refusé le tribut à Chilpéric, l'époux de Frédégonde,
battit ses troupes, consentit victorieux à payer mille sols et un
tribut annuel, rompit le traité, attaqua de nouveau les Francs,
ravagea le comté de Rennes, et, voyant son propre comté ravagé à
son tour par le comte de Rennes, se jeta sur celui de Nantes, dont
ses soldats coupèrent et emportèrent chez eux toutes les vendanges
en 579.
Vannes reconnut l'autorité des Carlovingiens jusqu'à
Charles le Chauve, qui, le dernier, y battit monnaie. Noménoë à
cette époque, enveloppa cette ville dans ses grands desseins d'indépendance
bretonne, et substitua à l'évêque Susannus un évêque de son choix.
Celui-ci, en 874, seconda le comte Pasquiten dans le complot qui
amena l'assassinat du roi Salomon au pied des autels.
Nous ne
reviendrons pas sur les luttes des comtes de Vannes et de Rennes.
Au milieu du XIIème siècle, Vannes fut conquise par Henri
II, roi d'Angleterre.
Dans la querelle de Charles de Blois et
de Montfort, les bourgeois de cette cité ne se prononcèrent franchement
pour l'un ni pour l'autre. Charles de Blois s'en empara en 1342,
et aussitôt Jeanne de Monfort accourut pour l'en chasser. Un premier
assaut échoua ; mais Robert d'Artois, qui était parmi les assiégeants,
divisa l'armée en trois corps, en fit marcher deux à' l'attaque
pendant la nuit à la lueur de grands feux allumés, tandis que le
troisième filait d'un autre côté silencieusement et dans les ténèbres.
Tous les défenseurs de la ville s'étant portés à la rencontre des
deux premiers corps, elle fut surprise par le troisième et tomba
au pouvoir des Anglais. Mais, peu de temps après, Clisson, Hervé
de Léon et Beaumanoir la reprirent de vive force par un beau fait
d'armes. Robert d'Artois, grièvement blessé dans la retraite, alla
mourir en Angleterre. Les seigneurs du parti français gardèrent
Vannes avec le même courage qui leur avait servi à la reprendre.
Ils repoussèrent Édouard III lui-même, malgré l'importance que ce
prince attachait à la conquête de cette place, lorsqu'il écrivait
au prince de Galles, son fils, « que la cité de Vanes est la
meilleure ville de Bretaigne après ville de Nautes et que sauns
estre seur de ladite ville, on ne pouvait l'être du pays. »
Un peu plus tard ( 1380), elle fut pourtant occupée par les Anglais
sous le commandement du duc de Buckingham, mais du plein gré des
habitants, qui, voyant Montfort triompher, ouvrirent leurs portes
au capitaine anglais en lui faisant jurer qu'il sortirait de la
ville quinze jours après qu'il en serait requis par eux. Pendant
son séjour, Vannes fut témoin d'un de ces combats chevaleresques
dont la guerre de Cent ans offre tant d'exemples. Cinq chevaliers
français, à la suite d'un défi jeté sous les murs de Nantes, combattirent
contre cinq chevaliers anglais à cinq coups de lance, cinq coups
d'épée, cinq coups de hache et cinq coups de dague. Les champions
anglais furent tous vaincus. Un de leurs compatriotes, Farrington,
ne put supporter cette humiliation nationale et crut l'effacer en
recourant à une perfidie qui ne fit qu'ajouter une flétrissure honteuse
à une défaite honorable. Il feignit un mal au genou et descendit
dans la lice sans cuissards, priant son adversaire de se dégarnir
de même pour égaliser la lutte. Celui-ci (c'était le seigneur de
Chastel-Morant, un des vainqueurs de la veille) y consentit par
courtoisie, et l'Anglais, traîtreusement, dès le troisième coup
de lance, lui perça la cuisse. L'indignation des deux armées fut
égale. Buckingham fit arrêter le chevalier déloyal et offrit à Chastel-Morant
de le lui livrer en lui envoyant 50 nobles dans un gobelet d'argent.
Aussi généreux que son adversaire l'avait été peu, Chastel-Morant
demanda qu'il fût mis en liberté, renvoya l'argent et ne garda que
le gobelet.
L'importance de Vannes dans ces guerres attire sur
elle l'attention des ducs de Bretagne. Souvent déjà ils y avaient
résidé, ils occupaient alors le château de la Motte, dont la première
fondation remontait au comte Warroch, mais qui avait été reconstruit
au VIIIème siècle. Jean VI voulut posséder dans cette
ville une résidence plus magnifique et donner en même temps à la
place une défense nouvelle. Dans ce but, Il fit construire le château
de l'Hermine, dont les murs se rattachaient à ceux de Vannes. Ce
château était en construction, lorsque Jean IV, jaloux de la puissance
d'Olivier de Clisson, qui venait d'ajouter à sa grande fortune le
titre de connétable de France et qui méditait une alliance avec
la famille de Charles de Blois, résolut de s'en débarrasser par
la perfidie. En 1381, Il convoqua des états à Vannes. Clisson y
vint avec le sire de Laval, son beau-frère le vicomte de Rohan,
son gendre, et le sire de Beaumanoir. Jean leur fit un accueil plein
de grâce, les traita magnifiquement au château de la Motte, et,
avant de les laisser se retirer, leur proposa de visiter l'Hermine.
On s'y rendit, on but avant d'entrer. On visita la bâtisse. A portée
de la tour principale « Sire Olivier, dit le duc, il n'y a homme
deçà la mer qui se connoisse mieux en ouvrage de maçonnerie que
vous faites. Si vous prie, beau sire, que vous montiez là sus, si
me saurez a dire comment le lieu est édifié. Si il est bien, il
demeurera ainsi si il est mal, je l'amenderai ou ferai amender.
» Olivier voulait qu'il passât le premier par honneur « Montez
toujours, répondit Jean; j'ai deux mots à dire au sire de Laval.
»A peine entré, le connétable fut saisi par des hommes armés
et chargé de fers. Le duc, dans la fièvre de cette mauvaise action,
plus vert qu’une feuille, après de longues hésitations et malgré
les prières des seigneurs de Laval et de Rohan, donna l'ordre de
jeter Clisson à la rivière. Sa nuit fut pleine de trouble, sans
sommeil. Le lendemain seulement, la lumière du jour sembla éclairer
tout à coup pour lui les conséquences de son crime. Il vit se dresser
devant ses regards la vengeance des Clisson, la vengeance des seigneurs
bretons, la vengeance du roi de France. Il appela le capitaine du
château, lui découvrit ses remords. Celui-ci les avait prévus et
n'avait point exécuté ses ordres. Jean IV fut plein de joie ; mais
ses remords n'allaient pas jusqu'à la réparation complète de son
crime, et il rendit la liberté au connétable en exigeant qu'il livrât
ses villes et châteaux avec une rançon dc cent mille écus d'or.
Clisson promit, sachant bien que l'honneur ne l'obligeait pas à
tenir une promesse arrachée par de tels moyens, et bientôt il commença
contre son suzerain une guerre à outrance.
Au XVème
siècle, Vannes, comme la plupart des villes de Bretagne, fut l'objet
de la sollicitude administrative des ducs. Pendant les états de
Vannes Pierre II, profitant des circonstances politiques pour augmenter
l'industrie de ses États, y appela, en leur accordant plusieurs
franchises, des ouvriers de divers états. Les intentions du duc
demeurèrent malheureusement sans résultats ou à peu près. Comme
à Rennes, une seule industrie, celle des draps, prit à Vannes quelque
consistance. Par un contraste assez singulier, c'est au moment même
où Vannes acquérait ces nouveaux éléments d'industrie qu'elle acquit
aussi un saint patron. Au reste, ce XVèmesiècle fut fertile
en personnages d'une grande sainteté et d'une puissante influence
morale sur la foule. Qu'il suffise de rappeler Jeanne Darc, précédée
déjà de deux ou trois enthousiastes dit même genre, et plus tard
saint François de Paule. Le saint qui devint le patron de Vannes
est le fameux Vincent Ferrier. Il s'y rendit en 1417, après avoir
déjà remué les peuples par sa parole. Le duc, la duchesse et leur
cour, le clergé, la bourgeoisie et le peuple, vinrent à la rencontre
du saint homme, monté sur son âne, qui refusa de loger au château
de la Motte et préféra une simple maison particulière. Il fit encore
quelques courses dans les pays voisins ; mais, quand il revint,
son âne ne voulut plus repartir ; il demeura et mourut à Vannes.
L'eau qui servit à laver son corps fut soigneusement recueillie
et gardée par la duchesse Jeanne. En 1455, un légat du pape vint
trente-six ans après célébrer à Vannes la fête de sa canonisation
accordée par le pape. Depuis ce temps, son image figure sur une
des portes de la ville, qui continue d'invoquer sa protection spéciale
et qui révère son tombeau dans la cathédrale.
C'est encore dans
le cours du XVème siècle que la cathédrale de Vannes,
dédiée à saint Pierre, fut mise, par les soins de l'évêque Validaire,
à peu près dans l'état où on la voit aujourd'hui. Elle avait commencé
à être rebâtie après l'invasion des Normands, qui avaient détruit
le bâtiment primitif. Une aiguille hardie la surmontait ; détruite
par la foudre, en 1824, elle a été remplacée par une flèche assez
lourde. La voûte intérieure a beaucoup de majesté et repose sur
des murs latéraux au lieu de pilastres.
Le dernier des ducs de
Bretagne, François II, fit à Vannes l'honneur d'y rétablir la résidence
du parlement créé par lui sous le nom de Grands Jours pour la province,
en 1485, et qui devait s'y assembler régulièrement du 15 juillet
au 15 septembre.
Ainsi le XVème siècle fut pour cette
ville un siècle de prospérité, d'accroissement. Mais la fin de ce
même siècle amena la fin de l'indépendance bretonne. François II
avait pris la précaution de faire déclarer dans les états tenus
à Vannes, en 1485, ses deux filles, Anne et Isabelle, aptes à lui
succéder. Mais cette mesure ne suffisait pas pour mettre la Bretagne
à l'abri de la convoitise des rois de France. Charles VIII fit entrer
dans ce pays ses troupes. Vannes tomba enfin avec toute la Bretagne
au pouvoir de la couronne de France, qui la traita avec égard. Elle
fut confirmée par Louis XII et Françoiser dans la possession
de son parlement, que Henri II ne lui enleva en 1554 qu'après l'avoir
dotée d'un présidial. C'est à Vannes que se tinrent, en 1532, les
états provinciaux dans lesquels fut déclarée définitive la réunion
de la Bretagne à la France. Les états de Bretagne se réunirent encore
six fois au XVIème siècle, dix fois au XVIIème,
une fois au XVIIIème.
Ceux de 1567 réclamèrent énergiquement
le maintien des libertés garanties par le contrat de la feue reine
Anne. Vers ce temps, en effet, les efforts redoublaient pour rattacher
la province au grand pays dont elle était devenue une partie intégrante.
Sous l'évêque Louis de La Haye, en 1577, René, seigneur d'Aradon,
fonda à Vannes un collège où les Bas-Bretons venaient apprendre
la langue des Gallos, d'où le proverbe Bon Breton de Léon, bon Français
de Vanne. Vannes devint donc comme le chef-lieu de la langue française
en Bretagne. Son collège acquit, sous la direction des jésuites,
une prospérité toujours croissante, jusqu'à compter 1 500 élèves
au XVIIIème siècle. Supprimé en 1791, il fut rétabli
en 1804 et a compté encore, sous l'Empire, 600 élèves. C'est aujourd'hui
un de nos bons lycées. Sous la Révolution, Vannes vit se dessiner
dans ses murs et autour de ses murs les différents partis qui divisèrent
alors la France. Tandis que l'évêque Amelot, refusant de prêter
le serment et de quitter son palais épiscopal conformément au décret,
appelait à lui les paysans en armes, la garde nationale de Vannes,
docile aux ordres des administrateurs du département, repoussait
des murs les agresseurs et le 13 février 1791 leur tuait vingt-six
hommes. M. Amelot fut envoyé à la barre de l'Assemblée nationale
et remplacé par Dl. Lemasle, curé de Pontivy. Deux autres fois encore
Vannes eut à lutter contre les campagnes, et le fit victorieusement,
grâce à l'énergie de ses magistrats. Puis elle vit passer Hoche,
se rendant à Quiberon, et le vit revenir vainqueur des Anglais et
des émigrés. Il y trouva les représentants de l'Assemblée en mission
dans le pays et leur rendit compte de l'expédition. Plus de 500
prisonniers de Quiberon furent fusillés à La Garenne, à L'Ermitage
et sur la rive droite de la baie de l'Armor, au lieu-dit encore
aujourd'hui la Pointe des émigrés. Parmi ceux qui tombèrent à La
Garenne, nous citerons MM. de Sombreuil, d Broglie de La Landelle,
de Hercé, évêque de Dol. En l'an VIII, Vannes fut surprise par Cadoudal
et sont armée divisionnaire de Vanne. Les républicains prirent la
ville. En 1815, il y eut encore un mouvement, celui de la petite
chouannerie, auquel prirent part les élèves du collège. Le duc d'Angoulême
vint ensuite dans cette cité, et l'on y célébra un service funèbre
pour les victimes exhumées de Quiberon.
Les siècles n'ont pas
beaucoup changé l'aspect de Vannes. Étages qui surplombent, pignons
en zigzag donnent à ses rues une physionomie moyen âge. Ses édifices
publics même sont pour la plupart d'antique origine. La cathédrale
Saint-Pierre, dont quelques parties datent du XIIIème
et du XVème siècle, était accompagnée d'une tour terminée
par une belle flèche pyramidale qui a été détruite par la foudre
en 1824 ; son portail septentrional en est la partie la plus remarquable
; l'évêché occupe l'ancien couvent des Carmes déchaussés la préfecture,
construction nouvelle sans intérêt, occupe en dehors de la ville
l'emplacement de l'ancien couvent des Jacobins. L'hôtel de ville,
qui date de 1680, était autrefois surmonté d'un beffroi, qui a été
abattu il y a une vingtaine d'années. Parmi les monuments publics,
citons encore l'hôtel-Dieu, l'hôpital général et l'hospice Saint-Yon,
qui reçoit les incurables. L'ancien couvent des Carmélites est occupé
par une maison centrale de détention pour les femmes celui des Visitandines
est converti en caserne ; la halle aux grains est une élégante construction
moderne. La salle de spectacle n'est autre que cette célèbre salle
haute de la Halle où se sont réunis les états de 1532. Nous ajouterons
que la chapelle du collège est un édifice d'un style remarquable,
et nous mentionnerons la Tour du Connetable, dernier débris du fameux
château de l'Hermine, démoli par l'ordre de Louis XIII. Ses salles
sont occupées par le Musée archéologique, un des plus riches de
France en antiquités préhistoriques et celtiques. Vannes possède
encore quelques restes de ses anciennes murailles ; nous citerons
la tour Juliette, La poudrière, la porte Saint Paterne et la porte
Neuve, qui était à l'angle de l'ancien château de la Motte ; enfin
plusieurs maisons en bois ou en pierre du XVème, et du
XVIème, siècle, entre autres celle de saint Vincent Ferrier
et le château Guillard, méritent l'attention par leur décoration
extérieure. Les deux principales promenades de la ville sont celles
de la Garenne et de la Rabine qui longe le port.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.