Nervers - Préfecture de la Nièvre
Retour au Département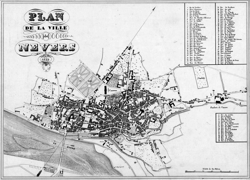

Nevers dont on ne sait rien avant l'arrivée
de César, est désignée par le conquérant sous le nom de Noviodunum
Ǽduorunz; ce nom de Noviodunum paraît être d'origine celtique nov,
rivière don, montagne. Elle emprunta ensuite à la rivière Niveris,
la Nièvre, qui se jette tout auprès dans la Loire, celui de Nevirnum,
Nivernum, Nevedinum. Celui de Noviodinum reparut plus tard,
à l'expiration de la domination romaine. Quand César domptait la
Gaule, il fit de Nevers un de ses dépôts de vivres, d'armes et de
munitions ; mais, en son absence, deux Éduens, Viridumar et Éporédorix,
s'introduisirent dans la place et en massacrèrent la garnison romaine.
César vint lui-même y relever ses aigles.
Nevers, à la chute
de l'empire romain, eut sa part des calamités communes, le roi des
Huns y passa, la flamme à la main. D'autres conquérants barbares
la dédommagèrent.
Certes, Nevers était chrétienne avant l'arrivée
des Francs, quoiqu'on ne puisse admettre qu'elle eût reçu le christianisme
de trois disciples de saint Pierre, saint Savinien, saint Pollentien
et saint Altin, prétention que Jacques Taveau a essayé de soutenir,
et que Fleury a renversée. Mais Nevers n'avait point encore l'honneur
d'être un chef-lieu de diocèse; or, vers l'an 500, apparut pour
la première fois à Nevers un évêque, saint Eulode, qui était sourd
et muet, Dieu ne pouvait permettre que le pasteur chargé de prêcher
ses ouailles et de recueillir leurs gémissements demeurât dans des
conditions si peu favorables à l'exercice de ses fonctions aussi
saint Séverin appelé à Paris à cette époque en 505, pour guérir
le roi franc de la fièvre quarte, passa à Nevers et guérit aussi,
chemin faisant, le pauvre évêque. Dix ans après, Clovis érigea Nevers
en évêché.
Pendant longtemps, Nevers n'apparaît dans l'histoire
qu'à de rares intervalles. Elle vit s'assembler, en 765, le Champ
de mai convoqué par Pépin, lorsqu'il se disposa à entrer en Aquitaine
pour aller châtier Waïfre. Charles le Chauve y établit un hôtel
des monnaies. De l'époque de Richard le Justicier date le premier
château de Nevers, dont il reste encore quelques débris de murs
épais et massifs, de style saxon, avec fenêtres à plein cintre.
On peut les voir dans les murailles qui soutiennent la terrasse
de l'ancien couvent des oratoriens et dans quelques jardins particuliers.
La plupart des édifices de cette époque en France ont disparu, ou
ne sont arrivés jusqu'à nous qu'en ruine, ce qui tient, soit à leur
mauvaise construction, soit aux dévastations continuelles qui remplissent
l'histoire de ces siècles barbares. En 910, c'est la cathédrale
qui s'écroule ; en 953, c'est le comte de Paris, Hugues le Grand,
qui prend, pille et brûle la ville. Phénomène curieux la ville de
Nevers s'amoindrit, disparaît, s'anéantit presque; son ancienne
importance n'est plus que dans les souvenirs Noviodunum antiquissimum
castrum quidem, sed instar viculi exiguum ; et, à sa place,
ce sont ses faubourgs qui attirent la population, s'élargissent,
s'enflent autour des riches monastères de Saint-Genès, de Saint-Victor,
de Saint-Étienne, de Saint-Martin ; ce sont les paroisses de Saint-Arigle,
de Saint-Troès, de Saint- Pierre, de Saint-Laurent, qui virent et
prospèrent aux dépens du centre. On doit ajouter, au reste, que
des fléaux naturels avaient contribué à cette décadence. Nulle part
les incendies, les pestes ne furent plus répétés. La peste de 1094,
entre autres, fit de tels ravages que les habitants épouvantés croyaient
à la fin du monde. Il fallait refaire cette ville, ou du moins réunir,
resserrer, renfermer dans une muraille ses membres épars.
A la
fin du XIIème siècle, Pierre de Courtenay fit élever
à ses frais la nouvelle et dernière enceinte qui enveloppa les faubourgs,
depuis l'embouchure du petit ruisseau de Crou dans la Loire, jusqu'à
la Nièvre en 1194.
Cette reconstitution de Nevers porta presque
aussitôt ses fruits. Voici cette ville qui prospère. La libéralité
de Pierre de Courtenay remet aux religieux de Saint-Étienne le droit
de gîte, et accorde à la ville une charte d'affranchissement, confirmée
définitivement plus tard en 1231 par Gui de Forez et Mahaut Ier,
sanctionnée par lettres patentes de saint Louis. Par cette charte,
le comte renonçait à tous les droits exercés dans la ville et les
faubourgs, particulièrement à l'ost et à la chevauchée ; un crédit
de quarante jours pour l'approvisionnement de sa table, sa justice
et ses forfaitures, était tout ce qu'il se réservait. Les habitants
étaient autorisés à nommer quatre jurés pour administrer les affaires
principales, convoquer les habitants en cas de besoin, proclamer
le ban de vendange, etc.
Les bourgeois ne relèvent que de leur
propre juridiction et ne peuvent être emprisonnés que pour vol,
rapt ou homicide, à moins de surprise en flagrant délit. Le bailli
rend la sentence, assisté de quatre bourgeois désignés par les jurés
; point d'appel pour le citadin, mais l'étranger peut en appeler,
et, en ce cas, le comte ou son bailli adjoint aux premiers assesseurs
deux de ses chevaliers. Le comte ne doit jamais recevoir plus de
3 sous pour les frais du procès et plus de 30 pour l'amende. Enfin
la commune reçoit la faculté d'acquérir des membres nouveaux par
la concession du droit de bourgeoisie à tout étranger qui y sera
domicilié depuis un an et un jour, exception faite des sergents
et des serfs du seigneur.
Assurément la postérité doit honorer
la mémoire de Pierre de Courtenay et de ses successeurs, qui se
signalèrent par un si généreux abandon de leurs prérogatives et
prévinrent, de six siècles à l'avance et dans les ténèbres du Moyen
Age, la grande émancipation de 1789, d'autant plus que ces concessions
paraissent avoir été volontaires de leur part, et que l'on ne voit
pas que les habitants aient été obligés de les arracher de vive
force.
Ils ne se réservaient, en effet, qu'une cense personnelle,
payable à la Saint-Martin d'hiver, variant de 40 sols à 12 deniers,
selon la fortune de chaque famille, et dont la répartition était
laissée aux bourgeois eux-mêmes. Deux autres droits seigneuriaux,
mais peu vexatoires, subsistèrent aussi ; l’un jusqu'en 1587, l'autre
jusqu'en 1789. Par le premier, tout habitant de Nevers, à moins
qu'il ne logeât dans le quartier privilégié de Saint-Étienne, devait
se présenter, le jour de son mariage, devant le comte, précédé des
violons, et lui donner « pour le festin de noces, 4 deniers, un
pain, deux plats de chair et une quarte de vin. » L'autre était
le droit de trumeau ou sabot le comte et l'évêque prenaient, l'un
le trumeau de devant, l'autre le trumeau de derrière « des chascunes
bestes au maille, bœuf ou vasse, vieille ou jeune, » tuées en
la grande boucherie.
Nevers devait aimer ses comtes. Et elle
les aimait, si l'on en juge par les réceptions brillantes qu'elle
leur faisait. Ainsi, lorsque le comte Jean, fils du duc de Bourgogne
Philippe le Hardi, fit sa première entrée, la ville lui offrit deux
tonneaux de vin, plusieurs lamproies des torches. L'année suivante,
nouvelle entrée, deux autres tonneaux de vin. Après sa captivité
chez les Turcs il vient en 1400, on le comble coupe d'argent doré
à couvercle en or, douze tasses d'argent, une boîte d'épices, trois
tonneaux de vin vingt-quatre lamproies, et nombre d'autres poissons,
sans parler du vin pour les officiers. Et dans le même temps, occupés
de le faire sortir de captivité, les bourgeois de Nevers contribuaient
pour 1,000 livres d'or à sa rançon, alors qu'une peste terrible
les décimait au point que le receveur sollicita un dégrèvement de
contribution. Ils savaient, dans l’occasion, mettre dans leurs hommages
une certaine galanterie lorsque Bonne d'Artois, seconde femme de
Philippe de Bourgogne, entra à Nevers en 1414, un ange habillé de
plumes de paon, lequel courait sur une corde de 80 toises, lui mit
sur la tête, à elle et à son fils Charles, un chapeau de Fleurs
artistement travaillé. Ils ne reçurent pas moins bien Charles VI,
qui vint deux fois dans leurs murs, et qui leur remit 200 livres
de tailles arriérées, pour être employées à la construction d'un
pont sur la Nièvre.
C'était le temps, à Nevers comme ailleurs,
des grandes constructions d'églises et de forteresses. Du XIVème
siècle, en effet, date la cathédrale dont la reconstruction fut
commencée par l'évêque Guillaume Ier, de Saint-Lazare.
C'était la quatrième fois que l'on bâtissait l'église de Nevers.
Un premier édifice avait été élevé au VIème siècle, un
second au sous l'invocation de la Vierge, de saint Gervais et de
saint Protais ; un troisième enfin par l'évêque Jérôme, sous Charlemagne,
et cette fois dédié à saint Cyr et à sainte Juliette. En 1210, un
violent incendie dévora cette église, et ce ne fut pas grand dommage,
car elle était encore couverte en chaume. Guillaume fit les choses
plus grandement. La nef de l'église, dont on peut admirer la pureté
comme exemple de gothique sévère et de la grande époque, lui appartient.
Les sculptures y sont d'une grande élégance ; les chapiteaux y représentent
les feuillages indigènes, fraisier, chardon, chêne et peuplier.
On y remarque surtout un chapiteau où est sculptée la légende de
saint Cyr et de Charlemagne ; l'empereur, menacé par un sanglier
furieux, s'est jeté à genoux pour invoquer le saint, qui apparaît
dans le moment même sur le dos du monstre et le tient immobile sous
lui. Le chœur et le sanctuaire sont d'une date différente du XIVème
et XVème siècles, et portent, en conséquence, un autre
caractère. La tour qui domine extérieurement l'édifice et qui fait
un gracieux effet, quoique peu en harmonie avec le reste ne fut
commencée qu'en 1509 par l'évêque Bahier, et achevée en 1528. On
était en pleine Renaissance et cela ne laisse pas d'être curieux
de voir la Renaissance s'essayer une fois par hasard dans le gothique,
accoler son génie à celui du moyen âge et répandre à profusion sur
une haute tour d'église, au flanc de l'austère ogival primitif,
son luxe plus gracieux qu'imposant de balustrades à jour, de statues
en pleine saillie, de dais richement brodés dans la pierre, et de
tourelles angulaires.
Pour entreprendre de si grandes choses,
il fallait que l'évêque de Nevers fût un puissant personnage au
XIIIème siècle. Il est à remarquer que c'est lui qui,
en 1028, avait pris le premier le titre d'évêque par la grâce de
Dieu. Il avait des serfs nombreux. Lorsqu'il faisait sa première
entrée dans la ville, les quatre barons de Cours-les-Barres, de
Givry, de Druy, de Poiseux, le portaient sur leurs épaules depuis
l'abbaye de Saint-Martin jusqu'à la cathédrale. Comme vassal du
roi de France, il lui devait le service militaire ; en 1224, Raynald
conduisit à Tours son contingent ; en 1244, saint Louis fit citer
à Chinon Robert Cornu, qui s'était affranchi de cette obligation,
Il faut reconnaître, d'autre part, qu'il avait à compter avec
ses diocésains et qu'il n'entrait pas dans la ville sans conditions.
Les prieurs des couvents de Saint-Étienne et de Saint-Martin l'attendaient
sous le porche et ne le recevaient qu'après lui avoir fait jurer
de maintenir leurs privilèges et ceux des bourgs. Les chanoines
aussi étaient des hommes puissants. Depuis 1201, ils nommaient seuls
l'évêque, tandis qu'auparavant le peuple participait à l'élection.
Ils étaient soixante, vivant en commun, ayant la haute justice,
des vassaux qui prêtaient foi et hommage, des serfs taillables et
exploitables à volonté. Leur trésorier entrait au chœur en habit
de guerre, et y siégeait l'épée au côté, l'oiseau sur le poing,
en bottes et en éperons.
Vis-à-vis des bourgeois, l'évêque prenait
encore des engagements, et la scène symbolique qui se passait mérite
d'être rapportée. Le nouvel évêque, se rendant en pompe à la cathédrale,
rencontrait dans la rue de la Parcheminerie les échevins et devant
eux une chaîne tendue, la chaîne s'abaissait pour laisser passer
le cortège et se tendait de nouveau devant l'évêque, pour lui montrer
que ceux-là étaient de la ville, mais que lui n'en était pas encore
tant qu'il n'avait pas prêté le serment d'en respecter les franchises.
Il y a dans cette cérémonie je ne sais quelle fierté aragonaise
qui donne bonne idée des bourgeois nivernais. On en trouverait peu,
en effet, qui aient été plus jaloux de leurs privilèges. Eux-mêmes
nommaient leurs jurats, appelés échevins depuis 1288, et, chose
curieuse, ils admettaient les nobles, non les prêtres, à l'échevinage.
L'élection se faisait le second dimanche du carême ; les jours précédents,
le préconisseur parcourait la ville et criait à tous les habitants
qu'ils eussent à y prendre part sous peine d'un écu d'amande. La
salle du chapitre de l'abbaye de Saint-Martin était, avant la construction
de l'hôtel de ville, en 1436, le lieu où se réunissait l'assemblée.
Dans cette même abbaye se trouvait la voix de la cité, la cloche,
le gros saint de la communauté, comme on l'appelait. Elle avertissait
les bourgeois lorsque le guetteur toujours présent, qui logeait
dans le clocher de Saint-Martin avec sa famille, avait aperçu au
loin dans la campagne quelque objet menaçant pour la ville. Deux
fois par jour, elle annonçait de sa grande voix l'ouverture et la
fermeture des portes, et les cloches plus petites, placées aux portes
mêmes, répétaient l'avertissement d'un ton plus argentin. Les bourgeois
de Nevers ne s'en remettaient qu'à eux-mêmes pour leur propre défense
chaque quartier avait ses soldats (quartiniers) qui formèrent plus
tard les compagnies bourgeoises, et ce privilège leur fut confirmé
formellement par Charles VI, en 1421. Ces soldats étaient choisis
parmi les habitants qui élisaient les officiers. Ils excellaient
au tir de l'arbalète, dont une école fut établie, en 1409, aux Chaumes
de la Loire ; aussi Charles VII les incorpora parmi ses francs archers,
et Charles VIII les emmena en Italie. En 1524, le tir à l'arquebuse
fut substitué au tir à l'arbalète, et les arquebusiers furent organisés,
en 1621, par Charles de Gonzague, en une confrérie célèbre sous
le nom de compagnie de Saint-Charles.
C'est à l'industrie, au
commerce, que les habitants de Nevers devaient cette indépendance.
Les vins de la province se buvaient, au moyen âge, jusque sur la
table du roi. Des fabriques d'émaux, des verreries fameuses, qui
donnèrent à la cathédrale les beaux vitraux qu'on y admire, popularisaient
par leurs élégants produits le nom de Nevers. Les manufactures de
faïence, les plus anciennes du royaume, établies par les ducs de
Nevers à l'imitation de celles d'Italie, jouissaient d'une réputation
qui dura jusqu'au siècle dernier. Les artisans formaient des corporations
celle des pêcheurs existait depuis longtemps déjà en 1250 ; celle
des boulangers prit naissance après que Louis 1er (1303)
eut autorisé l'un d''eux à bâtir un four dans sa maison, rue de
la Tartre, et à y cuire pour le public.
Une industrie qui prit,
deux siècles plus tard, un grand développement à Nevers et aux alentours,
ce fut celle des forges ; à tel point que les habitants se plaignirent
au roi de la cherté du bois, et lui demandèrent la suppression et
démolition des forges, qui leur fut accordée en 1560.
Nevers
ne resta pas en arrière pour l'instruction. Dès 1009, nous voyons
le chapitre de Saint-Cyr nommer un certain Gaudon grammairien des
petites écoles pour les enfants laïques. C'est à Nevers que fut
transportée, en 1316 l'université d'Orléans, interdite par le pape
Jean XXII. Elle y eut, au reste, peu de succès, comme nous l'apprend
Gui Coquille. Les écoliers firent tapage, « et à certain jour
plusieurs particuliers citoyens de Nevers prindrent la chaize du
docteur, en cholère la portèrent sur le pont et la jetterent en
Loire, disant ces mots que de par le diable, elle retourne à Orléans
dont elle estoit -venue. »
C'est en 1535 que fut établie
à Nevers la première imprimerie. Nevers, au XVème siècle,
suivit, avec le duc de Bourgogne, le parti anglais et reconnut Henri
VI. Quand Charles VII l'eut emporté, elle fut un moment l'un des
foyers de la jacquerie. Il vint dans ses murs. Louis XII, François
1er y parurent également.
La Réforme s'y manifesta
d'une façon singulière. Jacques Spifame, évêque de la ville, homme
fort distingué, qui avait été maître des requêtes au parlement,
conseiller d'État et chancelier.de l'Université de Paris, un jour
de Pâques, se mit à administrer la communion aux fidèles dans l'église
de Saint-Cyr, en disant « Reçois la figure du corps de Jésus-Christ.
Ces paroles hérétiques en pleine solennité pascale, firent bondir
le doyen du chapitre. « Tu mens effrontément, mentiris impudentissime
! » s'écria-t-il et il corrobora son apostrophe d'un violent
coup de poing appliqué sur la bouche coupable. Un grand tumulte
s'ensuivit, et bientôt le prélat se rendit à Genève après avoir
résigné son évêché en 1559). Une passion l'avait conduit, dit-on,
à se faire protestant. Il vivait depuis longtemps dans une grande
intimité avec Catherine de Gaspence, femme d'un procureur au Châtelet.
Tous deux s'épousèrent à Genève. Mais déjà ils avaient des enfants,
un de ses neveux ayant contesté leur légitimité, pour la prouver
Spifame fabriqua un faux acte de mariage antidaté, traduit devant
le conseil de Genève, il y fut condamné à mort comme adultère, en
1566.
Gilles Spifame, son neveu et son successeur à l'évêché
de Nevers, travailla avec ardeur à détruire le protestantisme qui
se répandait de plus en plus dans son diocèse. En 1561, les calvinistes
formèrent une première réunion ; il y opposa une procession à la
tête de laquelle il parut en habits pontificaux et les échevins
en robe rouge. Malgré la protection que les réformés trouvaient
dans le comte de Nevers, François de Clèves, ils furent l'objet
de persécutions qui coûtèrent la vie à plusieurs d'entre eux, et
qui ne cessèrent qu'après l'avènement de Louis de Gonzague et la
nomination de Gui Coquille aux fonctions de premier échevin de la
cité en1568. La Saint-Barthélemy ne fit point de victimes à Nevers,
et cette ville parut tiède à la Ligue, dont le conseil général,
siégeant à Paris, adressa aux habitants une lettre pour exciter
leur zèle.
Nevers reçut successivement au XVIIème
siècle, Louis XIII et Louis XIV. Elle subissait alors, comme toutes
les parties de la France, les effets de la révolution qui s'opérait
dans le royaume. Le progrès irrésistible de l'unité monarchique
emportait partout les institutions libres que l'esprit d'indépendance
locale avait arrachées au moyen âge.
Dès 1566, l'ordonnance
de Moulins avait enlevé aux échevins de Nevers la connaissance des
affaires civiles ; en 1692, leur autorité fut encore diminuée par
l'institution d'un maire. La connaissance des causes criminelles,
et même des délits de police leur fut, enfin retirée, et ils né
gardèrent en définitive, pauvre débris de leur ancienne autorité,
que la proclamation du ban des vendanges. Leur charge devint même
un fardeau insupportable, par une ressemblance fort curieuse avec
celle des curiales dans l'empire romain en effet, les échevins,
en matière d'impôt, répondaient pour leurs administrés de leur fortune
et de leur corps, et Nevers, au XVIIème siècle, n'ayant
pu acquitter des impôts devenus très lourds, on vit les habitants
fuir l'échevinage comme un fléau, et l'intendant de la généralité
en fut réduit à désigner pour ce supplice municipal quatre des plus
notables citoyens, qui acceptèrent par force. Ceci se passait un
peu avant la Fronde, pendant laquelle Nevers fut sévèrement contenue.
L'activité industrielle de Nevers ne paraît pas cependant avoir
alors beaucoup diminué, puisqu'en 1710 on y créa un tribunal de
commerce. Le XVIIIème siècle, au reste, si remarquable
dans presque toutes les provinces de France par les constructions
d'utilité publique et les établissements de bienfaisance, rendit
à Nevers un grand service en la débarrassant pour jamais de ce fléau
de la peste qui semblait l'avoir prise en affection, et venait encore
de la dévaster deux fois au siècle précédent. Un conseil de santé,
établie 1721, prit des mesures assez habiles pour le chasser sans
retour. C'est encore au XVIIIème siècle que Nevers doit
sa belle promenade. Le vieux château, commencé vers 1475 par Jean
de Clamecy, comte de Nevers, orné et terminé par les ducs de Nevers
; des maisons de Clèves et de Gonzague ; la place Ducale, qui le
précède, et qui fut bâtie en 1608 par Charles II de Gonzague, sur
le modèle de la place Royale de Paris, existaient déjà. Mais le
parc ne formait qu'un grand carré long, le reste planté en vignes.
En 1767, une des plus jolies femmes du pays, Mme de Prunevaux, fort
aimée du duc de Nevers, s'y promenait avec lui. Elle lui fit observer
que la vigne ajoutée au parc en rendrait la promenade bien plus
agréable, et le duc, par galanterie, s'empressa de faire transformer
cette partie en jardin anglais. Le parc est devenu public, et c'est
à la charmante dame de Prunevaux que Nevers doit un de ses plus
beaux ornements.
A l'époque de la Révolution, Nevers entra dans
le mouvement de 89 et fit rédiger des cahiers tout à fait dans le
sens du tiers état. La Terreur y envoya Fouché de Nantes, suivi
de Collot d'Herbois et de La Planche, qui firent bruler toutes les
archives.
Nevers serait une jolie ville par sa situation en
amphithéâtre sur la rive droite de la Loire, si l'affreux percement
de ses rues ne rebutait pas le voyageur. Il y pourra remarquer cependant,
sans parler du nouveau du parc et de la cathédrale, la porte du
Crou, qui donne une idée imposante des constructions féodales (on
y a établi un musée lapidaire) le pont de dix-sept arches, mais
trop massif, construit sur la Loire ; l'arc de triomphe élevé en
mémoire de la victoire de Fontenoy, où il lira quatre mauvais vers
de Voltaire qui furent payés par un présent de cent louis ; la préfecture,
à l'entrée de la ville ; l'hôtel de ville, qui renferme une bibliothèque
de 20,000 volumes ; le théâtre, le palais de justice, qui occupe
le premier étage du Palais ducal et dont le second étage a reçu
le Musée Nivernais, remarquable par sa belle collection de faïences
artistiques. Il ne passera pas dans la rue de la Parcheminerie sans
saluer la maison du menuisier poète, modeste maisonnette où grimpe
un cep de vigne, pour attester qu'on y a chanté Bacchus. Ce poète,
c'est Adam Billaut, ou Maitre Adam, le Virgile au rabot, que sa
verve naturelle porta à faire des vers tout en continuant de gagner
sa vie le rabot à la main. C'est l'auteur de la fameuse chanson
:
Aussitôt que la lumière
Vient redorer nos coteaux.
Le
cardinal de Richelieu voulut le voir, et lui donna un vetement neuf
, une pension de cent écus et de quoi s'acheter une maison. Il a
laissé trois recueils les Chevilles, le Vilebrequin et le Rabot
; ce dernier n'est pas imprimé.
Le collège, aujourd'hui le lycée,
tenu alors à Nevers avec grand succès par les jésuites, y faisait
prospérer les études et comptait parmi ses professeurs le célèbre
père Bougeant. Gresset y fut régent de rhétorique et y composa Vert-Vert,
dont il allait égayer la supérieure même des Visitandines de la
ville. Ce sont là, avec le fameux révolutionnaire Chaumette, procureur
de la Commune de Paris pendant la première Révolution, les principaux
noms célèbres que Nevers peut citer.
Plan du site |
Moteur de recherche |
Page Aide |
Contact ©
C. LOUP 2025.