Histoire de la Nièvre

Le département de la Nièvre a été créé
à la Révolution française, le 4 mars 1790, en application de
la loi du 22 décembre 1789, à partir de l'ancienne province
du Nivernais.
L'histoire de ce département n'égale pas en
intérêt celle de quelques autres, que leur situation, leur richesse
ont mêlés davantage aux grands événements. Ce pays de montagnes,
caché au centre de la France, a eu une existence plus modeste
et plus obscure. À cheval sur la chaîne des monts du Morvan
(Mor, noir ; Van, montagne), qui se détache des montagnes
de la Côte-d'Or, possédant à la fois les sources de l'Yonne
et une partie de la rive droite de la Loire, son histoire et
ses intérêts se trouvent engagés également dans les deux bassins
de la Manche et de l'océan Atlantique. Mais son influence ne
rayonna bien loin ni d'un côté ni de l'autre.
Au temps des
Gaulois, son territoire était occupé, pour la plus grande partie,
par les Éduens (Ǽdui), et, pour la partie nord-ouest, entre
Clamecy, Cosne et La Charité, par les Sénonais (Senones). Quelques
dolmens ou menhirs encore debout, quelques haches en pierre
trouvées dans le sol, voilà tout ce qu'a laissé dans le pays
l'époque druidique. César vint, et deux fois s'en rendit maître.
L'administration romaine eut grand souci d'un pays si voisin
du centre de partage des eaux de la France, si propre à établir
des postes militaires inexpugnables, et enfin situé sur la route
d'Autun à Courges, deux des plus grandes villes de cette époque.
Aussi trouve-t-on de nombreux vestiges de voies, de camps romains.
Le sommet du mont Beuvray, particulièrement, était un centre
où aboutissaient plusieurs routes. Des savants ont prétendu
que l'ancienne Bibracte était située sur un plateau élevé de
680 mètres au-dessus de la mer. Une levée de terre circulaire
semble indiquer, en effet, ou une ancienne ville gauloise, ou
un camp romain. Le camp est plus probable. Il y en avait un
autre à Saint-Sauges, dont les traces sont encore visibles,
et Château-Chinon possède les ruines d'un fort bâti par les
Romains. Mais les plus curieux débris de ces temps sont les
ruines d'une ancienne ville trouvée à Saint-Révérien ; l'amphithéâtre
de Bouhy, des fragments de statues, de cippes trouvés à Entrains,
et surtout les thermes de Saint- Honoré. Les eaux thermales
et minérales que toute cette région doit à sa nature volcanique,
étaient sans doute une des causes les plus actives qui attiraient
les Romains.
Les thermes de Saint-Honoré, dont la découverte
s'est complétée en 1821 par des fouilles faites au pied même
des montagnes du Morvan, sont remarquables par une salle de
bains toute revêtue de marbre, au milieu de laquelle trois réservoirs
donnent une eau abondante, et par les nombreuses et brillantes
habitations dont les Romains avaient orné cette petite ville.
Ils y fondèrent même un hospice militaire où les bains se prenaient
dans dix-neuf bassins aujourd'hui rendus à la lumière. Si l'on
en croit Gui Coquille, savant magistrat du pays même, la plupart
des noms en de la province seraient dérivés de noms latins par
la transformation suivante villa Cecilii, Cézilly ;
Germanici, Germancy ; Cervini, Corbigny ; Cassii,
Chassy ; S"abinii, Savigny ; Ebusii, Bussy,
etc. La terminaison fréquente nay viendrait de la terminaison
non moins fréquente chez les latins anum: Lucianum, Lucenay
; Casianum, Chassenay ; Appiamcm, Apponay ; etc.
C'est sous la domination romaine que cette province, comme
presque toutes celles de la Gaule, reçut le christianisme prêché
par saint Révérien et le prêtre saint Paul, qui furent martyrisés
à Nevers en 274. Saint Pèlerin, apôtre de l'Auxerrois, vint
presque aussitôt après enseigner l'Évangile aux habitants du
district d'Entrains, où il eut à lutter contre les prêtres d'un
temple de Jupiter élevé dans ce pays. Pèlerin finit aussi par
le martyre ; car, Dioclétien étant devenu empereur, il fut persécuté
comme tous les chrétiens, enfermé dans un souterrain et enfin
massacré.
La domination des Burgondes, établie sous Honorius
dans le sud-est de la Gaule, comprit le Nivernais.
Les Francs
survinrent, et Clovis, à l’occasion de son mariage avec Clotilde,
s'en empara. A sa mort survenue en 511, ce fut le roi d'Orléans
qui eut le Nivernais. Sous les derniers Mérovingiens, sous les
premiers Carlovingiens, la province suit le sort du reste de
la Gaule. Louis le Débonnaire la donne ensuite à Pépin, roi
d'Aquitaine, dans le partage qu'il fait de ses États en 817,
et elle est de nouveau entraînée dans les vicissitudes des grands
événements de l'époque ; elle souffre de tous ses maux.
Rien
ne donne une plus terrible idée des ravages des Normands, que
de voir ces pirates barbares porter la désolation jusque dans
le Nivernais, au cœur même de la France. Nevers eut cependant
pour comte le fameux Gérard de Roussillon, héros de tant de
romans de chevalerie. Mais Gérard se brouilla, en 865, avec
Charles le Chauve, qui transféra son comté, avec l'Auxerrois,
à Robert le Fort. Puis, les liens de l'obéissance à l'autorité
royale se relâchant de plus en plus, à la fin du même siècle,
le Nivernais fit partie des domaines du duc de Bourgogne, qui
le donnait à gouverner à des comtes de son choix. L'un de ces
comtes, Rathier, suivant une tradition, fut accusé par un certain
Alicher d'avoir violé la femme du duc, son suzerain ; le procès
se plaida par le combat judiciaire, et déjà Rathier avait enfoncé
son épée dans la mâchoire inférieure de son adversaire, quand
celui-ci le frappa d'un coup mortel. Le suzerain offensé et
vengé était alors Richard le Justicier. Il donna le fief à un
certain Séguin. Henri le Grand en investit ensuite Otto-Guillaume,
fils d'Adalbert, roi d'Italie, qui, en 992, le donna en dot
à sa fille Mathilde, en la mariant avec Landry, sire de Metz-le-Comte
et de Monceaux.
C'est de ce moment que date l'existence séparée
du Nivernais. Il eut ses comtes distincts, en même temps comtes
d'Auxerre. Les autres petits seigneurs du pays, vassaux du comte,
se fortifiaient à la même époque dans leurs châteaux et se rendaient
presque indépendants, faisant à l'égard des grands vassaux ce
que les grands vassaux faisaient à l'égard du roi.
Maintenant
nous sommes en pleine vie féodale. Guerres continuelles, de
voisinage, à droite, à gauche, principalement avec les dues
de Bourgogne à propos du comté d'Auxerre. Le plus remarquable
des comtes de Nevers dans cette période est Guillaume 1er
en 1040. Le chroniqueur assure qu'on ne trouverait pas, dans
toute sa vie, une seule année de paix. Autour de lui, il entretenait
sans cesse cinquante chevaliers, et cela ne l'empêchait pas
d'avoir toujours 50,000 sous d'argent dans ses coffres, ce qui-est
assez remarquable pour l'époque. II battit le fils du duc de
Bourgogne. Moins heureux lorsqu'il porta secours au roi de France
contre le seigneur du Puiset, il fut fait prisonnier au siège
de ce château qui tint en échec la faible royauté de ce temps.
Vers la fin de ce siècle, le Tonnerrois fut réuni par héritage
au Nivernais et à l'Auxerrois, et Guillaume II porta le titre
de comte d'Auxerre, de Nevers et de Tonnerre. Ce Guillaume partit,
en 1101, avec 15,000 hommes pour la Palestine, passa par Constantinople,
perdit à peu près tout son monde en Asie Mineure, et arriva
presque nu à Antioche, d'où il revint en Europe.
Il fut un
des fidèles alliés de Louis le Gros. Comme il revenait de combattre
le fameux Thomas de Marle, sire de Coucy, il fut fait prisonnier
dans une rencontre avec Hugues le Manceau qui le livra au comte
de Blois. Celui-ci le tint quatre ans enfermés dans son château
avec une opiniâtreté qui résista longtemps aux sollicitations
de la plupart des puissances de l'époque. On s'est demandé la
cause d'un tel acharnement, et peut être la trouverait-on dans
le mécontentement que devait exciter chez certains seigneurs
la persistance des comtes de Nevers à aider les progrès de la
royauté.
L'existence des comtes de Nevers fut assez agitée
.à cette époque. C'est Guillaume III qui accompagne Louis VII
en terre sainte et qui va ensuite en pèlerinage en Espagne.
C'est Guillaume IV qui voit son comté dévasté par les comtes
de Sancerre et de Joigny et qui réussit à les battre à La Marche,
entre Nevers et La Charité (1163). Cette guerre lui avait coûté
fort cher ; il avait fait des dettes comment les payer ? Or,
écoutez comment s'y prenait un débiteur féodal pour rétablir
ses finances. La ville de Montferrand passait pour très riche
et renfermait, disait-on, un magnifique trésor. Guillaume prend
la route de Montferrand, se jette sur la ville, la pille et
emmène le seigneur du lieu en disant aux habitants qu'il le
leur rendra quand ils auront payé une certaine somme. Un peu
plus tard, on le voit marcher sous la bannière du roi Louis
le Jeune contre le comte de Châlons. Puis, pour expier tous
ses péchés, il va en terre sainte et meurt à Saint- Jean-d'Acre.
Le clergé ne lui sut aucun gré de cette dévotion tardive, et
Jean de Salisbury, écrivant à l'évêque de Poitiers, lui fait
cette triste oraison funèbre qui pourrait aussi bien s'appliquer
à la plupart des seigneurs féodaux de ce temps. « Ce n'est ni
par les traits des Parthes ni par l'épée des Syriens qu'il a
péri ; une si glorieuse fin consolerait ceux qui le regrettent
; mais ce sont les larmes des veuves qu'il a opprimées, les
gémissements des pauvres qu'il a tourmentés, les plaintes des
églises qu'il a dépouillées, qui sont cause qu'il a échoué dans
son entreprise et qu'il est mort sans bonheur au champ de la
gloire. »
De tous ces comtes aventureux, le plus célèbre
et le plus malheureux fut Pierre de Courtenay. Il n'était comte
de Nevers que par sa femme. En effet, avec Guillaume V s'était
éteinte la descendance mâle, et le fief avait fait retour à
la couronne. Philippe-Auguste eut la générosité de le rendre
à Agnès, sœur de Guillaume V, à laquelle il fit épouser Pierre
de Courtenay, petit-fils de Louis le Gros, et, par conséquent,
de sang royal. A la mort d'Agnès, Pierre continua de gouverner
le Nivernais, comme chargé de la garde-noble de ce fief pour
sa fille Mahaut, que le roi de France maria plus tard avec Hervé,
sire de Gien. À ce moment, Pierre de Courtenay se retira dans
ses autres domaines. Quelque temps après, appelé au trône de
l'empire latin de Constantinople, il partit pour en prendre
possession mais un Comnène qui régnait en Épire l'arrêta par
trahison, et le tint si bien prisonnier qu'on n'eut plus jamais
de nouvelles de son sort.
Les comtes de Nevers et Pierre
de Courtenay, le premier de tous, se montrèrent libéraux dans
la question communale. Nevers, Clamecy obtinrent des franchises.
Des règlements furent publiés, d'accord avec les principaux
barons du pays, pour protéger les agriculteurs dans leurs travaux,
pour faciliter les mariages des femmes serves avec les hommes
des autres seigneurs, sauf toutefois l'autorisation de leur
propre seigneur, enfin pour maintenir la paix publique, et le
bannissement fut prononcé contre quiconque, ayant détruit ou
incendié une maison, refuserait la réparation exigée.
L'intervention
de la royauté n'était donc pas fort impérieusement réclamée
par l'intérêt des peuples dans ce pays. Mais la royauté, encore
plus guidée par l'ambition d'un pouvoir qui sent croître ses
forces que par ce beau motif du bonheur des peuples, intervenait
partout.
En 1280, un arrêt du parlement interdit aux comtes
de Nevers de créer des nobles. C'était le temps de l'impitoyable
Philippe le Bel. Par un nouvel arrêt du parlement, le comte
de Nevers se voit confisquer ses comtés de Nevers et de Rethel
pour avoir refusé de venir se justifier, en cour des pairs,
de quelques violences contre le clergé et la noblesse de son
fief. Il est vrai que, sous Louis le Hutin, la féodalité regagne
du terrain, et ce roi promet, en 1316, par lettres patentes,
de ne plus permettre les empiétements de ses officiers sur la
juridiction des comtes de Nevers. Une nouvelle famille de comtes
était encore une fois venue s'asseoir sur le siège comtal de
Nevers. Yolande, seule héritière en 1272, avait épousé Robert
de Dampierre, qui fut quelque temps comte de Nevers par sa femme,
et, après la naissance de leur fils, Louis ler continua
de gouverner le fief. Lui-même devint comte de Flandre. Philippe
le Bel accusa Louis de Nevers d'avoir soulevé les Flamands,
et le fit emprisonner. Rendu à la liberté, il en usa pour contester
à Philippe le Long son droit de succession au trône, de concert
avec le duc de Bourgogne, le comte de Joigny, etc. Un arrêt
du parlement confisqua toutes ses seigneuries, qui lui furent
peu après rendues. Louis II épousa la fille de Philippe le Long,
et devint, du chef de son grand-père et de son père, comte de
Flandre et de Nivernais en 1322. On l'appelle souvent Louis
de Crécy, parce qu'il mourut à la bataille de Crécy, en 1346.
Le Nivernais souffrit alors de l'invasion des Anglais. Ils le
ravagèrent après la bataille même de Crécy, et, dix ans après,
à l'époque du désastre de Poitiers, ils s'emparèrent de La Charité,
d'où leurs partis désolèrent la province. En 1319, elle fut
obligée de se racheter d'un nouveau pillage, lors du passage
de l'armée conduite par Édouard III. Louis III de Male avait
obtenu de Philippe de Valois des lettres patentes qui érigeaient
en pairie viagère les comtés de Nevers et de Rethel. Il ne laissa
qu'une fille, Marguerite, qui épousa Philippe le Hardi, duc
de Bourgogne, et lui porta à la fois la Flandre et le Nivernais.
Les deux époux détachèrent le comté de Nevers et le donnèrent
à l'aîné de leur fils, Jean sans Peur ; et celui-ci le céda
à son frère Philippe, qui se fit tuer à Azincourt. Les fils
de ce Philippe moururent aussi, ne laissant qu'une fille, Élisabeth,
et les Nivernais virent encore arriver un seigneur étranger
; c'était le duc de Clèves. Son petit-fils, François 1er,
se distingua par ses talents militaires et obtint l'érection
définitive du Nivernais en duché-pairie (1538). Les seigneurs
de Nevers firent alors exécuter un travail qui était bien dans
l'esprit de cette époque de fusion, de centralisation, d'étude,
c'est-à-dire la rédaction des coutumes de la province en 1534,
dont les états provinciaux convoqué en 1490 avaient jeté les
bases.
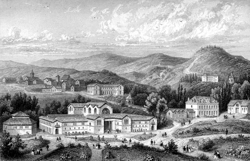
Dans les guerres de religion, les Nivernais
se montrèrent d'abord en majorité très catholiques et assez
intolérants ; mais à la fin ils changèrent et se rallièrent
à Henri IV. Leur pays fut, après Henri IV, le centre de cette
nouvelle guerre folle que les seigneurs formèrent contre Marie
de Médicis. La mort du maréchal d'Ancre apaisa tout.
La maison
de Gonzague possédait alors le Nivernais depuis le mariage de
Louis de Gonzague avec Henriette de Clèves, seule héritière
(1565). Le cardinal Mazarin acheta le duché (1659), qui, à sa
mort, passa à son neveu Philippe-Julien Mazarin, et sa maison
l'a possédé jusqu'en 1789. Quelques-uns des derniers ducs de
Nivernais se sont distingués au XVIIème et au XVIIIème
siècle par leur esprit, leur goût pour la littérature. Le dernier
de tous, à la fois auteur de gracieuses poésies légères et ambassadeur
à Rome, à Berlin et à Londres, perdit ses biens à la Révolution,
et sut vivre en sage, modestement, jusqu'en 1798.
Quant
à la province, elle forma à peu près le département de la Nièvre.
Auparavant, elle était un des trente-deux gouvernements militaires,
et se divisait, pour l'administration financière, en quatre
élections, dont Nevers et Château-Chinon, faisaient partie de
la généralité de Moulins; Clamecy, la troisième, de la généralité
d'Orléans; La Charité, la quatrième, de la généralité de Bourges.
Pour la justice, elle était comprise dans le ressort du parlement
de Paris mais elle avait sa coutume écrite, dont on a parlé
plus haut, sa chambre des comptes établie au nom du duc de Nivernais
son hôtel des monnaies, qu'on faisait remonter à Charles le
Chauve; enfin ses Grands-Jours, institués en 1329 par Louis
Il, tribunal d'appel composé de « trois prud'hommes, un chevalier
et deux gradués, pour juger les appeaux de Nivernais, tant des
prévôts que des baillis, » avec pouvoir de juger, retenir ou
renvoyer. Il y avait trois assises des Grands-Jours avant 1563
; elles furent alors réduites à deux par un édit royal. Le Nivernais
comptait 273,890 habitants. On ne peut omettre, dans l'histoire
du département de la Nièvre, celle du commerce tout spécial
qui le fait vivre et l'enrichit, d'autant plus qu'elle présente
des incidents assez curieux. Il s'agit du commerce des bois.
Les hautes montagnes du Morvan attestent que les volcans ont
remué ce sol ; et, en effet, si l'on perce la couche de sable
qui le recouvre, on trouve un fond de basalte et de granit.
Cette chaude nature du sol a produit de tout temps une riche
végétation de forêts. Si, aujourd'hui qu'on a tant exploité
les bois, le département de la Nièvre en possède encore 204,000
hectares sur 6 millions qui existent en France, combien en devait-il
être couvert lorsque la France entière, au XVIème
siècle, en possédait 30 millions d'hectares !
C'est à cette
époque, en effet, que le commerce se développant les communications
s'ouvrant de toutes parts, et Paris, de plus en plus peuplé,
manquant de bois, les Nivernais imaginèrent d'expédier le leur
à la capitale. Une compagnie de marchands se forma sous la raison
René Arnoult et compagnie, et des lettres patentes lui furent
accordées, qui portaient « autorisation de flotter sur les rivières
de Cure et d'Yonne, sans qu'il fût donné empêchement par les
tenanciers et propriétaires ou autres possesseurs d'aucuns moulins,
écluses, ou ayant droit de seigneurie, pêcheries ou autres,
et défense au parlement de Dijon de s'immiscer dans les contestations
sur le flottage des bois, attribuées spécialement aux prévôts
et échevins de la bonne ville de Paris en première instance,
et, par appel, au parlement de Paris. » Le flottage dont il
est ici question avait été, dit-on, déjà employé en 1490 sur
la rivière d'Andelle ; mais c'est véritablement à Jean Rouvet
que l'on attribue en 1549 l'invention de ce moyen de transport
au profit de la compagnie susdite. Son système consistait à
retenir par écluses les eaux au-dessus de Cravant, puis à les
lâcher en y jetant les bûches à bois perdu, pour les recueillir
ensuite au port de Cravant, et les expédier de là, par trains,
sur l'Yonne et la Seine jusqu'à Paris. Le même procédé est en
usage aujourd'hui. Des étangs creusés à la tête de chacun des
ruisseaux qui vont former ou grossir l'Yonne amassent l'eau
; dès qu'on lève les pelles, elle s'écoule avec impétuosité,
et le torrent emporte les bûches ; les premières, la cataracte
franchie, sont jetées à droite et à gauche du ruisseau inférieur
et s'y arrêtent c'est ce qu'on appelle border la rivière ; il
ne reste plus alors qu'un goulet étroit, au milieu du cours
d'eau, par où les autres sont emportées rapidement. On passe
ensuite à l'opération qui s'appelle toucher queue, c'est-à-dire
qu'on déborde le ruisseau et qu'on ramène dans le milieu les
bûches égarées sur les rives, pour les envoyer rejoindre celles
qui ont marché plus vite. Arrivées au port, elles sont toutes
arrêtées, tirées de l'eau, triées selon les marques des divers
marchands, et empilées jusqu'à la saison d'automne, qui permet
d'en former des trains sur la rivière et de les envoyer ainsi
à Paris.
Mais les marchands nivernais ne jouirent pas sans
conteste des avantages qui leur avaient été accordés. Les propriétaires
riverains se plaignaient de la servitude qui leur était imposée,
du chômage que souffraient leurs moulins. D'un autre côté, les
marchands de Paris, favorisés par la juridiction parisienne
à laquelle avaient été attribuées toutes les contestations en
cette matière se rendirent maîtres des prix ; et, en 1704, ils
gagnaient 30 livrés sur la corde de 36 livres 10 sols, tandis
que, les frais déduits, il ne revenait aux propriétaires que
5 sols par corde. Les propriétaires, les marchands forains se
liguèrent contre cette tyrannie et s'entendirent pour flotter
à leur gré, quelques-uns même pour conduire des trains jusqu'à
Paris. L'autorité intervint. Le subdélégué de l'hôtel de ville
de Paris résidant à Auxerre se rendit sur le port de Clamecy
avec une brigade à cheval et se vit entouré d'une foule menaçante
de 5 ou 600 personnes, qui s'armèrent de bâtons et de bûches
prises dans les piles, qu'ils aiguisaient par le bout. « Allons
s'écriaient-ils marchons allons à la guerre ; mourir aujourd'hui
ou mourir demain, cela est égal ; voilà de beaux hommes bien
habillés ; il faut les jeter à la rivière. Le subdélégué leur
défendit de toucher aux piles. « Eh monsieur, lui dit l'un d'eux,
je n'aurais qu'à rencontrer un chien enragé. » L'exaspération
allait croissant, les bâtons étaient levés ; ne se sentant pas
en force pour lutter, l'officier public se retira et dressa
le procès-verbal où ces détails sont écrits. Depuis ce temps,
le flottage est libre ; et pourtant il existe encore une rivalité
entre les marchands nivernais et ceux de Paris, puisque le ministre
de l'intérieur a dû intervenir en 1850 pour régler le partage
des flots de l'Yônne.
Durant la guerre franco-allemande
de 1870-1871, l'invasion s'arrêta aux limites mêmes de ce département,
Nevers

Nevers est une ancienne crié des Gaules
dont il est fait mention dans le VIIème livre des
Commentaires de César sous le nom de Noviodunum. C'était dès
lors une ville fortifiée, puisque ce général, partant pour une
expédition, y laissa, comme dans un lieu de sûreté, les otages
des Gaulois, ses provisions de vivres, ses bagages et sa caisse
militaire.
L'ancienne ville est comprise dans l'espace où
se trouvent le château et la place Ducale, l'église et le cloître
St-Cyr, les anciens couvents des jacobins, des récollets et
des oratoriens, et les rues de la Parcheminerie, des Rétifs
et des Marmousets. Les murailles de cette ancienne ville subsistaient
encore il y a environ deux cents ans, et alors l'espace qu'elles
renfermaient s'appelait la Cité. Il en reste aujourd'hui des
fragments parfaitement conservés dans les murs qui soutiennent
les terrasses de l'ancien couvent des oratoriens et de la maison
Dubourg, et quelques vestiges dans les maisons et les jardins
de plusieurs particuliers. Une nouvelle enceinte fut commencée
en 1194 par Pierre de Courtenay, comte de Nevers ; qui voulut
renfermer dans la ville le bourg de St-Etienne, les abbayes
de St-Martin, de Notre-Dame, de St-Sauveur et de St-Victor,
plusieurs autres monastères et les faubourgs. Les murailles,
très-hautes et d'une grande épaisseur, furent construites avec
beaucoup de soins et de dépenses ; on n'y employa que des matériaux
de choix. La Loire et la Nièvre les baignaient au sud, partout
ailleurs elles étaient entourées d'un fossé large et profond.
En plusieurs endroits elles étaient munies au dedans de remparts
de terre élevés jusqu'au marchepied ; et dans tout leur contour
intérieur , on avait ménagé une rue assez large pour que les
voitures pussent y circuler. Enfin dans le courant du XVème
siècle, on y ajouta encore, de distance en distance, de grosses
tours rondes, casematées el couronnées de créneaux et de mâchicoulis.
Ces murailles existent encore presque partout, mais plus ou
moins dégradées. La plupart des tours existent pareillement
: les unes sont à demi ruinées, d'autres ont été réparées et
forment aujourd'hui des maisons assez commodes. Les portes de
la Barre , de Nièvre et des Croux furent construites en même
temps que la nouvelle enceinte : les autres le furent plus tard.
Elles étaient toutes couronnées de créneaux et de mâchicoulis,
fortifiées de deux tours casematées et munies d'un boulevard
en avant.
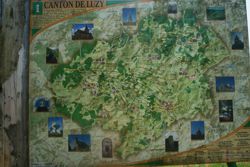
La porte des Croux, la seule qui subsiste
et qui puisse donner l'idée de ce qu'étaient les autres, fut
rebâtie en 1393. Outre la force de sa citadelle, Nevers, par
sa position, était une place très-importante dans le temps où
la France était bornée par la Loire, l'Aquitaine, l'Auvergne
et le Berry, qui obéissaient à d'autres souverains. Pépin le
Bref la choisit pour le centre de ses opérations dans la guerre
acharnée et cruelle qu'il fil au malheureux Waifre, duc d'Aquitaine.
Pendant cette guerre Pépin tint à Nevers, en 765 , l'assemblée
des grands du royaume, appelée alors champ de mai. Dans le IXème
siècle. Charles le Chauve y séjourna plusieurs fois, el y établit
sa monnaie. En 952 la ville de Nevers fut assiégée et prise
par Hugues, comte de Paris, qui la livra aux flammes. La duchesse
de Nevers s'y retira en 1617 et y fut assiégée par le maréchal
de Montigny; mais le siège fut levé peu de temps après. Les
Anglais dévastèrent les faubourgs et les environs dans le XVèmesiècle,
et les lansquenets dans le XVIème.
Un évêché
fut établi à Nevers vers la fin du Vème siècle. En
865 cette ville devint le chef-lieu d'un comté, auquel on donna
le nom de Nivernais, et que Charles le Chauve joignit aux autres
possessions de Robert le Fort : plusieurs conciles de Nevers
ont figuré dans nos guerres civiles. Le comté de Nevers fut
érigé en duché pairie en 1538. Il paraît à peu près certain
que l'affranchissement de la commune de Nevers remonte à Pierre
de Courtenay, en 1194; Ducànge, au mot Communantia, le dit expressément
et cite la charte. Nevers serait donc une des plus anciennes
villes municipales, dont l'affranchissement remonterait au moins
à soixante ans avant l'admission, pour la première fois, des
communes aux assemblées générales de la nation. Cependant on
ne fait remonter ordinairement l'établissement de la commune
de Nevers qu'au 27 juillet 1231, époque où Guy II, comte de
Forez et de Nevers, lui accorda une nouvelle charte, qui, concédant
probablement de plus amples privilèges aux habitants, aura fait
oublier l'ancienne. Cette charte de Guy II fut signée par quinze
barons, comme témoins et garants ; elle fut cautionnée en outre
par les archevêques de. Lyon, de Sens, et par les évêques de
Langres, d'Autun et d'Auxerre ; autorisée par une bulle du pape
Innocent IV , et confirmée par Charles, lieutenant du-roi Jean,
son père, eu 1356. Les princes de Nevers, les évêques, les lieutenants
généraux pour le roi et les grands baillis en promettaient l'exécution
avant d'être reconnus.
Nevers doit à Louis IV de Nevers sa
célèbre activité de faïencerie. Vers la fin du XVIème
siècle, il fait venir d'Italie Augustin Conrade, potier d’Albissola,
près de Savone, et ses frères, Baptiste et Dominique qu'il installe
au château du Marais à Gimouille. Leur réputation et leur réussite
deviendront telles, que Nevers s'affirmera au XVIIème
siècle comme capitale française de la faïence. Augustin Conrad
avait choisi Nevers pour s'implanter en France car tous les
éléments étaient réunis pour fabriquer de la faïence de qualité
(Les deux types de terre nécessaires, du bois qui chauffe mais
ne fait pas de feu que l'on trouve dans les forêts du Morvan,
la Loire pour le transport sécurisé de ses produits. On divise
sa production en trois grandes époques, caractérisées surtout
par le décor et l'emploi des émaux.
La Première, qui va
de 1566 à 1660, se distingue pas ses sujets mythologiques, ses
émaux jaune d'or, son émail blanc modelé avec des teintes de
bleu, de manganèse et de vert.
La seconde de 1668 à 1770
se signale par les émaux bleus, bleus et jaunes, bleus vert
jaune; les sujets traités sont des scènes galantes et champêtres.
La troisième de 1770 à 1789, moins originale que le précédentes,
s'inspire des céramiques orientales ainsi que des œuvres de
Rouen et de Moustiers. Enfin en 1789, Nevers produits ses célèbres
faïences patriotiques.
Bernadette Soubirous ou sainte Bernadette
(1844-1879); qui est à l'origine des apparitions de Lourde;
est morte comme moniale à la congrégation des Sœurs de la Charité
de Nevers et son cercueil vitré est visible à l'espace Sainte-Bernadette.
La ville de Nevers est dans une belle
situation, sur la rive droite de la Loire , au confluent de
la Nièvre. Elle est bâtie en amphithéâtre sur le penchant d'une
colline, et offre un aspect pittoresque, vue de la rive gauche
de la Loire; mais cette agréable position donne une pente rapide
à ses rues, qui, dans la partie située au bord de là rivière,
sont en général étroites et mal percées ; dans la partie haute
se trouvent le château et la cathédrale. L'entrée de la ville
par la route de Moulins est fort belle ; du côté de Paris on
y arrive par une porte en arc de triomphe élevée à la gloire
du vainqueur de Fontenoy. Cette porte, qui est aujourd'hui la
principale entrée, n'a servi pendant longtemps que pour les
manants du village de Varennes, qui étaient même obligés d'en
faire les réparations. L'arc de triomphe qui existe aujourd'hui
fut élevé en 1746 à l'occasion de la célèbre victoire de Fontenoy
; on lisait sur le fronton extérieur ces deux vers :
Au grand homme modeste, au plus doux des vainqueurs,
Au
père de l'État, au maître, de nos cœurs.
Et ceux-ci
sur le fronton intérieur :
A ce grand monument qu’éIeva
l'abondance,
Reconnaissez Nevers, et jugez de la France.
Ces vers, que l'on prendrait pour l'ouvrage d'un écolier
de rhétorique, sont cependant de Voltaire.
On traverse la
Loire à Nevers sur un pont en pierre de vingt arches, de construction
un peu lourde, mais solide ; il se joint en face de la ville
à une levée en pierre fort longue et fort large. Les quais sont
bordés de maisons étagées les unes au dessus des autres et assez
bien bâties
Le Château de Nevers, dont la façade forme un
des côtés de la principale place de cette ville, paraît avoir
été bâti par les princes de la maison de Clèves. Dès 1573 la
cour de ce château était fermée par une épaisse muraille, surmontée
de deux créneaux, à laquelle fut substituée une belle grille
en fer, détruite vers la fin du siècle dernier. Il est occupé
par les tribunaux , et la vaste salle où la princesse Marie,
entourée de sa cour, déployait ses charmes dans des fêles brillantes,
est aujourd'hui le théâtre des débats des plaideurs. C'est dans
ce château qu'un trouvère du XIII siècleème a placé
les principales scènes de l'histoire de Gérard de Nevers et
de la sage et belle princesse Euriant, sa mie.
La place Ducale,
qui précède le château, est due au duc Charles II de Gonzague;
elle fut bâtie, en 1608, sur le modèle de la place Royale de
Paris, et a près de 3 800 m. de superficie.
L'emplacement
qu'elle occupe était auparavant couvert de maisons, et traversé
par plusieurs rues, dont une était exclusivement réservée au
logement des femmes qui « couroient l'aiguillette et faisaient
folie de leurs corps ». Cent ans après cette profession cessa
d'être tolérée, et, suivant la remarque judicieuse d'un écrivain
du siècle dernier, en défendant aux filles de joie d'être nulle
part, on les obligea sous le règne de Louis XV d'être partout.
Le parc du château est devenu par acquisition une promenade
publique. Avant 1767 il ne contenait que le grand carré long,
aujourd'hui planté en ormes et en tilleuls ; toute la partie
haute était en vignes. A cette époque, le duc de Nevers se promenant
avec la jolie madame de Prunevaux, qu'il affectionnait beaucoup,
cette, dame lui fit observer que ces vignes ajoutées au parc
rendraient la promenade beaucoup plus agréable ; le galant duc
donna immédiatement des ordres pour faire transformer cette
partie en jardin dans le genre anglais. Ainsi, il y a 78 ans
qu'un mot d'une jolie femme, accueilli par la galanterie d'un
grand seigneur, procura à la ville de Nevers une des plus jolies
promenades que l'on connaisse.
Clamecy

L’origine de Clamecy est incertaine,
de même que son nom qui a donné lieu à des opinions variées,
sans fondement justifié.
Ce que l’on sait, c’est que, érigée
en paroisse vers la fin du VIIIe siècle, la châtellenie de Clamecy
relevait, au début du XIe siècle, de l’évêque d’Auxerre, sous
l’autorité suzeraine des comtes de Nevers. L’un d’eux, Hervé,
époux de la célèbre comtesse Mahaut de Courtenay, accorda aux
habitants de Clamecy, leurs premières franchises en 1219, par
suppression de la mainmorte et des corvées de toute nature leur
instituant comme seules charges la dîme et une redevance de
5 sols d’or par famille et leur concédant le droit d’usage sur
7 ou 8 arpents de bois.
Il convient de relater ici un évènement
unique : l’installation à Clamecy de l’évêque « in partibus
»de Bethléem. Guillaume IV, comte de Nevers, parti en 1167 à
la croisade en Palestine où il meurt de la peste. Il lègue par
testament à l’évêché de Bethléem, l’hôpital de Panténor à Clamecy,
créé par sa famille. L’évêque prendrait possession de cet hôpital
et de ses revenus dans le cas où le nouvel évêché de Terre Sainte
ne subsisterait pas. Ce qui advint vers 1223. Malgré de nombreux
démêlés avec les évêques d’Auxerre et d’Autun, l’évêché de Bethlèem
– les – Clamecy subsista jusqu’au concordat de 1801.
Au
XIIIe siècle, la ville de Clamecy, comptant de 1200 à 1500 habitants,
constituait une importante position stratégique où les comtes
de Nevers firent construire un imposant château entouré d’une
enceinte fortifiée.
Pendant la guerre de Cent Ans (1337
à 1453), Clamecy eut à subir des passages et occupations de
troupes, notamment celle de l’armée anglaise d’Edouard III.
La ville reçut en 1478 la visite de Louis XI, et en 1530,
celle de François 1er.

Profitant d’une période d’accalmie à
partir de 1497, les habitants de la cité restaurèrent leur ancienne
église paroissiale et firent ériger la touret le portail que
l’on peut admirer de nos jours.
L’histoire de Clamecy a
été marquée fortement par son rôle joué dans l’approvisionnement
de Paris en bois de chauffage, commerce instauré par Jean Rouvet
en 1549. Les bois du Morvan, flottant au fil de l’eau, parvenaient
à Clamecy et étaient constitués entrains de bois arrivant à
Paris par l’Yonne et la Seine. Au cours du XIXe siècle, ce mode
de transport est remplacé par celui par péniche ; mais l’augmentation
progressive de la consommation du charbon pour le chauffage
domestique parisien amena, au début du XXe siècle une réduction
du tonnage de bois, lequel, de l’ordre de 40 000 décastères
en 1650, tombait à peu près à zéro en 1925.
En 1582 et 1583,
une épidémie de peste causa dans Clamecy des ravages considérables
; puis la ville eut à supporter de nombreux combats, dus aux
guerres de religion de 1585 à 1594, auxquels succédèrent des
occupations de troupes pendant les guerres civiles jusqu’en
1617. Le 11 juillet 1659, Mazarin se rendait acquéreur du Nivernais
; Colbert, chargé de la prise de possession, vient à Clamecy
le 3 novembre 1659. Mazarin avait de grands projets pour faire
de Clamecy une belle et grande ville ; mais sa mort en mars
1661 arrête la réalisation de ces projets.
C’est à partir
de 1682 que Clamecy eut une organisation municipale ; mais le
titre de Maire ne fut conféré qu’en 1694. C’est aussi à la fin
du XVIIe siècle que viennent se fixer dans la cité, les deux
ordres religieux des moines Récollets et les sœurs de la Providence.
Dans la première moitié du XVIIIe siècle, la ville eut à
souffrir fortement des intempéries : le terrible hiver de 1709,
une sécheresse excessive en 1719 et, en 1740, un nouvel hiver
presque aussi rigoureux que celui de 1709. Toutes ces misères
causées par ces calamités, développèrent chez les flotteurs
clamecycois un esprit de mécontentement et d’insubordination,
qui causa des émeutes en 1763, et plus tard en 1792.
A Clamecy,
comme ailleurs, la période révolutionnaire donna lieu à de grands
excès. La Terreur y régna avec toute sa rigueur (exactions,
arrestations arbitraires) ; 17 personnes furent guillotinées
et un certain nombre ne dure leur salut quà la chute de Robespierre.

C’est par un arrêté des Consuls du 17
ventôse an VIII (17 février 1800) que le département de la Nièvre
fut partagé en 4arrondissements dont celui de Clamecy, et en
25 cantons. Il fut installé en cette ville un tribunal de 1ère
instance et une justice de paix
Après la chute de Napoléon,
Clamecy et les communes environnantes furent submergées de juillet
à octobre 1815 par des troupes des armées alliées, notamment
des autrichiens. Puis une violente réaction royaliste amena
un grand nombre de révocations de maires, de destitutions et
de suspensions d’emploi à l’égard de fonctionnaires, d’arrestations
de citoyens considérés comme suspects de sympathie pour Napoléon.
Le XIXe siècle, à Clamecy, une épidémie de choléra fit plus
de 200 victimes en 1832 ; une émeute dite « des Boisseaux »
en 1837, à l’occasion de la mise en service des mesures décimales
de capacité ; puis des événements beaucoup plus graves par suite
de la résistance au coup d’Etat du 2 décembre 1851. Cette résistance
eut pour conséquence la condamnation de près de 600 personnes
dont 6 à la peine de mort, 7 aux travaux forcés et le reste
à la déportation à Cayenne ou en Algérie.
Les travaux de
construction de la ligne de chemin de fer Auxerre-Clamecy devant
relier rapidement cette dernière cité à Paris furent menés activement
; et l’inauguration de la ligne eut lieu au cours de l’été 1870.
Cette voie ferrée allait trouver son utilité pour le transport
des troupes et l’évacuation des blessés au cours du proche conflit
franco-allemand.
La guerre de 1870-1871 et ses suites causèrent
à Clamecy les souffrances qui furent le lot de la plus grande
partie de la France , d’ailleurs aggravées par le très rigoureux
hiver 1879-71

Cosne-Cours-sur-Loire
L'établissement de la ville date de la
Préhistoire. À l'époque gauloise, elle se nomme Condate qui
signifie "confluent". Puis le site de Cosne est devenu le carrefour
de plusieurs affrontements à travers l'Histoire tels que la
guerre de Cent Ans et les guerres de religion. Henri V de Lancastre,
malade, tentera de rejoindre la garnison bourguinionne de Cosne,
mais mourra de toute manière de la dysenterie à Vincennes en
1422.
Vers le XVIIe siècle, la ville commence à se développer
grâce à l'industrie métallurgique et à la navigation sur la
Loire où seront acheminés les différents objets de cette industrie
prospère à l'époque.
Pierre Babaud de la Chaussade (1706-1792)
fonda en 1735 les Forges de La Chaussade qui devinrent les Forges
Royales de La Chaussade où étaient fabriqués des ancres, des
canons et d'autres accessoires pour la Marine Royale. La production
était acheminée par la Loire qui était un fleuve navigable à
cette époque. À partir de 1860, les forges commencèrent à péricliter
avec l'arrivée du chemin de fer qui remplaça peu à peu les voies
navigables de France. Les forges fermèrent définitivement en
1872. Aujourd'hui, il ne reste que la « grille d'entrée des
anciennes Forges Royales de La Chaussade (fin du XVIIe siècle)
»2 avec une plaque où est écrit un extrait d'une lettre de Madame
de Sévigné qui a visité les lieux le 30 septembre 16773.
L'activité industrielle métallurgique a connu une grande importance
pour le développement de Cosne jusqu'à aujourd'hui. Les années
1990 et le début de la décennie 2000 ont connu une large crise
dans ce secteur qui fut l'activité principale de la ville pendant
plusieurs siècles.
En 1833 fut construit le premier pont
sur la Loire qui fut détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.




