Beauvais - Préfecture de l'Oise
Retour
au Département
Retour Ville d'Art et d'Histoire
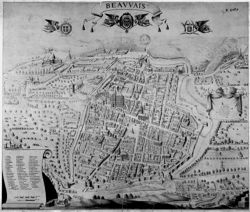
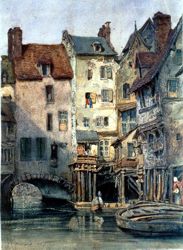
Beauvais (Cæsaromagus, Bellovaci, Bellovacum).,
César nous apprend que la ville principale des Bellovakes était
Bratuspantium.Des savants illustres, Scaliger, Hadrien de Valois,
l'historien Loysel, ont voulu que cette ville gauloise ait existé
sur l'emplacement occupé aujourd'hui par Beauvais. Cette opinion
est aujourd'hui à peu près complètement abandonnée, et des découvertes
archéologiques nombreuses donnent à penser que l'oppidum gaulois
mentionné par César n'est autre que la petite ville de Breteuil,
située à 24 kilomètres N.-E. de Beauvais, c'est l'avis de Mabillon,
et l'illustre d'Anville s'y est à peu près rangé.
Ptolémée appelle
du nom de Cæsaromagus la cité des Bellovakes la Table de Peutinger
mentionne cette ville, et elle est désignée dans l'Itinéraire d'Antonin
comme point de départ d'un chemin allant à Lutetia par Petromantalum
et Briva Isara. La Notice des Gaules, rédigée sous Honorius, dit
civitas Bellovacorum, d'où est venu, après de nombreuses variantes,
Bellovacum, qu'on a traduit par Beauvais. Nous sommes obligés de
passer rapidement sur les fables qui se rattachent à la fondation
de cette ville. On peut supposer que César et Auguste ne permirent
pas aux compagnons du Bellovake Corrée de demeurer dans la ville
qu'avait illustrée leur valeur et qui rappelait les souvenirs de
la nationalité et de l'indépendance ; Bratuspantium dut être forcément
abandonnée, et ses habitants se fixèrent dans le lieu qui, du conquérant,
prit le nom de Cæsaromagus. Le premier fait constant qui se rattache
à l'histoire de cette cité remonte au règne de Néron. Les actes
de saint Lucien nous apprennent que, sous cet empereur, la ville
reçut des fortifications. Les Bellovakes s'étaient pliés à la domination
romaine après la conquête de César et avaient formé, au service
de ce nouveau maître, une légion dite de l'Alouette (alauda), à
cause de l'oiseau, symbole de vigilance, qu'ils portaient sur leur
casque gaulois. Ils restèrent fidèles à Rome aussi longtémps que
l'empire résista aux attaques réitérées des barbares.
La misère
produite par les incursions et les ravages des Francs et des Allemands
fut telle, sous Constantin, qu'elle paraît avoir exigé la présence
de cet empereur à Beauvais. Un auteur contemporain dit qu'il rendit
dans cette ville, en 320, une loi relative aux immunités des vétérans.
Au Vème siècle, la cité des Bellovakes fut une des quarante-neuf
cités qui participèrent en Gaule au grand soulèvement des Bagaudes.

Peu après, le chef des Francs, Clodion, s'avança jusqu'à Beauvais
et s'empara de cette ville en 434 ; Attila survint ensuite et la
brûla en 450. Les Francs restèrent maîtres de Beauvais après la
victoire de Clovis sur Syagrius, fils d’Ægidius, dernier patrice
romain de la Gaule.
Dans les derniers temps de la domination
romaine, les évêques avaient remplacé les officiers impériaux dans
l'administration des affaires temporelles ; ils avaient acquis le
titre de defensores civitatis ; leur autorité ne fit que s'étendre
sous les Francs, qui s'appuyaient sur le clergé catholique.
Mais
toute cette époque est très obscure et il faut aller jusqu'à la
seconde race pour trouver des faits particuliers concernant l'histoire
de Beauvais. Hildemances, moine de Corbie, devint évêque de Beauvais
en 821. Ce prélat prit parti pour les fils de Louis le Débonnaire
dans leur rébellion contre leur père. L'année même de la mort de
cet empereur survenue en 840, Beauvais vit pour la première fois
les northmans (autre nom des Normands), qui la brûlèrent. En 845,
Charles le Chauve y réunit un concile de tous les évêques du royaume,
et le sage Hincmar fut élu archevêque de Reims.
Une bande de
pirates northmans parut de nouveau dans le Beauvaisis en 860 ; Beauvais
fut pillée et saccagée mais, attaquée pour la troisième fois par
ces mêmes Northmans en 877, elle se défendit et les repoussa. Cependant,
en 883, elle tomba en leur pouvoir. A cette époque, Beauvais commença
à former un comté appartenant à la riche maison de Vermandois. Eudes
II transmit en 1013 le titre de comte à son frère Roger, évêque
de Beauvais. Cette dignité fut dès lors conservée aux prélats de
cette ville et mit le comble à leur puissance temporelle.
Bientôt
ils y ajoutèrent les titres de pairs de France et de vidame de Gerberoy
et furent comptés parmi les premiers dignitaires du royaume. Mais
un élément nouveau, appuyé sur les rois de France et profondément
hostile à la féodalité, ne tarda pas à intervenir et à entrer en
guerre avec ces puissants seigneurs. Les bourgeois se formèrent
en conjuration communale. Il est probable qu'à Beauvais ; comme
dans un grand nombre de villes gauloises qui avaient longtemps vécu
sous l'administration romaine, la tradition des libertés municipales
n'avait jamais été complètement interrompue. Les désordres éclatèrent
de 1099 à 1101, dans les dernières années de l'épiscopat d'Ansel.
L'association des bourgeois fut dirigée primitivement contre le
châtelain ou capitaine de la cité, qui occupait une des principales
portes de la ville. Après la mort de l'évêque Ansel, le chapitre
prit part à la querelle ; les bourgeois en appelèrent au roi Louis
le Gros, qui intervint en 1115. Deux seigneurs puissants, Lancelin,
comte de Dammartin, et Thomas de Marle, de la puissante maison de
Coucy, mirent à profit les discordes qui agitaient Beauvais pour
s'emparer momentanément de cette ville et ravager son territoire.

En 1144, Louis le Jeune confirma la charte communale de Beauvais.
Les habitants acquirent le droit de se prêter un secours mutuel
et d'élire treize pairs, entre lesquels un ou deux devaient être
nommés majeurs. Ces officiers municipaux étaient chargés d'administrer
la justice. Le maire ou majeur et les douze pairs étaient nommés
annuellement. Cette concession ne mit pas fin aux troubles qui agitaient
Beauvais. D'autres malheurs fondirent en même temps sur cette ville
infortunée ; un terrible incendie la consuma presque entièrement
en l'année 1180. Les conflits de juridiction entre les bourgeois
et l'évêque se renouvelèrent sous le règne de Philippe le Bel. Depuis
Philippe-Auguste, les évêques se montraient fort attachés à la royauté
et s'étaient acquis de la sorte sa protection.
A la bataille
de Bouvines (1214), Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, «
plus attaché au service de Mars qu'à celui de Jésus-Christ »,
s'était distingué entre tous les hommes d'armes. Armé d'une massue
pour ne pas verser le sang, selon les prescriptions de l'Église,
il avait porté le désordre et la mort dans les rangs de l'armée
ennemie. Un de ses successeurs, le fameux évêque Simon, servit Philippe
le Bel avec zèle pendant sa guerre contre les Flamands. De retour
dans son évêché, il prétendit ravir aux bourgeois les privilèges
qui leur avaient été accordés par les chartes antérieures ; une
contestation s'éleva, à la suite de laquelle l'évêque fit enlever,
par son bailli, le maire et deux pairs et les fit jeter en prison.
Cette première fois, le différend fut porté devant le parlement,
qui donna gain de cause à la commune. En 1305, de nouveaux désordres
plus graves s'élevèrent ; la tyrannie de l'évêque Simon fut si insupportable
au peuple qu'il y eut un soulèvement universel dans la ville l'évêché
fut pris et dévasté, et Simon, chassé de son siège, reçut en dérision
le nom de Simon le Dévêtu.

Il se retira au village de Saint-Just,
près de Clermont, et excommunia les habitants. Ceux-ci se seraient
peu souciés de ce châtiment spirituel, qui leur venait d'un homme
si peu recommandable par ses qualités morales, mais le roi de France
intervint. Philippe le Bel fit en même temps arrêter le maire et
saisir le temporel de l'évêque il examina le différend et donna
gain de cause à Simon, qui appartenait à l'importante maison des
comtes de Clermont et de Nesle, et dont les deux frères étaient
l'un connétable et l'autre maréchal de France. Les magistrats municipaux
furent condamnés à lui demander pardon à genoux et à réparer les
dévastations commises. C'est alors que furent construites les tours
de l'ancien évêché, aujourd'hui le palais de justice. Simon mourut
en 1312 ; ses successeurs se montrèrent moins hostiles que lui à
l'existence de la commune ; d'ailleurs les événements de l'invasion
anglaise mirent forcément fin aux discordes civiles. En 1346, Beauvais
se défendit avec courage contre l'armée du roi Édouard III, quelques
jours avant la funeste bataille de Crécy.
Nous avons vu dans
l'histoire du département que Beauvais avait eu à souffrir des désordres
causés par l'insurrection des Jacques. Pendant la lutte des Armagnacs
contre les Bourguignons, le trop fameux Pierre Cauchon, partisan
de ces derniers, fut nommé, en 1420, évêque de Beauvais et fit reconnaître
dans cette ville l'autorité de Henri V, après la conclusion du traité
de Troyes, en 1420. Jeanne d’Arc reprit Beauvais, après sa victoire
de Gerberoy. Trois ans plus tard, les Anglais faillirent de nouveau
s'emparer de cette place, qui ne fut sauvée que par le dévouement
de plusieurs de ses habitants. Lorsque la guerre cessa, la misère
était à son comble dans cette malheureuse cité. L'illustre Juvénal
des Ursins, qui en occupait alors le siège épiscopal, s'efforça
de réparer les désastres causés par un siècle de ravages, et, vers
la fin du règne de Charles VII, Beauvais commençait à voir renaître
sa prospérité, quand la guerre que fit Louis XI, son successeur,
aux derniers grands vassaux de France ramena l'ennemi sous ses murs.

Le fait le plus célèbre de l'histoire de cette ville se rattache
à cette époque. En 1472, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire,
reprit les armes contre Louis XI, qu'il accusait d'avoir fait périr
par le poison son frère Charles de Guyenne, et s'avança avec 80,000
hommes sous les murs de Beauvais. La place n'avait qu'une très faible
garnison, mais les habitants résolurent tous, d'un commun accord,
de se défendre. Le duc de Bourgogne fit donner deux assauts dans
la première journée. Déjà la porte de Bresle et le faubourg de Saint-Quentin
sont en feu, les remparts battus en brèche ; les hommes n'étant
pas assez nombreux, dans la ville assiégée, pour les défendre, les
femmes se portent à leur secours, versant sur les ennemis de l'huile
bouillante, faisant écrouler sur eux des monceaux de pierres, combattant
même les armes à la main. Une d'entre elles, Jeanne Laisné, se distingua
plus que toutes les autres. Un soldat bourguignon, parvenu à l'extrémité
d'une échelle, plantait son étendard sur la muraille Jeanne l'abat
d'un coup de hache et se saisit de l'étendard, glorieux trophée
que Beauvais conserve encore aujourd'hui dans son Hôtel de ville.
Les Bourguignons cédèrent devant tant de courage. La procession
de Sainte-Angadresme fut instituée en souvenir de ce glorieux fait
d'armes ; cette procession a lieu encore chaque année ; les femmes
y ont le pas sur les hommes et marchent immédiatement après le clergé
; les jeunes filles tirent le canon. L'héroïne du siège retint le
nom de Jeanne Hachette. Louis XI la maria et, en récompense de sa
valeur, l’exempta à jamais, elle, son mari et ses enfants, de toute
taille et de toute charge publique.
L'histoire de Beauvais cesse,
n’a plus aucun intérêt jusqu'à l'époque de la Réforme. En 1560,
l'évêque Odet de Châtillon abjura le catholicisme ; des désordres
éclatèrent dans la ville, et Odet fut forcé de se sauver en Angleterre.
Beauvais eut le bonheur d'être une des villes où la Saint-Barthélemy
ne fit pas de victimes. Cependant les désordres continuèrent ; les
pauvres se soulevèrent en 1577 contre les riches bourgeois. Trois
ans plus tard, la peste exerça dans la ville ses terribles ravages.
En 1589, les habitants de Beauvais adhérèrent à la Ligue, la guerre
civile recommença et quelques massacres eurent lieu mais, après
l'abjuration de Henri IV, cette ville se soumit à lui en même temps
que Paris et le calme put renaître.
Beauvais se rattache à l'histoire
du XVIIème siècle par plus d'un souvenir Racine y fit
ses études, et Colbert y fonda, en 1664, une succursale de la manufacture
des Gobelins, à Paris. Il y avait, près de Beauvais, une abbaye
très ancienne et très importante, celle de Saint-Lucien, dont Bossuet
fut abbé. Nous avons dit plus haut la part que prit cette ville
à la Révolution.
En 1814, elle subit l'occupation étrangère
; en 1870, un corps de 2 000 Saxons en prit possession.
Cette
ville est située au confluent de l'Avelon et du Thérain, Il existait
sur le mont Capron, à l’est de la ville, un temple, et on a trouvé
à plusieurs reprises des débris de statues, des fragments de colonnes
et des pierres chargées d'inscriptions romaines qui avaient servi
aux fondations de la ville.
Au XVIIème siècle, en creusant
le sol pour construire l'hôtel de la châtellenie, on trouva une
pierre sur laquelle était inscrit le nom de Quintus Cicéron, fun
des lieutenants de César ; en 1752, on découvrit plusieurs médailles
en bronze ; l'une d'elles portait les noms de Trajan et d'Adrien.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025