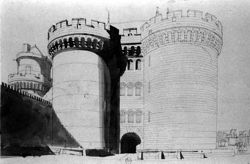Alençon - Préfecture de l'Orne
Retour au Département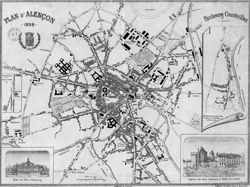

C'est une jolie ville, généralement bien
bâtie, située dans une grande et fertile plaine qu'entourent de
grandes forêts.
Son histoire se confond avec celle du comté,
que nous avons esquissée. Elle se trouvait située entre deux voies
romaines, mais aucune n'y aboutissait, et cela suffirait pour prouver
qu'à l'époque impériale Alençon ne possédait pas une grande importance.
En effet, ce n'était encore, au milieu du VIIIème
siècle, qu'une centenie ou chef-lieu de cent paroisses.
Néanmoins,
quelques antiquités gauloises et romaines, trouvées près de là,
prouvent que les Gaulois et des Romains ont occupé son emplacement.
L'évêque du Mans, saint Liboire, y édifia une Église au IVème
siècle, et la centenie d'Alençon fut comprise par Charlemagne parmi
les possessions de l'évêché du Mans.
La puissance d'Alençon
s'accrut rapidement pendant la période normande, et s'affirma par
la construction d'un Château.
Après la réunion de la province
à la Couronne, Alençon vit souvent ses faubourgs ravagés par l'invasion
étrangère.
La paix lui rendit et augmenta sa prospérité. Vers
la fin du XVème siècle s'élevèrent la plupart de ses
édifices religieux. Pendant les guerres de Religion, la ville joua
un rôle important.
Préparée à accueillir favorablement la Réforme
par le séjour qu'y fit la belle duchesse d'Alençon, Marguerite,
sœur de François Ier, cette ville compta bientôt parmi
ses habitants un assez grand nombre de partisans des idées nouvelles.
Une partie du clergé et des magistrats étaient Protestants.
Les excès auxquels les Huguenots se livrèrent, au commencement du
règne de Charles IX, le pillage de l'Eglise Notre-Dame, de Saint-Blaise
et du Couvent de l’Ave-Maria, amenèrent une véritable anarchie.
Les Catholiques s'armèrent pour se protéger. L'un d'eux, patron
du corps des bouchers, les réunit et leur donna l’ordre de se munir
de leurs assommoirs, de leurs coutelas, et, suivis de leurs chiens,
d'escorter ainsi la procession de la Fête-Dieu.
En commémoration
de cet événement, une procession annuelle des bouchers ainsi armés
et escortés se fit à Alençon jusqu'en 1789.
Les Protestants
du Mans, conduits par Georges d'Argenton et par Thibergeau, vinrent
appuyer leurs coreligionnaires ; ils s'emparèrent de la ville et
pillèrent de nouveau les Églises. Thibergeau se fit, dit-on, une
bandoulière avec des oreilles de prêtres ; mais il est bon de ne
pas croire trop facilement à ces horreurs, qu'en tout temps l'histoire
écrite par les vainqueurs prête trop généreusement aux vaincus.
L'ordre fut rétabli bientôt dans la ville.
« Il paraît même,
disent de La Sicotiére et Poulet-Malassis, que les protestants et
les catholiques arrivèrent à se partager presque également les fonctions
municipales. Sur les douze habitants choisis chaque année pour administrer
les revenus de la ville et de l'hôpital, six devaient être de la
religion réformée, ainsi que deux des quatre échevins et l’un des
présidents laïques de l'hôpital. Enfin le procureur-syndic devait
être alternativement un catholique et un protestant. »
Montgomery,
chef des Protestants, s'empara d'Alençon. Mais la ville fut bientôt
reprise, el le gouverneur Matignon sauva les Protestants à l'époque
de la Saint-Barthélemy, conduite aussi prudente que généreuse, car
ils étaient très nombreux dans le pays.
En 1574, les Protestants
s'emparèrent encore une fois d'Alençon.
En 1579, le roi de Navarre,
Henri IV, s'y réfugia lorsqu'il eut réussi à s'échapper de la cour,
ainsi que le duc d'Alençon, un des chefs des mécontents.
C'est
à Alençon que Henri rentra publiquement dans le sein de l'Église
protestante et renia le Catholicisme qu'on lui avait fait embrasser
à l'époque de la Saint-Barthélemy. On raconte qu'au moment où il
entra au prêche, le cantique marqué par ce jour, et que chantaient
les Fidèles, se trouvait être, par hasard, le psaume XXI; il commençait
ainsi :
Seigneur, le roi sejouira
D'avoir eu délivrance.
Henri en fut frappé et se rappela avec émotion que, pendant
qu'il fuyait la cour quelque temps auparavant el qu'il passait la
Seine à Poissy, un de ceux qui l'accompagnaient lui avait fait chanter
le même psaume.
Au temps de la Ligue, Alençon resta fidèle à
Henri III ; mais la place fut prise et rançonnée par le duc de Mayenne.
Assiégée de nouveau par le maréchal de Biron, un des généraux de
Henri IV devenu roi, elle eut beaucoup à souffrir de l'artillerie
royale, et la garnison des Ligueurs fut obligée de capituler.
Henri IV avait besoin d'argent ; il se fit payer par la ville
17,000 écus qu'elle devait encore au duc de Mayenne sur le prix
de sa capitulation.
Ainsi, Protestants et Catholiques s'unissaient
pour épuiser la pauvre cité.
Plus tard, nous voyons Henri IV
la vendre, ainsi que le duché, au duc de Wurtemberg.
Le rachat
ne s'en effectua que sous la régence de sa veuve, Marie de Médicis.
Au XVIIème siècle, l'existence d'Alençon ne fut troublée
qu'à l'époque de la révocation de l'Édit de Nantes.
Mme de Guise,
alors duchesse d'Alençon, encouragea les persécutions contre les
Protestants ; elle alla jusqu'à faire exhumer et jeter à la voirie
les restes de ceux qui étaient enterrés, puis réunit leur Cimetière
à ses jardins, montrant ainsi que, dans cette basse profanation,
son intérêt trouvait aussi bien son compte que son zèle pour la
pureté de la foi.
Au commencement du XVIIIème siècle,
Alençon eut à subir la famine et les épidémies.
En 1726, le
blé se trouva aussi cher que pendant l'affreuse année de 1700. La
disette, cette fois, tenait moins aux rigueurs des saisons qu'à
l'avidité barbare des accapareurs.
« Des perquisitions sont
ordonnées dans les maisons, disent les auteurs de l'ouvrage déjà
cité ; les possesseurs de grains sont forcés de les vendre à un
prix déterminé ; c'est le maximum de 1793 ! Les moines de Perseigne
résistent à l'enlèvement de mille boisseaux cachés dans le clocher
et sur la voûte de leur église, et une lutte violente s'engage entre
eux et les archers.»
D'autres famines vinrent les années suivantes
désoler Alençon.
Mais le commerce des toiles et du point, qui
avait eu beaucoup à souffrir de l'expulsion des Protestants, se
raffermit : Alençon reprit sa prospérité ; un nouveau Quartier s'éleva;
le Donjon et les Fortifications disparurent.
Celte ville fut,
comme toute la France, agitée par l'explosion de 1789.
Quelques
désordres y furent provoqués par de Caraman, qui, au mois d'octobre,
après le banquet des gardes du corps, à Versailles, avait fait retirer
aux soldats qu'il commandait la cocarde nationale, et rétabli la
cocarde blanche.
L'évêque refusa, en 1791, le serment constitutionnel
et fut remplacé à l'élection.
Après le 31 mai, Alençon sembla
d'abord se prononcer pour la Gironde, mais se soumit bientôt à l'autorité
de la Convention.
La même année, l'armée vendéenne ayant été
battue et mise en déroule au Mans, un grand nombre de Vendéens furent
pris, conduits et fusillés à Alençon.
Plus tard les environs
de la ville furent désolés el ensanglantés par les Chouans.
Après la mort de leur chef, de Frolté, le calme se rétablit.
Il n'a plus cessé jusqu'à nos jours.
Il ne reste plus de l'ancien
Château d'Alençon, qu'une Tour et un Pavillon. Le reste a été démoli
en 1783 pour construire l'Hôlel-de-Ville; ce vaste édifice, dont
la façade est semi- circulaire, contient le Musée qui est assez
riche.
La Tour de l'ancien Château, qui sert aujourd'hui de
Prison, se compose de deux Tours juxtaposées, d'une forme élégante
el pittoresque.
Elle fut longtemps l'habitation des gouverneurs
du Château.
La Cathédrale Notre-Dame, qui date du xv° siècle,
est, après celle de Sées, le monument le plus remarquable du département.
Le chœur et le clocher seuls sont modernes ; cette partie avait
été détruite par un incendie au xvni 0 siècle, et a été rebâtie
dans un style lourd, sans élégance, qui présente un triste contraste
avec le reste du monument. Les belles sculptures du portail ont
été achevées seulement en 1617. La chaire, qui, si l'on en croit
la tradition, fut construite au xvi° siècle, par un condamné à mort,
auquel ce travail valut sa grâce, est fort artistique, ainsi que
les riches vitraux de l'Eglise.
L'Eglise Saint-Léonard, qui
date de la fin du xv° siècle, a été commencée, par René, duc d'Alençon,
et terminée par Marguerite, sa veuve.
La Préfecture est l'ancien
Château de Mme de Guise, bâti dans la première moitié du xvne siècle
et qui fut plus tard occupé par l'intendance.
Les autres monuments
sont : le Palais de Justice, l'Asile des aliénés, la Halle aux grains,
la Halle aux toiles, le Tribunal de Commerce, l'Ecole Normale, le
Théâtre. La Bibliothèque est établie dans l'ancienne Église des
Jésuites.
Alençon est célèbre par ses dentelles en Point d'Alençon
ou Point de France. « Primitivement cette dentelle, dit Odolant-Desnos,
se fabriquait à Venise; mais Colbert, voulant enlever cette industrie
à l'étranger, dont le luxe français se trouvait tributaire pour
cet objet, fit venir de cette ville une dame Gilbert, native d'Alençon
et habile à fabriquer cette dentelle ; il lui fil une avance de
150,000 fr. Dès lors, celle dame forma des ouvrières, monta la manufacture
de points de France à Alençon, la fit constituer par lettres patentes
du 5 août 1676, et obtint un privilège exclusif jusqu'en 1685. Malgré
ces mesures, Louis XIV, pour assurer une garantie de durée et de
prospérité à celte fabrique, prohiba en outre l'entrée des dentelles
de Venise, de Gênes, de Flandre et d'Angleterre, par une ordonnance
de 1684. Depuis cette époque jusqu'en 1812, la fabrication du point
d'Alençon ne fit que prospérer, et la plupart des familles riches
de cette ville doivent leur fortune à cette industrie. La fabrication
du point d'Alençon est fort longue ; elle employait environ 2,000
ouvrières, qui gagnaient jusqu'à deux francs par jour. Ces ouvrières
se servaient de fil du prix de 100 à 1,800 francs la livre, qu'on
tirait de Flandre, et leurs produits étaient dirigés sur Paris ou
exportés dans toute l'Allemagne. Maintenant celle industrie, qui
s'étendait jusqu'aux environs d'Argentan, est totalement tombée.
»
La dentelle d'Alençon aujourd'hui Installé dans des locaux
municipaux de l'ancien collège des Jésuites abritant également le
musée des Beaux-Arts et de la Dentelle et, dans sa chapelle, la
bibliothèque municipale, l’Atelier national du point d’Alençon [archive],
a été créé en 1976 et rattaché à l’administration du Mobilier national.
Héritier de la Manufacture nationale du point de France fondée par
Colbert en 1665, afin de freiner les importations de dentelle au
point de Venise, il succède à l’École dentellière, maintenue jusqu’à
nos jours par la congrégation des sœurs de la Providence, avec le
soutien de la Chambre de commerce d’Alençon.
Aujourd’hui, l'Atelier
national préserve et transmet, sous l’égide du ministère de la Culture,
la tradition et la technique de ce point de dentelle particulier
tout en s’efforçant d’en renouveler la technique en transplantant
les caractéristiques du « point d’Alençon » sur de nouveaux matériaux
et en créant de nouvelles gammes de produits dérivés. L'atelier
participe à l’ameublement et à l’enrichissement des collections
nationales par la création de dentelles d’après des modèles d’artistes
contemporains, tels que Paul-Armand Gette, Pierrette Bloch, Christian
Jaccard, Esther Shalev-Gerz, Éric Gizard.
La dentelle d'Alençon
a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité par l'UNESCO le 16 novembre 20101, après
avoir été inscrite à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel
en France.
Les Châteaux sont très nombreux autour d'Alençon.
Citons : à Colombiers, les restes d'un Aqueduc romain ; à Héloup,
le Menhir de Pierre- Longue ; à La, Roche-Mabile, des ruines de
Fortifications.
La Dame Blanche du château d'Alençon
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025