Tarbes - Préfecture des Hautes-Pyrénées
Retour
au Département)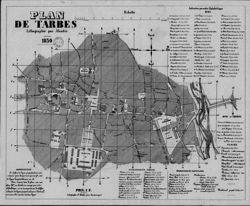
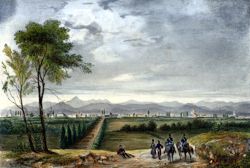
Tarbes (Tarba, Castrum Bigorra), était
appelée par les Romains Tarva,Turba ou Tarba. La Notice de l'empire
la désigne ainsi Tarba, ubi castrum Bigorra, à cause d'une petite
forteresse qui s'y trouvait et qui devait son nom aux habitants
du pays, Bigerri, Bigerrones.
Cette forteresse, qu'avait servi
aux habitants de lieu de refuge pour leurs objets précieux dans
la lutte contre Rome, devint ensuite la résidence d'un chef militaire
de l'empire. Quelques auteurs citent même le nom d'un Crassus, lieutenant
de César. Le premier évêque de Tarbes est, d'après la Gallia Chritiana,
saint Just, qui vivait vers 420.
Dans les siècles qui suivirent
la chute de l'empire, le pays et la ville furent successivement
ravagés par les invasions successives des Goths, des Vandales, des
Alains, des Vascons et des Sarrasins ; mais on ne possède sur cette
période aucun document authentique.
L'histoire n'a quelques clartés
qu'à dater de la venue des Normands, qui détruisirent la ville de
fond en comble les habitants, dispersés et réduits à la dernière
misère, tombèrent dans un état presque sauvage. Ce fut Raymond Ième
qui releva la ville et reconstruisit ses murailles au Xème>
siècle. C'est lui aussi qui fonda sur les frontières du Bigorre
et du Béarn ; le monastère de Saint-Pierre ou Saint-Pé. Le comte
Centulle en fit don quelque temps après à l'évêque de Tarbes. Un
nouveau prélat monta vers cette époque sur ce siège épiscopal, et
son caractère violent donna lieu à quelques scènes comme nous en
avons vu de semblables à Auch. Un gentilhomme, Guillaume Raymond
de Barthrez, mourut à Ludux, aujourd'hui Loubajac, et, en exécution
de ses dernières volontés, ses parents prièrent les moines de Saint-Pé
de l'enterrer dans leur église. Ceux-ci se rendirent à Ludux avec
tout l'appareil funéraire et dirent l'office des morts ; mais, au
moment où ils se disposaient à emporter le corps dans leur abbaye,
l'archidiacre Bernard d'Azereix fond sur eux avec des gens armés,
s'empare du défunt et le porte à Tarbes. La métropole ecclésiastique
de Tarbes avait été d'abord Eause; depuis la destruction de cette
ville, c'était Auch. Les moines se plaignirent donc à l'archevêque
d'Auch et au comte Centulle. Le comte cita les deux parties à comparaître
devant lui en son château de Lourdes, et là, en présence d'une nombreuse
assemblée, la preuve testimoniale ayant été admise, l'évêque fut
déclaré Coupable ; il fut condamné à céder à l'abbaye de Saint-Pé
le quart de dîme qu'il percevait à Séméac, moyennant la cession,
en dédommagement, que fit l'abbaye, du cazal de Saint-Martial, qu'elle
possédait à Tarbes auprès de l'église Sainte-Marie de la Sède.
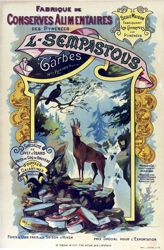
Nous n'avons point de charte de commune particulière
à Tarbes, mais il n'est pas douteux que cette ville n'en ait reçu
une de Centulle III ; car nous voyons Esquivat, en 1268, accorder
la confirmation de ses fors (coutumes et privilèges). La commune
élisait six consuls ou juras qui formaient un tribunal sous la présidence
du viguier du comte appelé aussi bayle ou bailli. Par la suite,
ils portèrent un costume particulier à leur dignité municipale ;
c'était une simarre mi-partie bleu et rouge, sur le dos de laquelle
étaient représentées les armes de la ville un écu écartelé aux
premier et quatrième de gueule, aux Deuxième et troisième d'or plein.
Il est probable que la commune embrassait à la fois la ville
et le bourg, quoique la ville, entourée de murs et de fossés, appartint
à l'évêque, tandis que le bourg était le domaine du comte. Le XIVème
siècle fut malheureux pour Tarbes. En 1353, une famine et une peste
terribles firent périr plus de la moitié des habitants, parmi lesquels
fut l'évêque. Sept ans après, malgré les protestations des Bigorrais,
la province était livrée aux Anglais par le traité de Brétigny,
et le prince Noir faisait solennellement son entrée à Tarbes en
compagnie de Gaston-Phoebus de Foix. Il faut toutefois reconnaître
que l'administration anglaise se montra douce aux Tarbais, et le
prince Noir lui-même, en 1366, par lettres datées d'Angoulême, confirma
« tous leurs privilèges, coutumes et libertés antiques. Tarbes fut
la dernière ville que les Anglais conservèrent dans la province
lorsqu'ils en furent chassés.
L'époque la plus funeste pour Tarbes
fut celle des guerres de religion. Les calamités dont cette ville
avait été accablée au temps des Normands furent renouvelées, comme
on va le voir. Le clergé, alors fort ignorant à Tarbes comme ailleurs,
n'avait point su lutter d'influence avec les prédicateurs de la
religion nouvelle, parmi lesquels se distinguait un certain carme
appelé Solon. Le protestantisme fit des progrès assez considérables
dans le Bigorre.
La majorité resta pourtant catholique à Tarbes
; mais les calvinistes avaient pour eux, à défaut du nombre, la
protection de Jeanne d'Albret, reine de Navarre et comtesse de Bigorre.
Pour leur complaire, elle interdit aux catholiques de Tarbes les
processions publiques, et autorisa l'existence simultanée des deux
religions. Les calvinistes abusèrent de cette protection, et bientôt
Jeanne elle-même, venue à Tarbes pour présider les états de la province,
fut obligée de rendre un édit pour réprimer leurs désordres. Le
pays n'avait point encore gravement souffert, lorsque la guerre
arriva avec Montluc et Terride, envoyés par Charles IX pour détruire
les protestants du Midi. Montgomery, lieutenant de Jeanne, s'avança
pour leur tenir tête. Ce terrible chef calviniste fut le fléau de
Tarbes.
La ville, n'ayant pas voulu ou pas pu payer à temps une
contribution qu'il exigeait, fut envahie et saccagée par lui les
habitants l'avaient quittée avant son arrivée et s'étaient réfugiés
dans les montagnes.
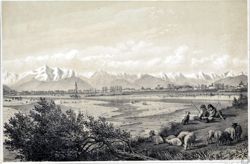
Les églises Saint-Jean et Sainte-Marie de
la Sède et le couvent des carmes furent détruits de fond en comble.
A peine les Tarbais étaient rentrés dans leur ville, que le vicomte
de Montamat, lieutenant de Montgomery, vint en faire le siège le
20 janvier 1570. La résistance ne fut pas bien longue, mais fut
assez énergique. « Il y avait dans le bourg Vieux, dit la chronique
de Mazières, deux bons arquebusiers, l'un nommé Imbert, facteur
de la maison de Prai, et l'autre Guonet, serrurier lesquels ne tiraient
aucun coup sans porter dommage, et eux deux, à la faveur de la lune
qui estait belle et claire, blessèrent et tuèrent un grand nombre
de soldats assiégeants. » Cependant les calvinistes ayant réussi
à détourner l'eau des fossés, la place dut se rendre. La plupart
des habitants n'avaient pas attendu ce moment pour s'enfuir. Au
reste Montamat se montra clément. S'il permit à ses soldats de piller
la ville, il renvoya libre et sans rançon le capitaine Forgues,
qui avait vaillamment défendu la place, et se contenta de mettre
à contribution le juge d'Opeaux et le syndic du pays de Bigorre.
Tarbes subit peu de temps après un second siège plus sérieux. Montamat
l'avait laissée déserte et sans garnison. Les Tarbais, honteux de
laisser inhabitée la capitale de leur comté et rougissan peut-être
enfin de la pusillanimité qui les avait portés deux fois à s'enfuir
avant l'arrivée de l'ennemi, se hasardèrent à rentrer ; mais ils
eurent soin de se faire accompagner par François de Bonasse, qui
commandait huit cents hommes de guerre à Lourdes. Ce vaillant capitaine
s'enferma avec eux et leur jura de mourir avec tous les siens pour
leur défense. A cette nouvelle, Montamat Accourt : Bonasse, ne pouvant
défendre les faubourgs, les brûle, et retarde ainsi les efforts
des assiégeants. Cependant Montamat, ayant fait avancer son artillerie,
commença à battre les murs du bourg Vieux, la brèche fut ouverte
le second jour et on monta à l'assaut. Bonasse, animant les siens
par son exemple, repousse les assaillants et les culbute dans les
fossés. Une seconde attaque ne réussit pas mieux, mais coûta tant
de monde aux assiégés, que Bonasse résolut de se retirer pendant
la nuit par la porte de Nolibos. Une trahison l'empêcha d'exécuter
ce dessein un de ses lieutenants, qui correspondait secrètement
avec les ennemis, persuada à Bonasse qu'il était de son honneur
de rester dans la place, y introduisit par une fenêtre basse plusieurs
soldats ennemis, et convint avec Montamat que l'assaut serait renouvelé
le lendemain.

« Ayant doncques l'aurore guidé sur l'orison
le fatal et triste jour qui devoit faire de la ville de Tarbe le
cimetière de tant de vaillants soldats et capitaines, grossir et
rougir les ruisseaux de sang humain, tapisser les rues de Tarbe
d'herbes vertes comme un pred durant la saison printanière, voicy
que M. de Montamat se présente à l'assaut, assuré d'estre secouru
de ceux qu'il avait jetés dans la ville. Bonasse, d'autre part,
et ses gens se trouvèrent à la bresche bien armés et mieux encouragés
pour se bien défendre. Comme ils sont venus aux mains, et que d'une
guerrière audace chacun tâche d'abattre ce qu'il a devant, ceux
qui estoient entrés par la fenestre sortent à la veue et accourent
furieusement envelopper les gens de Bonasse par derrière les assiégés,
se voyant attaqués de deux endroits et ne sçachant ce que ce pouvoit
estre, furent bien estonés et combattirent en confusion et désordre
jusqu'à ce qu'estant pressés et oppressés de la multitude, ils n'eurent
plus aucun moyen de se défendre, ains furent taillés en pièces ou
faits prisonniers de guerre. Bonasse mourut en combattant après
avoir veu défaire sa compaignie. » Les prisonniers furent égorgés,
beaucoup d'habitants eurent le même sort. On compta deux mille morts
que les paysans des campagnes voisines, après la retraite de Montamat,
passèrent huit jours à ensevelir dans les fossés et les puits.
« Cecy fust environ la feste de Pasques de la susdite année 1570.
Depuis ença la ville de Tarbes demeura sans habitants, et l'herbe
creut par les rues comme en un pred, qu'estoit chose fort déplorable
à voir, et passèrent trois ans entiers durant lesquels n'y eut aucune
garnison aussi n'estoit-elle dérensable à cause des ruines que le
canon y avoit faites. » Tarbes fut encore plusieurs fois victime
de la guerre. Elle trouva enfin le repos sous la sage administration
de Catherine, sœur de Henri de Bourbon (Henri IV), nommée par lui
régente du pays de Bigorre. Les partis religieux jouirent sous cette
princesse d'une égale tolérance. Cette heureuse paix ne fut troublée
que par une entreprise que firent les ligueurs, en 1592, à l'instigation
du clergé et des moines de Tarbes. Lâchement abandonnée par ses
défenseurs, cette ville fut prise par eux mais elle souffrit beaucoup
moins que les campagnes, où ces brigands répandirent la désolation.
Jamais, depuis le commencement des troubles, on n'avait fait une
guerre aussi funeste aux pauvres paysans ; « car, dit la chronique,
il y avoit un capitaine qui avoit son bagage assorti de cinq-cents
moutons; l'autre d'une troupe de juments; l'autre de vaches et généralement
capitaines, soldats, valets et volontaires estoient si chargés de
meubles que la charge leur en estoit ennuieuse. Aussi, après ce
brigandage, les païsans de Bigorre abandonnèrent la culture des
terres par manque de bestailh, et la plus grande partie d'iceux
print la route d'Espagne. » En général, la majorité des Tarbais,
comme aussi des Bigorrais, demeura, en fait de religion, également
éloignée des extrêmes, de la Ligue et du calvinisme. Aussi, point
de mouvements religieux sous Louis XIII. Sous Louis XIV, nous ne
voyons que la suppression des maires électifs par tout le Bigorre,
et leur remplacement par des maires héréditaires ce qui ne laissa
pas d'affliger les habitants attachés à leurs vieux privilèges que
Henri IV leur avait confirmés.
Le siècle le plus heureux fut
le XVIIIème. Plus de guerres ni d'atteintes aux libertés.
Un vent plus doux soufflait sur la France. Partout l'impulsion donnée
par les philosophes poussait l'administration dans la voie des améliorations
et des grands travaux d'utilité publique.
Tarbes paya son tribut
à l'invasion en 1814. Une rencontre eut lieu sur son territoire
entre les troupes françaises et un corps anglais venant d'Espagne.
La victoire de l'ennemi n'entraîna aucun dommage notable pour la
contrée ; c'est sur un autre théâtre que devaient se décider les
destinées de la France. Un beau pont de six arches fut bâti à Tarbes
entre 1742 et 1743 ; un haras royal, qui depuis a pris de magnifiques
développements, en raison des avantages que le pays offre pour l'élevage
des chevaux, y fut établi en 1784. La Révolution ne fit point déchoir
Tarbes, qui devint le chef-lieu du département. Elle envoya à nos
grandes assemblées Bertrand Barrère de Viensac, le célèbre conventionnel
il était né en 1755, et était fils d'un consul de cette ville. Barrère
étudia le droit à Toulouse, son esprit s'ouvrit aux idées libérales,
et, dès avant 1789, il avait de lui-même abandonné les revenus du
petit fief de Vieusac que sa famille possédait dans la vallée d'Argelès,
ce qui lui avait valu des remerciements écrits de la part des habitants.
Un procès de famille l'appela à Paris. « Tu vas, lui dit son père,
dans un pays qui sera bientôt très dangereux. La corde est trop
tendue, il faut qu'elle rompe. » Par son esprit, son talent d'écrivain,
la grâce de sa figure, il devint bientôt, comme dit Mme de Genlis,
l'homme de toutes les académies, de tous les salons. Ses compatriotes
l'envoyèrent à la Convention il en devint président, puis membre
du comité de Salut public. En 1815, il fut encore choisi par eux
pour représentant mais la Restauration l'exila, et il ne revit sa
patrie, ses chères Pyrénées, qu'en 1830. Il se laissa nommer, en
1834, membre du conseil municipal de sa ville natale, et en exerça
consciencieusement les fonctions jusqu'à sa mort survenue en 184t1.
Tarbes n'est pas une ville fort considérable. Elle offre peu de
chose aux souvenirs. Elle n'a pour monuments anciens que son château,
devenu la prison ; la tour, qui en est le seul reste important,
a été classée parmi les monuments historiques.
Ce que Tarbes
peut montrer avec orgueil, c'est la belle plaine qui l'entoure,
si fertile, si bien cultivée, si habilement arrosée en tous sens
de ruisseaux d'eaux vives, détournées de l'Adour, si gracieusement
ornée de ces vergers où la vigne se marie aux arbres et les unit
par de verts festons ; si belle, enfin, à contempler du haut des
terrasses et des belvédères dont plusieurs maisons de la ville sont
judicieusement pourvues. C'est surtout cette magnifique chaîne des
Pyrénées qui forme le fond du tableau, en hiver tout éclatante de
blancheur sous la neige où brille le soleil ; en été, non moins
belle et plus sombre avec ses flancs noirs que couronnent quelques
cimes encore neigeuses. Cette situation privilégiée a été très habilement
exploitée pour la création de charmantes promenades au nombre desquelles
le jardin Massey, près de la gare du chemin de fer, mérite une mention
particulière.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025