Perpignan - Préfecture des Pyrénées Orientale
Retour
au Département
Retour Ville d'Art et d'Histoire
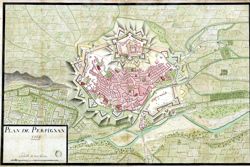
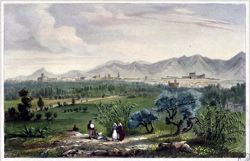
Perpignan ( Villa Perpini, Perinianum, Papirianum)
était autrefois la capitale de la province de Roussillon.
Perpignan
est, sans contredit, d'une bien antique et bien illustre origine,
si l'on voit dans cette ville la continuation ou la transformation
de l'ancienne cité de Ruscino. Son importance et sa prospérité auraient,
en effet, devancé de plusieurs siècles l'invasion romaine, puisque
c'est là que s'assemblèrent les chefs gaulois pour délibérer sur
les propositions d'Annibal demandant le passage pour l'armée qu'il
conduisait d'Espagne en Italie. Toutefois, malgré la proximité des
lieux et la concordance des temps, qui fait presque coïncider la
ruine de l'une de ces villes avec la naissance de l'autre, nous
ne croyons pas qu'il soit permis de confondre en une seule leur
double histoire.
Le plus ancien document qui constate l'existence
de Perpignan comme ville date de 922; il existe une autre charte
de 1025 : c'est un acte concernant l'église de Saint-Jean, paroisse
de l'unique quartier dont se composait la ville à cette époque.
Les habitants de Ruscino, obligés d'abandonner leurs foyers ravagés
d'abord par les Sarrasins, puis détruits presque entièrement par
les Normands en 859, avaient remonté les rives de la rivière de
la Têt et, séduits par la fertilité du sol et l'heureuse disposition
des lieux, s'étaient arrêtés près d'un hameau ou d'une ferme nommée
villa Pampiniani. La sécurité qu'ils y, avaient trouvée avait accru
leur nombre ; les progrès de la colonie fixèrent l'attention des
seigneurs du pays ; le comte de Roussillon, Gausfred II, résolut
d'y fonder une église, et peu après le bourg était devenu une petite
ville. Les successeurs de Gausfred la dotèrent, l'un d'une collégiale,
en1102; l'autre d'un hospice, en 1116 ; de sorte que, sous le comte
Guinard, qui abandonna le Roussillon à la maison d'Aragon, la villa
Perpiniani était la principale ville du comté. Elle était bien loin
encore de l'importance qu'elle acquit depuis. Alphonse II, dont
nous avons signalé les sympathies pour tout ce qui intéressait le
Roussillon, vit dans Perpignan bien plus ce qui restait à faire
que ce qui avait été réalisé. Il voulut changer l'emplacement de
la ville et la transférer sur une des collines au pied desquelles
elle s'étendait, sur le Puig Saint-Jacques ou montagne des Lépreux.
Les intérêts froissés protestèrent on s'adressa à la pitié d'Alphonse,
qui ne sut pas résistor aux larmes et aux supplications des femmes,
des enfants, des vieillards. Pour concilier les vœux des habitants
avec une mesure indispensable à la défense de la on relia le Puig
aux quartiers existants par des constructions nouvelles qu'on assigna
comme résidence aux juifs. Ceux-ci y demeurèrent longtemps en paix,
protégés surtout par l'intelligente tolérance du roi Martin. Leur
séjour ne fut pas sans influence sur les rapides et vastes développements
que prirent bientôt à Perpignan le commerce et l'industrie. Mais
la cause principale de cette prospérité fut le libéralisme des institutions
municipales qui régissaient la ville. Les rois d'Aragon avaient
compris la nécessité de s'assurer le dévouement d'une population
séparée par tant d'obstacles du reste du royaume et exposée, dans
son isolement en deçà des monts, moins peut-être aux attaques violentes
qu'à la séduction des intrigues étrangères.

C'est donc dans la
plus large mesure que privilèges et franchises furent prodigués
aux bourgeois de Perpignan. Cinq consuls nommés par le peuple administraient
les affaires de la ville leur pouvoir ne durait qu'une année. La
noblesse était exclue de toute magistrature municipale. Le droit
de se réunir en armes, sous la conduite d'un des consuls fut toujours
reconnu et souvent pratiqué. La répartition des impôts était aussi
dans les attributions des mandataires du peuple. Le clergé lui-même,
au XIVème siècle, dans l'époque de sa toute-puissance,
dut, après sept ans de résistance, payer sa part d'un impôt contracté
par les consuls en 1368 pour éteindre les dettes de la ville. Bien
peu de communes en France peuvent offrir l'exemple d'une semblable
indépendance. Nous en avons indiqué et les causes et les heureux
résultats. C'est au milieu de ces prospérités qu'un nouveau mais
dangereux honneur échut à Perpignan don Jayme partagea ses États
entre ses deux fils, et la capitale du Roussillon devint la capitale
du royaume de Majorque. Un château royal fut construit, en 1278,
sur la colline qui s'élève à la droite du Puig Saint-Jacques, et
qui domine toute la ville de nouvelles murailles agrandirent l'enceinte
de la cité, divisée dès lors en trois paroisses, Saint-Jean, Saint-Jacques
et Saint-Matthieu, et dotée en outre, en 1300, d'un temple à la
Vierge, sous l'invocation de Marie-de-la-Réal, parce qu'il était
voisin du château royal.
Perpignan échappa aux conséquences des
luttes qui inaugurèrent le malencontreux morcellement de la monarchie
aragonaise. Le règne de don Sanche, deuxième roi de Majorque, fut
pour cette ville pacifique et bienfaisant. Les premiers travaux
de la cathédrale et la construction entière du Castillet sont dus
à ce prince.
C'est aussi cette époque qu'on peut considérer
comme marquant l'apogée des prospérités commerciales de Perpignan.
La ville comptait alors 5 000 feux ; les maitres drapiers y étaient
au nombre de 349, sans comprendre dans ce chiffre les corporations
de Pratz-de-Mollo et Céret, véritables succursales de la métropole,
et les tissus de leurs fabriques étaient répandus dans l'Aragon,
dans le midi de la France et jusque dans le Levant. Perpignan n'eut
pas non plus à souffrir de la crise qui réunit aux mains de Pèdre
IV Aragon et Majorque. Cette guerre, si promptement terminée, amena
dans ses murs Philippe le Hardi, allié malheureux de Jayme II, troisième
et dernier roi de Majorque. Le prince français y mourut le 5 octobre
1285. Les chroniques du temps racontent qu'on fit bouillir sa dépouille
mortelle pour en séparer les diverses parties, qui furent partagées
entre la métropole de Narbonne, l'église Saint-Jacques des Frères
pêcheurs de Paris, l'abbaye de Noé, en Normandie et les caveaux
de Saint-Denis.

Nous arrivons une nouvelle période de l'histoire de Perpignan. Ce n'est plus la capitale d'un royaume, mais de nombreuses compensations lui sont offertes. Don Pèdre y fonde une université ; le château royal est transformé en citadelle formidable ; de nouveaux privilèges communaux sont concédés à la fière et ombrageuse bourgeoisie. La ville obtient le droit d'être représentée aux cortès et de concourir aux actes constitutifs de la Catalogne, les rois d'Aragon ne peuvent exiger d'être reconnus par les syndics de Perpignan qu'après avoir reçu le serment de toutes les autres villes du royaume. Le commerce n'est point oublié dans cette répartition des faveurs royales. Un consulat de mer est institué pour connaître des transactions commerciales avec l'étranger. Une loge ou bourse est bâtit par Martin, le protecteur des juifs, et un privilège spécial de Pèdre IV autorise, en cas de disette, les consuls à armer des galères pour arrêter en pleine mer et amener de force dans les ports du Roussillon tous navires chargés de blé qu'ils rencontreraient.

C'était donc sous de bien
favorables auspices que commençait cette partie de l'histoire de
Perpignan, qui devait être pourtant si agitée, si calamiteuse. Le
premier nuage qui vient obscurcir l'horizon, c'est l'antipape, Pierre
de Luna, Benoît XIII, beau-frère de Martin, vieillard orgueilleux,
obstiné, que les prières de l'empereur Sigismond trouvèrent aussi
inflexible dans ses prétentions que les foudres du concile de Constance.
Il avait accepté Perpignan comme résidence ; il y tint un concile,
en 1408 dans l'église Sainte-Marie-de la-Réal, et y reçut, en 1416,
la visite de Sigismond.
A la perturbation morale que jeta dans
les esprits le spectacle des querelles religieuses succédèrent bientôt
les sanglants débuts de la lutte entre la France et l'Espagne, duel
à outrance dont Perpignan était à la fois et le théâtre et l'enjeu.
Nous avons raconté, dans l'histoire générale du département, les
circonstances à la suite desquelles Louis XI pénétra dans le Roussillon.
Perpignan soutint alors contre les Français un de ces sièges fameux
qui suffisent à immortaliser une ville, et dont les détails rappellent
l'héroïsme de Sagonte et de Numance. Les habitants semblent avoir
voulu acquitter alors par leur inébranlable fidélité, les sacrifices
de toute sorte qu'ils s'imposèrent et l'invincible dévouement dont
ils firent preuve, la dette de reconnaissance qu'ils avaient contractée
envers les rois d'Aragon. La position était cependant critique.
Trente mille hommes cernaient la place, le château était occupé
par les soldats de Louis XI. Il y avait peu d'assistance à espérer
du dehors. Mais le vieux roi, Jean d'Aragon avait fait appel au
coeur sympathique et résolu des bourgeois de Perpignan ; à l'âge
de plus de soixante-dix ans, il n'avait pas craint de venir leur
confier sa couronne et sa vie en s'enfermant avec eux dans les murs
de la place assiégée. La résistance fut si énergique, qu'une trêve
dut être acceptée par les assaillants. Mais Louis XI, qui ne voulait
pas perdre les fruits de sa campagne, en hâta la rupture, et, profitant
du départ de Jean qui avait repassé les Pyrénées, il fit recommencer
et pousser les hostilités avec une nouvelle vigueur. La population,
réduite à ses seules forces, ne perdit pas courage et, pendant huit
mois, épuisa toutes les ressources de la défense la plus opiniâtre.
Depuis longtemps on avait épuisé les vivres, on ne se nourrissait
plus que d'herbes, de cuirs et de la chair des animaux les plus
immondes, une mère, dit-on, avait partagé le corps d'un de ses enfants
mort entre ses autres enfants affamés. Aucun secours n'était espéré
; il fallait se rendre. Perpignan ne voulut pas le faire avant d'en
avoir reçu l'autorisation de son roi, Jean la lui envoya en y joignant
pour la ville le titre de très fidèle ; honneur stérile, mais bien
mérité. Il accorda de plus à tous les Perpignanais qui voudraient
vivre ou voyageraient dans ses États les droits et privilèges dont
jouissaient les Aragonais. La capitulation fut signée le 11 mars
1475 ; les articles, fièrement rédigés par les consuls, les engagèrent
moins qu'ils ne liaient le vainqueur. Louis XI, d'ordinaire si habilement
oublieux et clément dans le succès, usa envers Perpignan d'une rigueur
rancunière tant il désespérait, sans doute, d'y changer la disposition
des esprits.

L'erreur de Louis XI disparaît devant la faute bien
autrement plus grave de son successeur, Charles VIII, abandonnant
sans compensation et sans motif la conquête de son père. Mais le
temps approchait où nos rivaux, si habiles jusque-là, se tromperaient
à leur tour. En face d’une population si fortement trempées, la
violence étant une arme inutile, la France avait moins à espérer
de ses victoires que des fautes de l'Espagne.
Les premiers symptômes
ne tardèrent pas à se manifester. Aux joies enthousiastes qui saluèrent
l'entrée solennelle de Ferdinand et d'Isabelle reprenant possession
en grande pompe de la province et de sa capitale, succédèrent bientôt
les défiances, les inquiétudes. L'inquisition était entrée dans
la ville sur les pas du brillant cortège ; c'est de là qu'on peut
dater la désaffection des cœurs, la dé- cadence des intérêts. Le
grand Charles-Quint lui-même, dans sa lutte avec François Ier,
met plus de confiance dans la solidité des remparts que dans le
zèle des habitants. Il rebâtit les murailles d'après un meilleur
système, trace de nouvelles lignes, élève de nouveaux bastions;
il fait entourer d'une seconde enceinte l'ancien château que le
vieux roi Jean avait contruit, lorsque, fort de l'amour de ses sujets,
il résistait si vaillamment à Louis XI. Le siège soutenu alors n'offre
sous aucun rapport le même intérêt que celui que nous venons de
rappeler. Si François Ième fut moins heureux que Louis
XI, ce n'est plus au dévouement de la population qu'il faut attribuer
le mérite de la résistance. Entre Perpignan et l'Espagne on s'aperçoit
que tous les liens d'affection se relâchent ; le règne du fanatique
Philippe II n'est qu'une série de calamités ; l'industrie émigre,
le commerce languit, plus de mille maisons abandonnées par leurs
propriétaires tombent en ruine, le poids des impôts devient écrasant
pour ce qui reste d'une population épuisée par la guerre, décimée
par la famine et par la peste.
Nous retrouvons à cette époque
la trace des derniers efforts tentés pour arrêter les progrès du
mal : c'est pour la cité le renouvellement de son titre de très
fidèle, le transfèrement du siége épiscopal d'Elne à Perpignan en
1602 pour la bourgeoisie, l'octroi de lettres de noblesse attribuées
aux fonctions municipales ; pour les pauvres, la création d'avocats
gratuits et comme indice des dangers qui ne cessaient de croître
malgré ces impuissants palliatifs, la construction d'une enceinte
extérieure pour la citadelle. Chez ces ardentes populations méridionales,
l'indifférence est une transition inconnue de l'affection à la haine.
Le joug espagnol était donc devenu odieux aux Roussillonnais, et
l'hostilité comprimée devait éclater à la première occasion. C'est
en 1610 que cela arriva. La Catalogne s'était révoltée, le Roussillon
avait fait cause commune avec la province rebelle ; les soldats
espagnols refluaient de ce côté-ci des Pyrénées, et leurs chefs
prétendaient les loger chez les habitants de Perpignan; ceux-ci
s'y refusèrent malgré les menaces de la citadelle occupée par les
troupes royales; des barricades s'élevèrent, et la lutte était déjà
commencée, lorsque l'évêque, revêtu de ses habits pontificaux, l'ostensoir
à la main vint se placer entre les mousquets du peuple et les canons
du roi. L'autorité de sa parole, l'héroïsme de son dévouement, firent
cesser le feu ; mais à peine le peuple avait-il déposé ses armes
qu'une attaque déloyale, inattendue, de la garnison, livra la ville
à ses indignes agresseurs ; pendant trois jours elle fut traîtreusement
saccagée. Une pareille conduite brisait tous les liens qui pouvaient
attacher encore Perpignan à ses maîtres. Un appel fut fait à la
France, les cœurs étaient désormais conquis, il ne restait que l'Espagnol
à chasser. Richelieu envoya une armée sous les murs de la ville,
et un nouveau siège commença ; celui-ci avait cela de nouveau que
les libérateurs étaient les assiégeants, et que l'ennemi occupait
la place.

Il en résulta pour les malheureux habitants une complication
de calamités inouïes. La famine fut accompagnée des persécutions
les plus atroces. La soldatesque affamée violait impudemment le
domicile des citoyens pour y enlever les vivres qu'elle espérait
y trouver; les mères étaient obligées de cacher leurs enfants ;
on parlait d'enlèvements dans les rues et de festins de cannibales.
Enfin, lorsque l'inutilité d'une plus longue défense fut bien démontrée
le 9 septembre 1642, la garnison espagnole capitula, et les autorités
françaises prirent possession de la ville. L'importance de cette
conquête fut comprise par Louis XIII, Perpignan prit place parmi
les grandes villes de la monarchie ; le roi se détourna de son chemin
pour la visiter lorsqu'il se rendit à Saint Jean-de-Luz pour y épouser
l'infante d'Espagne. Enfin, le règne de Louis XIV lui-même lui donna
dans le comte de Mailly un administrateur habile, intègre et bienveillant.
Perpignan était donc une ville bien française quand éclata la Révolution
de 1789. Elle s'associa alors à toutes les grandes émotions qui
agitèrent l'âme de la patrie. Lorsque l'Espagne essaya d'unir ses
efforts à ceux du reste de l'Europe coalisée contre la république
française, une première surprise la rendit maîtresse d'Arles et
de Céret ; on put croire un instant Perpignan menacé. Le comité
de Salut public y envoya sur-le champ le conventionnel Cassanges.
Rallier les volontaires roussillonnais sous les murs de la place,
repousser les attaques du général espagnol Ricardos, prendre l'offensive,
culbuter l'ennemi à Vernet, surprendre son camp de Peyrestores et
le poursuivre jusqu'au delà de la frontière, ce fut pour le représentant
du peuple l'affaire de quelques semaines. En septembre 1793, il
rentrait dans Perpignan traînant quarante-sept pièces de canon,
trophées de cette rapide campagne. Elle avait coûté toutefois à
la France deux de ses plus illustres défenseurs les généraux Dagobert
et Dugommier. Davout y avait conquis ses premiers lauriers. Depuis
lors, sauf le désastre universel de 1814 et 1815, les murs de Perpignan
n'ont plus revu l'étranger.
Perpignan s'étend des pentes adoucies
d'une colline peu élevée jusque sur les bords de la Têt et de la
Bosse, dans une plaine vaste et fertile l'enceinte dans laquelle
la ville est enfermée est d'une forme ovale, et occupe un emplacement
de 1 200 mètres de longueur sur 600 de largeur. La ville, assez
mal bâtie, assez pauvre en monuments, a des abords charmants ; la
campagne environnante est couverte de jardins, plantée d'orangers,
de grenadiers, de vignes et d'oliviers. Après la citadelle et le
Castillet, dont nous avons eu si souvent occasion de parler, il
faut citer la cathédrale dédiée à saint Jean et deux autres églises
remarquables à divers titres Saint-Jacques et la Réal, appelée autrefois
Sainte Marie-Ia-Royale.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025