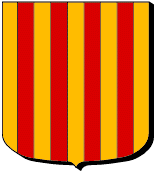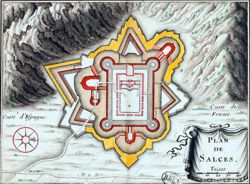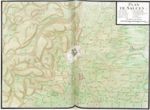Histoire des Pyrénées Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales
a été formé du Roussillon et de l'ancienne Cerdagne. Ce qu'on
sait de plus positif ou de plus probable sur l'origine des premiers
habitants de ces contrées, c'est que les Gaulois, dans leur
émigration du nord au sud, y substituèrent leur domination à
celle de colons sardes ou tyriens qui y avaient fondé d'importants
établissements. Les vainqueurs empruntèrent des vaincus ou leur
imposèrent le nom de Sardones, qui devint celui d'une puissante
tribu de la confédération des Consorani et des Tectosages. On
sait que ces peuples tentèrent de lointaines expéditions en
Orient et jusqu'en Asie. Les Romains, qui avaient appris à les
connaître, leur envoyèrent des ambassadeurs pour solliciter
leur alliance contre Annibal, qui, d'Espagne, marchait sur l'Italie.
Les Sardone refusèrent de prendre aucun engagement, et quand
à son tour se présenta le général carthaginois comme hôte, disait-il,
et non comme ennemi, le passage dans les campagnes lui fut laissé
libre, mais pas un des soldats de son armée ne put pénétrer
dans les villes. Tite-Live, qui rapporte cet épisode dans ses
annales, rend hommage à la fière indépendance de ces premiers
Roussillonnais.
Si le pays n'échappa point alors pour longtemps
aux armes romaines sa défaite a quelque chose d'honorablement
exceptionnel par l'éclat des grands noms qui s'y trouvent mêlés.
Après Annibal, c'est Marius qui apparait, venant punir les Cimbres
d'une double invasion ; c'est ensuite le grand Pompée, dressant
sur la cime des Pyrénées la colonne commémorative de sa victoire
sur Sertorius. César, enfin, vient après eux, et plus habile
dans son orgueil, c'est aux dieux qu'il élève un autel pour
marquer son passage.
La conquête du pays des Sardones, compris
plus tard dans la Gaule Narbonnaise, remonte à l'an de Rome
633 et est attribuée à Q. Marcius, le fondateur de la colonie
de Narbonne. Cette période dura jusqu'à l'année 409 de l'ère
chrétienne.

La position géographique du Roussillon
sur la route d'Espagne, la richesse de ses villes, dont l'une,
Elne, comptait dès lors parmi les sept sièges épiscopaux de
la Septimanie, le désignaient fatalement comme une proie à l'avidité
des Barbares. Vandales Suèves et Alains s'y étaient installés,
quand les Wisigoths les en chassèrent. La domination de ces
derniers dura trois siècles environ et laissa une profonde empreinte
dans les mœurs et dans la législation du pays. Entre Euric et
Roderic, le premier et le dernier roi de la monarchie wisigothe,
l'événement qui affecta le plus spécialement la, province dont
nous nous occupons est la révolte de Paul, un des lieutenants
du prince Wamba.
Envoyé par son maître, qui résidait alors
à Tolède, en Septimanie, pour y comprimer une sédition populaire
ce général se mit à la tête des rebelles et se, fit proclamer
roi d'Orient en 673.


Wamba fut obligé de venir en personne
combattre l'usurpateur ; il traversa deux fois le Roussillon
; la seconde, après la défaite et la prise de son rival, il
s'y arrêta pour réglementer l'administration ; il donna des
délimitations nouvelles aux diocèses, réforma sur différents
points la discipline ecclésiastique, rendit entre autres une
ordonnance qui obligeait les prêtres à prendre les armes pour
la défense du sol et, après une étude sérieuse des besoins du
pays, laissa à ses agents de sages instructions qui ne furent
pas sans une heureuse influence sur la province.
Deux siècles
après la bataille de Vouglé, le Roussillon était encore au pouvoir
des Wisigoths ; rien n'indique que cette possession fût même
menacée par les princes francs ou les ducs d'Aquitaine, lorsque
les Sarrasins, maîtres de l'Espagne, apparurent sur la crête
des Pyrénées, invasion méridionale venant se heurter contre
les hordes victorieuses du Nord. Le Roussillon fut le premier
champ de bataille et la première conquête des Sarrasins. La
grande épopée de Charles-Martel, la journée de Poitiers, les
exploits décisifs de Pépin n'appartiennent point à cette notice
; nous nous bornerons donc aux faits dont notre province fut
le théâtre. C'est en 719 que le Roussillon fut envahi par Zama,
gouverneur de l'Espagne pour les califes de Damas. Cette province
et la ville de Narbonne étaient les points où l'autorité musulmane
s'était le plus solidement établie. Un des lieutenants d'Abd-er-Rahman,
nommé Manuza, se laissa séduire par les charmes de Lampégie,
fille d'Eudes, duc d'Aquitaine, l'épousa, et conclut une trêve
de trois ans avec son beau-père. Cette inaction de Manuza au
moment d'une lutte suprême souleva la colère d'Abd-er-Rahman
; il envoya contre le traître un autre chef nommé Gedhi ; c'est
dans le Roussillon que les deux généraux se rejoignirent pour
combattre. Manuza, vaincu, alla mourir dans les murs de la petite
forteresse de Livia, dont on voit encore quelques ruines. Sa
femme captive fut conduite à Damas, au sérail du calife. A cette
époque, en 731, les Maures étaient encore maîtres du Roussillon,
et Charles-Martel avait échoué dans ses tentatives sur Narbonne
; c'est seulement vingt ans environ après, alors que Pépin prenait
enfin la ville vainement assiégée par son père, que les Roussillonnais
chassent eux-mêmes les soldats du prophète et se donnent au
fondateur de la seconde dynastie franque.

Il fallait que les circonstances fissent
de ce rapprochement une nécessité bien impérieuse, car de longs
siècles devaient s'écouler avant qu'aucune fusion fût possible
entre les conquérants des Gaules et les habitants des Pyrénées.
Lorsque Charlemagne traversa le pays en 778, rendant l'offensive
aux armes des Francs, il apprécia, dans son génie, le rôle que
pouvait jouer, dans son nouvel empire, la race roussillonnaise
; conciliant avec l'intérêt de la patrie commune l'indépendance
ombrageuse et la belliqueuse fierté de ces populations, il fit
de cette province un de ces comtés qui, sous le nom de marches
d'Espagne, devaient, comme des sentinelles avancées, veiller
sur les frontières naguère menacées. Mais le grand monarque
n'avait point prévu le rapide affaissement de son œuvre et les
déchirements auxquels la faiblesse de ses successeurs livrerait
son immense empire. Les comtes du Roussillon furent des premiers
à secouer le joug royal. Les chefs de cette maison féodale étaient
les comtes de Barcelone, qui apanagèrent deux branches cadettes
de leur famille, l'une de la Cerdagne et l'autre du Roussillon.
Cette période est la plus confuse et la plus désastreuse de
l'histoirede la province ; le nom même des seigneurs possesseurs
du pays disparaît dans ce chaos qui dura plus de trois siècles.
Gaucelme ou Gaucion échappe à cet oubli des chroniques par la
part qu'il prend à la lutte de Pépin d'Aquitaine contre Louis
le Débonnaire et par sa mort tragique. Étant tombé aux mains
de Lothaire, il eut la tête tranchée, et sa sœur, prisonnière
comme lui, fut enfermée dans un tonneau et jetée dans la Saône.
Aux attaques incessantes des Maures, aux courses dévastatrices
des Normands, se joignaient les horreurs d'une guerre civile
presque permanente, les rivalités locales mettant sans cesse
les armes aux mains des petits chefs féodaux. Ces désordres
devinrent tels, qu'une intervention des seigneurs tant laïques
qu'ecclésiastiques dut s'efforcer d'y apporter remède des constitutions
de paix et trêve, désignées sous le nom de treuga Dei (trêve
de Dieu ), furent décrétées dans deux conciles tenus dans la
petite ville de Toulouges, près de Perpignan, en 1041. Les clauses
principales de ces traités prouvent à quel degré le mal était
arrivé. Il était défendu de se saisir des bestiaux utiles à
l'agriculture au-dessous de six mois, tant on redoutait l'anéantissement
des espèces. Chacun avait le droit de tuer quiconque était reconnu
coupable d'avoir violé la trêve de Dieu; on alla plus loin encore,
et, pour stimuler l'ardeur des vengeurs de la justice, on déclara
que ceux qui auraient puni un homme condamné pour ce fait recevraient
le titre de zélateurs de la cause divine. Quelques fondations
pieuses, les exploits d'un Guinard au siège d'Antioche, la lutte
impie d'un autre Guinard contre son père Gausfred III et, à
la suite de ces déchirements, la désolationde la province réduite
à recourir à l'aumône de la Septimanie chrétienne, tels sont
les faits principaux dans lesquels se résume l'histoire du Roussillon
pendant cette déplorable époque.

Enfin ce Guinard, auquel son père avait
pardonné et qui avait hérité de ses domaines, ne s'étant pas
marié, légua son comté au roi d'Aragon, Alphonse Il, en 1172.
Il avait été précédé dans cette détermination par Bernard-Guillaume,
comte de Cerdagne, dont le testament, en 1117, avait institué,
pour hériter de ses petits États, Raymond V, comte de Barcelone,
qui devint roi d'Aragon en 1134, par son mariage avec Pétronille,
fille de Ramire II. Un dernier lien, malgré ces donations, rattachait
le Roussillon à la France les princes d'Aragon reconnurent pour
ces contrées la souveraineté de nos rois jusqu'à la renonciation
qu'en fit saint Louis en faveur de Jacques 1er, et
en échange des prétentions de ce dernier sur une partie du Languedoc,
prétentions qu'il abandonna par le traité de Corbeil, en 1258.
Quoi qu'il en puisse coûter à notre amour-propre national, il
faut reconnaître que la domination aragonaise inaugura pour
le Roussillon une ère de réparation et de prospérité. Alphonse,
vaillant, habile, doué de qualités aussi solides que brillantes,
mit tous ses soins à faire accepter par les sympathies et les
intérêts des provinces cédées leur incorporation à son royaume
d'Aragon. Perpignan devint une de ses résidences de prédilection
et l'objet de ses faveurs les plus signalées. Sa cour était
le rendez-vous des poètes et des savants de l'époque ; aux bruits
de guerre avaient succédé les chants d'amour, et les vers des
troubadours, les poétiques légendes remplaçaient le sinistre
récit des batailles. Guillaume de Cabestaing, le trouvère roussillonnais,
était un ami particulier d'Alphonse. Sa fin tragique, qui rappelle
la sanglante histoire de Gabrielle de Levergies, fut vengée
par le roi. Ce nom n'est pas le seul qui ait illustré le règne
d'Alphonse ; il faut lui joindre ceux de Bérenger de Palazol,
de Raymond Bistor, de Pons d'Ortessa et Tormit de Perpignan,
gracieux talents de la même époque dont le Roussillon garde
encore aujourd'hui le glorieux souvenir. Alphonse avait créé
de nouveaux comtes de Roussillon ; mais, pour prévenir toute
division, tout déchirement, c'est dans sa famille, au profit
de son frère don Sanche, qu'il avait constitué cet apanage.
Les traditions d'Alphonse furent suivies un siècle environ après
sa mort, arrivée le 25 avril 1196. C'est dans cet intervalle
que le roi don Jayme Ier, surnommé le Conquérant
parce qu'il avait agrandi ses États des îles Baléares et du
royaume de Valence, obtint de Louis IX sa renonciation à la
souveraineté de la Cerdagne et du Roussillon. Ce prince, regardant
comme solidement établie la domination de sa maison sur les
diverses parties de son royaume, le partagea à sa mort entre
ses deux fils, don Pèdre III et don Jayme. Le premier, qui était
l'aîné, eut l'Aragon, Valence et la Catalogne ; Majorque et
les possessions françaises échurent à l'autre. Ce malheureux
partage replongea nos provinces dans toutes les calamités de
la guerre. Les prétentions de suzeraineté soulevées par don
Pèdre jetèrent son frère dans les bras du roi de France. L'excommunication
fulminée par le pape contre le roi d'Aragon fournit un prétexte
à Philippe le Hardi, qui vint se faire battre au pied des Pyrénées
et mourir à Perpignan le 5 octobre 1285. La couronne de Majorque
perdit beaucoup de son prestige à cette défaite, et le Roussillon
en particulier, théâtre de la lutte, en éprouva des dommages
considérables. Les successeurs immédiats de don Jayme cherchèrent
à faire oublier les torts et les revers de leur aïeul par leur
attitude humble et soumise ; mais les éléments de rivalité n'en
subsistaient pas moins ; la lutte recommença entre Pierre IV
et Jayme II. Cette fois, elle fut décisive. Malgré l'obstination
désespérée de Jayme, toujours vaincu et toujours menaçant, malgré
l'infatigable dévouement des Roussillonnais, la dernière heure
était venue pour le royaume de Majorque ; en 1374, il était
définitivement réuni à l'Aragon, et le Roussillon retombait
pour trois siècles sous la domination espagnole. Il y eut un
retour momentané à la France mais ce court épisode se rattache
au XVème siècle et au règne de Louis XI, dont le
nom se représente partout où sont tentés les premiers efforts
pour constituer l'unité française, et près de deux cents ans
nous en séparent encore. Pierre IV était un prince d'une haute
capacité, l'énergie qu'avaient déployée les Roussillonnais pour
la défense du royaume de Majorque lui inspira plus d'estime
pour leur caractère que de rancune pour la résistance qu'ils
lui avaient opposée recommençant la politique d'Alphonse II,
c'est par une administration bienveillante qu'il voulut s'attacher
ses nouveaux sujets. Il les associa à la législation catalane,
les admit aux états généraux ou cortès, encouragea l'industrie
et la navigation par des traités avec les nations voisines,
protégea l'agriculture et fit replanter d'arbres les contrées
ravagées dans les dernières guerres. Jean Ier, fils
et successeur de Pèdre IV, ne suivit pas l'exemple de son père
; il abandonna le Roussillon à l'administration d'un gouverneur
général et d'officiers royaux, plus soucieux de leur enrichissement
et de leur élévation que des intérêts du pays. Le seul acte
qui signale ce règne est une ordonnance à la date du 13 décembre
1388, qui ouvre le Roussillon aux criminels expulsés des autres
provinces de l'Aragon.
Martin, qui succéda à Jean Ier,
était sympathique aux Roussillonnais, il répara une partie des
maux causés par l'incurie de son prédécesseur. Ce prince étant
mort sans héritier, les états du royaume décernèrent sa couronne
à Ferdinand, infant de Castille, dont le règne fut déchiré par
le schisme de Benoît III. Alphonse V, qui lui succéda, passa
presque toute sa vie à guerroyer en Italie ; le Roussillon n'eut
qu'à se louer de la régence de la reine Marie, sa femme, dont
l'administration laissa dans le pays des traces de grande sagesse
et des souvenirs de bonté.
C'est en 1458 que Jean II monta
sur le trône, et c'est presque aussitôt qu'éclatèrent ses démêlés
avec le roi de France. La Catalogne s'était soulevée, le Roussillon
s'était associé à la révolte ; Jean, impuissant à faire rentrer
ses sujets dans le devoir, s'adressa à Louis XI et sollicita
de lui un secours de sept cents lances. Le rusé monarque y consentit,
mais à la condition que les frais de l'expédition, évalués à
deux cent mille écus, seraient à la charge du roi d'Aragon,
et que, si cette somme n'était pas exactement payée dans un
délai donné, le Roussillon et la Cerdagne deviendraient les
gages de la créance. Jean ne tarda pas à s'apercevoir du piège
caché sous les conditions de son allié ; il mit alors toutes
ses espérances dans le succès de cette sédition qu'il était
naguère si désireux de comprimer. Les soldats français furent
reçus et traités en ennemis. Louis XI n'en fut sans doute que
médiocrement affecté ; il envoya à leur secours une armée de
trente mille hommes. La résistance fut encouragée et organisée
alors par le roi d'Aragon ; c'était la guerre elle fut vaillamment
soutenue de part et d'autre, mais Louis XI n'était pas homme
à se dessaisir facilement de ce qu'il avait une fois tenu. Les
négociations achevèrent l'œuvre que les armes avaient commencée,
et en 1475 le Roussillon et la Cerdagne appartenaient à la France.
Mais le génie n'est point héréditaire ; Charles VIII n'était
capable ni de comprendre ni de poursuivre les grandes traditions
politiques de son père ; il avait, d'ailleurs, pour antagoniste
ce Ferdinand qui, par son mariage avec Isabelle, venait de réunir
sous le même sceptre Aragon et Castille, et dont la couronne
allait s'enrichir de tous les trésors de l'Amérique.
Une
intrigue ourdie par deux moines à la solde de l'étranger jeta
le trouble dans la conscience du jeune roi, qui, malgré l'avis
de son conseil, malgré la résistance des gouverneurs provinciaux,
s'obstina à restituer les conquêtes paternelles Ferdinand et
Isabelle firent leur entrée solennelle à Perpignan en septembre
1493. Toutefois, cette faute était si énorme qu'elle excita
de fréquents regrets chez Charles VIII et Louis XII, qui tentèrent
d'inutiles efforts pour revenir sur cette déplorable cession.
L'occasion perdue ne devait pas sitôt renaître ; Louis XII,
aussi peu heureux à la guerre que dans les négociations, renouvela
authentiquement la restitution du Roussillon en échange du royaume
de Naples, qu'il ne devait pas mieux conserver ; déçu des deux
côtés, il recommença la lutte, triste héritage pour son successeur
François 1Ier. En Roussillon, comme à Pavie, «
tout fut perdu fors l’honneur » sous le règne du chevaleresque
monarque, et pendant soixante-dix ans la domination espagnole
ne fut plus même contestée.
La seule consolation que nous
puissions nous donner est le tableau de l'ignorance et de la
misère où le pays resta plongé pendant cette période de la domination
étrangère. Pestes, famines, envahissement des esprits par les
superstitions les plus absurdes, persécutions des prétendus
sorciers, plus absurdes encore, rien ne manque à la honte et
au malheur des populations.
Enfin la tâche de Louis XI put
être reprise. Richelieu gouvernait la France, lorsque les animosités
soulevées par Olivarès, premier ministre de Philippe IV, firent
explosion en Catalogne ; le Roussillions fit, comme toujours,
cause commune avec la province révoltée Olivarès, en recourant
aux moyens de répression pratiqués ailleurs par le duc d'Albe,
poussa les esprits au désespoir. Vers le même temps, une attaque
des Espagnols sur la ville de Trèves, sans déclaration de guerre
préalable, fournissait à Richelieu un prétexte d'intervention.
Condé entra dans le Roussillon ; les habitants songeaient alors
à fonder une république fédérative ; on leur fit comprendre
qu'on attendait un autre prix du secours qu'on leur apportait.
En haine de la domination espagnole, ils se donnèrent à la France.
Louis XIII vint en personne faire le siège des places fortes.
En 1642, tout le Roussillon était occupé par l'armée française
; en 1659, le traité de la Bidassoa consacrait les droits de
la France sur tout le versant septentrional des Pyrénées, et
le Roussillon prenait place parmi nos provinces.
Une conspiration
de quelques nobles, découverte en 1674 par suite d'une indiscrétion
amoureuse, fut la seule protestation contre le nouveau régime.
La crise de la Révolution, les désastres de l'Empire ont trouvé
les populations inébranlablement dévouées à la France.
Aujourd'hui,
si quelques usages, quelques détails de costume, quelques traits
de la physionomie trahissent encore chez les Roussillonnais
leurs longues et intimes relations avec l'Espagne, sous tant
d'autres rapports l'assimilation est si complète, qu'il faut
relire l'histoire pour ne pas oublier que cette contrée n'est
française que depuis un peu plus de deux siècles.

Note :Le département des Pyrénées-Orientales
recoupe approximativement les territoires appelés Roussillon,
ou Catalogne française ou Catalogne Nord. Ce dernier terme a
été inventé dans les années 1930 par les catalanistes du groupe
Nostra Terra qui souhaitaient rappeler les liens historiques,
culturels et linguistiques de cette région au reste de la Catalogne.
L'emploi de nos jours des termes Catalogne Nord, Roussillon ou Pyrénées-Orientales traduit plus ou moins l'attachement à une identité catalane. Le terme Catalogne Nord a obtenu une première forme de reconnaissance officielle lors de la session du conseil général des Pyrénées-Orientales du 10 décembre 2007, où a été approuvée une Charte en faveur du catalan. Celle-ci déclare en préambule que "La langue catalane, née il y a plus de mille ans, constitue un des piliers de notre identité, du patrimoine et de la richesse du département des Pyrénées-Orientales (Catalunya Nord)". Le terme Catalogne Nord, écrit toutefois en catalan et non en français, apparait ainsi pour la première fois sur un document officiel. Son usage tend donc aujourd'hui, à être plus courant, en particulier dans son usage par les touristes espagnols, de plus en plus présent dans les Pyrénées-Orientales.
Perpignan
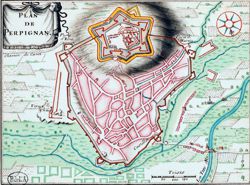

Saint Jean-Baptiste est patron de la
ville de Perpignan qui fut à l'origine le domaine rural d'un
certain Perpinianus. À la fin du 10ème siècle, ce
fut la résidence de Guilabert Ier, comte de Roussillon,
remplaçant l'antique Ruscino établi à l'époque romaine, là où
la via Domitia reliant l'Espagne à l'Italie franchissait le
Têt. En 1172 Perpignan et le Roussillon passèrent par héritage
à l'Aragon. En 1276 la ville devint la capitale du royaume de
Majorque attribué à une branche cadette de l'Aragon. Perpignan
connut alors les fastes de la cour de Majorque avec la construction
d'un Palais royal. Au 14ème siècle la ville retourna
à l'Aragon. Disputé entre la France et l'Aragon, Perpignan fut
définitivement réuni à la France en 1659 par le Traité des Pyrénées.
Le palais des rois de Majorque a été construit dans le dernier
quart du XIIIème. par le roi Jacques II de Majorque
qui s'installe à Perpignan (1276). Entouré de jardins, il s'élève
sur une colline au sud de la ville. Il aura fallu 35 années
de travaux pour mener sa réalisation à son terme, la consécration
des chapelles aura lieu en 1309.

Céret
L'histoire de Céret commence lors de
la formation de l'Empire carolingien. Le Vallespir fait alors
partie des marches d'Espagne. C'est un pagus dépendant du comté
de Roussillon. Les premières mentions de Céret apparaissent
au IXème siècle. La ville apparait d'abord comme
un fief des comtes d’Empuries sous contrôle de Pons de Vernet.
Le Castellas, ancien château seigneurial de la ville, date de
cette époque. En 1172, Alphonse II, comte de Barcelone et roi
d'Aragon hérite du Roussillon et ses pagus dont le Vallespir.
Jaume Ier d'Aragon partage
en 1262 ses possessions entre ses fils. Jaume II de Majorque
hérite du royaume de Majorque, du Roussillon et de Céret. Cette
époque voit la protection de la ville par des remparts et des
douves et la construction de l'abbaye bénédictine de Saint-Ferréol.
La rupture politique entre les héritiers de Jaume Ier
entraine la prise des possessions du royaume de Majorque par
la couronne d'Aragon.
Pierre IV d'Aragon envahit et annexe
le Roussillon en 1344. En 1268, Guillaume V, vicomte de Castelnou
obtient Céret en dot lors de son mariage avec Ava. Sa fille
en hérite en 1312. L'année suivante, en 1313, la fontaine des
neuf jets est construite, sous le règne de Sanç Ier
de Majorque. Comme le veut la mode de l'époque et un certain
calcul politique, une forme d'autonomie est offerte par le vicomte
dans la gestion de la ville. Quatre consuls sont élus annuellement
par la population. Vers 1321, la ville fait construire le pont
du Diable. Les frais sont partagés entre Céret et les villages
en amont du Tech qui en tirent parti.
À la suite du mariage
d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, et l'union
des deux royaumes qui s'ensuivit, Céret dépend du royaume d'Espagne.
![]() À cette occasion, la fontaine des neuf Jets est alors surmontée
d'un lion, emblème de l'Espagne. En 1640, les représentants
de la Généralité de Catalogne ont signé dans la commune un pacte
avec le représentant de Louis XIII, le cardinal de Richelieu.
En 1641, en pleine guerre franco-espagnole, la cité privilégiée
reçoit des droits spéciaux, à l'égal de Ille. Un second privilège
lui fut accordé lorsque les représentant des royaumes de France
et d'Espagne négocièrent en 1660 la nouvelle frontière entre
les deux pays, ouvrant la voie à la signature du traité des
Pyrénées. L'annexion du Roussillon à la France mit fin aux droits
spéciaux accordés à la ville. À cette occasion, la tête du lion
surmontant la fontaine des neuf jets, initialement tournée vers
l'Espagne, est tournée vers la France, et la phrase suivante
est gravée : «Venite Ceretens, leo factus est gallus» (« Venez
Cérétans, le lion s'est fait coq ».
À cette occasion, la fontaine des neuf Jets est alors surmontée
d'un lion, emblème de l'Espagne. En 1640, les représentants
de la Généralité de Catalogne ont signé dans la commune un pacte
avec le représentant de Louis XIII, le cardinal de Richelieu.
En 1641, en pleine guerre franco-espagnole, la cité privilégiée
reçoit des droits spéciaux, à l'égal de Ille. Un second privilège
lui fut accordé lorsque les représentant des royaumes de France
et d'Espagne négocièrent en 1660 la nouvelle frontière entre
les deux pays, ouvrant la voie à la signature du traité des
Pyrénées. L'annexion du Roussillon à la France mit fin aux droits
spéciaux accordés à la ville. À cette occasion, la tête du lion
surmontant la fontaine des neuf jets, initialement tournée vers
l'Espagne, est tournée vers la France, et la phrase suivante
est gravée : «Venite Ceretens, leo factus est gallus» (« Venez
Cérétans, le lion s'est fait coq ».
Prades
La première mention du lieu date de 843. C'est à cette date que Charles le Chauve fait donation au comte d'Urgell et Cerdagne alors en place de la villa de Prada. Le comte fait don de la villa à l'Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse vers 855. Prades devient alors seigneurie de Lagrasse, statut que le village conservera jusqu'à la Révolution. Il est fait mention au XIème siècle de l'actuelle église paroissiale Saint-Pierre. Au XIIIème siècle la ville se dote d'une enceinte fortifiée, qui sera renforcée au XVIème siècle avant d'être plus tard démantelée.

Les lieux incontournables
Les Pyrénées Orientales, du fait de leurs
positions stratégiques entre la France et l'Espagne, ont été
un lieu de passage privilégié des armées parties de France pour
aller combattent les espagnoles, et vices versa.
Villefranche
de Confolens est l'exemple parfait d'une cité verrou de vallée
car lieu de passage obligé pour allée d'un Pays à l'autre. Ce
bourg a été crée au XIème.. De ce fait dès le moyen
Age la ville se retranche derrière ses remparts qui sont réputés
imprenables. En 1680, Vauban entreprend la construction de la
citadelle et voici ce qu'il prononce en découvrant la bourgade
:
Villefranche est une petite villotte
d'environ 120 feux. Un air un peu froid en vérité, mais si sain
que les habitants m'ont dit être ordinaire de vivre des quatre
vingt ou quatre-vingt dix et même jusqu'à cent ans. Les hommes
y sont bien proportionnés dans leur taille et tous ont la jambe
bien faite, des dents blanche, les yeux vifs, de l'esprit et
entendent à demi mot ce que l'on veut dire, du surplus un peu
pendards et gens à escoupetter leurs ennemis sans beaucoup de
façons. La cité est commandée et serrée de près par des très
hautes montagnes, ce qui fait que les habitants ne peuvent mettre
pieds à leur porte ni la tâte à la fenêtre sans être découvert
aussi tôt de quelqu'un de ces montagnes pourtant le lieu à des
qualités qui méritent bien des considération particulière.»
Vauban a non seulement transformé la cité en forteresse mais
afin de la couvrir, il construit un autre ouvrage de défense
dans une grotte, la Cova Bastera ainsi que le Fort Libéria
qui domine la cité. Afin d'assurer une liaison protégé entre
Villefranche et Fort Libéria les militaires Français construise
dans la montagne un souterrain de plus de mille marches. Autre
lieu fortifié par Vauban et toujours occupé par des militaire
est la forteresse de Mont-Louis. C'est également à Mont Louis
qu'a été crée le premier four solaire. Citons également les
autres places fortes réalisées par Vauban dans le Roussillon.
Bellegarde, la plus proche de la frontière espagnole qui domine
les cols du Perthus et de Panissard.

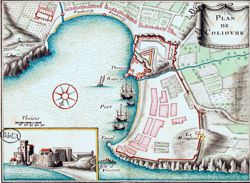
A Collioure Vauban à construit le fort du Miradou et a renforcé les défenses du château royal. Port-Vendres, Fort des Bains, cette citadelle a été construite très vite après la révolte des Angelets du Vallespir contre l'instauration de la gabelle dans cette région. Révolte très sévèrement maté en 1670 Citons également pèle mêle La forteresse de Salses, le Château des Rois de Majorque à Collioure, sans oublier la station thermale de Llo où vous pouvez plonger, même par un temps glaciale dans des eaux très chaudes. et tant d'autres lieux à visiter dans une des plus belles régions de France
Bourg Madame
Bourg-Madame, commune située à 56 kilomètres au sud de Prades, dans le canton de Saillagouse, a reçu ce nom en mémoire de Mme la duchesse d'Angoulême ; elle se compose de deux hameaux : Hix et Les Guinguettes. A Hix se trouve l'une des plus jolies petites églises romanes de ce cantons. Non loin de la, le torrent de la Raur, affluent de la Sègre, marque la frontière de la France et de l’Espagne