Rouen - Préfecture de la Seine Maritime
Retour au Département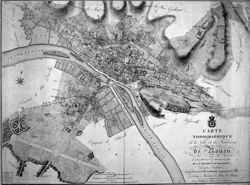

C'est une vanité patriotique, assez commune
aux anciennes villes de France, de chercher dans les Commentaires
de César les premières traces de leur origine Rouen ne peut prétendre
à cet honneur le conquérant des Gaules n'en fait aucune mention.
Cependant son existence est constatée sous la domination romaine,
et il semble prouvé qu'alors elle possédait déjà une enceinte fortifiée.
Des fouilles récentes ont fait découvrir quelques débris de monuments
romains, des médailles à l'effigie des Césars et des ustensiles
domestiques on a reconnu que, à l'époque impériale, le niveau moyen
de la ville était alors de 7 mètres plus bas que le niveau actuel.
Rouen fut, dès le IIIème siècle, conquise à la foi chrétienne
; elle eut ses saints et ses martyrs. Sous la domination romaine
et sous celle des Francs, l'histoire de Rouen n'est guère que celle
de ses évêques, dont l'autorité spirituelle et temporelle s'accrut
graduellement, en ces temps d'anarchie et de violences
Nous avons
raconté les malheurs et la mort de Prétextat. Un des successeurs
les plus célèbres de l'évêque Prétextat fut saint Romain, au nom
duquel se rattache une curieuse légende.
Un dragon gargouille
d'une grosseur extraordinaire désolait alors les environs de la
ville saint Romain prend avec lui deux prisonniers condamnés à mort
il marche droit au monstre, qu'il enchaîne par le cou avec son étole
et qu'il traine, docile et soumis, jusqu'au milieu de la ville ;
là, le monstre fut brulé solennellement ou, selon d'autres, jeté
à la Seine. La gloire de ce miracle parvint jusqu'au roi des Francs,
qui, pour en perpétuer le souvenir, accorda au chapitre de Rouen
le droit de délivrer chaque année un prisonnier, le jour de l'Assomption.
Saint Romain rebâtit la cathédrale de Rouen ; sa mémoire resta vénérée
dans toute la Neustrie, et la ville de Rouen prit saint Romain pour
patron, à l'exclusion de saint Godard, qui, depuis plus d'un siècle,
était en possession de cet honneur. Audoenus ou Dodon canonisé depuis
sous le nom de saint Ouen, hérita de l'œuvre et de la popularité
de saint Romain. Nommé évêque de la ville, après avoir rempli des
fonctions administratives, il acquit auprès du peuple et des rois
francs une grande influence par ses vertus, son activité et l'étendue
de ses connaissances. Il écrivit la vie de son ami saint Eloi. Ce
fut sous son gouvernement que s'élevèrent, dans le diocèse de Rouen,
les deux célèbres abbayes de Jumièges et de Fontenelle ou Saint-Wandrille.
Il légua en mourant son corps à la basilique de Saint-Pierre, fondée
par Clotaire 1er, et qui ne fut plus connue désormais
que sous le nom de Saint-Ouen. À partir du IXème siècle,
Rouen, comme la Neustrie, est livrée aux invasions des Normands.
Pillée et brulée par les pirates, qui disparaissaient après avoir
laissé d'horribles traces de leur passage, menacée en 876 par le
plus hardi des chefs normands, Rollon, elle lui envoie son archevêque,
qui le trouve à Jumièges, entouré de ses compagnons, et réussit
à le fléchir. Rouen, dès lors, devient la capitale du nouveau duché.
Selon quelques érudits, la ville lui devrait même son nom, Rou
Ham, et par altération Rouan, Rouen, ce qui signifierait l'habitation
de Rou ou de Rollon. Ce fut dans cette ville qu'après le traité
de Saint-Clair-sur-Epte, par lequel Rollon s'était engagé, lui et
les siens, à embrasser la foi chrétienne, il reçut le baptême dans
la cathédrale de Rouen.

Sous le gouvernement de Rollon et de ses
successeurs, Rouen devint bientôt une place de guerre d'une haute
importance et vit s'élever de nouveaux édifices religieux, qui durent
leur fondation ou leurs embellissements à la piété et aux remords
des Normands enrichis par le pillage et le meurtre. Mais cette importance
même l'exposa souvent aux dévastations et aux attaques soit des
princes étrangers, soit des vassaux rebelles.
Du reste, l'histoire
de la capitale de la Normandie se confond, à cette époque, avec
celle du duché nous ne répèterons pas ici ce que nous avons dit
de ces révoltes et de ces guerres dans l'histoire du département.
L'histoire des transformations intérieures de la cité rouennaise
est ici ce qui doit surtout nous occuper. C'est au génie commercial
de ses habitants que Rouen dut sa prompte prospérité et son affranchissement,
à l'époque de la révolution communale. Dès les temps les plus reculés,
les navigateurs rouennais, réunis en compagnie, avaient presque
tout le commerce de Seine en aval et en amont. Même, avant la conquête
de l'Angleterre, ils avaient obtenu dans ce pays d'importantes garanties
pour leur commerce, et Édouard le Confesseur leur avait accordé,
pour leur usage particulier, le port de Dunbeness, situé dans le
comté de Kent, à quelques lieues de Douvres. Les ducs de Normandie,
devenus rois d'Angleterre, augmentèrent encore les privilèges de
Rouen. Ses marchands, formant une association désignée sous le nom
de ghilde, obtinrent de Henri II le monopole exclusif du commerce
de l'Irlande, sous cette seule réserve « que la ville de Cherbourg
pourrait expédier pour cette ile un seul navire, une fois par an»
S'ils eurent ainsi en droit le monopole du commerce de l'Irlande,
ils possédèrent longtemps en fait celui des iles Britanniques. L'importance
que ces richesses donnèrent aux bourgeois de Rouen, le sentiment
de fierté qu'elles leur inspiraient, enfin la nécessité de les mettre
à l'abri des exactions féodales firent bientôt de la ghilde, ou
association commerciale, une association politique, une commune.
En 1144, Geoffroy Plantagenet, maitre de Rouen, dont les habitants
avaient pris parti pour lui contre son compétiteur, leur accorda
une charte qui consacrait des privilèges dont la ville jouissait
déjà en réalité ; ces avantages furent confirmés par ses successeurs.
Mais la commune de Rouen trouva un ennemi redoutable dans le clergé.
Longtemps les évêques avaient été des protecteurs dévoués pour le
peuple vaincu dont la plupart étaient sortis ; mais bientôt, devenu
riche et puissant et se recrutant en partie parmi la race conquérante,
le clergé devint hostile à l'affranchissement du peuple. « Partout,
dit AI. Chéruel, la commune de Rouen trouvait en lui un dangereux
adversaire ; là, il lui disputait la juridiction d'un quartier ;
ici, il ouvrait un asile aux marchands qu'il protégeait contre l'autorité
du maire ailleurs, il trainait les laïques devant le tribunal ecclésiastique,
pour des affaires purement temporelles. » Cet antagonisme resserra
l'union de la bourgeoisie rouennaise avec la royauté, qui rencontrait
souvent dans le haut clergé normand un dangereux adversaire, et,
dans sa lutte contre le pouvoir ecclésiastique, Henri trouva dans
la commune de Rouen une alliée fidèle et dévouée. Richard Cœur de
Lion avait confirmé les franchises de la ville ; mais, après le
départ de ce prince pour la croisade et pendant sa captivité, la
querelle s'envenima entre les deux puissances déjà rivales la commune,
qui déjà sentait sa force, et le clergé, qui avait conservé presque
tous les droits féodaux. Le chapitre possédait autour de la cathédrale
un emplacement, qui jouissait d'un double et important privilège
c'était un lieu d'asile pour le criminel et un lieu de franchise
pour le marchand. Les chanoines y firent bâtir des échoppes pour
les marchands, attirés en ce lieu par l'exemption de tout droit
les corporations d'arts et métiers, qui trouvaient, dans cette réunion
de marchands exemptés des obligations communes, une redoutable concurrence,
s'émurent et s'agitèrent.

Le chapitre demanda vengeance de ce qu'il regardait comme un attentat en l'absence de l'archevêque de Rouen, quatre évêques de Normandie se réunirent à Rouen, et, la commune n'ayant pas voulu céder à leurs menaces, ils jetèrent l'interdit sur la ville. Pendant six mois, l'office divin fut suspendu les malades mouraient sans obtenir les secours de la religion, et leurs corps ne reposaient point en terre sainte. Les bourgeois persistèrent néanmoins ; mais, à l'approche de Pâques et de ses cérémonies religieuses, les imaginations s'alarmèrent au moment où la catholicité tout entière allait s'assoir au banquet de la foi, seraient-ils seuls privés de la communion universelle ? Ils s'avisèrent alors d'un expédient pendant la semaine sainte, ils introduisirent dans la ville des prêtres étrangers, ouvrirent les portes des églises et firent célébrer l'office divin. Le chapitre indigné lança contre la commune de nouveaux anathèmes, auxquels la population exaspérée répondit par de nouvelles violences cette fois, les maisons des chanoines furent envahies, quelques-uns d'entre eux égorgés ; ceux qui échappèrent en appelèrent au pape Célestin III celui-ci confirma la sentence d'excommunication ; la terreur religieuse pesa de nouveau sur la ville. Rien ne put vaincre l'obstination de la commune. En vain Innocent III renouvela contre elle les anathèmes lancés par son prédécesseur, la lutte continua avec des péripéties diverses; on finit par obtenir des bourgeois quelques réparations ; mais ils se refusèrent formellement à relever l'enceinte détruite dans la première émeute, et les chanoines furent obligés de la rebâtir à leurs frais. Longtemps après le commencement de la querelle, lorsque la Normandie était passée sous l'autorité des rois de France ce fut saint Louis qui leur en accorda l'autorisation, mais sous cette condition formelle que le mur n'aurait pas plus de quatre pieds de hauteur. Quant aux échoppes, cause première de toutes ces querelles, la commune ne permit d'en rebâtir qu'un petit nombre.

Nous avons insisté sur cette querelle, dont la cause première peut
sembler peu importante, parce qu'elle marque quelle rapide transformation
s'était opérée parmi ces bourgeois, d'abord serfs du chapitre, maintenant
indépendants et maitres dans leur ville ; un mur et quelques échoppes,
voilà l'occasion de la lutte; mais le résultat est grand ; ce n'est
rien moins que la substitution du pouvoir civil à la féodalité ecclésiastique,
accomplie avec une persévérance surprenante, si l'on tient compte
de l'empire que les terreurs religieuses exerçaient au XIIIème
siècle sur ces pieuses imaginations à ce titre, cette révolution
locale méritait qu'on s'y arrêtât.
Si maintenant l'on considère
l'organisation de cette commune, on est étonné d'y trouver une véritable
république, sous la suzeraineté du roi un maire, choisi par le roi
parmi trois prudhommes, présentés par les cent pairs de la ville,
était investi, pour un an, du pouvoir le plus étendu; ces cent pairs
formèrent une espèce de patriciat, qui, plus tard, tenta de fermer
ses rangs aux classes inférieures. Le roi de France même, en 1320,
fut obligé d'intervenir, sur la réclamation du peuple, pour modifier
cette constitution dans un sens plus démocratique. « Le droit
électoral et politique, dit M. Chéruel, était restreint à un petit
nombre de bourgeois. La masse du peuple ne nommait ni le maire ni
les conseillers du maire. » Quelques nominations de magistrats
d'un ordre inférieur lui étaient seules réservées. Une disposition
libérale, obtenue sous Guillaume le Conquérant et confirmée par
ses successeurs, doit être mentionnée ici si un serf restait un
an et un jour dans la ville sans être réclamé par son seigneur,
il devenait libre. Cette disposition, qui s'étendait à toutes les
villes et châteaux de la domination normande, augmenta rapidement
la population et la puissance des villes, où les serfs de la campagne
cherchaient et trouvaient un refuge. Enfin, une milice communale,
commandée par le maire, était chargée de défendre des droits si
péniblement conquis. Jean sans Terre, successeur de son frère, Richard
Cœur de Lion, confirma les privilèges de la commune.
Néanmoins,
son règne ne fut marqué que par des désastres. En 1200, pendant
la nuit de Pâques, la cathédrale fut dévorée par un incendie, six
mois après, le feu détruisit encore une partie de la ville. Les
exactions de ce prince, sa protection accordée aux juifs, enfin
la captivité et le meurtre présumé de son neveu, Arthur de Bretagne,
le rendirent l'objet de l'exécration générale. Cependant, telle
était la vigueur du patriotisme local, que les bourgeois résistèrent
avec courage aux armes de Philippe-Auguste. Jean sans Terre ayant
lâchement refusé de secourir la ville, elle fut obligée de se soumettre.
Le roi de France promit de respecter les frontières de la commune.
Mais il ne tarda pas à la menacer, faisant élever, sur une des hauteurs
qui dominent la ville, un château dont le donjon subsiste encore,
levant des impôts considérables. De nouveaux incendies dévorèrent
plusieurs quartiers de la ville, où les maisons, construites en
bois et entassées les unes sur les autres, propagèrent rapidement
la flamme.
Ces catastrophes et les ravages des pastoureaux contribuèrent
sans doute à augmenter la ferveur religieuse, dont nous trouvons
des signes nombreux à cette époque des miracles, des extases, l'introduction
des moines mendiants, dont la règle sévère plaisait mieux aux âmes
pieuses que les mœurs relâchées du clergé séculier enfin, des persécutions
exercées contre les hérétiques, dont plusieurs furent brulés vifs.
Ce fut à cette époque que le roi Louis IX vint visiter la ville;
il confirma par une charte les privilèges communaux, et ce prince
éclairé, qui sut toujours, malgré son ardente piété, réprimer les
passions envahissantes du clergé, décida, en 1259, que l'archevêque
de Rouen ne pourrait frapper d'excommunication les habitants pour
cause temporelle. Le règne de Philippe le Bel vit plusieurs émeutes,
causées par des impôts excessifs, facilement réprimées. Sous son
successeur, Philippe V, la constitution de la commune fut modifiée.
La haute bourgeoisie, qui d'abord s'était fait suivre par le peuple
dans sa lutte contre le clergé, avait fini par affecter des allures
aristocratiques, qui causèrent plusieurs dissensions.
Le corps
des pairs, anciennement au nombre de cent, fut réduit à trente-six,
qui durent se renouveler par tiers tous les trois ans et on institua,
en face de cette assemblée, un conseil de douze bourgeois nommés
les prudhommes du commun. Quatre receveurs, pris par moitié parmi
les pairs et parmi les prudhommes, eurent l'administration des
revenus de la ville. Sous Philippe VI eut lieu la première réunion
des états de Normandie et les bourgeois y par eurent comme composant
un troisième ordre. Les états accordèrent des subsides au roi pour
soutenir la guerre contre les Anglais, et Philippe confirma la charte
aux Normands.
Mais ces jours d'indépendance allaient bientôt
finir. En 1382, le rétablissement des gabelles, sous Charles VI,
provoqua une insurrection, les traitants sont massacrés, les prêtres
poursuivis et menacés par une multitude furieuse. Mais Charles VI
arriva bientôt avec une armée et des exécutions signalèrent son
entrée dans la ville. On rase le beffroi, qui contenait la Rouvel,
la cloche de la ville, qui avait si souvent appelé les bourgeois
à l'insurrection, la commune est supprimée ; vieilles franchises,
privilèges antiques des corporations, tout disparait dans ce jour
néfaste. Une rançon énorme est exigée de la ville et de chacun des
principaux bourgeois, qui ont été jetés dans les cachots. Pendant
un an, la plus implacable tyrannie s'appesantit sur la malheureuse
ville. Peu à peu, l'autorité royale se relâcha de ses rigueurs ;
un conseil électif fut reconstitué ; mais les fonctions du maire
furent remplies par un bailli royal. Pour cette royauté, qui l'avait
si cruellement frappée Rouen allait pourtant soutenir contre Henri
V, roi d'Angleterre, un siège héroïque, qui devait épuiser ses dernières
forces.
Après une défense désespérée, honorée par des sorties
furieuses et des actes individuels d'un courage dont l'histoire
gardé le souvenir, après avoir vainement imploré le secours de la
cour de France, Rouen est obligée de capituler. Le roi d'Angleterre
impose une rançon de trois cent mille écus et excepte de la capitulation
un certain nombre de ses défenseurs tous réussirent à sauver leur
vie en sacrifiant la moitié de leurs biens, un seul, le capitaine
des arbalétriers de la ville, Alain Blanchard, est voué à la mort
par l'indigne vainqueur. « Je n'ai pas de biens pour racheter
ma vie comme les autres, dit le martyr en montant à l'échafaud ;
mais, quand j'aurais de quoi payer ma rançon, je ne voudrais pas
racheter le roi anglais de son déshonneur » Quelques années
plus tard, la domination anglaise, qui ne fut à Rouen qu'une longue
suite d'exactions et de violences, devait se signaler par un crime
plus abominable encore. Depuis 1449, époque où Rouen redevint ville
française, son existence fut plus calme jusqu'au temps des guerres
de religion. Elle eut un archevêque célèbre, Georges d'Amboise,
dont le nom appartient à l'histoire générale de la France. Sur sa
proposition, Louis XII érigea en cour perpétuelle l'échiquier de
Normandie cette institution, en donnant une plus grande importance
aux légistes sortis du tiers état, fit naitre à Rouen, comme dans
les autres villes de magistrature, une noblesse parlementaire, qui
s'honora souvent par ses lumières et son indépendance.

Malheureusement,
dès le règne de François 1er, le parlement de Rouen déploya
une cruauté extrême contre les hérétiques, nombreux dans la ville.
Ces atrocités exaspérèrent les huguenots, qui se révoltèrent en
1562 et restèrent maitres de Rouen. Reprise par les catholiques
sous la conduite du duc de Guise, la ville fut pillée pendant huit
jours. Les supplices recommencèrent, et, au mois de septembre 1572,
Rouen eut son massacre de la Saint-Barthélemy cinq ou six cents
personnes périrent égorgées ; un tiers environ des habitants de
Rouen s'était enfui.
Ainsi délivré de ses ennemis, le parti catholique
domina dès lors à Rouen. La ville prit parti pour la Ligue, lutta
contre Henri III, dont l'assassinat fut accueilli à Rouen par des
transports de joie ; elle soutint bravement un pénible siège contre
Henri IV ; le roi fut obligé de se retirer. Mais, deux ans après,
l'amiral de Villars, qui commandait la place, la vendit à Henri
IV pour le titre de maréchal et une indemnité de 120 000 écus. Le
roi y fit son entrée et y tint l'assemblée des notables en 1596.
L'histoire de Rouen, depuis cette époque, est moins tragique ; elle
eut bien, en 1639, une émeute causée par la misère et l'excès des
impôts, émeute impitoyablement châtiée par le chancelier Séguier
; mais elle jouit d'un repos inaccoutumé jusqu'à la révocation de
l'édit de Nantes.
Là, comme ailleurs, l'industrie et le commerce
étaient en partie aux mains des protestants ; cet évènement porta
un coup terrible à la prospérité de Rouen. La population de Rouen,
qui s'élevait à 80 000 âmes en 1685, diminua de 20 000 en cinq ans.
Cependant, au commencement du XVIIIème siècle, le commerce
de Rouen se releva, grâce à l'heureuse industrie d'un négociant
de la ville, Delarue, qui, le premier, imagina de faire filer le
coton. Dès lors, les toiles de coton teintes désignées sous le nom
de Rouenneries devinrent à Rouen une branche d'industrie très active.
Ses faïences et ses porcelaines étaient déjà à cette époque fort
estimées.
En 1707, Boisguilbert, lieutenant général au bailliage
de Rouen, publia un livre rempli de vues sages et neuves, le
»Détail de la France sous Louis XIV ». Frappé des maux du peuple
et de la manière scandaleuse dont les impôts se percevaient, il
proposait des réformes, moins absolues que celles de Vauban, mais
qui n'en irritaient pas moins contre lui ceux qui profitaient des
abus et voulaient les perpétuer. « La vengeance ne tarda pas,
dit Saint-Simon ; Boisguilbert fut exilé au fond de l'Auvergne.
Au bout de deux mois, j'obtins son retour ; mais ce ne fut pas tout.
Boisguilbert, mandé en revenant, essuya une dure mercuriale et,
pour le mortifier de tout point, fut renvoyé à Rouen, suspendu de
ses fonctions, ce qui toutefois ne dura guère. Il en fut amplement
dédommagé par la foule de peuple et les acclamations avec lesquelles
il fut reçu. » Ce bon citoyen mourut en 1714. L'histoire de
Rouen, au XVIIIème siècle, ne se compose guère que des
luttes du parlement contre l'autorité ecclésiastique ou contre la
cour. Supprimé par Louis XV, auquel il avait résisté plusieurs fois,
il fut remplacé par deux conseils siégeant à Rouen et à Bayeux (1771).
Il fut rétabli au commencement du règne de Louis XVI.
Néanmoins,
une nouvelle opposition se manifesta en 1788 de nouvelles persécutions
s'ensuivirent ; mais la Révolution approchait, et l'esprit nouveau
était déjà plus puissant que les persécuteurs. Tout se borna à d'inutiles
et vaines démonstrations ; le parlement, exilé d'abord, fut bientôt
rétabli. Au commencement de la Révolution il y eut à Rouen quelques
mouvements populaires, causés par la cherté du pain. Néanmoins,
pendant la Terreur, il y eut peu d'excès ; on ne compte que deux
exécutions politiques pendant les années 1793 et 1794. Sous le Directoire
et le Consulat, les brigands connus sous le nom de chauffeurs jetèrent
l'épouvante dans les départements ; un grand nombre furent pris
et exécutés à Rouen.
Depuis le règne de Napoléon 1er,
Rouen avait joui d'un calme et d'une prospérité sans exemple. A
peine si les évènements de 1830, de 1848 et de 1852 l'avaient un
moment troublé ; mais il n'en fut pas de même en 1870. À la suite
du combat de Buchy, où un corps de marins, de volontaires et de
mobiles français eut à lutter, mais sans succès, contre une armée
prussienne, celle-ci marcha sur Rouen, qu'elle occupa sans coup
férir le 6 décembre 1870, et qu'elle abandonna ensuite après l'avoir
pillée et dirigé son butin sur Amiens. Aujourd'hui, grâce aux bienfaits
de la paix, Rouen est redevenu ce qu'elle doit toujours être, une
des villes les plus industrielles et les plus productives de la
France.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025
