Amiens - Préfecture de la Somme
Retour au Département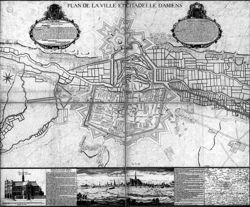
L'origine d'Amiens ce perd dans les ténèbres
de l'antiquité. César et Ptolémée nomment la capitale des Ambiani
Somarobriva, dont il est aussi fait mention dans les Lettres
de Cicéron. L'Itinéraire d'Antonin et la Table de Peutinger déterminent
avec la plus grande précision la position de cette ville ancienne
à Amiens, par six routes qui se réunissent dans cette ville, et
qui partent de Arras Nemetacum , St-Quentin Augusta Veromanduorum,
Soissons, Augusta Suessionum, Beauvais Cæsaromagus
, Boulogne-sur-Mer Gessoriacum, Cassel Castellum Menapiorum.
.
Dans ses dernier temps de la puissance romaine, Somarobriva
prit le nom du peuple Ambiani, dont on a fait Amiens.
Jules César,
qui y tint l'assemblé des Gaules et y plaça ensuite trois légions,
Antonin et Marc Aurèle l'embellirent et dès lors elle fut considérée
comme une des cités les plus opulentes de la seconde Belgique. Valentinien
y fit reconnaître Auguste son fils Gratien en 367.
Les Gépides,
les Alains, les Vandales et les Francs s'en emparèrent successivement.
Vers le milieu du Vèmesiècle, Clodion en chassa les Romains
et y établit le siège de son empire. Mérovée y fut proclamé roi
et porté à son trône sur un pavois ou bouclier. Pendant le règne
de ce monarque, le féroce Attila porta la dévastation dans Amiens.
Clovis donna cette ville en partage à Clotaire, et depuis lors elle
fit partie du domaine de la couronne jusqu'à la décadence de la
maison de Charlemagne. Elle fut ensuite gouvernée par des comtes,
des vidâmes et des châtelains qui la firent ceindre de fortifications
considérable mais malheureusement impuissantes pour la protéger
contre les Normands: trois fois ces barbares la brûlèrent et la
dévastèrent. A cette époque de désastres disparurent sans doute
ses monument antiques.

Les rois de France avaient donné la seigneurie
d'Amiens aux évêques, qui la transmirent aux seigneurs de Boves
ceux-ci en furent dépossédé par la maison de Vermandois, Isabelle
de Vermandois apporta la ville en dot à Philippe d'Alsace, qui,
en1185, la céda à Philippe Auguste. En 1435, Charles VII engagea
Amiens et les autres places de la Somme à Philippe, duc de Bourgogne,
moyennant la somme de 400 000 écus d'or, mais avec la réserve du
droit de retrait. En 1463, Louis XI paya cette somme au duc de Bourgogne
et rentra en possession d'Amien est des autres villes de la Somme.
Deux ans plus tard, Louis XI les céda de nouveau, par le traité de
St-Maur, au comte de Charolais, avec la réserve de pouvoir les racheter
à la mort dudit comte. En effet, à la mort de Charles le Téméraire
Louis XI les recouvra et les réunit de nouveau et pour toujours
au domaine royal.
Sous François Ier et Henri II, les
Impériaux cherchèrent, mais en vain, à se rendre maîtres d'Amiens.
Ses habitants, entraînés par l'exemple des villes voisines embrassèrent
avec chaleur la Ligue ou sainte union, et une chambre des états
y fut instituée mais ce second essaie de parlement Picard n'eut
pas plus de durée que la cour souveraine instituée en 1385 par Isabeau
de Bavière. Peu de temps après, les habitants se soumirent à Henri
IV, qui fit son entrée dans cette ville le 25 août 1594; ils furent
les premiers qui, sans aucun traité ni conditions au péril de leur
vie et de leurs biens, reçurent le roi dans leur ville; ce qui fit
un si grand plaisir à ce monarque qu'il leur accorda, entre autres
avantages celui d'être exempts du droit de gabelle. Henri IV ayant
déclaré la guerre à Philippe II, roi d'Espagne Amiens tomba Au pouvoir
des Espagnoles, en 1597, par un stratagème assez singulier, à l'aide
d'un sac de noix répandues sous la porte de la ville, et que la
garde s'amusa à ramasser. Henri IV ne recouvra Amiens qu'après un
siège où il se couvrit de gloire, mais qui fut long et coûteux il
y fit bâtir une citadelle sur la rive droite de la Somme, et manqua
ainsi à la promesse qu il avait faite aux habitants, en 1594, de
ne jamais faire construire aucun fort dans leur ville.
Amiens
possédait une charte de commune dès 1113. L'histoire de l’établissement
de cette commune remonte à l'année qui suivit la catastrophe de
la révolution de Laon. Il paraît que l'exemple de cette dernière
ville avait inspiré aux habitants leur premier désir de liberté.

L’évêque exerçait les droits de la seigneurie sur une partie de
la ville, le comte sur une autre le Vidame sur une troisième, et
enfin le propriétaire d'une grosse tour qu'on nommait le Châtillon
prétendait aux mêmes droits sur le quartier voisin de sa forteresse
De ces quatre puissances la plus généralement reconnue mais la plus
faible de fait était celle de l'évêque, qui, n'ayant point de soldats,
tremblait devant le comte et recevait de ses autres coseigneurs
des injures qu'il ne pouvait leur rendre. Par intérêt, sinon par
esprit de justice, l'évêque d'Amiens devait donc être favorable
à la formation d'une commune qui, au prix de quelques concessions,
lui assurerait un appui contre ses trois rivaux, dont elle ébranlerait
ou détruirait le pouvoir. Le hasard voulut que la dignité épiscopale
fût alors occupée par un homme d'une vertu exemplaire, d'un esprit
aussi éclairé que le permettait son siècle, et plein de zèle pour
le bien général. Sans se laisser épouvanter par les terribles scènes
qui venaient d'avoir lieu à Laon. L'évêque Geoffroy comprit ce qu'avait
de légitime le désir d'indépendance et de garanties pour les personnes
et pour les biens. Il céda sans efforts et gratuitement aux requêtes
des bourgeois et, concourut avec eux à l'érection d'un gouvernement
municipal. Ce gouvernement, composé de vingt quatre échevins, sous
la présidence d'un majeur, fut installe sans aucun trouble au milieu
de la joie populaire et la nouvelle commune promulgua des lois dans
la forme suivante :
« Chacun gardera en toute occasion fidélité
envers son juré, et lui devra aide et conseil.
» « Si quelqu'un
viole sciemment les constitutions de la commune et qu'il en soit
convaincu, la commune si elle le peut, démolira sa maison et ne
lui permettra point d’habiter dans ses limites jusqu'à ce qu'il
ait donné satisfaction. »
Quiconque aura sciemment reçu dans
sa maison un ennemi de la commune et aura communiqué avec lui, soit
en vendant et achetant, soit en buvant et mangeant, ou lui aura
donné aide et conseil contre la commune, sera coupable de lèse-commune
et, à moins qu'il ne donne promptement satisfaction en justice,
la commune, si elle le peut, démolira sa maison. »
« Quiconque
aura tenu devant témoin des propos injurieux pour la commune, si
la commune en est informée, et que l'inculpé refuse de répondre
en justice, la commune, si elle le peut, démolira sa maison, et
ne lui permettra pas d'habiter dans ses limites jusqu'à ce qu'il
ait donné satisfaction. »
« Si quelqu'un attaque de paroles injurieuses
le majeur dans l'exercice de sa juridiction, sa maison sera démoli
ou, il payera rançon pour sa maison en la miséricorde des juges.
»
« Nul ne causera ni vexations ni troubles soit à ceux qui demeurent
dans les limites de la commune soit aux marchands qui viendront
à la ville avec leurs denrées. Si quelqu'un ose le faire, il sera
réputé violateur de la commune, et justice sera faite sur sa personne
et sur ses biens. »
« Si un membre de la commune enlève quelque
chose à l'un de ses jurés, il sera sommé par le maire et les échevins
de comparaître en présence de la commune, et fera réparation suivant
l’arrêt des échevins. Si le vol a été commis par quelqu'un qui ne
soit pas de la commune, et que cet homme ait refusé de comparaître
en justice dans les limites de la banlieue, la commune, après l'avoir
notifié aux gens du château où le coupable a son domicile le saisira
si elle le peut, lui ou quelque chose qui lui appartienne, et le
retiendra jusqu'à ce qu'il ait fait réparation. »
Quiconque aura
blessé avec armes un de ses jurés, à moins qu'il ne se justifie
par témoins et par serment, perdra le poing ou payera neuf livres
: six pour les fortifications de la ville et de la commune, et trois
pour la rançon de son poing mais s'il est incapable de payer, il
abandonnera son poing à la miséricorde de la commune. Si un homme
qui n'est pas de la commune frappe ou blesse quelqu'un de la commune,
et refuse de comparaître en jugement, la commune si elle le peut
démolira sa maison et, si elle parvient à le saisir, justice sera
faite de lui par devant le majeur et les échevins. »
« Quiconque
aura donné à l'un de ses jurés les noms de serf, mécréant, traître
ou fripon, payera vingt sols d'amende. » « Si quelque membre de
la commune a sciemment acheté ou vendu quelque objet provenant de
pillage, il le perdra, et sera tenu de le restituer aux dépouillés,
à moins qu'eux-mêmes ou leurs seigneurs n'aient forfait-en quelque
chose contre la commune. »
« Dans les limites de la commune,
on n'admettra aucun champion gagé au combat contre l'un de ses membres.
»
« En toute espèce de cause, l'accusateur, l'accusé et les témoins
s'expliqueront, s'ils le veulent, par avocat.»
« Tous ces articles,
ainsi que les ordonnances du majeur et de la commune, n'ont force
de loi que de juré à juré; il n'ya pas égalité, en justice entre
le juré et le non-juré.»
La constitution, établie de
commun accord par l'évêque et les bourgeois d'Amiens, fut soumise
à l'agrément des trois autres seigneurs, comme parties intéressées
Le vidame le moins puissant des trois, y donna son approbation,
moyennant garanties pour quelques-uns de ses droits et une bonne
rançon pour le reste. Mais Le comte ne voulut entendre à rien; il
dit qu'il maintiendrait qu'au dernier tous les privilèges de son
titre, et entraîna dans son parti le châtelain de la grosse tour.
Dès lors il y eut guerre déclarée entre ce parti et celui de la
commune. Le comte d'Amiens était Enguerrand de Coucy, père de Thomas
de Marle.

Afin de s'assurer un appui contre ce puissant adversaire
la commune eut recours au roi, et, par l'entremise de son évêque,
obtint à prix d'argent l'approbation, ou suivant le style officiel,
l'octroi de ses règlements municipaux. Quoique le nom du roi, inscrit
en tête de la Charte d'Amiens, lui conféra la légitimité selon le
droit, public du royaume, Enguerrand n'en tint nul compte, et, faisant
marcher sur la ville tout ce qu'il avait de chevaliers et d'archers,
il entreprit d'en rester maître. Menacés par des forces qui avaient
sur eux la supériorité de la discipline les bourgeois n’eurent d'autre
ressource que de se recommander au fameux Thomas de Marle qui alors
était en guerre avec son père. A l'aide de ce secours, ils parvinrent
à chasser le comte de la ville et à le contraindre de s’enfermer
dans la grosse tour, dont le châtelain nommé Adam, lui ouvrit les
portes. Cette tour, qui était d'une telle force qu'on la jugeait
imprenable, fut attaquée avec vigueur par les bourgeois et par le
roi de France Charles VI, venu à leur secours. Malgré la discipline
des troupes royales et le dévouement de la bourgeoisie la tour du
Châtillon garda sa réputation d'imprenable; le roi enleva le siège,
que les habitants d'Amiens convertirent en blocus. Ce fut seulement
au bout de deux ans que les assiégés rendirent la tour, qui fut
aussitôt démoli et rasée.
La commune d'Amiens eut d'assez longs
jours ; elle ne perdit que lentement une à une ses anciennes prérogatives
supprimée par ordonnance de Philippe IV, elle fut rétablie par le
même roi en l'année 1307, et, selon toute probabilité ce fut sa
grande richesse qui la sauva.
On ne peut dire à quelle somme
d'argent monta le prix de son rétablissement mais on sait que peu
d'années après il lui en coûta une fois payées, et une rente de
700 livres pour le rachat définitif de tous ses droits. Dès lors,
elle parcourut en paix le cercle entier de la destinée des vieilles
constitutions municipales.
L'élection du majeur et des vingt
quatre échevins subsista jusqu'en l'anuée1397, où un édit du roi
Henri IV réduisit à la fois le nombre et les privilèges de ces magistrats
populaires. Les anciens droits des comtes, dont la commune avait
hérité, lui furent enlevés avec la plus grande partie de ses revenues
et, la juridiction de l'échevinage fut bornée au petit criminel,
aux disputes entre bourgeois aux procès concernant et police rues,
les métiers, les services du guet le logement des gens de guerre.
Toutefois., dans les cérémonies publiques les insignes de la haute
justice, du droit de vie et de mort, continuèrent d'accompagner
comme dans l'ancien temps, le maire et les échevins d'Amiens. Ces
attributs d'une puissance qui n'était plus consistaient en deux
glaives de forme antique, porté à la main par deux officiers de
la ville qu’on désignait à, cause de leur emploi par terme provincial
d'espadrons.;
C'est à Amiens que saint Louis, nommé arbitre
par Henri III, roi d'Angleterre, et par les barons de son royaume
avec lesquels il était en querelle relative aux statuts d'Oxford
prononça son jugement sur la validité de ces statuts. Saint Louis
arriva à Amiens au commencement de l'année 1264, suivi de toute sa
cour; il entendit le roi d'Angleterre et les barons mécontents exposer
leurs droits et leurs griefs ; il apporta à l'examen des uns et autres
cette attention et cette bonne foi dont il ne se départait point,
même lorsqu'il s’agissait de ses intérêts les plus directs « Après
avoir pleinement entendu, dit-il dans son prononcé, les propositions
les défenses et les raisons des parties; nous étant assuré que par
les provisions les statuts et les obligations d'Oxford, et par toutes
celles qui en ont été la suite, le droit et l'honneur royal ont
souffert une grande diminution; qu'il en est résulté le trouble
du royaume, la dépression de l'Eglise, le pillage des personnes
tant ecclésiastiques que séculières tant indigènes qu'étrangères
et que de plus grands dommages pourraient s'ensuivre encore. Ayant
pris conseil des hommes de bien et des grands, au nom du Père, du
Fils, et du Saint-Esprit, nous cassons et nous invalidons par notre
prononcé les sus dites provisions, ordinations et obligations, de
quelque manière qu'elles soient entendues, aussi bien que tout ce
qui s'est fait en conséquence d’autant plus que nous voyons que
le souverain pontife les a déjà cassées et annulée psar les lettres.
Nous ordonnons que tout le roi et les barons et les autres qui ont
consenti au présent compromis, et sont obligés à l'observer, s'en
regardent comme entièrement quittes et absous». Par les articles
suivants, Louis IX rend au roi d'Angleterre la garde de toutes les
places fortes et la nomination à tous les offices de la couronne
il rappelle les étrangers, et les admet sur le même pied que les
indigènes à l'administration du royaume il rend au roi la pleine
puissance et le libre gouvernement de ces Etats, ajoutant seulement
qu'il n'entend point par cette ordonnance déroger aux privilèges
royaux, aux chartes, aux libertés, aux statuts et aux louables coutumes
d'Angleterre telles qu'elles existaient avant ant les provisions
d'Oxford et, il termine en invitant le roi et les barons à se remettre
toute offense réciproque et à oublier toute rancune.
Cette sentence
fut rendue à Amiens les 23janvier 1264; elle a été célébrée par
les historiens français comme un modèle d'impartialité.
C'est
dans l'église St-Nicolas, dont il ne reste aucuns vestiges qu'en
1195 Philippe Auguste épousa Ingelberge, qu'il fit couronner le
lendemain par Philippe de Champagne archevêque de Reims. Ce fut
à Amiens qu'au temps des expéditions pour la terre sainte les rois
de France, d'Angleterre d,'Aragon de Navarre et de Bohème, se réunirent
pour concerter une nouvelle croisade.
En 1363, le roi Jean convoqua
à Amiens les états généraux de la langue d'oil pour régler l'imposition
de l'aide destinée au payement du reste de sa rançon, et pour prendre
les mesures les plus propres à réformer les abus introduits dans
l'administration des finances, la perception des impôts, etc.,etc.
Les élus et députés des provinces et des villes eurent commission
d'adjuger, chacun dans leur district, la levée de cette aide aux
fermiers qui se présentaient. Le roi rétablit en outre la monnaie
sur l'ancien pied, diminua le prix du marc d'argent, et défendit
de prendre occasion de cette diminution pour survendre et renchérir
les marchandises augmenter le salaire des artisans, etc. Après avoir
ainsi réglé les finances, il crut qu'il n'était pas moins nécessaire
de faire la révocation des domaines de la couronne, aliénés depuis
plusieurs années par la libéralité des rois ses prédécesseurs e
t par lui-même.
Le traité de paix entre la République française,
l'Angleterre l'Espagne et la Hollande fut signé à Amiens en 1802.
Le système de la neutralité armée ayant été reconnu par la Russie,
la Prusse, le Danemark et la Suède, et, par suite, le commerce anglais
s’étant vu fermer le continent le ministre Pitt fut renversé par
l'opposition du parlement anglais et remplacé par Addington. Le
nouveau ministère entama dès lors des négociations avec la France.
Les préliminaires d'un traité de paix furent signés à Londres le
Ier octobre1801. Le 27mars 1802 (6 germinal an X), les
plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne de l'Espagne
et de la république Batave, Joseph Bonaparte, lord Cornwallis, le
chevalier d'Azara et Schimmelpenninck signèrent à Amiens un traité
définitif dont voici les principales dispositions: l'Angleterre
rend ses conquêtes à, l'exception de Ceylan et de la Trinité ; les
ports de la colonie du Cap restent ouverts à ses vaisseaux, la France
et l 'Espagne recouvrent leurs colonies; la république des Sept-Iles
est reconnue l'île de Malte doit être rendue aux chevaliers de l'ordre;
la France évacuera Rome, Naples et l'ile d'Elbe. L'intégrité des
Etats de la Porte ottomane, telle qu'elle existait avant la guerre
est reconnue. Cette dernière clause décida le sultan Sélim à accéder
au traité d'Amiens, le 13 mai. Cependant de nouvelles difficultés
s'élevèrent bientôt entre la France et l'Angleterre: le gouvernement
anglais, craignant une nouvelle expédition en Egypte ne voulut pas
évacuer l'île de Malte. Plusieurs autres motifs de querelle amenèrent
la guerre qui, après plusieurs violations du traité, fut enfin déclarée
à la France par l'Angleterre le 18 mai 1803.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025