Histoire de la Somme

La Somme est notre ancienne Picardie,
province dont le nom a été, pour les étymologistes, le texte
de si longues et si stériles dissertations. Les Romains trouvèrent
ce territoire occupé par de nombreuses tribus dont ils nous
ont transmis les noms c'étaient, au nord, les Morini ; à l'ouest,
les Ambiani, qui avaient pour capitale Somarobriva, et les Britanni
; les Veromandui, à l'est, et, au sud, les Bellovaci et les
Sylvanectenses. Les Ambiani, les Morini et les Bellovaques prirent
une large part à la guerre de l'Indépendance sous Vercingétorix
mais, vaincus comme les autres peuples de la Gaule, ils se soumirent
et firent partie de la seconde Belgique. La résistance des habitants
à la domination étrangère leur mérita l'estime des vainqueurs.
D'importants privilèges, de larges franchises municipales, de
nombreux embellissements dans les villes assurèrent la paix
dans le pays jusqu'à l'arrivée des Francs.
Clodion est le
premier chef qui y pénétra, au commencement du IVème
siècle ; c'est à peu près vers la même époque qu'apparaissent
aussi les premiers propagateurs de la foi chrétienne, saint
Firmin, saint Crépin et saint Crépinien, saint Valère, saint
Ruffin, saint Quentin, saint Vaast, saint Valery, saint Ricquier,
saint Lucien et les apôtres de l'Église irlandaise. Leur lutte
contre le druidisme et le paganisme romain fut laborieuse et
rude les traits principaux du caractère picard se retrouvent
aussi prononcés, à cette époque, qu'ils se sont maintenus depuis.
La ténacité, l'obstination, la fidélité aux vieilles croyances
furent de sérieux obstacles à l'établissement de la foi nouvelle.
Mais hâtons-nous d'ajouter que la vérité, une fois connue et
acceptée, ne trouva nulle part de plus zélés sectateurs ni de
défenseurs plus intrépides.
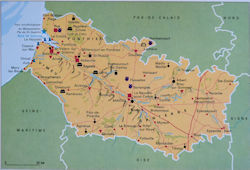

Sous les princes de la première race,
la Picardie demeura inféodée au domaine royal elle faisait partie
de ce qu'on appelait alors La France. Ce fait s'explique
quand on se rappelle que, jusqu'à Charlemagne, Soissons fut,
à vrai dire, la capitale de la monarchie franque et la résidence
la plus habituelle des rois. Sous les successeurs du grand empereur,
l'immensité des possessions conquises nécessita la création
de comtes ou lieutenants, chargés de gouverner les provinces
au nom du souverain, qui en vivait éloigné. C'est en 823 que
nous voyons Louis le Débonnaire abandonner pour la première
fois l'administration de la Picardie à un comte. On sait quels
furent les rapides envahissements de ces nouveaux pouvoirs,
et en combien de lieux et de circonstances ils parvinrent à
se rendre indépendants.
Grâce à l'inamovibilité des fiefs
féodaux, les alliances de famille concentrèrent bientôt entre
les mains de quelques seigneurs une puissance rivale de celle
des rois. Le développement de ces usurpations remplit toute
la seconde race et aboutit au triomphe définitif, au couronnement
de la haute féodalité dans la personne des Capet, comtes de
Paris. La Picardie suivit la loi générale.
Un Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui avait épousé une comtesse de Vermandois, voulut, après la mort de sa femme, retenir le comté d'Amiens, qui devait retourner à Aliénor, comtesse de Saint- Quentin, sœur cadette de la défunte. L'injustice de cette prétention était si flagrante, et l'ambition du comte Philippe prenait des proportions si menaçantes, que le roi de France crut devoir enfin intervenir ; il ne s'agissait ni de remontrances ni d'arbitrage, c'est une guerre sérieuse qu'il fallut entreprendre pour réduire l'ambitieux vassal et encore une dernière satisfaction lui fut-elle donnée par le traité de paix qui intervint il fut convenu que le beau-frère et la belle-sœur jouiraient successivement de la province en litige, et qu'après leur mort elle appartiendrait à la, couronne. C'est à Philippe-Auguste qu'on doit cet arrangement, qui fit rentrer la partie la plus importante de la Picardie dans le domaine national. Le Ponthieu, dont Abbeville est la capitale, passa successivement dans les maisons d'Alençon, de Dammartin, de Castille et d'Angleterre. Philippe de Valois reprit sur Édouard III, par confiscation, ce comté, ainsi que celui de Santerre (territoire de Péronne), avait été rattaché à la couronne, lorsque Charles VII, en 1435, engagea au duc de Bourgogne, pour quatre cent mille écus, toutes les villes situées sur la Somme. Le droit des rois de France étant enfin reconnu, cette aliénation ne devait être que momentanée.

Le premier soin de Louis XI, deux ans
après son avènement au trône, en 1463, fut d'acquitter la dette
contractée par son père et de rentrer dans l'entière possession
de la Picardie. Depuis cette époque, la province n'a pas cessé
d'être française.
Elle comprenait alors l'Amiénois, le Boulonnais,
le Ponthieu, le Santerre, le Vermandois, le Thiérache, le Pays
reconquis, le Beauvoisis, le Noyonnais et le Laonnais on y réunit
l'Artois. Dans la suite, les territoires de Beauvais, Noyon
et Laon en furent détachés au profit de l'Ile-de-France; puis
en 1790, dans la dernière division du sol français en départements,
Boulogne et Montreuil furent affectés au Pas-de-Calais, l'Aisne
eut les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins; tout
le reste forma le département de la Somme.
Depuis la réunion
de la Picardie à la France, son histoire, comme province, se
confond avec l'histoire générale du pays. L'intérêt et l'importance
des événements qui s'y sont passés sont tout entiers dans les
chroniques particulières des villes ; nous y renverrons donc
le lecteur, nous contentant ici de quelques observations sur
la physionomie général de la province.
La grande lutte de
Charles le Téméraire trouvera sa place dans la notice de Péronne,
et les chroniques d'Amiens nous diront l'histoire de la rivalité
des maisons de France et d'Espagne.

Ce qu'il importe de constater ici, comme aperçu synthétique, c'est la profonde empreinte laissée sur le sol picard par chacune des grandes crises sociales qui ont tour à tour transformé notre pays. Le caractère des habitants, lent et paresseux dans ses évolutions spéculatives, défiant dans sa naïveté, après avoir opposé aux principes nouveaux une résistance obstinée, s'en est laissé pénétrer plus profondément qu'aucun autre. Nous avons parlé de l'enracinement des croyances païennes en face de la Gaule presque entièrement convertie au christianisme dès que la vraie foi se fut emparée des intelligences et des cœurs, la Picardie devint le pays le plus religieux peut-être de la chrétienté. Est-il besoin de citer les fameuses écoles monastiques de Corbie et de Saint-Ricquier, les pèlerinages si célèbres et si fréquentés à Notre-Dame de Liesse, à Notre-Dame de Boulogne et à l'église du Saint- Esprit de Rue ? L’époque des croisades surtout éclate en glorieux témoignages de la piété des Picards et, pour emprunter les paroles d'un historien moderne de la province, c'est un Picard, Pierre l'Hermite, qui prêche la première croisade et marche à l'avant-garde. C'est un Picard, le baron Creton d'Estourmel, qui, le premier, plante sa bannière sur les murs de Jérusalem, et sa famille, en mémoire de ce fait d'armes, inscrit sur son blason cette noble devise « Vaillant sur la crête » enfin, c'est un Picard, Godefroy de Bouillon, le plus glorieux peut-être, qui porta le premier la couronne de Jérusalem. Voilà pour le sentiment religieux.

Quant à l'esprit féodal, les preuves
de son développement, en Picardie, sont bien plus nombreuses
encore. Suivant le même auteur, on comptait dans la mouvance
directe du comté de Ponthieu 250 fiefs et plus de 400 arrière-fiefs
dans la mouvance du comté de Guines, 12 baronnies et 12 pairies.
La plupart des seigneurs avaient haute et basse justice, et
sur aucun point du royaume peut-être le droit féodal ne présentait
des usages plus bizarres, des symboles plus étranges. Les familles
nobles, sous le règne de Louis XIV, étaient au nombre de 500,
toutes d'origine ancienne ; et, parmi les plus illustres, nous
citerons les maisons d'Ailly, de Boufflers, de Créqui, de Rambures,
d'Estrée, d'Humières, de Melun, de La Motte-Houdancourt, de
Gamaches, de Mailly, de Rubempré, de Senarpont ; n'oublions
pas qu'outre Godefroy de Bouillon, la noblesse picarde a donné
huit rois au trône de Jérusalem. Non, cependant, que la sève
du pays soit épuisée par cette exubérance dé floraison aristocratique
lorsqu'à bout de résignation et de patience, après un long et
sérieux travail des esprits, l'indépendance municipale essayera
ses premières manifestations, quels magnifiques exemples d'habile
persévérance, de courageuse initiative et d'invincible fermeté,
les villes de Picardie ne donneront-elles pas au reste de la
France ?
Vers 1250, l'affranchissement des communes était
à peu près complet dans la province entière.
Cette vaillance proverbiale des Picards, mise au service des intérêts locaux, n'a jamais fait défaut non plus dans les grandes questions nationales depuis Bouvines jusqu'aux immortelles campagnes de la République et de l'Empire, les Picards ont toujours marché au premier rang parmi les défenseurs de la patrie ; le bataillon de la Somme fut toujours un de ceux qui se firent le plus remarquer par leur valeur et leur patriotisme. Pendant la guerre de 1870-1871, le département de la Somme fut envahi par les Prussiens. Après les combats de Mézières, de Boves et de Villers- Bretonneux, ils occupèrent Amiens et sa citadelle, abandonnées par l'armée du Nord, qui, sous les ordres du général Faidherbe, ne tarda pas à reprendre l'offensive, en s'emparant de la forteresse de Ham, et en livrant, à Pont-Noyelles, aux Prussiens, un combat qui leur fit éprouver des pertes considérables. Cependant, Péronne, assiégée et bombardée pendant plusieurs jours, dut capituler mais Abbeville ne fut occupée qu'après l'armistice, jusqu'au 22 juillet 1871, où les Prussiens évacuèrent le département.
Amiens


C’est à Amiens, capitale de la Picardie,
que fut créée la première ébauche de la royauté française
par l’élévation sur le pavois de Mérovée, le premier monarque
de la dynastie des Mérovingiens.
Ce n’est qu’après les
grandes invasions normandes qui dévastèrent la contré que
la ville puissent renaitre de ses cendres et à Amiens, en
1095, une première ébauche d’une organisation municipale
est crée avec l’accord de l’évêque et reconnu ensuite par
le roi France. Louis le Gros, et l’évêque Geoffroi accordent
leur soutien et sont présent à Amiens pour soutenir les
habitants contre le comte Enguerrand de Boves qui refuse
de reconnaître l’institution communale. Réunis à la couronne,
en 1185, la ville est donnée à la Bourgogne par le traité
d’Arras.
C'est dans l'église St-Nicolas, dont il ne
reste aucuns vestiges qu'en 1195 Philippe Auguste épousa
Ingelberge, qu'il fit couronner le lendemain par Philippe
de Champagne archevêque de Reims. Ce fut à Amiens qu'au
temps des expéditions pour la terre sainte les rois de France,
d'Angleterre d'Aragon de Navarre et de Bohème, se réunirent
pour concerter une nouvelle croisade.
A la mort de Charles
le Téméraire survenue en 1477, la ville sera acquise, par
le roi Louis XI qui autorisera la tenue de deux foires annuelles,
de sorte que non seulement la ville s’accroisse mais également
que n’augmente pas la fuite de devises en raison de la concurrence
exercé par les grandes foires d’Anvers et de Bruges.
L'évêché d'Amiens fut fondé vers
303. Les évêques étaient originairement seigneurs d’Amiens
mais ils donnèrent ce comté aux seigneurs de la maison de
Bouves, lesquels en furent dépossédé par Raoul, comte de
Vermandois. Mais le gendre de ce dernier céda le comté d'Amiens
a Philippe Auguste qui, pour se libérer de l'hommage dû
à l'évêque, lui fit quelques concessions aux moyen des quelles
ce prélat renonça à son droit de suzeraineté.
L'abbé
du monastère de Corbie était comte de Corbie et seigneur
temporel et spirituel de cette ville; celui de St Riquier
était seigneur de Centuls, d'Abbeville, de Danmar, de Montreuil
etc.; Celui de St-Valery, qui possédait au moyen âge une
partie du Vimeu ; fut peu à peu dépossédé par ses avoués,
qui prirent le nom de barons puis de marquis ; mais ce ne
fut qu'en 1669 que l’abbé de Vimeu perdit, par arrêt du
parlement, la juridiction pro épiscopale dans la ville de
St-Valery. Celui du Clairfay avait haute et basse justice
et une seigneurie étendue.

Le 23 janvier 1264, Saint Louis rend à Amiens un arbitrage dans un conflit opposant le roi Henri III d’Angleterre à ses barons révoltés et soutenu par Simon V de Montfort. Saint Louis prend parti pour le roi d’Angleterre, mais les barons refusent d’accepter les termes de cet accord, ils seront vainqueur le 14 mai 1264, lors de la bataille de Lewes, mais le 4 aout 1265 ils seront écrasés par les troupes d’Edouard le Sec, le fils d’Henri III.

En 1363, le roi Jean convoqua à Amiens les états généraux de la langue d'oil pour régler l'imposition de l'aide destinée au payement du reste de sa rançon, et pour prendre les mesures les plus propres à réformer les abus introduits dans l'administration des finances, la perception des impôts, etc.,etc. Les élus et députés des provinces et des villes eurent commission d'adjuger, chacun dans leur district, la levée de cette aide aux fermiers qui se présentaient. Le roi rétablit en outre la monnaie sur l'ancien pied, diminua le prix du marc d'argent, et défendit de prendre occasion de cette diminution pour survendre et renchérir les marchandises augmenter le salaire des artisans, etc. Après avoir ainsi réglé les finances, il crut qu'il n'était pas moins nécessaire de faire la révocation des domaines de la couronne, aliénés depuis plusieurs années par la libéralité des rois ses prédécesseurs et par lui-même.

Le 11 mars 1597, après un siège de
plus des cinq mois, la ville tombe aux mains des Espagnols
à la suite d’un astucieux stratagème élaboré par des soldats
de Pedro Enriquez de Acevedo. Les soldats déguisés en Paysans
viennent devant la portes des remparts proposer au Amiénois
affamés des pommes et des noix. Sans méfiances les habitants
ouvrent les portes, et les Espagnols en profitent se ruer
à l’intérieure prendre la cité.
Après six mois de siège,
les troupes d’Henri IV reprennent la ville, mettant ainsi
fin à son autonomie de gestion.
Le traité de paix entre
la République française, l'Angleterre l'Espagne et la Hollande
fut signé à Amiens en 1802. Le système de la neutralité
armée ayant été reconnu par la Russie, la Prusse, le Danemark
et la Suède, et, par suite, le commerce anglais s’étant
vu fermer le continent le ministre Pitt fut renversé par
l'opposition du parlement anglais et remplacé par Addington.
Le nouveau ministère entama dès lors des négociations avec
la France. Les préliminaires d'un traité de paix furent
signés à Londres le Ier octobre1801. Le 27mars
1802 (6 germinal an X), les plénipotentiaires de la France,
de la Grande-Bretagne de l'Espagne et de la république Batave,
Joseph Bonaparte, lord Cornwallis, le chevalier d'Azara
et Schimmelpenninck signèrent à Amiens un traité définitif
dont voici les principales dispositions:
![]()
L'Angleterre rend ses conquêtes à,
l'exception de Ceylan et de la Trinité ; les ports de la
colonie du Cap restent ouverts à ses vaisseaux la France
et l'Espagne recouvrent leurs colonies; la république des
Sept-Iles est reconnue l'île de Malte doit être rendue aux
chevaliers de l'ordre; la France évacuera Rome, Naples et
l'ile d'Elbe. L'intégrité des Etats de la Porte ottomane,
telle qu'elle existait avant la guerre est reconnue. Cette
dernière clause décida le sultan Sélim à accéder au traité
d'Amiens, le 13 mai.
Cependant de nouvelles difficultés
s'élevèrent bientôt entre la France et l'Angleterre: le
gouvernement anglais, craignant une nouvelle expédition
en Egypte ne voulut pas évacuer l’île de Malte. Plusieurs
autres motifs de querelle amenèrent la guerre qui, après
plusieurs violations du traité, fut enfin déclarée à la
France par l'Angleterre le 18 mai1803. Au XVIIIème
et au XIXèmesiècles, Amiens est réputé pour ses
textiles dont le célèbre velours d’Amiens. La famille Cosserat
deviendra alors l’une des plus grandes familles de l’industrie
textile de la ville.
Abbeville

Suivant d'anciens historiens, il
existait avant la conquête des Gaules par César, sur l'emplacement
occupe aujourd'hui par la ville d'Abbeville, une antique
bourgade, qui ne pouvait plus contenir tous les habitants
des environs qui s'y étaient réfugiés. Alarmés par l'approche
des troupes romaines, les habitants s'établirent sur le
terrain environné par la Somme, et formèrent par la suite
de cet emplacement une ville fortifiée. Cependant s,'il
faut en croire les auteurs de la description historique
du département de la Somme Abbeville, Abbatis Villa, n'est
pas une cité fort ancienne. Ce n'était, dans le Xème
siècle, qu'une maison de campagne, appartenant à l'abbé
de St-Riquier, qu’Hugues fit fortifier en 992, et où il
établit Hugues Capet, son gendre, pour arrêter de nouvelles
incursions des Danois et des Normands par l'embouchure de
la Somme; ces anciens travaux de défense ont été remplacés
par des fortifications élevées d'après le système de Vauban.
Vers ce temps, Abbeville devint la capitale du Ponthieu,
et la résidence des comtes de ce nom.
Cette ville servit
de boulevard contre la puissance des comtes de Flandre.
En 1130, Guillaume de Talvas accorda aux habitants d'Abbeville
le droit de commune qui leur fut authentiquement confirmé
par une charte que leur vendit Jean, comte de Ponthieu.

En 1214, la milice d'Abbeville prend
part à la bataille de Bouvines. La commune d'Abbeville faisait,
dans ces temps reculés, battre monnaie en son nom. Pendant
le XIVème siècle, cette ville eut beaucoup à
souffrir de l'invasion des Anglais ; les habitants parvinrent
à s'en délivrer en 1369. Plus tard, elle retomba sous la
domination anglaise qui respecta ses privilèges. Charles
VII, après avoir chassé les Anglais abandonna au Duc de
Bourgogne Abbeville et toutes les places sur la Somme. Louis
XI racheta cette ville pour 400,000 écus d'or, stipulés
au traité d'Arras, en 1463, mais il fut forcé de l'abandonner
De nouveau au duc de Bourgogne qui fit serment de garder
ses privilèges et ses franchises et qui, au mépris de cette
promesse, éleva dans son enceinte, en 1471, une forteresse
que les habitants rasèrent en peu d'heures, en 1587, époque
où la place était commandée par le duc d'Aumale, qui suivait
alors le parti de la Ligue. On trouva dans les décombres
cette Inscription gravée sur une pierre :
L'an mil
quatre cent soixante et onze,
Moi Charles duc de Bourgogne,
J'ai ce château ici mis,
En dépit de mes ennemis
Abbeville a réuni dans ses murs les
chefs de la troisième croisade.
C'est dans cette ville,
le 9 octobre 1514, Que Louis XII épousa, avec une pompe
vraiment royale, la sœur de Henri VIII, roi d'Angleterre,
c'est également dans Abbeville que Louis XIII, pendant le
siège d'Hesdin, en 1637, voua son royaume à la Vierge, en
présence du cardinal de Richelieu.
Avec le développement rapide du commerce du sel (depuis Rue), de la guède (waide en picard) et de l'industrie du drap de laine, les bourgeois augmentent en nombre et en importance politique : ils demandent une charte accordée dans le courant du XIIe siècle et qui fut confirmée en 1184 par le comte Jean Ier de Ponthieu qui mourut en Palestine. Pour commémorer l'événement, ils édifient un beffroi en 1126. Un siècle plus tard, Jeanne de Dammartin, comtesse de Ponthieu (1220-1278), permet aux religieux de convertir une partie supplémentaire des forêts en terres labourables, permettant le développement de l'économie locale.

Au milieu du XIIIème siècle,
Abbeville était « une des bonnes villes des rois de France
». Son port était un des premiers du royaume et son commerce
considérable. En 1259, les États généraux du royaume se
tinrent à Abbeville et Henri III d'Angleterre s'y rencontra
avec Louis IX de France pour y signer le traité de Paris
qui réglait la question des conquêtes de Philippe Auguste.
.
En 1272, le Ponthieu avec Abbeville, passe par mariage
aux rois d'Angleterre, mais Philippe le Long reprend la
ville, prétextant qu'Édouard II d'Angleterre n'avait pas
rempli son devoir de vassal. Édouard II s'étant conformé
à la loi féodale, Abbeville retombe sous domination anglaise.
Toutefois de nombreuses contestations s'élèvent entre les
bourgeois et leurs nouveaux maîtres. .
Montdidier

Quelques historiens croient que Montdidier
a été bâti sur les ruines de Braluspance, ancienne ville
gauloise ; on attribuent son nouveau nom à Didier, roi des
Lombards, qui y fut détenu avant d'être confiné à Corbie.
On assure aussi que plusieurs monarques de là troisième
race y ont résidé :on dit même que Philippe Auguste y tint
sa cour en 1219 ; que Charles VI y convoqua, au mois de
janvier 1413, ses fidèles sujets de Picardie.
Celte
ville est bâtie sur le penchant d'une montagne, au pied
de laquelle coule la rivière du Dom. Elle était jadis entourée
de fortifications dont on voit encore quelques restes. Les
Espagnols l'assiégèrent en 1636, mais les habitants, dans
une sortie vigoureuse, les défirent complètement et les
forcèrent à la retraite.
Note : Voici un commentaire
qu’on peut lire dans Dictionnaire géographique, historique,
industriel et commercial de tout les communes de la France…
'L'intérieur de Montdidier est fort triste. La plupart des
maisons sont vieilles, et presque toutes les rues sont inégales
et mal pavées.
Doullens

Cette ville, située sur la rive gauche
de l‘Authie, est défendu par une double citadelle bâtie
sur une éminence, qui en fait une place forte. Son étendue
est peu considérable, mais elle offre un aspect assez riant.
Les boulevards qui l'entourent offrent d'agréables promenades.
Doullens appartint d'abord aux comtes de Vermandois, et
ensuite à ceux de Ponthieu. Charles X fut le dernier prince
qui la posséda à ce titre.
On remarque cette formule
singulière dans les anciennes charte: «Donné à Doullens,
ville empruntée du roi notre sire, et de messieurs les mayeurs
et échevins, etc.»
Les Espagnols, sous la conduite
du comte de Fuentès, prirent cette place le 31 juillet 1595,
et y commirent des cruautés inouïes.
Le baron de Geismar
colonel aux gardes de l'empereur de Russies, s’en empara
en l814.
Ham
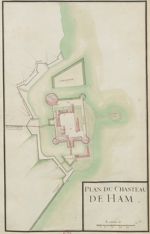
La ville de Ham possède des vestiges d'un château fort dont les premiers remparts élevés en pierre datent du XIIIème siècle sous le règne du seigneur des lieux : Odon IV. Dès le XVème siècle, sous l'influence de Jean II de Luxembourg-Ligny, puis de son neveu Louis de Luxembourg-Saint-Pol, le château se transforme en une véritable forteresse féodale qui est très convoitée. Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol et connétable de Louis XI en 1465, fait édifier un donjon monumental : 33 m de hauteur, 33 m de diamètre, 11 m d'épaisseur de murs. En 1840, ce château devient la prison du prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il s'en évade six ans plus tard, déguisé en maçon, et sous l'identité de Badinguet. En mars 1917, l'occupant allemand fait sauter en grande partie le château dont il ne reste aujourd'hui que la tour d'entrée et quelques vestiges du donjon et des remparts.

Ham domine une plaine fertile ; des marais,
l'entourent. Le château, fort, qu'on découvre d'assez loin,
jette dans l'âme la terreur et l'effroi.
Il fut bâti vers
l'an 1470, par Louis de Luxembourg, comte de St-Pol, que Louis
XI fit plus lard décapité. Au-dessus de la porte on lit cette
inscription en caractères gothiques : « Mon Mieux ». La grosse
tour a 33 mètres de hauteur et 33 mètre de diamètre; c'est l’une
des plus fortes qui existent en France. Ce château sert depuis
longtemps de prison d'Etat : le maréchal Moncey y fut détenu
pendant trois mois en 1815, pour s'être récusé lorsqu'il fut
nommé membre du conseil de guerre qui devait juger le maréchal
Ney; les ex-ministres de Charles X y ont été détenus jusqu'à
l’époque de la commutation de la peine qui leur avait, été infligée.
La ville de Ham fut détruite en 1411 par le duc de Bourgogne,
qui avait rassemblé à Douai une armée considérable. Il en sortit
dans les premiers jours de septembre avec 2 500 chevaliers,
800 hommes d'armes, et 50 000 fantassins, et se dirigea contre
Hamville, où Bernard d'Albret s'était établi avec 500 hommes
d'armes armagnacs. La résistance de ce dernier ne fut pas longue.
L'artillerie qu'avaient amenée les Flamands
était si supérieure, en calibre à celle qu'on avait accoutumé
d'employer, que dès le premier jour du siège elle renversa des
pans de murailles et des édifices que les assiégés croyaient
inébranlables. Dans la nuit suivante, Charles d'Albret s'échappa
avec la garnison et tous ceux des bourgeois qui lui avaient
montré quelque faveur: Ceux qui attendirent les Bourguignons
avaient au contraire souvent prouvé leur dévouement au comte.de
Nevers, leur seigneur, et ils comptaient sur sa protection.
Ils furent presque tous massacrés; leurs maisons furent pillées
méthodiquement, et ce ne fut qu'après que tout ce qui avait
là moindre valeur eut été enlevé que les Flamands mirent le
feu à la ville, et l'entretinrent pour qu'elle fût entièrement
consumée.
Note : Pendant la Grande Guerre, après la Bataille
de la Somme, l'Armée allemande se replia sur la ligne Hindenburg,
ligne fortifiée de Lens à Soissons, pratiquant, sur les territoires
abandonnés, la tactique de la "terre brûlée". C'est ainsi que
la forteresse et l'ensemble de la ville de Ham furent dynamitées
par les Allemands, le 19 mars 1917. Il ne reste aujourd'hui
du bel édifice que des ruines pittoresques dominant le cours
paisible du canal de la Somme.
Crécy en Pontieu
Crécy (Crisiacum), chef-lieu de canton,
à 19 kilomètres nord d'Abbeville, sur la Maye, est un bourg
qui tirait jadis toute sa notoriété d'une maison de plaisance
qu'y possédaient les rois de France au VIIème siècle.
Une autre et plus triste illustration lui a été acquise depuis
c'est dans ses plaines, au nord-est du village, que fut livrée,
le 26 août 1346, la sanglante bataille qui menaça si sérieusement
la nationalité française. A défaut du récit détaillé de cette
journée néfaste, évoquons les souvenirs que les lieux, rappellent.
C'est ici que se tenait à portée des traits ennemis, et après
avoir eu son cheval tué sous lui, Philippe de Valois, lorsque
Jean de Hainaut l'entraîna loin du champ de bataille ; voici
la croix et le moulin à vent qu'occupait Édouard III, observatoire
improvisé d'où le roi anglais qui avait, ce jour-là, cédé le
commandement en chef à son fils, le prince de Galles, dit le
Prince Noir, suivait les mouvements des deux armées. Les murailles
de l'humble bâtiment sont couvertes des noms de touristes anglais,
curieux de visiter ce théâtre des exploits de leurs ancêtres.
Nous n'avons à enregistrer que la liste de nos morts ; elle
est longue, mais glorieuse aussi ce sont le roi de Bohême, le
duc de Lorraine, le duc d'Alençon, dont l'imprudence décida
du sort de la journée ; les comtes de Flandre, de Nevers, de
Blois, d'Harcourt, avec ses deux fils ; d'Aumale, de Bar, de
Sancerre, le seigneur de Thouars, les archevêques de Nîmes et
de Sens, le grand prieur de l'hôpital Saint-Jean, le comte de
Savoie, six comtes d'Allemagne et un nombre infini d'autres
seigneurs et hauts barons.
Ajoutons, comme détail curieux, que c'est
à la bataille de Crécy qu'il fut fait, pour la première fois,
usage du canon.
Note : Cette assertion reprise par beaucoup
d’historient est en fait fausse, en effet, tous les témoins
de cette bataille ne citent pas l’usage de canons à la bataille
de crécy. C’est à la suite du récit de Jean Frossard qui mentionne
les canons plus de 40 ans après la bataille














