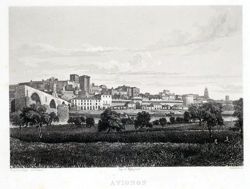Avignon - Préfecture du Vaucluse
Retour
au Département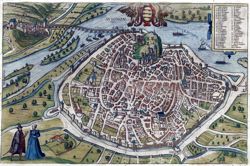

Le nom d'Avignon, comme ceux de la plupart
des villes voisines qui ont une terminaison sem-blable, parait être
d'origine celtique et faire allu¬sion à sa situation sur un fleuve.
Ce nom, en effet, dans sa forme primitive, que nous ont transmise
les Grecs, est Aouenion, c’est-à-dire, en celtique (aeuen, fleuve,
ion, seigneur, domina¬teur), ville qui domine le fleuve, qui est
située sur le fleuve. Nous verrons de même Cvasion, Vaison, ville
sur l’Ouvcze ; Cabalioii, Cavaillon, ville sur le Cabal, rivière
aujourd’hui appelée le Caulon; Arausio ou Araïsioi Orange, ville
sur l’Araïs, aujourd’hui rivière de Meyne. On a donné bien d’autres
étymologies du nom d'Avignon, la plupart puériles ; nous citerons
celle-ci, a vento épigramme contre la violence du vent du nord-
ouest, le fameux mistral, qui se fait souvent sentir à Avignon pour
la salubrité, sinon pour l’agrément de la ville : A venio ventosa,
sine vento venenosa, cnm veuto fastidiosaf.
Avignon n’était
encore qu’une colonie de pêcheurs quand les Phéniciens y apportèrent
le commerce et le culte d'Hercule. Aux Phéniciens succédèrent les
Phocéens de Marseille. Que les Massaliotes aient possédé, à proprement
parler, Avignon, il nous semble qu’on a eu raison de le contester,
puisque nous savons qu’ils eurent toujours assez de peine à se préserver
des attaques de leurs voisins, et que, d’après Strabon, ils ne s’emparèrent
qu’assez tard de quelques territoires situés autour d’eux. Mais
il n’est point douteux que les intérêts de leur commerce n’aient
fixé un grand nombre de familles massaliotes à Avignon, devenu un
lieu de passage et une sorte d’entrepôt de toutes les marchandises
qui se dirigeaient du nord et du centre de la Gaule vers Marseille.
A côté de l’autel d’Hercule s’éleva un temple de Diane, la grande
divinité massaliote.
On ne peut douter de la prospérité d’Avignon
sous la domination romaine. Pomponius Mêla et Pline la rangent parmi
les cités les plus importantes de la Narbonnaise. Que reste-t-il
pourtant de monuments romains à Avignon, alors que des villes voisines
nous en offrent de si beaux ? Quelques arcades derrière le théâtre
moderne et près du château des papes, des mosaïques et des fragments
de marbre déposés au musée, les débris d’un aqueduc sur la route
de Carpentras. On ne sera point surpris de celle disparition des
souvenirs romains quand on saura tous les sièges qu’Avignon eut
à subir, et les attaques des Sarrasins et celles des Francs ; surtout
quand on aura réfléchi qu’Avignon eut une autre époque monumentale
qui effaça nécessairement la première. Il fallut, en effet, faire
place au palais des papes, aux fortifications, aux couvents.

Le roi de Bourgogne Gondebaud, après avoir
vaincu et tue Gondicaire, se voyant poursuivi par Clovis, se réfugia
dans Avignon. Le roi des Francs en fit le siège et se retira sans
pouvoir la prendre ; mais il avait tout ravagé aux alentours, coupé
les oliviers, arraché les vignes. Un peu plus tard, en l’an 500,
s’étant allié avec Théodoric, ils soumirent à eux deux le pays,
et, dans le partage qu’ils en firent, Avignon échut au roi des Ostrogoths.
Avignon était regardée alors comme une ville encore toute romaine
; elle avait un sénat et des tribunaux où les traditions romaines
et, jusqu’à un certain point, les traditions païennes s’étaient
conservées, si l’on en croit un passage de Grégoire de Tours où
il nous montre un ecclésiastique refusant l’évêché d’Avignon « dans
la crainte que sa simplicité ne fût exposée dans un pays plein de
sénateurs sophistes et de juges philosophes (senatores sophisticos
et judices pkilosophos). ».
Les fils de Clovis, Sigebert, roi
d’Austrasie, Gontran, roi de Bourgogne, se disputèrent cette place,
qui fut prise et reprise. En 583, le roi de Bourgogne y assiège
sans succès Mummol, qui s'était mis en révolte et occupait Avignon
pour le rebelle Gondovald.
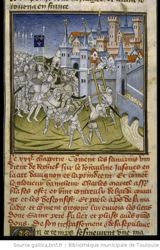
Les seigneurs des bords du Rhône avaient
profité de la faiblesse des Mérovingiens pour se rendre indépendants.
Charles-Martel, dont la main rude et forte reconstituait la monarchie
franque, les fit rentrer dans le devoir et mit une garnison dans
Avignon en 733. Alors ils traitèrent avec les Sarrasins et Youssouf
entra dans la place en l’an 736. Charles-Martel accourut : les Sarrasins
replièrent toutes leurs garnisons sur Avignon, une des plus fortes
villes du Midi : Urhem munitissimam ac montuosam, dit le continuateur
de Frédégaire. En effet, moins étendue qu’aujourd’hui, elle était
entourée presque de tous côtés par le Rhône, et le rocher des Doms,
taillé à pic, portait sur son sommet une formidable citadelle. Après
un siège long et meurtrier, Charles, qui avait fait jouer toutes
les machines en usage alors, prit la ville d’assaut, fil passer
au fil de l’épée tous les Sarrasins et une partie des habitants,
puis livrer aux flammes les maisons et les édifices publics de celle
ville trop romaine. Ce fut le plus grand désastre qu’Avignon eut
à subir dans le cours de son existence en 737.
Sous le régime
féodal, Avignon eut pour suzerains les comtes de Provence, qui,
en 1125, partagèrent cette suzeraineté avec les comtes de Toulouse.
Un vicomte, qui existait depuis la fin du Xème siècle,
les représentait dans la ville. Le dernier de ces vicomtes, à la
fin du XIIème siècle, apparaît dans la légende de saint
Bénezet sous des traits odieux, soit qu’un pouvoir qui tombe ne
puisse échapper à la calomnie, soit qu’en effet la cruauté de son
dernier représentant en ait amené la chute. Un jeune pâtre d’Alvilard,
dans le Vivarais, nommé Bénézet ou Benoît, eut à douze ans une visite
de Jésus-Christ, qui lui ordonna de quitter son troupeau et d’aller
bâtir un pont sur le Rhône. « Seigneur, qu’est-ce que le Rhône ?
— Je t’enverrai un guide qui t’y conduira. — Seigneur, comment construire
un pont avec les six oboles que j’ai ?— Va, et je t’en donnerai
les moyens.»
Bénezet part et rencontre en chemin un pèlerin ;
ce pèlerin était un ange envoyé par le Christ. Bénézet arrive au
bord du Rhône : « Seigneur Jésus, s’écrie- t-il, quel large fleuve
pour y bâtir un pont ! — Ne crains rien, lui répond le pèlerin qui
disparaît en même temps. » Bénézet aborde un batelier, et le prie,
au nom de la vierge Marie, de le porter sur l’autre rive. » Au nom
de la vierge Marie ! lui dit-il en se moquant ; le batelier, qui
était juif, donne-moi de l’argent, cela vaut mieux. » Bénézet donne
trois oboles et passe. Il va à la cathédrale, où l’évêque Pons prêchait
; il l’interrompt et crie bien haut : « Écoutez-moi ; Notre-Seigneur
Jésus-Christ m’envoie pour construire un pont sur le Rhône. » L’évêque,
interrompu dans son éloquence par ce personnage grotesque, le fait
conduire au viguier pour qu’on châtie son insolence, qu’on lui coupe
les pieds et les mains comme à un malfaiteur. Devant le viguier,
Bénézet répète : « Le Seigneur m’envoie pour construire un pont
sur le Rhône. — Toi ! s’écrie le viguier, toi, misérable pâtre !
Et comment ferais-tu ce que les hommes les plus puissants et Charlemagne
lui-même n’ont pas osé entreprendre ? Au reste, les ponts se font
de pierre et de ciment, je vais le fournir une pierre qui se trouve
dans la cour de mon palais ; si tu la portes, je te croirai. » Bénézet
y va, et soulève comme un caillou cette pierre que trente hommes
eussent de la peine à ébranler. Il la porte jusqu’au Rhône, suivi
de la foule et de l’évêque lui-même, qui étaient accourus, et la
jette dans le fleuve pour servir de première assise à la première
arche. Tous, reconnaissant sa mission divine, célébrèrent la puissance
de Dieu. Le viguier, le premier, tomba à genoux, saluant Bénézet
du nom de saint, et lui donna trois cents sols. En quelques instants,
les dons de la foule s’élevèrent à cinq mille sols, destinés à la
construction du pont en 1177. Bénezet travailla sept ans à son œuvre
et mourut en 1184, sans l’avoir achevée. On l’ensevelit, suivant
son désir, dans une petite chapelle que l’on éleva sur le bord du
pont entre la troisième et la quatrième arche, et qui est encore
debout ; les mères des mariniers du Rhône y vont prier pour leurs
fils. Bénezet fut canonisé sous le pontificat d’Innocent IV. Avant
de mourir, il avait fondé une confrérie de Frères Pontifes ou faiseurs
de ponts, qui terminèrent son grand travail quatre ans après sa
mort 1188 ; c’était un pont de vingt-cinq arches et de 1 947 mètres
de long, qui traversait les deux bras lu Rhône, partagé en cet endroit
par l’île Barthelasse. La ville de Saint-André, située de l’autre
; côté du fleuve et appelée depuis Villeneuve, devint un faubourg
d’Avignon. Malheureusement, le Rhône du celtique Rôdan, (tourner
comme une roue) a broyé sous le choc de ses flots l’œuvre magnifique
de Bénezet et de ses frères pontifes ; le pape Clément VI en releva
plusieurs arches en 1349 ; les frères pontifes étaient d’ailleurs
encore là pour s’occuper de ces réparations. Leur confrérie, puissante,
enrichie par les quêtes publiques et par les bienfaits des comtes
de Toulouse, établie dans un couvent situé à l’extrémité du pont,
du côté de la ville, était chargée de recevoir les pèlerins qui
arrivaient, de veiller à la conservation du pont et d’en construire
d’autres ; on suppose que le pont de Sorgues, sur la route d’Avignon
à Orange, était aussi son ouvrage. Ses fonds étaient administrés
par des recteurs, qu’on trouve encore mentionnes dans un acte de
1469.
Le pont était sans doute encore en bon état
au XVIème siècle, puisque le chancelier de l’Hospital
en parle ainsi dans ses vers latins :
Nil ponte superbus
illo Quem subtus Rhodanus müllis jam labitur auctus fluminibus.
Sans cesse agitée, cette puissante république avignonnaise qui,
à l'imitation des républiques italiennes, s’était donné au XIIIème
siècle un podastat, partagea le sort de la Provence et du Languedoc
pour en avoir partagé les doctrines et la résistance passionnée
aux hommes du Nord. Le comte de Toulouse, voyant fondre l’orage
sur lui, ne négligea rien pour se l’attacher et pour assurer ainsi
à sa puissance un solide appui sur la rive gauche du Rhône. En 1212,
il lui céda tous ses droits sur le monastère de Saint-André de Villeneuve,
ainsi que sur le bourg du pont de Sorgues et ses dépendances. Plus
tard, il lui donna Caumont, Le Thor, Girmagnanègues, Touzon, Joncquières.
Lorsque, fugitif avec son fils, il revint de Gènes, où il avait
cherché asile, et débarqua à Marseille, une députation de 300 Avignonnais
vint l’y trouver et lui promit le concours de la cité. Le peuple
d’Avignon entra donc pleinement dans le mouvement du Midi de la
France : il mit en pièces le comte des Baux, prince d’Orange, qui
tentait de s’y opposer, et se fédéra avec Marseille, Toulouse, Béziers
; toutes ces villes se garantissant mutuellement leurs domaines
et leurs libertés.
Le meurtre du comte des Baux attira sur Avignon
les anathèmes pontificaux. Louis VIII arriva à Lyon avec 30 000
hommes. Troublés par l’approche du danger, les Avignonnais lui offrirent
le passage sur le pont de Saint-Bénézet et des vivres pour son armée.
Il accepta. Mais les magistrats de la ville, redoutant le contact
de l’armée des croisés et d’une population ardente, et au fond à
peu près albigeoise, firent adapter au pont de pierre un pont de
bois qui permettait aux Français de traverser le Rhône sans passer
par la ville. L’entrée n’en était permise qu’au roi, au cardinal-légat
et aux principaux chefs. Cette méfiance déplut à Louis VIII ; il
voulut traverser Avignon le casque en tête, la lance au poing et
ses hommes d’armes derrière lui. Les magistrats indignés opposèrent
un énergique refus. Les épaisses murailles carrées, de construction
romaine, flanquées de tours, entourées de fossés remplis par les
eaux vives de la Sorgues, se couvrirent de défenseurs vigilants.
Le podestat et le bayle (bailli) du comte de Toulouse se mirent
à la tête de la résistance. De son côté, Louis VIII jura qu’il ne
s’éloignerait pas avant d’avoir pris la ville, et fit dresser ses
pierriers, ses balistes, ses mangonneaux, ses chats. Le légat enjoignit
solennellement aux croisés de « purger Avignon d’hérétiques, » et
le siège commença le 10 juin. Il dura trois mois. L’énergie des
assiégés fut secondée par Raymond, qui ne cessait de troubler les
croisés par ses incursions, d’enlever leurs convois et leurs fourrageurs,
après avoir pris soin, pour les priver de toutes subsistances, de
ravager le pays autour d’Avignon ; il avait même fait labourer les
prairies, afin que leurs chevaux ne pussent trouver à s’y nourrir.
La difficulté de se procurer des vivres amena la famine dans le
camp des assiégeants, surchargé d’une foule d’aventuriers et de
fanatiques accourus à la croisade. La campagne se couvrit de cadavres
d’hommes et de chevaux, et de ces corps épars dans la plaine s’élevaient,
avec un affreux bourdonnement, des essaims de grosses mouches noires,
qui venaient jusque sous les tentes et les pavillons des princes
infecter les plats et les hanaps, et apporter aux vivants la peste
engendrée par les morts en putréfaction. Pendant ce temps, les Avignonnais
ne cessaient de faire de violentes sorties. Les croisés furent obligés
de creuser un fossé pour s’en garantir, comme s’ils eussent été
assiégés eux-mêmes. Un jour, ils voulurent livrer à la ville un
grand assaut par le pont de bois, qui joignait l’île Barthelasse.
Le pont s’écroula sous eux, et le fleuve en engloutit un grand nombre.
20,000 avaient déjà péri, et beaucoup de seigneurs, qui avaient
fourni au roi leurs quarante jours de service, se retiraient. Malheureusement
la ville avait épuisé ses ressources et dut capituler. Le légat
dicta les conditions. Les Avignonnais furent obligés de livrer 300
otages, de payer une forte amende, de remettre leurs navires à voiles
et toutes leurs machines de guerre, leurs fossés furent comblés,
leurs murailles renversées, 300 maisons fortifiées de tourelles
(domus turrales) démolies, les routiers français et flamands au
service de la commune ou du comte Raymond mis à mort le12 septembre
1226. Le 14 du même mois, le roi et le légat se rendirent processionnellement
à la chapelle de Sainte-Croix en expiation de l’hérésie, et le saint
sacrement y resta continuellement exposé. Telle fut l’origine des
pénitents gris, qui se glorifient de compter Louis VIII au nombre
de leurs membres, et auxquels Pierre de Corbie, alors évêque d’Avignon,
prescrivit des règles confirmées par le légat. De leur côté, les
Dominicains s’installèrent sur-le-champ dans la ville, comme ils
faisaient dans tous les lieux conquis par les croisés.
Les Avignonnais
furent vengés par la peste ; les plus grands seigneurs, le roi lui-même,
emportèrent en s’éloignant les germes d’une mort qui les atteignit
peu de temps après. Avignon entra dès lors dans une nouvelle phase
de son existence. La catastrophe de 1226 fut le tombeau de sa grandeur
républicaine. Une autre grandeur, qui lui vint des papes, lui était
réservée.
En 1251, Charles d’Anjou, comte de Provence, et son
frère Alphonse, devenu, en 1249, par la mort de Raymond VII, comte
de Toulouse et du Venaissin, se concertèrent pour imposer aux Avignonnais
le traité de Beaucaire. Cela ne se fit point sans protestations
de la part des vieux républicains d’Avignon ; menacée d’un siège,
la ville, qui n’avait plus de murailles, céda la haute et la moyenne
justice aux deux comtes et reçut dans ses murs leur viguier. Au
lieu de consuls, elle n’eut plus que des syndics. Elle obtint pourtant
de conserver ses coutumes et ses lois communales, et d’être exemptée
de toutes tailles et péages. Alphonse mort, sa moitié d’Avignon
passa au roi Philippe le Hardi, son héritier. Philippe le Bel la
céda à Charles II, roi de Naples, qui, possédant déjà l’autre moitié
comme comte de Provence, devint seul seigneur d’Avignon.
Les
bienfaits des papes en faveur d’Avignon commencèrent avant même
qu’ils y fussent établis ; car, en 1303, Boniface VIII érigea en
université l’école de droit que les rois de Naples venaient d’y
fonder, et y ajouta une Faculté de théologie. Le recteur de cette
université, appelé primicier, était annuel et avait l’insigne privilège
de devenir noble en sortant de charge.
Nous ne raconterons pas l’histoire
si connue des démêlés de Philippe le Bel et de la papauté, qui vint
tomber, terrassée, à Avignon, sous la rude main du roi de France.
Devenu pape par la protec¬tion de ce monarque, Bertrand de Got,
ambitieux Gascon, lui inféoda la tiare achetée au prix de cette
soumission. Clément V vint s’établira Avignon en 1309 ; il fut harangué
à son entrée par le primicier de l’université, et se logea au couvent
des frères prêcheurs. « Je connais les Gascons, dit alors le doyen
des cardinaux, Matthieu Rosso des Ursins, l’Église ne reviendra
pas de longtemps eu Italie. » Il ne croyait peut-être pas dire si
vrai. L’exil des papes fut de 70 ans : exil moitié forcé, moitié
volontaire ; les Etats romains, troublés par la turbulence des seigneurs,
offraient si peu de sécurité ! L’établissement à Avignon ne fut
pas le seul sacrifice que Clément V s’était obligé de faire, il
fallut qu’il livrât les templiers, et il faillit immoler de même
la mémoire de Boniface VIII à la vengeance du roi ; il réussit pourtant
à l’amener par l’adresse de ses délais à un désistement sur ce dernier
point. Clément V, malade et comme chargé de remords, n’acheva pas
sa vie à Avignon ; il changea plusieurs fois de résidence, et se
fixa enfin à Carpentras, où il fit frapper des monnaies à son effigie
avec te titre du comte de Venaissin, cornes Venaissini.
Sentant
sa fin prochaine, il voulut aller mourir à Bordeaux, son cher pays
; mais la mort le surprit en chemin et il décède le 20 avril 1314,
à Roquemaure actuellement dans le Gard.
Après deux ans de troubles
et d’interrègne, Jacques d’Ossa fut élu pape sous le nom de Jean
XXII. De Lyon, où s’était tenu le conclave, il descendit le Rhône
sur une flottille de barques pavoisées et arriva à Avignon le 2
octobre 1316. Un soleil magnifique brillait au ciel ; une foule
accourue de toutes parts se pressait sur les deux rives. Les Avignonnais
reconnaissaient leur ancien pasteur ; car Jacques d’Ossa avait été
évêque de leur ville en 1310. Ravi de ce spectacle, le nouveau pape
le faisait remarquer au cardinal Napoléon des Ursins, secret partisan
du retour à Rome, et protestait qu’il n'abandonnerait point Avignon
et le ciel de France. Jean XXII, homme d’une science et d’un esprit
supérieurs, avait conçu le dessein d’appuyer la papauté à Avignon
sur un établissement solide. Cette possession était, d’ailleurs,
fort précaire, et Avignon, sur laquelle les comtes de Provence,
ceux de Toulouse, les rois de France, les empereurs d’Allemagne
avaient ou avaient eu des droits, pouvait être considérée à peu
près comme un terrain neutre. Jean, qui remuait toute l’Eglise et
relevait dans la chrétienté le pouvoir pontifical tant abaissé,
déploya la même activité dans Avignon. Son neveu, Jacques de Via,
fut fait par lui évêque d’Avignon et cardinal. Deux archidiaconats,
dont il pourvut le chapitre, furent donnés à deux de ses créatures,
il lui fallait de plus un palais qui eût la valeur d’une forteresse
et où il pût se mettre à l’abri d’un coup de main. Le rocher des
Doms, abrupt, défendu par le Rhône, offrait une position magnifique.
Sur cette éminence, où s’étaient élevés jadis les temples païens
et plus tard le château des premiers seigneurs d’Avignon (de Dompnis,
d’où le nom des Doms), existait alors l’église métropolitaine de
Notre-Dame-des-Doms, dont la légende attribuait la première fondation
à sainte Marthe. Cette légende se trouve précisément rapportée dans
un livre qui fut dédié au pape Jean XXII, le Spéculum sanctorale
, œuvre du dominicain Bernard Guido, pénitencier de ce pontife.
Marthe, la vénérable hôtesse du Christ, après avoir vaincu la Tarasque,
ce monstre effroyable qui désolait le pays entre Avignon et Tarascon,
vint s’établir entre la première de ces deux villes ; elle fit bâtir
une belle église dédiée à la mère de Dieu, fonda un couvent tout
à côté, et se retira elle-même dans une excavation du rocher où
elle passa sa vie. Elle se couvrait de peaux de brebis, se ceignait
les reins d’une corde à gros nœuds, couchait sur un lit de feuilles
sèches, se nourrissait de racines et d’herbes; mais elle traitait
ses hôtes mieux qu’elle-même. Saint Maximien, évêque d'Aix, saint
Trophime, évêque d’Arles, saint Eutrope, évêque d’Orange, vinrent
par inspiration divine consacrer la nouvelle église ; Marthe leur
offrit un excellent repas, et « en leur présence l’eau fut changée
en vin comme aux noces de Cana. » Elle mourut âgée de 70 ans,
après avoir converti le pays. Telle est la légende, qu’il n’est
pas besoin de discuter.
Il va sans dire qu’Avignon se donne pour premier évêque un disciple de saint Paul ; c’est saint Ruff, après lequel les légendaires perdent la suite des évêques d’Avignon, et ce n’est pas étonnant. L’église de Sainte-Marthe étant tombée en ruine, Constantin, dit-on, la releva ; les Sarrasins ayant détruit l’église de Constantin, Charlemagne en édifia une nouvelle, qui est celle que nous voyons aujourd’hui. Des archéologues prétendent que le porche est de construction romaine ; mais qui ne sait que Charlemagne ne se faisait aucun scrupule d’employer les débris de l’art antique à la construction de ses propres édifices, témoin les colonnes de Ravenne qu’il fit transporter à Aix-la-Chapelle ? Un cloître magnifique fut annexé à l’église, alors appelée église de la Sainte-Vierge, de Saint-Jean et de Saint-Étienne, et qui ne prit qu’au XIVème siècle le nom de Notre-Dame-des-Doms (Ecclesia Sanctœ Maria de Dompnis ou Dominis Avenionis.) C’est en ce lieu que Jean XXII voulut élever sa résidence. Par ses ordres, Jacques de Via, son neveu, démolit l’ancienne maison épiscopale et le cloître, et construisit un nouvel évêché, celui qui existe encore aujourd’hui. Sur le reste de ce terrain, Jean fit creuser les fondements de son propre palais. Ce petit vieillard de 70 ans, quelle que fût son énergie, ne pouvait se flatter d’achever lui-même ce grand ouvrage. D'ailleurs, le parti des cardinaux italiens, furieux de le voir enchaîner le Saint-Siège sur les bords du Rhône, avait juré de se débarrasser de lui et des siens. « Les magiciens Jacques, dit le Brabançon, Jean d’Ainant, médecin, écrivait-il à l’évêque de Riez, ont préparé des breuvages pour nous empoisonner, nous et quelques cardinaux nos frères, et n’ayant pas eu la commodité de nous les faire prendre, ils ont fait des images de cire sous nos propres noms pour attaquer notre vie en piquant ces images. Mais Dieu nous a préservés et a fait tomber en nos mains trois de ces images diaboliques. » Le plus grand coupable était un chapelain du pape, Hugues Géraud, évêque de Cahors ; il fut condamné à une dégradation publique et à une détention perpétuelle. Jean allait pourtant lui-pardonner, lorsque Jacques de Via mourut subitement empoisonné. « Infâme Géraud, s’écria le pape, tu voulais donc exterminer toute ma race ! ». Cette fois, il fut sans pitié et le livra au bras séculier. Condamné à être brûlé vif, Géraud fut attaché à la queue d’un cheval et traîné ainsi au lieu du supplice en 1317. Plus heureux que son neveu, Jean échappa à ces tentatives de meurtre, et mourut de sa mort naturelle, en 1334.
On admire dans Notre-Dame-des-Doms son élégant mausolée, où se joue en clochetons dentelés la merveilleuse architecture gothique du XIVème siècle. Selon Villain, un trésor de 25 millions était accumulé dans la tour de son palais. C’étaient des ressources pour son successeur.
Le conclave, tenu cette fois à Avignon, élut,
le 8 janvier 1335 Jacques Fournier, qui prit le nom de Benoit XII.
Moins brillant que Jean XXII, c’était un homme honnête et sévère
dans ses principes. La question de résidence s'agita de nouveau.
Pétrarque, qui était venu sous le règne précédent s’établir à Avignon,
n’avait pas cessé d’engager Jean XXII à revenir à Rome, et la résistance
de ce pontife à ses conseils est peut-être une des principales causes
du jugement rigoureux, qu’il a porté sur lui. Une députation arriva
de Rome. Benoît hésita, songea à Bologne plutôt qu’à Rome, et enfin
se décida à rester à Avignon. Aussitôt il reprit le projet de son
prédécesseur et se mit à l’œuvre. Mais ce qui était déjà bâti du
palais pontifical était au-dessous du plan qu’il avait conçu : il
le fit démolir et fit construire sur de plus larges bases un édifice
nouveau. Il termina ainsi la partie septentrionale du palais des
papes et l’immense tour de Trouillas. Le second conclave d'Avignon
plaça la tiare sur la tête de Clément VI, pape mondain, ami du luxe
et des fêtes autant que son prédécesseur avait été austère (1342).
Quoique déchue, la papauté avait déjà donné aux Avignonnais sous
les règnes précédents de magnifiques spectacles, tant regrettés
des Romains. Tantôt c’était le roi de Naples venant rendre hommage
à Clément V, ou les ambassadeurs de Venise, après trois heures d’attente,
admis à se prosterner la chaîne au col devant ce même pontife, en
expiation du crime de leur république, qui avait enlevé Férrare
au Saint-Siège. Tantôt c’était l’antipape de l’empereur Louis de
Bavière, Pierre de Corbario, venant au milieu des insultes du peuple
implorer son pardon, abjurant son erreur sur un échafaud dresse
en public et se traînant la corde au col aux pieds du pontife (1330).
Tantôt c’étaient les envoyés du grand kan des Tartares, venant rendre
hommage à Benoit XII, ou le moine grec, Barlaam, chargé par l’empereur
Andronic de tenter la réunion des deux Églises, ou Pierre IV, roi
d’Aragon, sollicitant la croisade qui aboutit à la grande victoire
do Rio-Salado (1339). A ces pompes orgueilleuses du plus haut pouvoir
de la chrétienté, Clément VI fit succéder l’éclat d’une cour fastueuse.
En vain, en 1343, deux grands hommes, Pétrarque et Rienzi, vinrent-ils
de la part de la ville éternelle plaider la cause de l’Italie et
solliciter le retour du pape auprès du tombeau de saint Pierre ;
ils ne réussirent point a le déterminer. Cet échec décida Rienzi
à accomplir dans Rome cette révolution qui eut pour lui une issue
désastreuse. Chassé de Rome après y avoir régné en dictateur, il
fut livré au pape Clément VI et envoyé à Avignon.
Les populations
provençales se pressaient sur son passage avec l’enthousiasme d’une
secrète sympathie ; mais le pape, dès son arrivée, le fit enfermer
dans une des tours du palais, le pied attaché à une chaîne dont
le premier anneau était fixé à la voûte de la prison. Que d’émotions
pour les Avignonnais ! Après avoir couru au-devant de Rienzi, ils
entendent de leurs oreilles, le jeudi saint de l’an 1348, tonner
dans leur cathédrale l’excommunication terrible de l’empereur Louis
de Bavière, et, à la fin de la même année, ils sont éblouis de fêtes
splendides données à Charles IV, l’empereur du pape, qui vint acheter
la couronne par d’humiliantes conditions. Dans un des bals où brillèrent
alors toutes les beautés d’Avignon, l’empereur Charles, fendant
la foule, marcha droit à l’une d’elles, et déposa un baiser sur
ses yeux et sur son front. C’était Laure de Sade, déjà fameuse dans
l'Europe par les sonnets de Pétrarque, la belle Laure, qui touchait
à sa fin. Deux ans n’étaient point écoulés, et la grande peste de
1348 répandait la mort dans Avignon. Le pape fit venir des médecins,
soudoya des manœuvres pour enlever les morts, et acheta, pour y
déposer les cadavres, un champ spacieux (le champ FIeury)hors de
la ville. Néanmoins, en trois jours, le fléau enleva 1 400 personnes,
et si l’on en croyait quelques historiens, le nombre total des victimes
aurait monté à 100,000. Hélas! Laure en était ! Elle mourait, chaste
épouse et mère de onze enfants. Pétrarque n’en fut pas moins inconsolable.
Elle fut ensevelie dans l’église des Cordeliers, qui bientôt oublièrent
leur précieux dépôt.
Deux siècles après (1533), un savant Lyonnais,
Maurice de Sève, découvrit le tombeau de Laure ; on l’ouvrit, on
y trouva une boîte de plomb, dans la boite, une médaille représentant
une femme qui de ses deux mains se découvre le sein, et un parchemin
où se lisait un sonnet de Pétrarque. La même année, François Ier
se rendant à Marseille visita, accompagné de Marot, ce mausolée
désormais célèbre. Après avoir entendu le sonnet de Pétrarque :
« On ne reprochera pas, dit-il, à la muse d’un roi de France
d’être restée muette en ce jour» et il écrivit sur-le-champ
ces deux quatrains sur un papier, qui fut déposé dans la boîte de
plomb :
En petit lieu comprins vous pouvez voir
Ce qui
comprend beaucoup par renommée :
Plume, labeur, la langue et
le savoir
Furent vaincus par l’amant de l’aimée.
0 gentille
Ame! étant tant estimée,
Qui te pourra louer qu’en se taisant
?
Car la parole est toujours réprimée
Quand le sujet surmonte
le disant.
En 1730, un Anglais, ayant pour complices son
or et un sacristain, vola la boîte, les vers de Pétrarque et ceux
du roi. Un autre Anglais, comme pour expier le délit de son compatriote,
retrouva le lieu déjà oublié de nouveau où avaient reposé les restes
de Laure, et il y fit élever à ses frais un modeste monument.
Le fait le plus important du pontificat de Clément VI pour Avignon
fut l’arrivée de Jeanne, reine de Naples, qui venait d’égorger son
époux. Elle entra en souveraine dans la ville, qu’elle traversa
à pied sous un dais de drap d'or, suivie de huit cardinaux et escortée
des troupes pontificales. Reçue en consistoire public, elle obtint
à peu près son absolution, et épousa Louis de Tarente, se disposant
à rentrer avec lui par la force dans ses États d’Italie. L'argent
lui manquait : elle proposa à Clément VI de lui vendre la ville
et l’État d’Avignon, et le marché fut conclu, le 6 juin 1348, au
prix de 80 000 florins d'or. Un chapelain du pape se rendit à Gorlitz
et obtint la renonciation formelle de l’empereur Charles IV à tout
droit de fief, hommage, souveraineté, domaine direct, propriété
sur la ville d’Avignon. Cette précieuse acquisition mettait le pape
chez lui : ce fut un puissant motif pour donner suite à l’établissement
commencé par ses prédécesseurs. La construction du palais fut reprise
et continuée ; pour décorer la salle du consistoire, Clément fit
venir d’habiles peintres d’Italie, imitant l’exemple des papes précédents.
Giotto, sous Clément V, Giottino, Simon de Sienne, avaient été successivement
appelés dans la seconde Rome et l'avaient enrichie de leurs chefs-d’œuvre.
Ce ne fut pas tout : Clément VI voulut que sa ville d’Avignon, démantelée
depuis plus d’un siècle, fût mise à l’abri des attaques, et il commença,
en 1350, ces magnifiques murailles où se voient ses armes, et qui
étonnent par leur belle construction en pierre de taille et en briques,
avec des tours carrées de distance en distance. Hérédia mérita la
reconnaissance des Avignonnais par le soin qu’il mit à diriger ce
travail. Mais c’est bien eux qui en ont fait les frais, témoin les
bulles que le pape Innocent VI leur adressa pour les exhorter à
avancer l’ouvrage, les impositions qu'il fit mettre sur le sel et
sur le vin, la diminution qu’il opéra sur les mesures et les acquits
donnés par les maçons aux consuls.
On vérifia bientôt l’utilité de celle précaution.
L'archiprête Arnaud de Cervolles et ses compagnies blanches, après
avoir pillé la ville du Pont-Saint- Esprit, se présentèrent devant
Avignon, où régnait l'effroi (136j). Jugeant la ville incapable
de résister, Innocent VI (élu en 1352) fit prier ce redoutable bandit
de venir le trouver. Cervolles s’y rendit bien accompagné, «
et fut receu, dit Froissart, comme s’il eust été le fils du roi
de France. » Il mangea avec le pape, et reçut, avec l’absolution,
40,000 écus, moyennant quoi il quitta les terres de l’Église. Le
peuple s’émut, accusant les cardinaux de s’entendre avec les écorcheurs.
Innocent eut beaucoup de peine à le contenir. Six ans après (1366),
une visite du même genre vint alarmer les Avignonnais et le pape
Urbain V (élu en 1362): c’étaient les grandes compagnies et Du Guesclin,
qui demandaient une aumône do 200,000 livres. La somme fut levée
sur les bourgeois. « Je n'en veux point, s’écria Du Guesclin, c’est
le pur sang du peuple ; que Sa Sainteté donne du sien. A celle condition,
il se contenta de 100,000 livres, toujours avec l’absolution, et
partit pour l’Espagne. Entre Cervolles et Du Guesclin, en 1361,
une nouvelle peste avait emportée 17,000 personnes à Avignon. C’est
alors qu’Innocent construisit, pour s’y retirer, la chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon, qu’il surnomma la Vallée de Bénédiction,
et où il appela les religieux de Saint-Bruno.
Un grand changement
se fit sous Urbain V. Le pape quitta Avignon et revint à Rome (1367).
Ce ne fut point sans l’opposition des cardinaux. Ils s’étaient fait
à Avignon de si douces habitudes ; ils y avaient de si beaux palais
! « Mauvais pape ! disaient-ils, père impie ! où mènes-tu tes enfants
?» Et ils lui reprochaient de ne point imiter le Christ, qui avait
toujours résidé dans sa patrie. En revanche, Pétrarque lui écrivit
une longue, belle et flatteuse épître. Par une singulière inconséquence,
ce môme Urbain V revint à Avignon au bout de trois ans, et rien
ne put l’en détourner, ni les instances de l’infant Pierre d’Aragon,
ce royal illuminé, ce prince qui s'était fait franciscain, ni les
prières de sainte Brigitte, accourue du fond de la Suède et à qui
la sainte Vierge avait révélé que, si le pape revenait à Avignon,
il mourrait en y mettant le pied.
Le but d’Urbain V était d’aller
négocier lui-même la paix entre la France et l’Angleterre : il n’en
eut pas le temps. Ce fut son successeur, Grégoire XI, qui reporta
pour toujours le Saint-Siège à Rome et mit fin à ce que l’on a appelé
: la seconde captivité de Balylone.

Après le départ des papes, l’histoire d’Avignon
est de peu d’intérêt jusqu’à la Révolution française. En 1790, à
l’occasion d’une disette, la population d’Avignon se souleva et
pilla les greniers des Dominicains. Bientôt, s’engagea la lutte
d’Avignon et de Carpentras, puis vinrent les cruautés du terrible
Jourdan Coupe-tête, qui, pour venger le meurtre du greffier Lécuyer
dans l’église des Cordeliers, ordonna le massacre de la Glacière
: soixante et un prisonniers, assommés à coups de barres de fer,
furent précipités du haut des tours. Bonaparte a raconté dans le
Souper de Beaucaire comment, trois ans après en 1793, les Marseillais
qui occupaient Avignon s’étant laissé entraîner dans la réaction
et ayant repoussé des murs l’armée de Carteaux, un jeune lieutenant
d’artillerie qui commandait une colonne de cette armée les obligea,
par deux coups de canon habilement dirigés, à rentrer dans le parti
de la Convention. Ce lieutenant était Bonaparte lui-même, qui préludait
ainsi à son beau fait d’armes de Toulon.
Le 2 août 1815, le maréchal
Brune, qui traversait Avignon, y fut arrêté par les royalistes ;
en vain le préfet et le maire voulurent-ils le délivrer ; l’hôtel
du Palais-Royal, où il avait été conduit, fut envahi par la foule
furieuse, et le maréchal fut tué d’un coup de carabine par Trestaillon.
Alors on mutila son cadavre et on le traîna par les rues jusqu’au
Rhône, où il fut précipité ; sur la quatrième arche du pont, on
écrivit en lettres rouges : Tombeau du maréchal Brune. Avignon a
beau paraître calme aux yeux du voyageur, les passions méridionales
couvent toujours au fond de ces cœurs à moitié italiens.
Avignon
a été dotée, sous le premier Empire, d’une succursale de l’hôtel
des Invalides, qui fut supprimée sous le second. Son beau musée
Calvet, formé par les soins du savant médecin de ce nom, fut inauguré
en 1826 par Carie et Horace Vernet. Sa population, abaissée à 17,000
âmes pendant la Révolution, s’est relevée jusqu’à 38,000. Quoique
la ville, par la disproportion de ses monuments et de son importance
actuelle, semble peu vivante, ses habitants sont actifs et industrieux.
Jadis elle était un des principaux centres du commerce des soies
en Europe. Ses habiles artisans avaient porté à leur perfection
les tissus connus sous le nom de florances.
Si les sévères prohibitions du gouvernement français lui ont enlevé ses belles industries du velours et des toiles peintes, si ses vignobles et ses oliviers ont dépéri, une autre culture est venue la dédommager : nous parlons de la garance, dont la culture en grand est due en France par Persan Jean Althen. Le père d’Althen, ambassadeur de Thamas-Kouli-Kan, avait été entraîné dans la chute de son maître ; Jean Althen se réfugia auprès du consul de France à Smyrne, et, au péril de sa tête (car il était défendu sous peine de mort d’exporter la graine de la garance), il se rendit à Marseille, pourvu de cette graine précieuse. Louis XV lui accorda une audience et favorisa son projet ; le Comtat ayant paru à Althen le lieu le plus favorable à son entreprise, il s’y élablit. La culture de la garance réussit, et naguère elle procurait au département de Vaucluse un revenu de plus de 15 millions. Mais Althen s’y était ruiné, et il mourut dans la misère, ainsi que sa fille. Pour toute récompense, une inscription fut d’abord gravée sur une plaque de marbre dans l’ancien local du musée : A Jean Althen, Persan, introducteur et premier cultivateur de la garance dans le territoire d'Avignon, sous les auspices de M. le marquis de Caumont, en 1768, le conseil général du département de Vaucluse, 1821. Depuis on lui a élevé une statue sur l’Esplanade des Doms, et son nom a été donné à une commune du département.
Avignon, dominée par sa cathédrale et l’ancien
château des Papes, s’élève sur la rive gauche du Rhône, qui en cet
endroit décrit du nord-est au sud-ouest un arc de cercle. De loin,
avec sa ceinture de murailles et les clochers de ses églises, elle
présente un bel aspect, qui est démenti lorsque l’on pénètre dans
ses rues pour la plupart encore étroites et tortueuses.
Voici
comment un enfant du pays dépeint Avignon :
« Quant au vieux, au vrai Avignon, le seul moyen de le voir, c’est de s’y perdre. Rien d’ailleurs de plus aisé dans cet écheveau embrouillé des rues : rue Étroite, rue de l’Ombre, du Migrénier, de l’Olivier, du Diable, du Chat, de la Monnaie, de l’Anguille, des Amoureux, des Anes, des Clefs, des Ciseaux d’or, rue Philonarde, rue du Vieux-Sentier, rue de la Pignote, rue de la Fonderie, rue de la Fusterie, rue de la Banasterie, du Grand-Paradis, du Petit-Muguet, de l’Oriflan. La rue Saint-Étienne, où sont les restes d’un cirque romain que le moyen âge appelait, Dieu sait pourquoi : le cirque des Chèvres. La rue où saint Agricol, pour l’étonnement des Avignonnais, faisait venir à son plaisir, puis congédiait, les cigognes. La rue Rouge, où le sang des Sarrasins ruissela. La rue des Fourbisseurs, où le duc de Guise se fournissait d'armures, montrant encore sa miraculeuse Vierge peinte qui saigna sous le soufflet d’un joueur. La rue de la Tarasque et son bas-relief naïf qui représente un monstre rugueux et cornu en train de dévorer un chevalier dont on ne voit plus que les jambes. La rue de la Bonneterie, célèbre pour sa légende réaliste de l’égout de M. Cambaud, véritable enfer des cuisinières, où une servante peu charitable, qui jetait le pain des pauvres aux chiens, hurle changée en chien pendant les nuits d’orage. La rue des Teinturiers, un morceau de L’Isle-sur-Sorgues transporté dans Avignon, avec son canal et sa procession de grandes roues en marche sous les platanes. La place Saint- Pierre et son église, dont Saboly, l’exquis faiseur de noëls, fut le maître de chapelle. La place Pie, où des fanatiques démolirent la maison du docteur Perrinet Parpaille, primicier de l’université d’Avignon, décapité comme huguenot, et puis pendu (supplice étrange et qui dut embarrasser l’exécuteur !) en 1563. Et près de la rue, maintenant, hélas ! débaptisée, du Cimetière du Bourreau, la place Saint-Didier, au milieu de laquelle se dressait une croix surmontée d’un coq en pierre qui devait chanter à la fin du monde. Partout des ruines de couvent, partout des chapelles : pénitents bleus, gris, violets, blancs et rouges ; partout des restes d’hôtels seigneuriaux, de palais cardinalices. Mais où sont, hélas ! les hôtelleries de l’Avignon des papes et des vice-légats, que chantèrent La Bélaudière et d’Assoucy, le Coq, les Trois-Testons, les Quatre-Deniers, le Chapeau-d’or, le Sauvage, la Lamproie ; où sont les mails, les lices, le Jeu de paume, et cette rue de la Madeleine couchée avec ses bains publics et ses lieux de plaisir si célèbres vers 1500 ? » (Paul Annie.) Les principaux édifices d’Avignon sont : l’église métropolitaine de Notre-Dame-des-Doms, qui date du commencement du XIème siècle et qui se recommande par ses beaux tableaux et ses monuments sculptés ; le palais des papes, lourde construction du moyen âge, qui ressemble plutôt à une forteresse qu’à la demeure du premier pasteur de la chrétienté ; les églises Saint-Agricol, qui renferme les reliques du patron de la ville, Saint-Pierre, Saint-Martial, Saint-Didier, les chapelles des pénitents noirs (de la Miséricorde) et des pénitents gris, qui possèdent de beaux tableaux ; l'hôtel de ville, le conservatoire de musique (ancien hôtel des monnaies), le lyéce, le théâtre, le musée Calvet ; la bibliothèque, qui n’a pas moins de 80,000 volumes ; l’hôtel-Dieu, la prison départementale, etc., etc.
Sur la place de l’Horloge s’élève la statue du brave Grillon ; les belles avenues qui entourent les remparts servent de promenades, et, selon leur exposition, elles prennent le nom de promenades d’Été et de promenades d’Hiver. Le Jardin des plantes, près de l’église Saint-Martial, et le jardin anglais, qui occupe la plate-forme du rocher des Doms, sont aussi très fréquentés ; au milieu de ce dernier s’élève, nous l’avons dit, la statue en bronze du Persan Allhen.
Avignon communique avec Villeneuve-lès-Àvignon, située sur la rive droite du Rhône et dans le département du Gard, à l’aide d'un pont suspendu, qui traverse l’île de la Barthelasse.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025