La Roche-sur-Yon - Préfecture de la Vendée - 85
Retour
au Département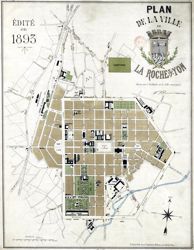

Sur cet emplacement s'élevait autrefois un
immense château autour duquel s'était groupé un bourg peu considérable
et d'assez triste aspect. Il avait pour base une roche coupée à
pic vers la rivière d'Yon et dont le sommet forme un grand plateau
que deux ravins isolent latéralement. Celte situation explique le
nom de La Roche-sur-Yon, devenu commun au château et au bourg qui
l'avoisinait. On manque de documents sur la date à laquelle cet
édifice a pu être construit ; on le suppose antérieur aux croisades
; quelques auteurs en font remonter la fondation aux premiers siècles
de la monarchie. Le premier épisode qui s'y rattache avec certitude
n'est que du XVème siècle. La Roche sur-Yon appartenait
à cette époque à Louis II, comte d'Anjou. Les Anglais vinrent, en
1369, assiéger cette place, qui, quoique bien approvisionnée et
bien fortifiée, fut livrée au prince Noir pour six mille livres
par Jean Blondeau, son gouverneur. Le comte d'Anjou fit arrêter
le traître et le fit jeter à l'eau enfermé dans un sac. Quatre ans
après, en 1373, le château fut repris par Olivier de Clisson. La
Roche-sur-Yon devint ensuite une des nombreuses possessions de
la maison de La Trémouille, puis passa à la maison de Bourbon et
fut érigée en principauté. Pendant les guerres de religion, le château
soutint plusieurs sièges, passa successivement au pouvoir des catholiques
et des huguenots et subit de nombreuses dégradations ; il fut enfin
totalement démantelé sous le règne de Charles IX ou sous celui de
Louis XIII. L'oubli enveloppait les ruines du vieux manoir et le
bourg végétait dans la plus complète obscurité, lorsque l'insurrection
vendéenne éclata.
En 1793, un détachement de soldats républicains,
appréciant les avantages stratégiques de cette position, prit son
cantonnement dans les débris de l'ancienne forteresse et ramena
sur cet emplacement l'attention de l'autorité. Dix ans après, sous
le Consulat, à une époque où la Vendée, pacifiée par Hoche, semblait
devoir protester par de nouvelles manifestations contre les exigences
toujours croissantes de la conscription, un général, inspecteur
de gendarmerie, fut envoyé sur les lieux pour apaiser les mécontents
et étudier les moyens de réorganiser le pays. C'était le général
Gouvion, homme d'un grand sens, qui s'entoura de toutes les lumières
que les gens de bonne foi purent lui apporter. Le siège de l'administration
était alors à Fontenay, à une des extrémités du département, dans
un pays de plaine, loin du théâtre de la dernière guerre, loin des
populations qu’il s'agissait principalement de surveiller et de
concilier. Il y avait un autre inconvénient à placer la préfecture
dans une des importantes localités du département. Les villes avaient
embrassé avec ardeur la cause républicaine, leurs gardes nationales
avaient combattu l'insurrection ; ces souvenirs entretenaient des
haines encore vivaces ; l'influence d'une capitale naguère ennemie
pouvait perpétuer la rancune des vaincus. L'idée de créer une ville
nouvelle pour en faire le chef-lieu du département était donc heureuse
et logique. Elle devait être comprise par Bonaparte ; le 5 prairial
an XII (25 mai 180), huit jours après le sénatus-consulte qui le
déclarait empereur, il signait à Saint-Cloud le décret qui transférait
le chef-lieu du département de la Vendée à La Roche-sur-Yon, qui
prit alors le nom de Napoléon-Vendée.
Malgré quelques objections,
le décret dut être exécuté, et, le 19 août 1804, la préfecture était
installée. Le préfet se logea dans le château de la Brossardière,
à une demi-lieue de La Roche-surYon, où quelques chambres avaient
échappé aux incendies de la guerre civile ; il eut un cabinet dans
une des maisons du bourg. On avait construit à la hâte quelques
baraques en torchis pour ses bureaux ; les employés des diverses
administrations se casèrent comme ils purent dans des maisons à
demi ruinées. Les ingénieurs s'étaient dépêchés de rendre praticables
aux voitures les chemins vicinaux qui conduisaient à ce village
isolé loin des grandes routes. Bientôt cependant l'argent manqua
pour continuer l'œuvre si hardiment commencée ; au mois d'août
1808, Napoléon, revenant de Bayonne et traversant le département
de la Vendée, s'arrêta dans la nouvelle ville. Il se promena dans
des landes incultes décorées du nom de rues, et dont de simples
fossés figuraient l'alignement ; il n'y avait d'à peu près terminé
que la que la préfecture, une auberge et la caserne, dont la construction
déplut à l'empereur, qui, pour prouver, dit-on, la mauvaise construction
d'un mur, le traversa de son épée. Il reçut les autorités et fit
surtout bon accueil aux fonctionnaires locaux. Ce voyage ne fut
pas sans résultats : on consacra à la nouvelle ville trois millions,
qui n'étaient pas complétement dépensés encore en 1814. A cette
époque, un très petit nombre de maisons particulières étaient venues
s'ajouter aux édifices publics ; la population ne s'élevait qu'à
environ 1,500 habitants. Le nouveau gouvernement eut le bon esprit
d'accepter et de continuer ce qui était commencé ; on changea seulement
le nom de la ville, qui s'appela Bourbon-Vendée ; un collège y
fut établi, les tribunaux y avaient été transférés depuis 1810,
et la population continua à s'accroître de tout ce qu'a-mènent à
leur suite les établissements publics ; mais c'est surtout depuis
1830, depuis l'achèvement du réseau des voies de communication,
et de nos jours depuis l'établissement des chemins de fer qui la
mettent en communication avec Paris, Nantes, Bordeaux, Tours et
le reste de la France, que les développements de la ville ont été
rapides et consi-dérables. Seulement sa destinée est de changer
de nom avec la forme du gouvernement ; c'est ainsi qu'après avoir
repris, sous le second Empire, le nom de Napoléon-Vendée, elle a
vu la troisième République lui restituer son ancien nom de La Roche-sur-Yon.
Elle est agréablement située sur une colline, dont la petite rivière
d'Yon baigne le pied. Au centre et sur le haut du plateau se trouve
la place Napoléon, carré long, spacieux, bordé de plusieurs rangées
d'arbres, entouré de monuments publics et de beaux hôtels, où aboutissent
la plupart des rues de la ville, ainsi que trois grandes routes
qui se croisent au centre. Les rues de la ville sont larges et bien
alignées, propres et formées de jolies maisons ; plusieurs d'entre
elles sont encore inachevées ; elles abondent en cafés et en auberges
; mais les établissements industriels y sont rares.
L'église,
de ce style néo-grec si en faveur sous le premier Empire, est un
monument vaste et majestueux ; sur la même place est la mairie,
décorée d'un élégant péristyle, derrière, sur une promenade plantée
de tilleuls, on trouve une belle halle, le théâtre, le musée et
la bibliothèque.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025