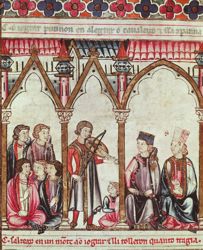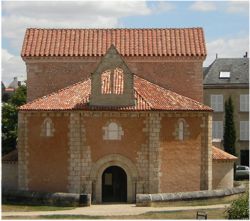Poitiers - préfecture de la Vienne
Retour
au Département

Poitiers est une des plus anciennes cités de la vieille Gaule ; les Romains, à leur arrivée, la trouvèrent florissante, sous le nom de Lemo ou Lemo¬um, qu'elle échangea, pendant le cours de leur domination, pour celui de Pictavum, d'où est venu Poitiers, nom emprunté à la nation des Pictones, dont elle était la capitale. Après s'être associés aux premiers efforts de résistance tentés contre les Romains, les Pictones, plus tard Pictavi, furent des premiers à faire alliance avec les vainqueurs ; ils soutinrent même un siège contre un certain Dumnacus, chef ou roi des Andecavi, et furent délivrés par un lieutenant de César, nommé Fabius, qui vint à leur secours en toute hâte. Les Romains payèrent cette fidélité de toutes les richesses dont leur magnificence savait embellir les villes amies. Portiques, aqueducs, théâtres, temples, tout fut prodigué pour approprier la cité gauloise à la civilisation nouvelle qu'elle acceptait. Les nombreux débris qui subsistent encore sur ce sol tant de fois bouleversée témoignent encore de l'ampleur et de l'étendue que les Romains donnèrent à leurs tra¬vaux. Ils y fondèrent aussi des écoles de grammaire et de rhétorique qui devinrent célèbres ; et il est permis de supposer que les traditions littéraires de celle période ne furent pas sans influence sur le gout que la population a toujours conservé depuis pour les arts libéraux. Le christianisme eut à Poitiers, pour organisateur, le grand évêque saint Hilaire, une des gloires les plus pures de l’Eglise.

Il occupait ce siège vers le milieu du
IVème siècle, alors que la doctrine d'Arius menaçait
d'envahir tout l'Occident chrétien. Sa résistance au schisme
lui attira de puissantes inimitiés ; dépossédé, banni, il demanda
et obtint d'aller combattre par la parole les ariens d'Italie
et d'Orient. Après de longues et rudes épreuves, il revint en
Poitou, où il mourut en 368. Les ouvrages qu'il a laissés sont
placés au premier rang parmi ceux des docteurs de l'Église,
et il n'est guère de livres de ce genre plus forts en dialectique
et en érudition. Saint Hilaire est demeuré le patron de la ville.
Lorsque les Wisigoths succédèrent aux Romains dans la possession
du pays, Poitiers devint une des résidences royales ; Alaric,
le dernier roi de cette race, vint y habiter pour surveiller
de plus près les projets des Francs sur l'Aquitaine. La ville
avait pris dès lors des développements qui rendaient insuffisante
son enceinte primitive et laissaient exposés aux dangers d'une
attaque de vastes el riches faubourgs ; les Wisigoths construisirent
de nouvelles murailles, et, soit précipitation, soit barbarie,
ils mêlèrent aux matériaux employés des fragments de bas-reliefs,
des pierres richement sculptées, débris de monuments somptueux,
confondus avec les fortifications wisigothes, dont on retrouve
encore les assises en fouillant le sol.
Ainsi donc, au Vème
siècle, après la victoire de Clovis, Poitiers, ville du royaume
franc, subissait sa troisième transformation. De la ville romaine,
après les invasions des barbares, il restait moins encore qu'il
n'était resté de la ville gauloise après les embellissements
des Romains, et encore ce qui était demeuré debout n'était-il
qu'un amas confus de ruines.

C'est au séjour d'une pieuse reine, d'une
sainte, aux efforts qu'elle fit de son vivant, aux souvenirs
vénérés qu'elle laissa après sa mort, que Poitiers dut une influence
réelle et une espèce de résurrection. Radegonde, fille de Berther,
roi des Thuringiens, délaissée, après six ans de mariage, par
le roi Clotaire, son époux, obtint de lui l'autorisation de
se vouer au Seigneur et, s'étant retirée près de Poitiers, y
bâtit un monastère dans lequel elle se renferma avec d'autres
femmes pieuses, en prenant pour règle de conduite les statuts
arrêtés par Césaire, évêque d'Arles. Cet établissement, commencé
en 550, dans de petites proportions, agrandi successivement
et terminé seulement en 559, reçut, en 568, le nom de Sainte-Croix,
quand Radegonde y eut déposé une parcelle de la croix du Christ
que l'empereur Justin Il lui avait envoyée de Constantinople.
C'est à cette occasion que fut composée, par le poète Fortunat,
la belle hymne Vecilla regis, conservée jusqu'à ce jour parmi
nos chants d'église.
Au calme et à la paix qui, sous Radegonde,
avaient régné dans le couvent de Sainte-Croix succédèrent, à
sa mort, des discordes, des scandales, des violences qui font
voir au milieu de quel chaos se constituait la société nouvelle.
Deux princesses de sang royal, Clodielde et Basine, religieuses
dans le monastère, refusèrent de reconnaitre l'autorité de l’abbesse
qui avait été nommée ; elles intéressèrent les parents qu'elles
avaient sur les marches du trône et le roi Childebert lui-même
dans leurs querelles ; de son côté, Leubovère, la supérieure
du couvent, eut pour défenseurs de ses droits l'évêque Mérovée
et tout le parti laïque. Après de scandaleux débats, d'obscènes
accusations et de véritables combats sous les murs et jusque
dans l'intérieur de l'abbaye, on en vint à une transaction qui,
comme toujours, sacrifia les faibles et donna satisfaction aux
deux puissances en qui la lutte s'était personnifiée ; Basine
obtint l'absolution et rentra à Sainte-Croix ; Clodielde, sa
cousine, établit sa résidence à la campagne dans un domaine
que lui donna le roi Caribert.

Pendant la période mérovingienne, si
agitée, Poitiers fit successivement partie des divers royaumes
formés avec l'héritage de Clovis. Chramne, l'Absalon de l'époque,
y domina pendant quelques années, marié qu'il était avec Catte,
fille de Willechaire, comte de la province. Ennius Mummole s'empara
de cette ville, pour Sigebert et Gontran, en 568. Lors de la
révolte des Poitevins, après la mort de Chilpéric, Poitiers,
obligé de se soumettre à Gontran, ne se racheta du pillage qu'en
livrant au vainqueur un trésor, dans lequel l'évêque Mérovée
fit entrer une partie de l'argenterie des églises. Plus tard,
et quand son neveu Childebert fut un peu avancé en âge, Gontran
lui remit le gouvernement de ses États, dont Poitiers faisait
partie. Il résulte d'un passage de Grégoire de Tours qu'à cette
époque, vers la fin du VIème siècle, les constructions
de Poitiers étaient presque toutes de bois. La ville était réservée
à de cruelles épreuves pendant les deux siècles suivants ; ce
fut d'abord l'invasion d'Abd-el-Rhaman, qu'arrêtèrent les murailles
wisigothes, mais qui ravagea la basilique de Saint¬ Hilaire
et le monastère de Sainte-Croix ; puis vinrent les luttes sanglantes
entre les maires du palais et les ducs mérovingiens d'Aquitaine.
Waifre, en 765, fit raser les fortifications que rétablit Pépin
Je Bref dès qu'il se fut emparé de la place. L'ordre et la sécurité
ne reparurent que sous le grand règne de Charlemagne.
On
sait qu'un nouveau royaume d'Aquitaine fut fondé par les premiers
Carlovingiens ; Pépin I, fils de Louis le Débonnaire, fixa sa
résidence à Poitiers ; il y mourut le 13 décembre 838, après
avoir fondé le monastère de Saint-Cyprien, et peut être le palais
de la Cité, aujourd'hui palais de justice. Son héritage fut
disputé à son fils par Charles Je Chauve, que Louis le Débonnaire
avait nommé roi d'Aquitaine. Après une guerre sans résultat,
un accord intervint en 847 entre les deux prétendants ; l'Aquitaine
fut divisée en deux duchés : Charles eut le Poitou, l'Aunis,
la Saintonge et l'Angoumois, avec Poitiers pour chef-lieu ;
Pépin II resta possesseur des contrées méridionales, dont la
capitale fut Toulouse. Mentionnons, comme se rattachant à cette
époque, la réclusion dans le monastère Sainte-Croix de l'impératrice
Judith, seconde femme de Louis le Débonnaire, accusée d'adultère,
et un séjour à Poitiers de ce prince, qui y passa les fêtes
de Noël de 839. Deux faits d'une grande importance signalent
encore le IXème siècle dans les annales poitevines
: l'arrivée des Normands, qui pillèrent, saccagèrent et brûlèrent
Poitiers à diverses reprises, et l'acheminement vers le pouvoir
féodal.

L'avènement au trône de Charles le Chauve
avait nécessité la création de comtes chargés de gouverner en
son nom. L'éloignement du pouvoir central accroissait l'importance
de ses représentants. Le désordre était partout ; les rivalités
des seigneurs, les prétentions du clergé, les menaces continuelles
de ces pirates du Nord qui, remontant les fleuves, ravageaient
villes et campagnes sur leur passage, tout réclamait la concentration,
dans des mains fermes, d'une autorité capable de remédier à
tant de maux; le pouvoir s'offrait donc à qui saurait le prendre
et en user. C'est au milieu de ces circonstances qu'une nuit
d'hiver de l'année 902, Ebles Mangez, fils naturel de Raynulfe
II, s'introduisit dans la ville de Poitiers et s'y fit proclamer
comte, pendant qu'Adhémar, qui remplissait, pour le roi, les
mêmes fonctions, prenait paisiblement le parti de la retraite.
L'usurpateur était un homme habile ; il sut garder ce qu'il
avait conquis, et sa descendance resta en possession du Poitou
jusqu'au mariage d'Éléonore, dernière héritière de cette famille.
Plusieurs conciles, plusieurs sièges soutenus contre les comtes
de Paris et les comtes d'Anjou, la construction d'églises, la
fondation d'établissements religieux sont les principaux événements
qui marquèrent le règne des comtes héréditaires.
Nous avons raconté ailleurs le double
hymen d'Éléonore. Son second époux, Henri Plantagenet, devenu
roi d'Angleterre, enferma Poitiers dans une nouvelle enceinte,
où furent compris les bourgs de Sainte-Hilaire et de Sainte-Radegonde,
avec d'autres annexes. Une des gloires de Poitiers, c'est d'être
restée ville française, lorsque l'Anglais triomphait et dominait
partout autour d'elle. Les traits de dévouement et d'héroïsme
fournis par sa population abondent pendant cette période néfaste
des XIVème et du XVème siècles. En 1202,
pendant les guerres de Philippe-Auguste et de Jean sans Terre,
malgré la complicité du maire vendu aux Anglais, les clefs de
la ville sont miraculeusement soustraites à celui qui voulait
les livrer à l'ennemi ; les deux patrons de Poitiers, saint
Hilaire et sainte Radegonde, apparaissent au-dessus d'une des
portes, et, le courage des habitants aidant, l'étranger est
obligé de lever le siège. Clément V et Philippe le Bel vinrent
concerter à Poitiers la ruine des templiers ; le roi logeait
chez les jacobins, et comme ce couvent était vis-à-vis de celui
des cordeliers, habité par le pape, on établit sur la rue, à
la hauteur du premier étage, un corridor couvert, qui donnait
au monarque et au souverain pontife la plus grande facilité
pour se réunir, à toute heure, sans que du dehors on pût s'en
apercevoir. Vers la même époque, Gui de Lusignan, le dernier
membre de la branche aînée de cette illustre famille, vint mourir
à Poitiers, dans le couvent des frères prêcheurs qu'il y avait
fondé.
En 1346, après le désastre de Crécy, le comte de Derby
pénétra dans Poitiers ; mais la défense avait été si opiniâtre,
les dispositions des habitants paraissaient si peu sûres aux
vainqueurs, qu'au bout de huit jours ils abandonnèrent leur
conquête, non sans l'avoir préalablement pillée. Toutefois,
les sympathies françaises étaient si peu découragées que, dix
ans plus tard, à la nouvelle de la funeste bataille de Maupertuis,
les habitants fermèrent leurs portes ; les Anglais n'essayèrent
même pas de la faire traverser par leur royal prisonnier, et
la population, moines en tête, alla recueillir sur le champ
de bataille les cadavres des chevaliers qu'on apportait « par
charretées » et qu'on mit dans une même fosse creusée dans le
couvent des cordeliers. Ce ne fut pas alors un assaut, mais
un traité, celui de Brétigny, qui ouvrit au prince Noir les
portes de Poitiers ; Du Guesclin l'en chassa quelques années
après, et, dans cette œuvre de délivrance, il fut si vaillamment
aidé par les habitants, que Charles pour récompenser leur dévouement,
accorda la noblesse aux maire et échevins et de larges privilèges
à la ville. Le duc de Berry, frère du roi, reçut alors le Poitou,
en augmentation d'apanage. Le séjour de ce prince dans la capitale
de la province fut marqué par de nombreux embellissements ;
on lui doit une nouvelle enceinte fortifiée, la construction
du charmant château de Clain et-Boivre, une belle façade décorée
de statues ajoutée au palais de la Cité, l'importation d'une
horloge placée alors dans une tour, sur la place de Notre-Dame,
la grande ; c'était la troisième qui fût établie dans le royaume.
Malheureusement, ces travaux ne pouvaient
s'exécuter sans de grosses sommes prélevées sur un peuple épuisé
déjà par la guerre ; les contemporains purent donc, avec quelque
raison, reprocher au duc son goût ruineux pour les ouvrages
d'art, les livres et les pierreries ; mais il appartient à la
postérité de signaler son règne comme une époque de renaissance
dont Poitiers surtout fut appelé à profiter.
Qui pourrait
affirmer que cet éclat littéraire et artistique ait été sans
influence sur le rôle politique que la ville devait bientôt
jouer ? L'alliance de l'Angleterre et de la Bourgogne, la complicité
de la reine Isabeau, la démence de Charles VI ayant livré Paris
à l'étranger, Poitiers devint la capitale de la France. C'est
dans ses murs fidèles que se retira le dauphin ; c'est là qu'il
fut solennellement proclamé roi, à la mort de son père ; c'est
là qu'il transporta son conseil, son université et son parlement;
c'est là, enfin, que lui fut présentée la vierge inspirée qui
devait lui conquérir son royaume. Jeanne d’Arc inspirait aux
courtisans autant de défiance que d'étonnement ; on constitua
un comité de quinze à vingt docteurs en théologie pour l'examiner.
Après eux, des membres du parlement l'interrogèrent, puis ce
fut le tour des dames de la cour et des bourgeoises ; et, pour
faire agréer ses services, l'héroïne eut autant d'obstacles
à vaincre que pour chasser les Anglais. Lorsque ses campagnes
et ses victoires eurent éloigné Charles VII de Poitiers, Je
dauphin, Louis XI, vint habiter Je château de Clain et-Boivre
avec Marguerite d'Écosse, sa jeune épouse ; le poétique épisode
du baiser donné par la reine au page Alain Chartier endormi
eut pour théâtre une des salles de ce palais. Après la réunion
du Poitou et de sa capitale à la couronne, en août 1436, nous
n'avons à relater pendant plus d'un siècle que la solennité
des réceptions faites aux différents princes qui visitèrent
Poitiers. Ce fut Charles VIII, en février 1486, appelé par la
révolte du duc d'Orléans. François Ier, le 5 janvier
1519 ; Charles-Quint, en 1539, et, dans l'intervalle, en 1525,
le triste passage de la duchesse d'Angoulême conduisant en Espagne
les princes qui devaient y demeurer en otages de leur père prisonnier
à Pavie. La révolte de la gabelle, peu sérieuse à Poitiers,
nous sépare seule des guerres de religion. Nous avons dit déjà
que ce furent les prédications de Calvin lui-même qui semèrent
à Poitiers les premiers germes de la Réforme. En 1562, après
le massacre de Vassy, les protestants s'emparèrent de la ville,
et, par représailles des mauvais traitements qu'avaient exercés
sur eux les catholiques, ils pillèrent les églises, brûlèrent
les statues des saints et dispersèrent les reliques. Quelque
temps après, Poitiers fut repris par le parti des catholiques,
qui y commit des excès plus infâmes encore ; le maréchal de
Saint-André fit pendre le maire et plusieurs autres particuliers
et abandonna la ville à la licence des soldats.
En 1569, l'amiral Coligny investit celte ville avec une armée
considérable ; le siège fut long, les habitants se défendirent
avec courage, les femmes mêmes y partagèrent la fatigue des
guerriers. La ville fut sauvée, grâce à un de ces travaux que
le désespoir enfante et fait exécuter ; les assiégés bouchèrent
les arcades du pont sur la Rochereuil, les eaux du Clain débordèrent
et inondèren les assiégeants et les forcèrent à la retraite.
Les ligueurs se rendirent maîtres de Poitiers et s'y maintinrent
par les menées de l'évêque, du maire et par les prédications
furieuses de quelques moines, jusqu'à l'époque où Henri IV fit
abjuration. C'est dans cette ville que fut jugé, condamné et
brûlé vif, en 1634, le malheureux Urbain Grandier, dont nous
parlerons plus longuement dans la notice de Loudun. L'histoire
contemporaine a ajouté une page sanglante à ces tristes épisodes
; c'est la condamnation du général Berton et de ses infortunés
compagnons, le 12 septembre 1822, au sujet de la conspiration
de Saumur. (Voir la notice de cette ville, dans le département
de Maine-et-Loire.)
Malgré les nombreuses améliorations dont
elle a été l'objet depuis trente ans, la ville de Poitiers est
loin encore de mériter le titre de belle ville, dans l'acception
moderne du mot. Située au confluent du Clain et de la Boivre,
dominée de tous côtés par des hauteurs, elle se compose de rues
irrégulières, sombres, qui lui donnent un aspect peu attrayant
; mais le voyageur ne doit pas se laisser arrêter à cette première
impression ; en examinant de plus près, il sera largement récompensé
de sa persévérance et de ses recherches. Poitiers a conservé,
en petit nombre, il est vrai, et sur une échelle fort restreinte,
des échantillons de l'art français à chacune des époques de
notre histoire. Ainsi, le dolmen dit la Pierre-Levée y rappelle
l'époque celtique ; les Arènes, la période romaine ; le temple
de Saint-Jean, l'un des premiers qui aient été consacrés au
christianisme en France (il date du IVèmee siècle),
la période mérovingienne ; les basiliques de Saint-Hilaire et
de Sainte-Radegonde, quoique mutilées, amoindries et maladroitement
restaurées, reportent les souvenirs au temps de Radegonde et
du grand évêque. Les églises de Montierneuf et de Notre-Dame,
avec leur architecture romano-byzantine, l'une du Xème
et l'autre du XIème siècle, offrent dans leur ornementation
des détails pleins d'intérêt; la cathédrale, enfin, dédiée à
saint Pierre et fondée en 1162, par Henri II, roi d'Angleterre,
et sa femme, Éléonore de Guyenne, est d'un aspect majestueux,
tant par la grandeur du vaisseau, la hardiesse de ses voûtes,
que par l'ensemble et la régularité de ses diverses parties
se rattachant toutes à la transition du roman au gothique. Il
faut encore citer le palais de justice, ancien palais des comtes
de Poutou. A l’angle de la rue Saint Paul et du Coq, la maison
qui fut la demeure de la célèbre Diane de Poitiers.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025