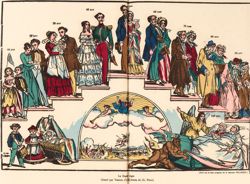Epinal - Préfecture des Vosges
Retour
au Département

Le Château d'Épinal fut un des plus anciens
de la Gaule Belgique ; que cette ville, qui s'appelait Chaumont,
fut ruinée et désolée par les Vandales vers l'an 406 ; rebâtie en
431, elle fut détruite encore vers 636; qu’étant devenue déserte,
on n'y vit dans la suite que ronces et épines, d'où cet emplacement
fut nommé Spinal, ou Espinaulx, du mot latin Spina, épine. Suivant
d'autres auteurs, ce nom viendrait du sommet pointu de la montagne
au pied de laquelle la ville est assise.
Quoi qu'il en soit,
ce n'est qu'à la fin du Xème siècle que commence l'histoire
d'Épinal.
En 980, Thierry Ier, évêque de Metz, éleva
au bord de la Moselle un Monastère et une Église où il transféra
le corps de saint Goëry, qui avait occupé l'évêché de Metz au VIème
siècle. Le successeur de Thierry, Adalbéron Il, établit dans l'Église
des Religieuses, à qui il donna la règle de saint Benoit.
Autour
de cette Église et de ce Monastère se groupèrent les habitations
d'Épinal. L'Église, qui renfermait les reliques du saint, fut consacrée
par un autre saint, Gérard, évêque de Toul, et devint bientôt un
pèlerinage si renommé, qu'elle se trouva trop petite pour le grand
concours de gens qui venaient y implorer le secours de saint Goëry
contre le « mal des ardents»; dès le XIème siècle,
il fallut en bâtir une plus grande, qui fut consacrée par le pape
Léon IX. Mais, dès cette époque aussi, les Religieuses d'Épinal
commençaient à s'écarter de la règle austère établie par Adalbéron.
Lorsque, en 1094, Poppon, évêque de Metz, vint visiter l'Abbaye,
une Religieuse, qu'on disait avoir le don de prophétie, se plaignit
à lui du relâchement qu'elle voyait parmi ses compagnes. L'avenir
justifia ses craintes ; car au XIIIème siècle, un évêque
de Toul ayant entrepris de rétablir dans le Monastère la règle primitive,
ces dames lui firent signifier que, bien qu'elles vécussent religieusement
et qu'elles célébrassent louablement l'office divin, néanmoins elles
ne faisaient pas profession de l'Ordre de Saint- Benoît, ni d'aucun
autre. Elles finirent par se séculariser entièrement, par être immédiatement
soumises au Saint-Siège.
![]()
Au XVIIIème siècle, elles avaient
deux costumes, l'un pour l'intérieur et l'autre « pour la ville
et le monde ».
Comme c'était un évêque de Metz qui avait fondé
le Monastère, ses successeurs prétendirent naturellement à la souveraineté
d'Épinal, et ils la conservèrent longtemps. L'un d'eux, Jacques
de Lorraine, fit fortifier la ville au XIIIème siècle.
Cette souveraineté ne s'exerça pas sans contestation. D'une part,
les bourgeois de la ville se soulevèrent souvent contre les prétentions
ou la tyrannie des évêques. De l'autre, les seigneurs, qui recevaient
des évêques eux-mêmes le titre d'avoués, c'est-à-dire de défenseurs
du Monastère, abusèrent de leur pouvoir contre ceux mêmes de qui
ils le tenaient. En 1139, l'évêque Étienne de Bar fut obligé de
recourir au duc de Lorraine, Mathieu Ier, pour faire
rentrer dans le devoir l'avoué d'Épinal, qui s'était retranché dans
le Château et qui refusait de reconnaître la souveraineté de l'évêque.
Quant aux bourgeois, leurs démêlés avec les évêques se renouvelèrent
fréquemment. Il est vrai que cette sujétion avait parfois des conséquences
fort désagréables. C'est ainsi que des bourgeois d'Épinal furent
saisis, en 1289, par les créanciers de Burchard, évêque de Metz,
sous prétexte qu'étant ses sujets, ils étaient responsables de ses
dettes. C'est ainsi encore qu'à la même époque le comte de Bar et
le duc de Lorraine, ne pouvant obtenir de l'évêque Laurent le payement
de 8,000 livres, s'emparèrent d'Épinal. Plus d'une fois les évêques
furent obligés de céder dans leur lutte contre les bourgeois.
En 1387, Raoul de Coucy donne sa parole d'évêque de maintenir et
garder les « bourgeois de la ville d'Épinal » dans leurs franchises
et libertés anciennes, et veut que celles qu'ils ont obtenues de
ses prédécesseurs demeurent dans leur valeur. Mais la bonne intelligence
ne dura guère entre les bourgeois et leurs suzerains. En 1429, sous
l'épiscopat de Conrad de Boppart, qui avait poussé à bout la patience
des bourgeois et qui même perdit un procès contre eux en cour de
Rome, Épinal se mit enfin sous la protection de René d'Anjou, duc
de Bar et époux de l'héritière de la Lorraine. En 1441, ils passèrent
une convention du même genre avec Louis, fils de René. Ils étaient
disposés à se donner à tout le monde, paraît-il, excepté à leur
évêque, car, en 1444, Charles VII étant venu en Lorraine, les députés
d'Épinal vinrent le trouver à Nancy pour lui offrir la souveraineté
de la ville. Charles VII accepta, fit une entrée solennelle à Épinal,
ordonna de placer les armes de France sur les Tours, et les bourgeois
prêtèrent serment de fidélité entre les mains du roi.

L'évêque
réclama et cita les bourgeois à comparaître en cour de Rome. Comme
ils ne parurent pas au jour fixé, le pape Nicolas V mit la ville
en interdit. Charles VII négociait avec le pape et l'évêque, quand
il reçut une nouvelle réclamation. L'empereur d'Allemagne, Frédéric
III, se plaignait que le roi de France eût occupé sans plus de formalité
une ville qui relevait de l'empire. On ne sait ce qu'il advint de
ce démêlé. Mais, sous Louis XI Épinal accepta, du consentement du
roi, la souveraineté du duc de Lorraine, Jean, fils de René. Le
21 juillet 1400, le fils du duc Jean se présenta à l'entrée de la
ville et jura avant d'entrer, le maintien de ses anciennes franchises
envers et contre tous, « notamment contre l'évêque de Metz ».
Depuis cette époque, les habitants d'Épinal, fidèles à leur
choix, demeurèrent toujours soumis aux ducs de Lorraine. Sous le
règne de René II, la place d'Épinal fut occupée par les troupes
de Charles-le-Téméraire, qui avait pour allier l'évêque de Metz.
Mais elle ne souffrait qu'avec peine de se voir au pouvoir des Bourguignons.
Les paysans de la campagne s'obstinaient à ne pas vouloir porter
leurs provisions à Épinal, ce qui réduisit les soldats et les bourgeois
à une extrême disette. Les magistrats envoyèrent secrètement auprès
de René II, qui était en Alsace, des délégués qui convinrent de
lui livrer la ville. René parut devant Épinal au jour convenu le
8 septembre 1470 et aussitôt les bourgeois prirent les armes. Les
Bourguignons intimidés prièrent les magistrats de faire leur composition
avec le duc, et obtinrent de partir avec armes et bagages.
Épinal
jouit d'une assez grande tranquillité jusqu'au règne malheureux
du duc Charles IV, où de dures épreuves lui étaient réservées. En
1633, la place est occupée par l'armée française du maréchal de
La Force, comme presque toutes les villes de Lorraine. En 1635,
le duc Charles, qui avait deux fois signé son abdication, rentrait
en Lorraine par les Vosges et refoulait le maréchal de La Force
vers Lunéville. Mais la garnison française d'Épinal fit une longue
et vigoureuse résistance. Jean-Baptiste de Lameran, qui y commandait,
s'y défendit avec tant de résolution que, la ville et le Château
ayant été pris d'assaut, il demeura, lui cinquième, entre les mains
des officiers lorrains, qui le tinrent prisonnier pendant une année
entière et lui firent payer cher sa liberté. L'année suivante se
produit une nouvelle occupation des Français. Un conseiller de la
ville introduit le duc Charles pendant la nuit peu de temps après.
En 1637, Épinal se revoit au pouvoir des Français.
Moins d'un
an après, quand Turenne se laissa battre à Remiremont, un détachement
de la petite armée du duc rentra dans Épinal. Charles IV, lassé
de son existence vagabonde, signa, en 1641,1e Traité de Saint-Germain
qui lui rendait la Lorraine, mais en le dépouillant de toute indépendance.
A peine arrivé à Épinal, il renouvela par-devant notaire une protestation
déjà faite à Paris contre tout ce que la France exigeait de lui.
En même temps, il traitait avec le comte de Soissons et le duc de
Bouillon, grands ennemis de Richelieu. Une armée française reparut
devant Épinal, au mois d'août 1641. Il fallut employer le canon
pour que la ville se rendît. Le baron d'Hurbach, gouverneur, s'étant
retiré dans le Château, on se servit de la mine pour faire brèche.
Le Château pris, restait le Donjon, où le brave d'Hurbach tint encore
un jour avant de se rendre.
C'était la coutume, quand il avait
fallu employer le canon contre une ville pour la réduire, de lui
prendre ses cloches ou de les lui faire racheter; mais il est dit
dans un des articles de la capitulation accordée à la ville que
l'on ne demandera rien pour le rachat des cloches, bien que le canon
eût été tiré.
Louis XIII mourut en 1043, précédé dans la tombe
par son terrible ministre.
Le nouveau roi était mineur elle pouvoir
aux mains d'une femme.
Le duc Charles n'eut garde de laisser
échapper cette occasion et reparut en Lorraine. Ses troupes rentrent
dans Épinal. Elles y sont assiégées par le maréchal de La Ferlé.
Le maréchal fait faire une grande brèche, mais n'ose donner l'assaut.
Berce et Remirecourt, qui commandaient dans la place, lui mandent
que, si la brèche n'est pas assez grande, ils lui feront abattre
encore cinquante pas de muraille afin qu'il puisse venir à eux plus
aisément et livrer bataille au milieu de la ville. La Ferté ne jugea
pas à propos d'accepter l'offre et se retira en louant la valeur
des Lorrains.
Mais l'année suivante, il revint et cette fois
entra dans la place d'Épinal, qui ne fut rendue au duc qu'à l'époque
du Traité de Vincennes signé le 28 février1661. Quelques années
plus tard, le duc Charles, se disposant à rompre de nouveau avec
la France, vint à Épinal, qu'il fit fortifier avec soin. Louis XIV,
se doutant de ses intentions, fit envahir la Lorraine par le maréchal
de Créqui. La place d'Épinal fut investie au mois de septembre 1670.
Les assiégés firent deux sorties si vigoureuses que Créqui parlait
déjà de convertir le siège en blocus. Mais la division se mit entre
les troupes lorraines et leurs chefs. Peut-être même le gouverneur
était-il gagné à la France. Ce qui est certain, c'est que, dès le
26 septembre, il proposa de se rendre. Créqui ne se contenta pas
des conditions qu'il offrait, et en exigea de plus humiliantes,
qui furent acceptées. La ville fut alors démantelée. En 1674, Charles
IV rentra un moment en possession d'Épinal. Mais, à sa mort, la
ville était déjà reprise par les Français.
Le Traité de Ryswich
rendit Épinal au duc Léopold. À partir de cette époque, sous les
règnes pacifiques de Léopold, de François et de Stanislas, l'histoire
de cette ville ne présente plus rien d'important. Un édit de Stanislas,
rendu en 1751, assure à Épinal, conjointement avec Nancy, le monopole
de la fabrication des caries à jouer. Lorsque, en 1742, sur la demande
de Louis XV, Stanislas forma des bataillons de troupes lorraines
pour prendre rang dans l'armée française, ces bataillons furent
désignés par des noms de villes : Épinal, Neufchâteau. C'est à cette
époque aussi que furent construites les Casernes que l'on y voit
encore. En 1790, Épinal devint le chef-lieu du département des Vosges.
En 1814, la ville fut occupée par les Wurtembergeois qui faisaient
partie de l'armée d'invasion commandée par Schwarzenberg. En 1815,
les Bavarois s'y établirent et y levèrent de fortes contributions.
En 1870, les Allemands occupèrent encore et pressurèrent Épinal.
Épinal, dont le passé est si plein de souvenirs guerriers, est une
ville assez bien bâtie quoique mal percée, divisée par la Moselle
en Grande-Ville, sur la rive droite ; Petite-Ville, dans une Ile
formée par le Canal et par la rivière
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025