Auxerre - Préfecture de l'Yonne
Retour
au Département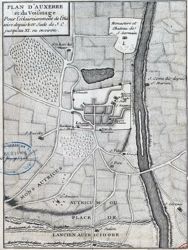

Les Romains, à leur arrivée dans les Gaules,
trouvèrent la ville d'Auxerre déjà florissante. Les avantages de
sa position ne pouvaient échapper à des colonisateurs aussi habiles.
Ils s'efforcèrent donc, en devenant maîtres, d'augmenter encore
son importance. Elle fut élevée au rang de cité, civitas; deux Voies
furent construites pour la rattacher à Sens et à Autun. L'empereur
Julien s'y arrêta en se rendant au siège de Reims et y fit reposer
son armée.
Saint Pèlerin, envoyé par le pape Sixte II, est le
premier apôtre qui ait apporté dans le pays les lumières de l'Évangile,
vers le milieu du IIIème siècle. Les progrès du Christianisme
durent y être rapides, car saint Germain, à qui l'on doit la construction
de plusieurs Églises et qui vivait avant l'invasion d'Attila, était
déjà son sixième évêque.
Aux Huns, qui saccagèrent seulement
les Faubourgs d'Auxerre, succédèrent les Bourguignons, qui se fixèrent
dans la contrée. Mais, par un compromis qui survint entre les Romains
et les nouveaux conquérants, la ville d'Auxerre resta au pouvoir
de ses anciens possesseurs, de sorte qu'après les victoires des
Francs, elle passa directement des mains des Romains à celles de
Clovis.
Dans le partage qui suivit la mort du fondateur de la
monarchie franque, Auxerre échut en 560 à Gontran, qui fut aussi
roi de Bourgogne. Celui-ci constitua Auxerre en comté, dont le premier
titulaire fut Eunius, plus connu sous le nom de Mummole, et célèbre
par ses victoires, ses services et sa rébellion. Sous les descendants
de Clovis, le comté d'Auxerre ne fut point un fief héréditaire.
Les rois de France le donnaient viagèrement à des seigneurs dont
ils voulaient récompenser les services.
Plusieurs évêques d'Auxerre
furent, pendant cette période, revêtus de la dignité de comtes,
gloire mondaine ajoutée à la haute influence religieuse qu'ils exerçaient
de leur vivant, et aux honneurs plus insignes qui leur étaient réservés
après leur mort. Jusqu'à la fin du VIIIème siècle, tous
ces prélats furent successivement canonisés.

Chaque pas dans
l'histoire du passé révèle quelque témoignage de l'importance d'Auxerre.
Charlemagne y résidait à son retour d'Espagne, quand il apprit la
révolte des Saxons. Louis-le-Débonnaire comprenait l'Auxerrois dans
les États dont il formait l'apanage de Charles-Ie Chauve. Ce prince,
dont les actes contribuèrent tant à l'établissement et à l'extension
du régime féodal en France, autorisa les évêques d'Auxerre à battre
monnaie. C'est à Auxerre qu'il maria sa fille Judith, veuve d'un
roi des Anglais, avec Baudouin Bras-de-Fer, grand forestier de Flandre.
Nous parlerons ailleurs de la sanglante bataille de Fontenoy qui,
par sa date, 841, se rattache à ce règne, et qui fut livrée dans
les environs d'Auxerre. C'est à ces temps aussi que remonte la grande
illustration scientifique et littéraire de l'Abbaye d'Auxerre et
de ses écoles. Lothaire, troisième fils du roi Charles, fut élevé,
vécu et mourut dans cette fameuse Abbaye de Saint-Germain d'Auxerre,
qu'il contribua à enrichir. Sous les faibles descendants de Charles-le-Chauve,
le comté d'Auxerre fut joint au duché de Bourgogne sans perdre toutefois
son organisation particulière. Les comtes d'Auxerre reconnaissaient
les ducs de Bourgogne pour souverains, au lieu de relever directement
de la Couronne de France. Cet état de choses dura jusqu'à la réunion
de la Bourgogne à la France sous le sceptre de Hugues Capet. L'aveuglement
politique qui permit une nouvelle séparation de la Bourgogne et
de la France, eut pour résultat la reconstitution, héréditaire cette
fois, du comté d'Auxerre.
Landry, qui succéda à Othon-Guillaume,
son père, fut la souche d'une dynastie de comtes dont les règnes
furent signalés par des calamités de toute espèce : famine en 1033
; désastreux incendies en 1062 et en 1187 pestes et inondations
dans le siècle suivant. La guerre ajouta à tous ces fléaux ses horreurs
presque permanentes : guerre du comte Guillaume ercontre
le duc Robert son oncle ; de Guillaume II contre le comte de Champagne
de Guillaume IV contre les seigneurs de Sancerre et de Joigny ;
de Gui contre le duc de Bourgogne ; de Pierre de Courtenay contre
Hervé de Donzy ; discordes intestines entre les comtes et les évêques.
Ainsi s'écoulèrent les deux siècles XIème et XIIème.
Arrivèrent ensuite les invasions des Anglais et la lutte sanglante
des maisons de Bourgogne et de France Peu de loisirs étaient laissés
pour les améliorations et les embellissements de la cité. Guillaume
IV, cependant, entreprit d'enfermer la ville dans une nouvelle Enceinte,
il l'augmenta de six Faubourgs très peuplés, agrandit la Place principale
et transféra à Auxerre les foires qui se tenaient précédemment à
Tannet. Pierre de Courtenay, en 1187, continua les Fortifications
du côté de l'Yonne, et allégea par quelques concessions le poids
des servitudes féodales qui pesaient sur les habitants. Ces premières
franchises furent confirmées et étendues, en 1223, par la comtesse
Mathilde. Le lieu appelé le Change fut déclaré privilégié. Le Quartier
des Drapiers devait jouir de toute liberté. Les affaires de la commune
étaient administrées par douze jurés. Le sceau des rois de France
Philippe-Auguste et Charles V figure au bas des chartes. Une ordonnance,
qui autorise la reconstruction du Pont de l'Yonne, est signée de
saint Louis et datée de Rogennes, en 1266.
Si l'association d'Auxerre
à la fortune de la France se révèle ici par quelques mesures bienveillantes
et libérales auxquelles les monarques participèrent, bientôt cette
solidarité devait coûter cher aux malheureux habitants de l'Auxerrois.
Les Anglais, vainqueurs à Poitiers, se répandirent comme un torrent
dévastateur sur les États du roi Jean, vaincu et prisonnier. La
ville d'Auxerre ne fut point épargnée les Églises et les Maisons
furent pillées, les Murs abattus, les Portes brûlées. Le butin ravi
s'éleva à 600 000 moutons d'or, évalués à plus de 4 000,000 de notre
monnaie. Après avoir passé huit jours à fouiller partout pour s'assurer
si aucun objet précieux ne leur avait échappé, les Anglais déclarèrent
aux bourgeois qu'avant de s'éloigner ils allaient brûler la ville,
si on ne la rachetait par une rançon de 500,000 florins. L'ennemi,
qui avait conservé une garnison à Segonnes, revint plusieurs fois.
La place d'Auxerre, sans Murailles, sans défenseurs, et dont le
comte avait été fait prisonnier avec le roi Jean, ne fut délivrée
que par Du Guesclin. Encore les 400 gens d'armes que le connétable
jeta dans la place firent-ils presque regretter aux habitants, par
leur indiscipline, le tardif secours qu'ils leur apportaient. La
ville, si cruellement éprouvée, trouva cependant des ressources
sous Charles V pour relever ses Fortifications. Son zèle et son
dévouement furent récompensés par la concession de nouveaux privilèges.
En 1370, Jean de Châlons, ayant consenti à se démettre du comté,
Charles V le lui acheta au prix de 31 000 francs d'or, somme équivalente
aujourd'hui à 700 000 francs. Les Auxerrois s'associèrent au marché,
en abandonnant à la Couronne, pendant trois ans, le dixième de leurs
récoltes en grains et en vins, pour la couvrir de ses avances. En
considération de ce nouveau sacrifice, le monarque avait décidé
qu'Auxerre ferait pour toujours partie du domaine royal. Charles
VII, en 1450, céda cependant, par le Traité d'Arras, le comté au
duc de Bourgogne. Mais Louis XI se garda bien d'oublier Auxerre,
parmi les dépouilles de Charles-le-Téméraire, dont il enrichit la
France. Depuis cette époque, le comté ne fut plus détaché de la
monarchie. Les premières années du XVIème siècle furent
marquées par la famine et la peste. Les guerres de Charles-Quint
tinrent la ville dans une anxiété continuelle. Puis survinrent les
luttes sanglantes de la Réforme. Un voyage que fit Charles IX à
Auxerre, en avril 1566, son attitude envers les Huguenots, fort
nombreux dans la ville, semblent avoir été le signal des hostilités.
L'année suivante, les Protestants, sous la conduite d'un capitaine
nommé La Borde, surprenaient la place. La rigueur des persécutions
antérieures explique, sans les justifier, les excès dont les vainqueurs
se rendirent coupables Reliques des saints, ornements des Temples,
Bibliothèques des Abbayes, tout fut profané, saccagé, dispersé ;
la seule Église des Cordeliers fut conservée pour le service du
culte vainqueur.
L'Édit de pacification du 3 mars 1568 remit
la ville sous l'obéissance du roi, et fut suivi de près par les
massacres de la Saint-Barthélemy, qui eurent à Auxerre un caractère
inouï de férocité et d'acharnement. Cette surexcitation de fanatisme
religieux livra plus tard la ville aux Ligueurs ; le duc de Guise
en chassa tous ceux qu'il soupçonnait de n'être pas aveuglément
attachés à la Sainte-Union. Ces accès de fièvre et de délire ne
pouvaient avoir une longue durée. Le sens droit et loyal des Auxerrois
revint bientôt à une plus saine appréciation des grandes questions
qui s'agitaient. Quatre bourgeois notables furent députés vers Henri
IV, et la nouvelle du bienveillant accueil que leur fit le roi fut
reçue avec enthousiasme. La trahison qui livra Amiens aux Espagnols
acheva d'ouvrir les yeux et de réveiller le patriotisme. La ville
décréta un don volontaire de 3 000 écus au roi pour l'indemniser
de la perte d'Amiens. C'était un heureux et touchant prélude à la
réconciliation complète. Auxerre, en effet, ne tarda pas à faire
sa soumission. Ce retour était tellement sincère, que pendant la
Fronde rien ne put ébranler la fidélité des habitants. Condé, vainqueur
à Bléneau, eut beau menacer la ville et en commencer le siège ;
les Portes lui en restèrent fermées jusqu'à l'arrivée de Turenne,
qui contraignit le prince rebelle à la retraite.
Un arrêt du
conseil, en 1669, confirmatif d'une ordonnance de Henri IV, annexa
définitivement le comté d'Auxerre au duché de Bourgogne.
Auxerre,
depuis cette époque, a pris sa part, avec un patriotisme qui ne
s'est jamais démenti, à tous les événements qui ont influé sur les
destinées de la France. Ce n'est plus comme autrefois la ville des
conciles, le rendez-vous choisi pour la signature des traités, pour
les réconciliations des princes, les conférences politiques ou les
assemblées générales du royaume. Mais c'est une des principales
villes de la Bourgogne, cette vaillante et riche province. Elle
l'a bien montré à une époque récente. Durant la guerre franco-allemande
de 1870-1871, elle fit tous ses efforts pour échapper à l'invasion,
qu'elle fut néanmoins forcée de subir. Le 21 novembre 1870, les
troupes allemandes entraient à Auxerre, pour n'en sortir que le
11 mars 1871.
La ville est située sur le sommet et sur le penchant
d'une colline qui s'affaisse jusqu'au bord de l'Yonne.
Un Port
commode et très fréquenté y a été creusé en face et bordée de moulins
d'un aspect très pittoresque. Une enceinte entoure Auxerre d'un
arc, dont la rivière serait la corde. Les Rues sont larges et d'un
accès facile ; les maisons n'y manquent pas d'élégance. Du Pont
de l'Yonne, on découvre les Églises, les Promenades, les Iles boisées
de la rivière et les Moulins établis le long des rives du cours
d'eau.
Le plus remarquable édifice d'Auxerre, sa Cathédrale,
Saint-Étienne, monument historique, dont l'achèvement s'est poursuivi
du commencement du XIIIème siècle à la fin du XVIème
siècle sans que l'harmonie générale se ressente des longues et fréquentes
interruptions occasionnées par les guerres et les calamités du temps,
est de style ogival, et mesure 100 mètres de longueur sur 10 de
largeur, les voûtes élancées de la Nef et du chœur ont 32 mètres
de hauteur; la tour qui s'élève à l'angle Nord du grand Portail
a 62 mètres au-dessus du sol. Le chœur renferme un tombeau et une
statue à mi-corps de Jacques Amyot. Viennent ensuite l'Église Saint-Germain,
qui mériterait une longue description, tant pour son architecture
extérieure que pour ses cryptes curieuses remontant au IXème
siècle, où repose, parmi les nombreux évêques de la ville, le saint
illustre dont l'église porte le nom; les deux Églises de Saint-Pierre
et de Saint-Eusèbe, monuments historiques ; l'Hôtel de la Préfecture,
vieux Palais épiscopal, l'ancienne porte de l'Horloge, surmontée
d'une Tour, dite Tour-Gaillarde et contiguë au Château des ducs
de Bourgogne.
Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025