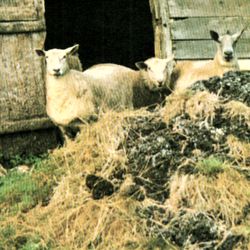Histoire de l'Eure

Le territoire qui forme aujourd'hui le
département de l'Eure était habité, au temps de Jules César,
par deux peuples de la Gaule celtique les Aulerci Eburovices,
groupés autour de la ville qui est devenue Évreux, et les Velocasses,
répandus dans la contrée appelée depuis Vexin.
Le Vexin se
trouva divisé deux parties après la cession, faite par Charles
le Simple au chef normand Rollon, de l’ancienne Neustrie, en
911 ; le Vexin normand a été réuni en 1790 au département de
l'Eure il forme l'arrondissement des Andelys. Les Aulerques
et les Vélocasses prirent part aux guerres contre César. Clovis,
le premier, pénètre jusque dans cette province et la rangea
sous sa domination.
Parmi ses successeurs, Dagobert et Clotaire
III résidèrent quelquefois au château d'Étrépagny Pendant la
période mérovingienne, la foi chrétienne se développa sur le
territoire des Aulerci et des Velocasses, et les évêques d'Évreux
acquirent une grande importance. Au nombre des abbayes fondées
à cette époque dans le diocèse d'Évreux, on distingue celle
de Saint-Taurin, qui s'éleva probablement vers la fin du VIIème
siècle, sur le bord du grand chemin, en dehors de la ville,
à l'emplacement qu'occupait le tombeau du premier évêque d'Évreux,
dont le corps fut levé et déposé dans un reliquaire.

Quelques années plus tard s'éleva le monastère de la Croix- Saint-Leufroy. On rapporte qu'en l'année 674 saint Adrien, évêque de Rouen, étant parti de cette ville pour aller, dit ta légende, rendre compte au roi de quelques affaires dont il avait été chargé, passa par le territoire d'Evreux. Alors accablé par l'âge et les infirmités, il ne pouvait plus monter à cheval, et il voyageait dans une litière traînée par deux mulets ; de temps en temps, il s'arrêtait dans les divers pays qu'il parcourait et, instruisait les populations accourues pour recevoir sa bénédiction.

Il était parvenu près de la rivière d'Eure, dans un village du nom de Nadud, en un lieu où deux chemins se coupaient en forme de croix ; les mulets s'arrêtèrent tout court et refusèrent d'aller plus avant, quoiqu'il n'y eût aucun obstacle et que le chemin fût beau. Le saint plein d'étonnement, descendit et pria ; à peine avait-il commencé d'élever ses yeux vers le ciel, qu'il vit une croix toute brillante de lumière et qu'il sentit son esprit éclairé d'une céleste inspiration qui lui apprit que Dieu avait choisi ce lieu pour être la retraite d'un grand nombre de solitaires. Aussitôt il commanda qu'on lui apportât de quoi faire une croix, et, à défaut d'autre bois, il brisa en deux l'aiguillon dont un paysan se servait pour exciter ses bœufs éleva un tertre de gazon et y plaça la croix avec de saintes reliques. Bientôt le lieu consacré devint le théâtre de prodiges ; pendant la nuit, une colonne de feu y répandait une clarté miraculeuse, et des malades étaient guéris par le contact de la croix plantée par le saint. Une chapelle fut élevée pour perpétuer la mémoire de ces prodiges, et, quelque temps après, saint Leufroy y fonda un monastère dont il fut le premier supérieur, et qu'il illustra par ses vertus. Ainsi, pieuse et dévouée l'église comme le reste de la Neustrie, la contrée vivait paisible toute son histoire se résumait dans la succession de ses évêques, respectés de tous, et dans les prodiges sans nombre que les, rares monuments de cette époque nous ont légués; elle avait mérité le nom de nouvelle Thébaïde, quand le calme dont elle jouissait fut troublé par les invasions normandes du VIIIèmee et du IXème siècle ce furent surtoutl es parties septentrionales de la Gaule et les villes situées sur le cours des fleuves qui eurent à souffrir des incursions de ces terribles pirates.
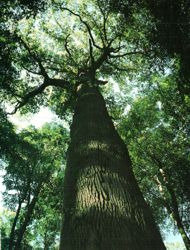
Ce département, que traversent la Seine
et l'Eure, fut plus que tout autre maltraité par les barbares.
En l'année 844, Rouen et son diocèse, dont faisaient partie
les villes de Gisors, des Andelys, d'Étrépagny et tout ce qui,
dans le département de l'Eure, est situé sur la rive droite
de la Seine, furent saccagés. Le diocèse d'Évreux ne fut pas
épargné non plus par le fléau. Guntbert était alors évêque de
cette ville ; il assista avec son métropolitain Gombault, qui
prenait pour la première fois le titre d'archevêque, à deux
conciles tenus à Paris en 847 et 853, pour prévenir le retour
des barbares du Nord. Charles le Chauve éleva une forteresse
à Pont-de-l'Arche l'année suivante en 854 et fit jeter un pont
sur la Seine pour barrer le passage à leurs barques. Cependant
ils reparurent en 870, puis en 876. Cette fois, ils étaient
conduits par le chef qui établit définitivement dans la Neustrie
la domination normande. Le Scandinave Roll ou Rollon, chassé
par un roi danois des États qu'avait possédés son père, se mit
à la tête d'une émigration de ses compatriotes, aborda en France
en 876, ravagea pendant quelques années les côtes de la Bretagne
et de la Neustrie, puis remonta la Seine ; pilla sur son passage
Jumièges, Rouen, Pont-de-l'Arche, où il battit l'armée du roi
Charles le Chauve, commandée par le duc Renault ; puis il vint
assiégé Paris. Ce fut pendant la durée du siège qu'il dirigea
vers Évreux une expédition dans laquelle il se rendit maître
de cette ville (892). Déjà Rouen était en son pouvoir ; cette
ville ets on archevêque avaient mieux aimé se soumettre aux
Normands et leur payer un tribut que d'être sans cesse exposés
à leurs pillages ; des négociations furent ouvertes, par l'intermédiaire
de l'archevêque Francon, entre le chef barbare et le roi Charles
le Simple pour traiter de la cession de toute la province.
Le Carlovingien ne sacrifiait rien de sa puissance effective
en abandonnant une contrée où son autorité avait cessé d'être
reconnue, et, en échange de cet abandon, il acquérait un allié
et protégeait toute la Gaule contre les invasions de nouveaux
Normands, puisque les compagnons de Rollon étaient intéressés
à défendre leur conquête. Le chef normand promit d'épouser Giselle,
fille du roi de France, se convertit au christianisme et obtint
toute la partie de la Neustrie qui s'étend au nord de la Seine
depuis les rivières d'Epte et d'Andelle, et, au midi de ce fleuve,
tous les pays situés entre la Bretagne, le Maine et l'Océan.
Ce fut en 911 que ce traité fut signé dans.la ville de Saint-Clair-sur-Epte.
Le pirate, devenu maître d'une des plus riches provinces de
la France, se montra, par sa sagesse, digne de sa fortune ;
il releva les cités que lui-même avait détruites avant de devenir
maître de la contrée ; Évreux fut de nombre ; il se fit sincèrement
chrétien et enrichit les églises de donations nombreuses. Cependant
il ne put empêcher que ses anciens compagnons, qui avaient reçu
avec lui le baptême, ne s'emparassent des abbayes et des évêchés
; peut-être même favorisa-t-il ce nouveau clergé pour placer
toute la Neustrie plus directement sous son influence ; de grands
désordres résultèrent de cette nouvelle organisation. Guillaume
Longue-Épée, fils de Rollon, lui succéda. Passionné pour les
exercices de la chasse, Il fit construire au milieu de la forêt
de Lyons un pavillon qui devint, depuis, le château de Lyons
et le rendez-vous de chasse du duc de France Hugues le Grand,
de Hébert, comte de Senlis de Herbert, comte de Vermandois,
et de Guillaume, comte de Poitou. Richard, âgé seulement de
dix ans, succéda, en 944, à Guillaume Longue-Épée, et, en 947,
il eut avec le roi Louis IV une entrevue à Saint-Clair-sur-Epte.
Les deux princes conclurent un traité par lequel le Vexin normand,
qui jusqu'alors avait appartenu aux ducs de Normandie comme
province séparée, fut réuni au duché. Hugues le Grand ; duc
de France, profita de la minorité de Richard pour lui enlever
le comté d'Évreux. Louis d'Outre-Mer voulut à son tour essayer
de reconquérir tout le duché de Normandie et commença par s’emparer
d'Évreux, sous prétexte de restituer au jeune duc cette portion
de ses États ; puis il se saisit de sa personne et le fit transporter
à Laon ; le comte de Senlis, vassal de Hugues, enleva Richard.
Le duc de France usa de cet avantage pour faire épouser
au duc normand sa fille Emma, et ce mariage fut célébré dans
la cathédrale de la ville d'Évreux, qui s'était délivrée du
joug des Français.
Après Louis IV, son fils Lothaire fit
de nouvelles entreprises sur les États normands, il vint assiéger
Évreux, s'en empara et donna cette ville à Thibaud, comte de
Chartres, l'un des seigneurs qui lui étaient restés fidèles
mais Richard ne tarda pas à la recouvrer. Richard rebâtit Evreux,
releva ses églises, qui avaient été détruites dans les précédentes
irruptions, et la donna, avec le titre de comté, à son fils
naturel Robert, en 989. Ce même Robert obtint de son père l'archevêché
de Rouen, en même temps que le comté d'Évreux. Philippe-Auguste
enleva ce comté, en 1193, au comte Amaury III, pour le donner
à Jean sans Terre, alors son allié. Avec la ville d'Évreux ;
ce prince, comptant regagner, par une horrible perfidie, les
bonnes grâces des Anglais, invita à un festin les officiers
de la garnison française, les fit massacrer et passa au fil
de l'épée tous les soldats. Le roi de France, en ce moment occupé
au siège de Verneuil, s’empressa d’accourir, reprit la ville
et la mit en cendres, puis il conquit presque tout le reste
du comté. Amaury fit, en 1200, à Philippe, une cession complète
de ses possessions ; le comté d'Évreux fut de la sorte réunie
à la couronne.
Il en fut détaché environ un siècle après
en 1307 par Philippe le Bel en faveur de Louis, fils de Philippe
le Hardi. Le nouveau comte servit fidèlement son frère et se
distingua dans la guerre contre les Flamands. Plein de sagesse,
il pensait qu'un prince n'est grand qu'à la condition de rester
soumis à Dieu, au roi et aux lois. Il eut pour successeur, en
1319, son fils Philippe, qui hérita le surnom de Bon ou de Sage.
Ce comte avait épousé la princesse Jeanne, fille unique du roi
Louis la Hutin et qui prétendait par son père au royaume de
Navarre et au comté de Champagne et de Brie. Cette princesse
obtint seulement, en 1328, la Navarre, qui passa, en 1349, son
fils, Charles le Mauvais, déjà comte d'Évreux depuis 1343. La
vie agitée de ce prince se passa presque tout entière en dehors
de son comté, et la bataille de Cocherel, qu'il perdit le 16
mai 1364, est le seul fait important qui se soit passé sous
lui dans le pays d'Évreux. Charles V confisqua, en 1378, les
possessions de Charles le Mauvais en Normandie mais le roi Charles
VI restitua au fils du roi de Navarre, Charles II le Noble,
le comté d'Évreux ; ce prince le rétrocéda au roi en échange
d'une rente de 12,000 livres à tenir en duché-pairie avec le
titre de Nemours. Sous ce règne désastreux de Charles VI, les
Anglais, victorieux à Azincourt (1415), se répandirent par toute
la France et reprirent la Normandie.
Après la mort de ce roi, le dauphin Charles
VII dépossédé en vertu du traité de Troyes, s'efforça inutilement
de repousser cette grande invasion anglaise jusqu'au moment
où Jeanne d’Arc lui prêta son merveilleux secours ses troupes
furent battues à Verneuil, par le duc de Bedford, en 1424. Mais
lorsque le siège d'Orléans eut été levé, les Français obtinrent
des succès presque aussi constants que l'avaient été jusque-là
leurs revers. La Normandie fut cependant l'une des dernières
provinces que perdirent les Anglais, ils ne furent chassés d'Évreux
qu'en 1441.
La fin du règne de Charles VII et les règnes
suivants ramenèrent, avec le calme, un peu de prospérité jusqu'à
l'époque de la Ligue. La paix ne fut troublée momentanément
que sous Louis XI, par le soulèvement de quelques villes dans
la guerre du Bien Public.
Lorsque la Réforme de Calvin s'introduisit
en Normandie, le diocèse d'Évreux dut à la sagesse de ses prélats
d'être préservé de l'hérésie. L'évêque Ambroise Le Veneur visitait
souvent, pendant la nuit, les villes et les villages de son
diocèse pour voir si l'erreur ne s'y produisait pas. Son successeur,
Claude de Saintes, eut la prudence de consentir à réformer le
Bréviaire, le Rituel et le Missel d'Évreux, où se trouvaient
plusieurs préceptes indignes de la sainteté de la religion.
Mais ce pasteur pieux et savant exagéra son zèle religieux au
moment où Henri IV fut appelé au trône par la mort de Henri
III en 1589 et engagea Évreux dans la ligue contre le roi protestant.
Tous les bourgeois s'unirent à l'évêque ; ils s'armèrent et
s'emparèrent du château d'Harcourt en 1590 ; celui de Neubourg
fut également emporté, la ville de Conches fut saccagée; mais
Breteuil se défendit courageusement et le maréchal de Biron
vint sommer Évreux de se rendre. Après quelques pourparlers
et un peu d'hésitation, les habitants ouvrirent leurs portes
et l'évêque s'enfuit à Louviers (janvier 1591). Henri IV ne
tarda pas à venir en personne dans le comté d'Évreux ; il y
gagna sur Mayenne la bataille d'Ivry (1591), s'empara de Louviers,
fit prisonnier l'évêque d'Évreux et le transféra au château
de Caen, puis à Crèvecœur, près de Lisieux. Dans les premières
années du XVIIème siècle, Henri IV visita, avec Marie
de Médicis, la plupart des villes de Normandie et, entre autres,
Évreux. Le calme se rétablit dans le diocèse, et il ne fut plus
troublé que par quelques soulèvements qui eurent lieu en 1649,
à l'époque de la Fronde. Le duc de Longueville, gouverneur de
Normandie, se révolta et entraîna dans sa rébellion les villes
de son gouvernement. François d'Harcourt, marquis de Beuvron,
lieutenant général du roi en Normandie, vint mettre le siège
devant Évreux les bourgeois résistèrent pendant une année environ
; l'emprisonnement des princes de Condé et de Conti et du duc
de Longueville (1650) leur fit déposer les armes ; l'évêque,
qui s'était déclaré contre la Fronde, rentra dans la ville,
et le diocèse jouit d'une longue paix jusqu'en 1789.
Le
département de l'Eure, formé en 1790, accueillit avec faveur
la Révolution jusqu'au moment où les girondins furent renversés
par la Montagne. A ce moment, une armée fédéraliste s'organisa
et fut conduite jusqu'à Vernon par le général Wimpfen et le
marquis de Puisaye. Le général républicain Schérer eut l'avantage
en diverses rencontres la guerre se reporta dans la Bretagne
et dans la Vendée, et depuis ce temps jusqu'à nos jours la paix
ne fut plus troublée dans le département de l'Eure jusqu'à la
funeste guerre de 1870-1871. Lorsque Metz eut succombé et qu'elle
eut été livrée plutôt que défendue par le maréchal Bazaine,
les troupes du prince Frédéric-Charles, après avoir envahi la
Flandre et la Picardie, entrèrent en Normandie ; l'arrondissement
des Andelys, situé sur la rive droite de la Seine, fut un des
premiers pays normands occupés par les Allemands mais ce ne
fut pas sans résistance. Le 30 novembre 1870, le général Briand
leur livra même un combat heureux et les délogea d'Étrépagny
mais il fut rappelé sur un autre point par des ordres supérieurs
; l'ennemi revint en force, reprit ses positions et continua
sa marche sur Rouen. Évreux fut occupé par l'ennemi, mais il
n'eut pas à subir de violences.
Evreux


Dans l’Antiquité romaine, Évreux est
identifiée par le nom de Mediolanum Aulercorum ; elle était
la capitale du peuple des Aulerques Éburovices et fut fondée
à la fin du Ier siècle av. J.-C.12. Au début du Haut-Empire,
ces derniers honoraient les dieux gallo-romains dans le sanctuaire
de Gisacum à cinq kilomètres de la cité.
Taurin est le premier
évêque d’Évreux. Évreux devint en 989 le siège du comté d'Évreux
et de l’évêché d'Évreux. Les Normands la prirent en 892, Lothaire
la pilla en 962. Elle fut saccagée par Henri Ier d'Angleterre
en 1120. En 1194 Philippe-Auguste confie la garde de la ville
à Jean sans terre. Mais ce-dernier le trahis pour se faire pardonner
auprès son frère Richard Cœur de Lion. Pour cela il fait massacrer
par traitrise 300 chevaliers fidèles au Roi de France et s'empare
de la ville au nom de l'Angleterre. En représailles, Philippe-Auguste
brule la ville. Il est à remarquer que la Famille Devereux que
l'on retrouve en Angleterre (notamment en Essex dont plusieurs
comtes étaient des Devereux) et en Irlande tire son nom de la
ville. Durant le XIVème siècle et la première moitié
du XVème, la Maison d'Evreux, branche cadette de
la dynastie capétienne, connut son apogée.
Avec le mariage de Philippe d'Evreux
avec Jeanne II de Navarre, des d'Evreux régnèrent sur le Royaume
de Navarre. La lignée principale s'éteignit en 1400 avec la
mort de Charles d'Evreux, tandis que la lignée navarraise (la
Maison capétienne d'Evreux-Navarre) persista jusqu'en 1441.
Aujourd'hui, un quartier d'Evreux est nommé Navarre. Pendant
la Guerre de Cent Ans, la ville est prise en 1418 par le roi
anglais Henri V. Elle retourne à la souveraineté du roi de France
en 1440 grâce à l’action de Robert de Flocques dont la dalle
funéraire se trouve dans l'église de Boisney.
La ville a
subi de forts dommages au cours de la Seconde Guerre mondiale
et la plus grande partie de son centre a été reconstruite.
Bernay

Entre 996 et 1008, le duc de Normandie,
Richard II, offre cette région en dot à son épouse, Judith de
Bretagne, qui fonde aussitôt une abbaye bénédictine : l'abbaye
Notre-Dame. Les moines aménagent le site par des travaux hydrauliques
importants : assainissement, moulins, pêcheries… et la construction
d'une abbatiale qui reste un joyau de l'architecture romane
normande. Pour couvrir les frais et assurer leur défense, ils
cèdent une partie de leur propriété en 1048. L'activité commerciale
attestée dès 1198 prend son essor sur l'axe principal de la
ville. L'industrie du drap est réputée, les foires sont nombreuses,
notament, la Foire Fleurie au moment des Rameaux en est un souvenir,
en raison de la diversité et de l'abondance des produits agricoles
de la région.
Bernay devient d'ailleurs un immense marché
chaque samedi. La vénération de Notre-Dame de la Couture dès
le XIIIème siècle, est à l'origine de pèlerinages
importants qui attirent les foules de toute la Normandie ; le
pèlerinage marial diocésain a toujours lieu chaque Lundi de
Pentecôte. Au cours du XIXème siècle, d'importants
aménagements de voirie modernisent la ville, et l'évolution
de la structure industrielle s'oriente vers le pourtour de la
cité. Ce développement continuera au cours du siècle dernier,
avec l'arrivée de nouvelles industries et l'extension considérable
de Bernay sur les coteaux surplombant le centre traditionnel,
lequel a su rester fidèle à ses origines.
Les Andélys

Le monument qui a fait la célébrité de
la petite ville normande est sans doute le Château Gaillard
dont les ruines surplombent la vallée de la Seine. Le château
est bien visible de la large vallée que forme à cet endroit
un important méandre de la Seine. À la fin du XIIème
siècle, la Normandie fait partie de l'empire Plantagenêt et
les rois de France lorgnent depuis toujours sur ces terres riches
qui leur permettraient le contrôle de la Seine et un accès à
la mer.
![]()
Aussi, les Ducs de Normandie ont depuis longtemps cherché à protéger cette position stratégique et leur frontière, en construisant une série de châteaux forts (Louviers, Malassis, Vernon, Gasny, Pacy-sur-Eure, Baudemont, Ecos, Château-sur-Epte, etc.) et ainsi, défendre l'accès à la capitale normande, Rouen. En arrière de Vernon et des premiers points fortifiés sur l'Epte, tombés en partie aux mains du roi de France, Richard Cœur de Lion lance la construction de Château Gaillard en 1196 sur une falaise de craie surplombant la vallée de la Seine. Cette position est considérée comme inexpugnable. Pour empêcher toute descente du fleuve par la flotte française, il fait planter trois rangées de pieux dans le lit de la Seine en contrebas. La construction de Château Gaillard aurait duré un an et, selon la légende, Richard Cœur de Lion aurait déclaré en 1197 : « Qu'elle est belle, ma fille d'un an » et il serait aussi l'auteur de : « Que voilà un château gaillard ! » .
Château Gaillard

Le choix des Andelys par Richard pose
un double problème : d'une part, le lieu appartient à l'archevêque
de Rouen, Gautier de Coutances à l'époque ; d'autre part, le
roi d'Angleterre n'a pas le droit de fortifier l'endroit selon
les termes du traité de 1196. Mais, il n'a pas le choix s'il
veut défendre la vallée de la Seine. Il passe donc outre les
oppositions. Ce qui lui valut les foudres de l'archevêque Gautier
de Coutances. Finalement, un compromis est trouvé en octobre
1197 : Richard offrit au prélat plusieurs terres ducales contre
la possession des Andelys, dont le port de Dieppe, source d'importants
revenus. L'échange était particulièrement favorable à l'Église.
Richard installe le château sur un éperon rocheux dominant la
Seine d'environ 90 mètres. Le site n'est toutefois pas l'endroit
le plus haut du secteur puisqu'au sud-est s'étend un plateau
qui le domine de 50 mètres.
Le système défensif dépassait
de loin la seule forteresse encore visible aujourd'hui et bloquait
littéralement le fleuve. Au pied du château, le bourg fortifié
de la Couture (embryon du Petit Andely) avait été créé. De là,
un pont enjambait la Seine et prenait appui sur une île fluviale
qui accueillit le petit château de l'île. Quelques centaines
de mètres en amont du fleuve, une triple rangée de pieux empêchait
la descente des navires (l'estacade). Deux mottes castrales
servaient d'avant-postes : la tour de Cléry sur le plateau et
celle de Boutavent dans le vallée. Au centre, poste d'observation
magistral et imprenable, le Château-Gaillard L'ensemble avait
pour vocation de verrouiller la boucle de la Seine en amont
de Rouen en cas de danger.
Après la mort de Richard en avril
1199, son jeune frère Jean sans Terre lui succède sur le trône
ducal. Philippe Auguste profite de ce changement de règne pour
reprendre la conquête du duché de Normandie. Sous la pression
du légat Pierre de Capoue, le roi conclut un traité de paix
le 22 mai 1200, connu sous le nom de traité du Goulet.

Philippe Auguste conserve ses dernières
conquêtes, notamment le Vexin Normand, à l'exception de Château
Gaillard. Cette paix est rompue en 1202. Le roi reprend l'offensive
et en août 1203, il s'empare de l'île d'Andely avec son fort
et du bourg de la Couture, abandonné par sa population. Non
loin, les Anglo-Normands abandonnent sans combat le château
du Vaudreuil puis c'est au tour du château de Radepont de tomber.
L'estacade est détruite, rendant la navigation sur la Seine
possible. La route de Rouen est ouverte pour les Français. Donc,
quand en septembre, Philippe entreprend le siège du château,
la forteresse n'est plus si indispensable à prendre.
Elle
reste toutefois pour le roi de France un symbole à abattre car
c'est le château de Richard Cœur de Lion . Philippe Auguste
entoure la forteresse d'un double fossé de circonvallation qu'il
hérisse de 14 beffrois. Mais conscient du caractère redoutable
de la place forte, le roi de France compte surtout sur un blocus
qui affamera la garnison et la population retranchées à l'intérieur
pour soumettre Château Gaillard.
Roger de Lacy commande la
garnison et se montre prêt à résister le temps qu'une armée
de secours envoyée par Jean sans Terre le débloque. Pour préserver
les vivres, les 1 200 habitants de La Couture (Petit Andely),
qui avaient trouvé refuge dans le château, en sont chassés en
décembre. Les Français assiégeants les repoussèrent. Tassés
dans la deuxième enceinte, exposés au froid de l'hiver, ils
moururent de faim. Mais ce n'est pas la famine qui assure au
roi de France la prise de Château Gaillard. Il tire parti des
« erreurs dans la conception même de la forteresse, qui vont
apparaître au fur et à mesure de la progression de l'assaut
».
Les Français attaquent d'abord la grosse tour qui domine
l'ouvrage avancé. Son écroulement oblige les défenseurs à se
replier dans le château proprement dit. La légende voudrait
que les Français soient entrés dans la basse-cour par les latrines.
Un soldat un peu plus rusé que les autres, un certain Bogi,
pénétra dans la forteresse en empruntant les latrines et réussi
enfin à ouvrir la porte de la seconde enceinte.* Les assaillants
débouchent dans la basse-cour tandis que les défenseurs s'enferment
dans le donjon. Mais comme un pont dormant relie la basse-cour
au donjon, les mineurs français n'ont pas de grandes difficultés
à s'approcher de la porte. Un engin de jet l'enfonce finalement.
La garnison comprenant 36 chevaliers et les 117 sergents ou
arbalétriers se rend le 6 mars 1204. Le siège a coûté la vie
à quatre chevaliers. Lambert Cadoc chef mercenaire de Philippe
Auguste fut l'un des grands artisans de cette victoire, Le roi
de France lui confia la garde du château.
Le champ est désormais
libre au roi de France pour achever la conquête du duché de
Normandie. Conquête facilitée par l'abattement moral chez les
Anglo-Normands, consécutif à la chute de Château Gaillard. Le
duché tombe entièrement en juin 1204.
C'est également à
Château Gaillard, devenu une prison, que la reine Marguerite
de Bourgogne est morte étranglée sur ordre de son époux Louis
X le Hutin. elle avait été condamnée pour d'aldultère lors de
l'affaire de la Tour de Nesle
* Note : La légende voudrait que les Français soient entrés dans la basse-cour par les latrines ; Adolphe Poignant au XIXème raconte que ce sont les troupes de Lambert Cadoc qui l'ont prise d'assaut, une nuit. Cependant, à la lumière du récit de Guillaume le Breton, ils se seraient introduits en réalité par l'une des fenêtres basses de la chapelle que Jean sans Terre aurait fait construire bien mal à propos. La légende des latrines est encore reprise en tant qu'histoire vraie aujourd'hui par diverses sources peu spécialisées, comme des ouvrages de vulgarisation ou des sites internet. Cette fable aurait été inventée après les faits, car elle frappe l'imagination en introduisant du cocasse dans une situation dramatique et surtout, parce que la vérité est quelque peu embarrassante pour l'image de la monarchie de droit divin, une chapelle étant normalement un sanctuaire inviolable
La légende des Deux Amants à Amfreville-sous-les-Monts
Plan du site |
Moteur de recherche
| | Page Aide |
Contact
© C. LOUP 2025