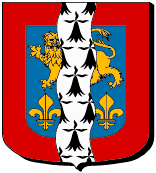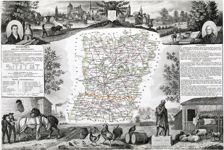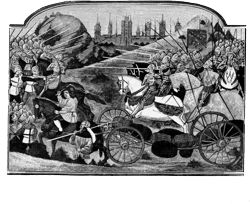Histoire de la Mayenne

Les diverses populations qui occupaient
le territoire dont est formé le département de la Mayenne étaient
les Andes, qui habitaient la partie méridionale du pays, l'arrondissement
actuel de Château- Gontier les Aulerces Arviens dans l’arrondissement
de Laval) ; leur cité était Vagoritum, ville détruite, dont
l'emplacement s'appelle encore la Cité, dans la commune de Saint-Pierre-d'Herve
; les Aulerces Diablintes dans l’arrondissement de Mayenne ;
Noiodunum et Jublains était leur capitale.
Le pays, sous
la domination des Romains, fit partie de la troisième Lyonnaise.
Plus tard, la partie méridionale du département se trouva comprise
dans l'Anjou et le pays habité par les Arviens et les Diablintes
fit partie du Maine. Ces diverses contrées suivirent la destinée
des grandes provinces auxquelles elles appartenaient nous ne
pouvons que renvoyer le lecteur à l'histoire des départements
de Maine-et-Loire et de la Sarthe, où il trouvera également
celle de l'Anjou et du Maine.
Les deux principales subdivisions
du pays, au moyen âge, furent les comtés de Mayenne et de Laval;
on en trouvera plus loin l'histoire dans les notices consacrées
à ces deux villes. Pendant la Révolution française, ce pays
fut un des plus éprouvés par la guerre civile. L'insurrection,
née dans le département de Maine-et-Loire, s'y étendit promptement.
Au lieu de disperser l'histoire de la guerre civile dans ce
département, en rattachant le récit de chacun des faits à la
notice des localités diverses qui en furent le théâtre, nous
croyons que, réunis ici, on en saisira mieux la suite, et qu'ils
offriront plus d'intérêt.
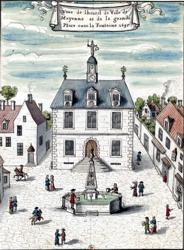
Après sa défaite à Cholet survenue le
17 octobre 1793, l'armée vendéenne passa la Loire, se jeta sur
la rive droite, et, sans éprouver de résistance, traversa Château-Gontier
et Laval. L'armée républicaine ignorait la direction que les
Vendéens avaient pu suivre. Après quelques hésitations entretenues
par de faux rapports qui les représentaient comme totalement
anéantis, on apprit que la colonne fugitive présentait encore
un effectif de trente ou quarante mille hommes en état de tenir
tête aux républicains. On se décida alors à s'avancer par Château-Gontier.
Westermann et Beaupuy commandaient l'avant-garde, Kléber suivait
avec le corps d'armée. Le chef nominal, que son incapacité,
sentie par tous et même par lui, tenait en réalité en dehors
du commandement, était Séchelles il laissait Kléber diriger
tous les mouvements.
Le 25 octobre au soir, l'avant-garde
républicaine arriva à Château-Gontier le gros des forces était
à une journée en arrière. Westermann, quoique ses troupes fussent
très fatiguées, quoiqu'il fit presque nuit et qu'il restait
encore six lieues de chemin à faire pour arriver à Laval, voulut
y marcher sur-le-champ. Beaupuy, tout aussi brave, mais plus
prudent que Westermann, s'efforça en vain de lui faire sentir
le danger d'attaquer la masse vendéenne au milieu de la nuit,
fort en avant du corps d'armée et avec des troupes harassées
de fatigue. Beaupuy fut obligé de céder au plus ancien en commandement.
On se mit aussitôt en marche. Arrivé à Laval au milieu de la
nuit, Westermann envoya un officier reconnaître l'ennemi ; celui-ci,
emporté par son ardeur, fit une charge au lieu d'une reconnaissance,
et replia rapidement les premiers postes. L'alarme se répandit
dans Laval, le tocsin sonna, toute la masse ennemie fut bientôt
debout et vint faire tête aux républicains. Beaupuy, se comportant
avec sa fermeté ordinaire, soutint courageusement l'effort des
Vendéens. Westermann déploya toute sa bravoure, le combat fut
des plus opiniâtres, et l'obscurité de la nuit le rendit encore
plus sanglant. L'avant-garde républicaine, quoique très inférieure
en nombre, serait néanmoins parvenue à se soutenir jusqu'à la
fin; mais la cavalerie de Westermann, qui n'était pas toujours
aussi brave que son chef, se débanda tout à coup, et l'obligea
à la retraite. Grâce à Beaupuy, elle se fit sur Château-Gontier
avec assez d'ordre. Le corps de bataille y arriva le jour suivant.
Toute l'armée s'y trouva donc réunie le 26, l'avant-garde épuisée
d'un combat inutile et sanglant, le corps de bataille fatigué
d'une route longue, faite sans vivres, sans souliers et à travers
les boues de l'automne. Westermann et les représentants voulaient
de nouveau se porter en avant. Kléber s'y opposa avec force
et fit décider qu'on ne s'avancerait pas au-delà de Villiers,
moitié chemin de Château-Gontier à Laval.
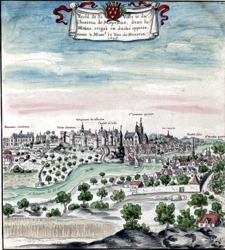
Il s'agissait de former un plan pour
l'attaque de Laval. Cette ville est située sur la Mayenne. Marcher
directement sur la rive gauche que l'on occupait était imprudent,
comme le fit observer judicieusement un officier très distingué,
Savary, qui connaissait parfaitement les lieux. Il était facile
aux Vendéens d'occuper le pont de Laval et de s'y maintenir
contre toutes les attaques ; ils pouvaient ensuite, tandis que
l'armée républicaine était inutilement massée sur la rive gauche,
marcher le long de la rive droite, passer la Mayenne sur les
derrières et l'accabler à l'improviste. Il proposa donc de diviser
l'attaque et de porter une partie de l'armée sur la rive droite.
De ce côté, il n'y avait pas de pont à franchir, et l'occupation
de Laval ne présentait point d'obstacle. Ce plan, approuvé par
les généraux, fut adopté par Séchelles. Le lendemain, cependant,
Séchelles, qui sortait quelquefois de sa nullité pour commettre
des fautes, envoie l'ordre le plus sot et le plus contradictoire
à ce qui avait été convenu la veille. Il prescrit, selon ses
expressions accoutumées, de marcher majestueusement et en
masse sur Laval, en longeant par la rive gauche. Kléber
et tous les généraux sont indignés cependant il faut obéir.
Beaupuy s'avance le premier, Kléber le suit immédiatement. Toute
l'armée vendéenne était déployée sur les hauteurs d'Entrammes.
Beaupuy engage le combat, Kléber se déploie à droite et à gauche
de la route, de manière à s'étendre le plus possible. Sentant
néanmoins le désavantage de cette position, il fait dire à Séchelles
de porter la division Chablos sur le flanc de l'ennemi, mouvement
qui devait l'ébranler. Mais cette colonne, composée de ces bataillons
formés à Orléans et à Niort, qui avaient fui si souvent, se
débande avant de s'être mise en marche. Séchelles s'échappe
le premier à toute bride, une grande moitié de l'armée qui ne
se battait pas fuit en toute hâte, ayant Séchelles en tête,
et court jusqu'à Château-Gontier, et de Château-Gontier jusqu'à
Angers. Les braves Mayençais, qui n'avaient jamais lâché pied,
se débandent pour la première fois. La déroute devient alors
générale ; Beaupuy, Kléber, Marceau, les représentants Merlin
et Turreau, font des efforts incroyables, mais inutiles, pour
arrêter les fuyards. Beaupuy reçoit une balle au milieu de la
poitrine. Porté dans une cabane, il s'écrie « Qu'on me laisse
ici, et qu'on montre ma chemise sanglante à mes soldats. » Le
brave Bloff, qui coin mandait les grenadiers, et qui était connu
par sa bravoure extraordinaire se fait tuer à leur tête. Enfin
une partie de l'armée s'arrête au Lion-d’Angers, l'autre fuit
jusqu'à Angers même. L'indignation était générale contre le
lâche exemple qu'avait donné Séchelles en fuyant le premier.
Les soldats murmuraient hautement. Les représentants du peuple
suspendirent Séchelles et proposèrent le commandement à Kléber,
qui le refusa, puis à Chablos, le plus vieux général de l'armée,
qui l'accepta.
Pendant ce temps, les Vendéens arrêtés à Laval,
quoique débarrassés de leurs adversaires, ne savaient quel parti
prendre. Entre tous ceux qui se présentaient, ils choisirent
le plan qui, en les rapprochant de la côte, leur permettait
de recevoir des secours des Anglais. Ils se dirigèrent vers
le département de la Manche.
Leur armée s'était recrutée
d'un grand nombre de combattants à Laval et à Mayenne. « L'esprit
public, dit le général Turreau dans ses Mémoires, y était perdu,
et, d'ailleurs, le prince de Talmont y avait la plus grande
influence. Je me suis assuré sur les lieux qu'a parcourus cette
armée des causes de son accroissement progressif je les ai trouvées
dans le recrutement volontaire et forcé qu'elle a fait depuis
Varades, Ancenis, Oudon, et autres points sur le rivage de la
Loire, jusqu'à son arrivée à Laval, où le recrutement fut généralement
spontané. »
Cependant, quelques jours plus tard, vaincus
dans le nord par Kléber, Marceau et Westermann, les Vendéens,
diminués des deux tiers, se rabattirent sur le département de
la Mayenne, traversèrent de-nouveau Laval sans s'y arrêter ;
ils devaient être écrasés au Mans le 23 décembre suivant. Ils
s'y étaient abondamment pourvus de tout ce qui leur était nécessaire
par un moyen emprunté à la Révolution elle-même, en créant pour
neuf cent mille livres tournois de bons hypothéqués sur le
trésor royal et remboursable à la paix ; ordre fut intimé
aux Lavalois d'accepter ce papier en échange de leurs marchandises.

L'armée vendéenne, bien approvisionnée,
se mit en marche vers le département de la Manche. Après ce
désastre, le prince de Talmont, irrité de l'ingratitude des
siens qui lui refusent le commandement des derniers débris de
l'armée, les quitte, et, déguisé en meunier, errant de village
en village, il se dirigeait vers Laval, lorsqu'il fut arrêté
à Bazouges par une patrouille de la garde nationale. Il mourut
sur l'échafaud, à Laval, le 28 janvier 1794.
Cependant la
guerre civile se ranima bientôt sous une autre forme. Les quatre
frères Cottereau, dits Chouan, du département de la Mayenne,
donnèrent leur nom à la chouannerie. « Les chouans, dit M. Thiers,
ne formaient pas ; comme les Vendéens, des rassemblements nombreux,
capables de tenir la campagne ils marchaient en troupes de trente
ou quarante, arrêtaient les courriers, les voitures publiques,
assassinaient les juges de paix, les maires, les fonctionnaires
républicains, et surtout les acquéreurs des biens nationaux.
Quant à ceux qui étaient non pas acquéreurs, mais fermiers de
ces biens, ils se rendaient chez eux et se faisaient payer le
prix du fermage. Ils avaient ordinairement le soin de détruire
les ponts, de briser les routes, de couper l'essieu des charrettes,
pour empêcher le transport des subsistances dans les villes.
Ils faisaient des menaces terribles à ceux qui apportaient leurs
denrées dans les marchés, et ils exécutaient ces menaces en
pillant et incendiant leurs propriétés. Ne pouvant pas occuper
militairement le pays, leur but évident était de le bouleverser,
en empêchant les citoyens d'accepter aucune fonction de la République,
en punissant l'acquisition des biens nationaux et en affamant
les villes. Moins réunis, moins forts que les Vendéens, ils
étaient cependant plus redoutables, et méritaient véritablement
le nom de brigands. Le département de la Mayenne était très
bien disposé pour cette guerre de partisans ce terrain inégal,
coupé d'un grand nombre de ruisseaux, de ravins, de haies bordant
les chemins, formés d'un talus couvert de buissons et protégé
par un fossé, offre un grand nombre d'arbres, chênes, hêtres,
châtaigniers, dont on a coupé la tige à une certaine hauteur,
et dont le tronc fort gros se creuse par en haut. On les nomme
émousse. Les chouans y cachaient leurs armes et leurs provisions,
et s'y cachaient souvent eux-mêmes. Dans un des cantons du département,
bien des années après la guerre, on découvrit dans un de ces
arbres que l'on abattait le squelette d'un chouan qui était
venu y mourir. Son fusil était placé à côté de lui, et entre
les doigts du squelette se trouvait encore un chapelet.
Aubert-Dubayet,
après s'être entendu à Laval avec le général Hoche, se mit à
la tête d'une colonne mobile, et par son activité, ses courses
incessantes, lassa bientôt les chouans. Le vicomte de Cepeaux,
qui commandait une des troupes les plus nombreuses, fut contraint
de déposer les armes, deux mille fusils furent remis et apportés
à Laval. Plus tard la chouannerie recommença, et le comte de
Beaumont, un des chefs des chouans, battit près de Laval un
détachement de troupes de ligne et de garde nationale. Mais,
défait par le général Chabot, il fit sa soumission au- gouvernement
consulaire. Ce département fut encore agité en 1832, lors de
la descente de la duchesse de Berry dans la Vendée. Des rencontres
eurent lieu entre les chouans et les soldats sur quelques points
du département, entre autres à La Gravelle, près de Laval. Le
département fut mis en état de siège, et la tranquillité ne
tarda pas à s'y rétablir.
Depuis ces événements le département
de la Mayenne avait joui d'une paix profonde quand la guerre
de 1870-1871 vint la troubler. L'ennemi n'occupa que momentanément
quelques points de son territoire il s'arrêta en réalité sur
les confins, à Sillé-le-Guillaume, à Saint-Denis-d'Orgues et
à Sablé-sur-Sarthe, dans le département de la Sarthe; mais notre
deuxième armée de la Loire, sous les ordres du général Chanzy,
s'y rallia, après la bataille du Mans. Nous avons raconté ailleurs
les départements du Loiret, de Loir-et-Cher et de la Sarthe),
les péripéties de cette lutte émouvante et de cette héroïque
retraite de nos jeunes soldats, à peine armés, mal chaussés,
mal vêtus, accablés de fatigues. Après la perte de la bataille
du Mans le 11 janvier, il fallut se résigner à la retraite,
qui fut favorisée par le brouillard. L'armée française s'était
dérobée sans déroute ; mais elle laissait aux mains de l'ennemi
18,000 prisonniers et 20 canons ; La poursuite continua jusqu'à
Laval. Le 17 janvier, après avoir livré, le 14, des combats
offensifs heureux aux troupes allemandes, à Saint-Jean-sur-
Erve et à Sillé-le-Guillaume, l'armée du général Chanzy continua
son mouvement et occupa des positions autour de Laval. Le 16ème
corps passe la Mayenne sur les ponts de la ville, se reliant
avec la droite du 17ème corps et protégeant les convois
qui filent par la grande route du Mans, se plaçant à cheval
sur la route et sur le chemin de fer de Laval à Vitré le 170
corps, derrière la rivière, dont il observe le cours jusqu'au
pont de Montgiroux le 21ème, sa gauche à la ville
de Mayenne, sa droite à Contest, relié avec le 17ème
corps par sa cavalerie, le quartier général à Laval, la division
de cavalerie du 17" corps en arrière des lignes. Une fois encore,
grâce à l'habile retraite de son chef, l'armée de la Loire était
conservée à la France. Les Allemands rétrogradèrent. Toutefois,
il fallait au général Chanzy quelques semaines pour se refaire.
L'armistice, conclu le 28 janvier, vint le surprendre et. l’arrêté
au milieu de sa réorganisation
Laval

Laval parait devoir son origine à un
antique château bâti dans le VIIIème siècle pour
arrêter; les courses des Bretons. Cette forteresse fut détruite
par les Danois ou par les Normands, et rebâtie en 840 par Guyon,
troisième, fils de Guy-Valla, comte du Maine. Plusieurs habitations
s'étant groupées autour du château formèrent en peu de temps
une petite ville que Guy on fit entourer de murailles et de
tours. Au XIIème siècle, Laval devint le chef-lieu
d'une baronnie, à laquelle fut attaché le surnom de Guy par
le pape Pascal II, vers l'an 1101, en faveur de Guy IV, baron
de Laval, et de ses descendants, pour les services qu'il avait
rendus à la chrétienté dans la terre sainte, sous Godefroy de
Bouillon ; privilège qui fut confirmé par lettres patentes du
roi de France Philippe Ier. Sous Charles VII, cette
baronnie devint un comté, qui fut érigé en duché par Louis XI
en 1481. Dans le XVème " siècle, Laval était une
ville importante ; l'Anglais Talbot la prit en 1466, mais elle
fut reprise par les Français l'année suivante.
C'est dans
les environs de Laval qu'à pris naissance la chouannerie : quatre
villageois, les frères Chouan, en furent les créateurs et les
premiers chefs.
Les environs de Laval ont été le théâtre
d'une bataille sanglante en octobre 1793. Les républicains éprouvèrent
une perte immense en hommes, bagages et artilleries; quinze
mille d'entre eux qui s'étaient réfugiés derrière les murs d'Angers,
purent à peine achever de se réorganiser dans! l'espace de douze
jours. Le général Léchelle ne put survivre à ce grand désastre
en butte aux insultes de ses propres soldats et aux menaces
de-Merlin de Thionville, il mourut peu après à Nantes, de honte
et de douleur. Il avait obtenu, quelque temps avant cette malheureuse
affaire, trois brillantes victoires sur les Vendéens mais la
défaite de Laval les avait effacées
Laval est une ville bâtie
dans une situation pittoresque, sur la pente d'un coteau au
pied duquel coule la Mayenne. On y arrivé du côté de la ville
de ce nom, par un beau faubourg qui forme, en population et
en étendue, environ un tiers de la ville avec laquelle il communique
par un beau pont en pierre dé taille.
Au pied de l'amphithéâtre,
dont la ville occupe le. centre, coule la Mayenne, bordée des
deux côtés par des maisons irrégulièrement bâties les unes en
saillie les autres en retraite ; quelques terrasses, quelques
petits jardins, quelques bouquets d'arbres et quelques tapis
de verdure s'entremêle à ces habitations et concourent à former
deux rives extrêmement confuses, qui ne sont agréables que par
leur variété, mais belles pour là peinture ; aussi ce point
de vue a-t-il été souvent dessiné.
Sous le pont la rivière s’étend en nappe
; plus haut et plus bas, elle se précipite tout entière en cascade
par, des chaussées de moulins dont l'inégale structure répond
à l'inégalité des deux rives de là Mayenne. Les méandres que
décris cette rivière sont interrompus, à gauche, par l'église
gothique d'Avenières, dont le clocher pyramidal couronne heureusement
la perspective ; à droite la vue est bornée par le monticule
pittoresque de Bel-Air, sur lequel s'élève une charmante habitation,
bâtie dans une situation des plus délicieuses, son enclos embrasse
à la fois le sommet et le pied le flanc et les escarpements
de la colline; lé plateau est occupé par la maison et ses jardins,
par des plantations et des allées, le bas par d'autres allées
et par un vaste tapis de prairies qui s'étendent le long de
là rivière, et qui se développent en tous sens au milieu des
rochers, des mousses, des grottes et des fontaines, en un mot
de tout ce que là nature a de plus frais et de plus romantique.
Après le jardin d Bel-Air les étrangers voient avec intérêt
ceux de la Perinne dont les terrasses fixent agréablement les
regards lorsqu'on passe sur le pont.
La Ville est ceinte
d'un cordon de murailles fortifiées dont quelques parties sont
assez bien. conservées. Elle est généralement mal bâtie, et
ne présente qu'un entassement de vieilles maisons séparées par
deux rues aussi noires qu'escarpées, aussi étroites que tortueuses.
Une de ces rues se prolonge sous des maisons voûtées; une autre,
également couverte, est percée: en galerie et l'on ne peut rien
voir de plus triste et de plus malpropre que cette singulière
rue. La rue qui s'ouvre vis-à-vis du pont gravit directement
et si rapidement là colline, qu'on la croirait inaccessible
aux voitures; si l'on ne voyait rouler, sur son pavé de marbre,
des chariots trainés à pas lents par des chevaux et des bœufs
; une rue large, bien bâtie et d'un accès beaucoup plus; facile
conduit de la partie haute de la ville dans le faubourg de Bretagne.
La plupart des maisons qui bordent ces rues sont construites
en bois et remarquables par leur ancienneté, il en est qui n’ont
pas moins de six à sept cents, ans d'existence, et qui ne sont
point encore dégradées : elles étonnent les curieux et les Voyageurs
par les poutres d'une longueur et d'une grosseur peu communes
que l’on y remarque. Là tradition veut que ces poutres proviennent
des chênes que l'on a abattus sur la place même où les maisons
sont construites ; ce qui parait d'autant plus probable, que
l’on concevrait difficilement comment en aurait pu transporter
d'un lieu plus éloigné ces énormes masses de bois.
Au milieu
du triste groupé de bâtiments qui composent la ville s'élève
sur lé bord de la Mayenne un énorme et antique château, surmonté
d'une haute tour ronde qui en forme le donjon. Cette ancienne
demeure des ducs de Laval, fut celle de la famille de la Trémoille.
Pendant la Révolution française, la famille de la Trémoille
est dépossédée du château, et celui-ci devient un bien public.
Le Vieux-Château est transformé en prison, et le Château-Neuf
devient un palais de justice3. La tour de la Poterne, la Chambre
dorée qui se trouvait dessus ainsi que le Petit Château sont
détruits en 1794.
Château-Gontier

Cette ville doit son origine à un château
fort, construit au commencement du XIème siècle par
Foulques Néra, comte d'Anjou, et démoli par ordre de Louis XIII.
Le lieu ou Foulques établit son château portait le nom de Basilica
(Bazoche;) le comte d'Anjou lui donna le nom de Gontier, chevalier
auquel il en confiait la garde. Il s'y est tenu cinq conciles
provinciaux, en1231, 1254, 1269, 1336 et 1448: l'archevêque
de Tours, Juhel de Mayenne, présida le concile en1336. Château-Gontier
était entouré de fortifications, mais il ne parait pas que cette
ville ait été assiégée dans les guerres du XIV et du XVème
. siècle. Louis XI y a fait sa résidence pendant quelques mois.
Les Vendéens la prirent le 21 octobre1793, et l'évacuèrent
peu de temps après.
Château Gontier est agréablement situé
au milieu d'une riante campagne c'est une ville mal percée mais
assez bien bâtie, sur la Mayenne, que l'on y passe sur un pont
de pierre, qui la sépare de son principal faubourg. Elle possède
une jolie promenade d'où l'on jouit d'une vue délicieuse sur
le bassin de la Mayenne dont les rives sont bordées de noyers,
de vergers, de prairies, et dominées par des escarpements ombragés
qui produisent un effet très pittoresque. Il ne reste de l'ancien
château qu'un pan de mur qui fait partie d'une maison . Le site
que ce château occupait est devenu une place, sous la quelle
la tradition prétend qu'il existe d'anciens souterrains qui
s'étendent jusqu'à la rivière.
On trouve aux environs une
source d'eau minérale.
Mayenne

L'origine de Mayenne est peu connue :
son histoire certaine ne remonte pas au delà du IXème
siècle. C'était autrefois une place importante, défendue par
des fortifications considérables, etl par un château fort qui
passait pour imprenable.
Cette ville a soutenu plusieurs
sièges : le plus remarquable est celui de 1424, où elle eut
à se défendre contre l'armée anglaise commandée par le comte
de Salisbury ; ce siège dura trois mois ; la ville soutint quatre
assauts , et ne se rendit qu'après avoir obtenu une capitulation
honorable.
Mayenne a porté primitivement le nom de Mayenne
la Jubel, nom de celui de ses seigneurs qui fit bâtir le château.
Celait une baronnie appartenant à la maison de Lorraine et de
Guise, que François Ier érigea en marquisat en 1544
: Charles IX l'érigea en duché-pairie en faveur de Charles de
Lorraine qui prît le nom de Mayenne , et devint ensuite chef
de la Ligue.
Cette ville est irrégulièrement bâtie sur le
penchant de deux coteaux qui bordent les rives de la Mayenne.
Le quartier de la rive droite, le plus élevé des deux, est la
ville proprement dite ; celui de la rive gauche n'est qu'un
faubourg, mais ce faubourg renferme à lui seul un tiers de la
population totale. La grande roule de Brest en rase l'extrémité
et laisse la ville à droite pour continuer sa direction en face.
Le voyageur en poste n'y entre que pour relayer s'il se dirige
sur Laval, mais il traverse la ville dans toute sa longueur
s'il suit la direction de Fougères, qui l'oblige à subir toutes
les difficultés et les aspérités de ce trajet, c'est-à-dire
à descendre la rue extrêmement escarpée qui conduit au pont
jeté sur la Mayenne , et à gravir la rampe plus difficile encore
qui conduit an haut de la ville. C'est un spectacle curieux
.pour un étranger que l'ascension des charrettes chargées du
bas de la côte à son sommet : en été, on attelle jusqu'à huit
chevaux et quatre bœufs à une seule voilure; en hiver on est
quelquefois obligé d'atteler jusqu'à trente bêtes, tant bœufs
que chevaux. Les rues de Mayenne sont généralement mal percées
et bordées de vieilles maisons dont l'aspect a quelque chose
de bizarre ; on y trouve des habitations de construction moderne
. mais qui n'ont rien de remarquable. Dans la partie élevée
de la ville on voit une vaste place publique décorée d'une assez
jolie fontaine : un des côtés est occupé par la façade d'un
hôtel de ville moderne, derrière lequel est une autre place
presque aussi .grande que la première. Sur la rive droite de
la Mayenne s'élève le vieux château des seigneurs de Mayenne
, qui domine le pont d'une manière pittoresque ; il est séparé
d'un bâtiment qui en dépendait autrefois , el qui sert aujourd'hui
de halle aux toiles, par une terrasse plantée d'arbres dont
on a fait une promenade publique. La ville proprement dite n'a
qu'une église paroissiale fort petite, dont la nef est assez
jolie.