Histoire de la Meurthe-et-Moselle
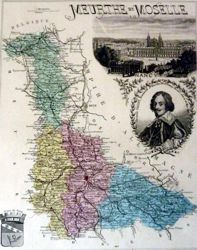
Le département de Meurthe-et-Moselle
fut créé le 7 septembre 1871, à partir des territoires des départements
de la Meurthe et de la Moselle que le traité de Francfort avait
laissés à la France. Les arrondissements de la Meurthe (Lunéville,
Nancy et Toul), restés français comme celui de Briey en Moselle
furent associés pour constituer le nouveau département de la
Meurthe-et-Moselle. Les autres arrondissements de la Meurthe,
ceux de Château-Salins et de Sarrebourg, de même que le reste
de la Moselle, furent quant à eux rattachés à l'Empire allemand
jusqu'en 19181.
La limite actuelle entre les départements
de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle correspond précisément
à la frontière franco-allemande entre 1871 et 1919. Cette limite
servit à nouveau de frontière de fait après l'annexion illégale
des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
par les nazis entre 1940 et 1944.
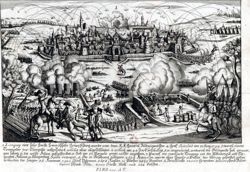
Histoire du département de la Meurthe-et-Moselle.
Adolphe JOANNE 1881
Les peuples qui habitèrent primitivement
le territoire actuel du département de Meurthe-et-Moselle furent
les Leuci ou Leukes, de la confédération des Belges, qui s’étendaient
le long du cours de la Meuse, de la Moselle et de la Seule.
Leur capitale était Toul, appelée Tullum, qui avait une importance
assez grande à l’époque de l’invasion de César. Ses habitants,
habiles à lancer les dards, prirent parti pour le conquérant.
Cette région fit ensuite partie de la cité de Toul, qui était
divisée en pagi ou cantons :
1° celui du Chaumontois, vaste
territoire compris entre les sources de la Moselle, de la Meurthe
et de la Sarre, jusqu’au confluent des deux premières rivières
au-dessus de Custines;
2° le Saintois, contrée qui comprenait
le pays de Vaudémont et était situé entre le Chaumontois et
le Toulois. Elle ne comptait alors aucune ville importante,
mais seulement quelques stations militaires et des établissements
agricoles sur le bord des rivières, comme Pompey, Champigneulles,
etc.
Les Romains la colonisèrent promptement. Toul, Scarponne
virent s’élever dans leurs murs de beaux monuments; des routes
sillonnèrent les campagnes: les voies les plus importantes étaient
celle venant de Reims par Toul, Scarponne et Metz, et trois
autres qui passaient aussi à Scarponne. Mais le sommet des montagnes
resta couvert de forêts.
Sous Constantin, le pays des Leuci,
avec ceux des Mediomatrici et des Treviri, forma la province
de la première Belgique. On éleva alors un grand nombre de camps
fortifiés sur la crête des montagnes et sur le bord de la Moselle,
de Bayon à Metz, pour arrêter les invasions des Germains. C’est
dans une de ces invasions, en 366, que Jovinus, général romain,
les défit non loin de Pont-à-Mousson.
Il existait alors
des établissements romains à Dieulouard, à Sion, hameau de Saxon,
qui était une ville, à Tantonville, à Lunéville, à Dommartin-lès-Toul,
à Villers et à Gondreville. A Blénod, était un fort en ligne
avec ceux de Saint-Mihiel et de Bagneux; à Chavigny, dans la
forêt, à la source du ruisseau de Bonne-Fontaine, s’élevait
un petit temple dédié à Hercule Bibax, auquel les Leukes paraissent
avoir voué un culte.
Le christianisme fut prêché chez les
Leukes au troisième siècle par saint Mansuy, qui fut le premier
évêque de Toul. Saint Euchaire fut martyrisé près de Pompey,
par ordre de Julien.

Tout était au quatrième siècle une place
importante, commerçante et bien fortifiée. Mais, au commencement
du cinquième siècle, cette ville fut saccagée par les Barbares
comme Metz. Trêves et Scarponne, détruite par Attila. Vers 450,
elle tomba au pouvoir des Francs, et, en 496, Clovis y passa.
A cette époque, le pays de Meurthe-et-Moselle dépendait du royaume
d’Austrasie, dont Metz était la capitale.
Sous les Mérovingiens,
la ville de Toul, qui avait été un municipe romain, passa avec
le pays sous le gouvernement des comtes, assistés de sept juges
ou échevins élus.
Pendant les guerres entre Dagobert Il,
roi d’Austrasie, et Théodoric III, roi de Neustrie, le pays
eut beaucoup à souffrir (vers 680) ; Toul fut prise et brûlée
plusieurs fois.
Les rois francs avaient des palais à Savonnières
et à Vendières, où ils venaient tenir des plaids et recevoir
leurs leudes.
Par le traité de Verdun (845), la Meuse devint
frontière de la France, et les terres de la rive droite furent
attribuées à l’empereur Lothaire; son fils, Lothaire II, premier
roi de Lorraine (855-869), donna son nom au pays. Il se tint
alors au palais royal de Savonnières, à deux kilomètres de Toul,
une grande assemblée politique et religieuse.
Les souverains
carlovingiens de France et d’Allemagne se disputèrent longtemps
la possession de la Lorraine, qui perdit le titre de royaume.
Toul fut prise et pillée, en 954, par les Hongrois, et, en 957,
par les soldats de Lothaire; Scarponne, un instant relevée,
eut le même sort.
Les évêques de Toul, qui avaient acquis
une grande puissance depuis le septième siècle, reçurent, en
928, d’Henri l’Oiseleur, empereur d’Allemagne, le comté de Toul
en fief. Leur diocèse avait une grande étendue. En 984, l’évêché
de Toul, distrait. de la Haute-Lorraine, formait une souveraineté
indépendante qui ne relevait que de l’empereur.
La Lorraine
mosellane, distraite de la Basse-Lorraine par le duc Brunon,
archevêque de Cologne, continua à avoir des ducs bénéficiaires
jusqu’en 1048 : Briey en faisait partie.
A cette époque,
la Haute-Lorraine fut constituée en duché et gouvernée par Gérard
d’Alsace et ses descendants jusqu’en 1451. Ces seigneurs furent
des amis fidèles de la France et moururent à son service.
En 1072, l’empereur Henri VI créa le comté de Vaudémont
en faveur de Gérard 1er. Gérard II augmenta la ville et y construisit
une tour près du château. Le fief relevait directement de l’empereur
; sa capitale était Vézelise, et le comté comprenait 57 villes
ou villages. Au douzième siècle, les bourgeois de Toul perdirent
une bataille assez considérable contre le comte de Vaudémont;
le château de Dieulouard fut pris deux fois par les Messins,
qui le rasèrent.
En 1112, Renaud, comte de Bar, ruina de
nouveau Scarponne, déjà détruite lors de l’invasion d’Attila.
Mathieu, duc de Lorraine, qui se distingua par sa charité envers
les pauvres, établit la capitale de son duché à Nancy (1153),
qui jusqu’alors n’était qu’un village et qui lui fut cédé par
Drogo, fils du sénéchal de Lorraine, en échange de la châtellenie
de Rosières et d’autres terres. La résidence des premiers ducs
avait été jusque-là à Saint-Dié. Mathieu fonda l’abbaye de Clairlieu
(1159). Liverdun fut affranchi en 1178 par l’évêque de Toul,
seigneur de ce lieu. C’est à la fin du douzième siècle que commence
à être connue en Lorraine la loi ou coutume de Beaumont-en-Argonne
cette fameuse loi de Beaumont, donnée en 1182 par Guillaume
de Champagne, archevêque de Reims, réglait les droits des seigneurs,
l’organisation municipale, la justice, la police, etc.
Au
treizième siècle, l’affranchissement des communes s’étend dans
la Lorraine, et la loi de Beaumont est accordée à un grand nombre
de villes et de villages. En 1200, Pont-Saint-Vincent la reçoit
d’Hugues, comte de Vaudémont, qui y avait bâti une ville neuve.
D’autres villes et villages la reçurent alors de leurs seigneurs,
comme Frouard (1255), Haumeville (1261), Saint-Nicolas-du-Port,
Nancy, Lunéville, Gerbéviller, du duc Ferry III (1265) ; Saxon
(1260). Essey et Maizerais furent affranchis et mis sous la
loi de Stenai par Thibaut, comte de Bar, en 1289.

Eu 1250, eut lieu, dans les plaines de
Frouard et de Champigneulles, une bataille sanglante entre Henri
II, comte de Bar, et Mathieu II, duc de Lorraine ; celui-ci
la perdit.
Le treizième siècle vit encore d’autres guerres
locales en 1250, entre les bourgeois de Toul et leur évêque;
entre Thibaud, comte de Bar, et les troupes de l’évêque de Metz,
qui brûlèrent Thiaucourt (1258). En 1288, Ferry III, duc de
Lorraine, qui, pendant son long règne, avait développé dans
ses états l’affranchissement des serfs, fut enlevé par des barons
de son duché dans les bois de Heys et emmené dans le château
de Maxéville, où il resta longtemps prisonnier.
Fn 1298,
le comte de Vaudémont, faisant la guerre au duc de Lorraine,
envahit la Lorraine avec 600 hommes et brûla Maxéville.Après
la ruine du château de Velaine, au treizième siècle, une nouvelle
ville s’éleva, celle de Vézelise, qui devint plus tard le chef-lieu
du comté de Vaudémont.
Au commencement du quatorzième siècle,
des guerres locales causent de grands dommages aux villages
de la Lorraine. Vers 1306, Laxou est brûlé par le comte de Vaudémont,
qui guerroyait contre le duc Thibaud II. En 1508, le même duc
bat devant Frouard Renaud de Bar, évêque de Metz, ligué avec
les comtes de Bar et de Salm ; ces derniers sont faits prisonniers
et l’évêque demande la paix. Les Toulois étaient alors fort
belliqueux; réunis aux Messins, ils mirent en déroute à Dieulouard
et à Gondreville cinquante gentilshommes du pays, qui leur avaient
déclaré la guerre à cause de leur esprit d’indépendance.
Toul était au quatorzième siècle sous la protection du roi de
France cependant, l’empereur Charles IV, qui était venu dans
cette ville en 1556, accorda, dix ans après, aux habitants une
charte confirmative de leurs privilèges, appelée la Bulle d’Or
à cause du sceau en or qui y était suspendu.
Les ducs de
Lorraine du quatorzième siècle combattent avec dévouement dans
les rangs de l’armée française. Ferry IV fut tué à la bataille
de Cassel (1328). Raoul, dit le Vaillant, après avoir bataillé
contre les Maures en Espagne et le comte de Montfort en Bretagne,
fut tué à la journée de Crécy (1346). Jean Ier chassa de ses
états les Grandes compagnies.

De nouvelles guerres locales troublèrent
encore la Lorraine au milieu du quatorzième siècle. Les Messins
l’envahirent (1350), en représailles des courses faites par
la duchesse Marie de mois sur leurs terres, ils prirent et pillèrent
le château de Frouard, et Rosières, qu’ils reprirent encore
vingt ans après.
La même année 1350, la duchesse de Lorraine
s’empara de Liverdun pour se venger des ravages que les troupes
de l’évêque de Toul avaient exercés en Lorraine. Cette ville
appartenait aux évêques de Toul, qui avaient le droit de battre
monnaie.
Les bourgeois de Toul se montrèrent plusieurs fois
très-belliqueux contre le duc Chartes Il. Ce prince ayant exigé
la somme de cent livres qui lui était due comme gardien de Toul,
les bourgeois la refusèrent. Le duc assiégea la ville, et les
bourgeois capitulèrent après deux mois de siège. En 1421, une
nouvelle querelle entre les Toulois et le duc ramena celui-ci
encore devant la ville, et les habitants se soumirent.
Les
ducs de Lorraine furent, au quinzième siècle, plus intimement
mêlés aux affaires de la France, et Chartes le Hardi donna sa
fille unique en mariage à René d’Anjou, prince français, déjà
assuré du duché de Bar et de la terre de Briey par son oncle
le cardinal, duc de ce pays. Mais les Bourguignons avaient en
Lorraine un allié, le comte de Vaudémont, neveu de Chartes le
Hardi, qui prétendit qu’en vertu de la loi salique le duché
de Lorraine lui appartenait. Vaincu à Bulgnéville (1431) par
Antoine de Vaudémont et les Bourguignons, René d’Anjou fut emmené
captif à Dijon, où il demeura longtemps prisonnier dans une
tour du palais des ducs qui existe encore. Les pays de Meurthe-et-Moselle
furent fort maltraités par les troupes des deux partis. Vézelise
fut pris et pillé (1425 et 1439). Enfin, la guerre se termina
par la médiation du roi de France qui engagea René à donner
sa fille à Ferry, fils de son adversaire, le comte Antoine de
Vaudémont (1441).
René II, fils de Ferry, hérita du duché
de Lorraine en 1475. Il fut le chef de la branche de Lorraine-Vaudémont,
qui gouverna le duché jusqu’en 1737.
La Lorraine eut alors
à subir la terrible invasion de Chartes le Téméraire, duc de
Bourgogne, qui rêvait la fondation d’un nouveau royaume par
la réunion de tous ses états disséminés sur la frontière de
la France, depuis le Rhône jusqu’à la mer du Nord. Dans ce but,
il voulait s’emparer de la Lorraine et faire de Nancy sa capitale.
Après s’être fait céder quelques places fortes et le libre passage
dans le duché de Lorraine, il témoigna de nouvelles prétentions,
auxquelles René, soutenu en secret par Louis XI, répondit par
une déclaration de guerre. Charles le Téméraire envahit bientôt
la Lorraine. Il entra à Toul, qui n’opposa pas de résistance,
prit Lunéville, Briey et Pont-à-Mousson. Nancy, assiégé, capitula
après une longue défense. Lorsqu’il eut terminé sa campagne
contre les Suisses, le duc de Bourgogne se tourna de nouveau
contre René; mais il fut mis en déroute à la bataille de Nancy,
où il fut tué (1476). Le théâtre principal de l’action fut sur
le territoire de Jarville, à 3 kilomètres de Nancy. « Le lendemain
soir de la bataille, dit Guizot, le comte de Campo-Basso amena
au duc René un jeune page romain qui, disait-il, avait vu de
loin tomber son maître et saurait bien retrouver la place. A
sa suite, on se dirigea vers un étang voisin de la ville; là,
à demi enfoncés dans la vase de l’étang, étaient quelques cadavres
dépouillés. Une pauvre blanchisseuse s’était, comme les autres,
mise à cette recherche; elle aperçut briller la pierre d’un
anneau au doigt d’un cadavre dmt on ne voyait pas la face; elle
avança et retourna le corps:
« Ah! mon prince ! » s’écria-t-elle;
on accourut; en dégageant la tête de la glace où elle était
prise, la peau s’enleva ; une large blessure se découvrit. En
examinant le corps avec son médecin, son chapelain, Olivier
de la Marche, son chambellan, et plusieurs valets de chambre
reconnurent sans hésiter le duc Charles ; des signes certains,
entre autres la cicatrice de la blessure qu’il avait reçue à
Montlhéry et deux dents qui lui manquaient, mirent leur affirmation
hors de doute. » Une croix commémorative s’élève encore sur
le lieu où se passa l’événement.
C’est au duc René II que
Nancy doit sa première administration municipale; jusque-là
la ville avait peu d’importance; sous ce prince, elle prit un
certain accroissement. Le duc René II ayant doté son fils Claude
de grandes possessions en Champagne, en Picardie et dans d’autres
provinces, celui-ci se fixa à la cour de Fiance, devint un serviteur
actif du roi, et ses descendants se mêlèrent, au seizième siècle,
à tous les troubles de ce pays.
En 1522, la peste sévit
cruellement à Toul ; plus de 350 personnes périrent en deux
mois. Cette ville comptait alors 5000 habitants. Deux fois encore,
quelques années après, cette épidémie éprouva la malheureuse
ville. Charles-Quint y lit une entrée solennelle en 1544, et
les habitants lui prêtèrent serment de fidélité. Mais, l’année
suivante, les Toulois, encouragés par le cardinal de Lorraine,
passèrent un traité portant reconnaissance perpétuelle du roi
de France pour leur protecteur. Eu 1552, le roi Henri II prit
possession de Toul ; cependant l’union officielle de cette ville
et de son territoire à la France n’eut lieu qu’en 1648.
Chartes III, duc de Lorraine, qui régna de longues années (1545-1608),
s’appliqua à maintenir, autant qu’il put, la paix dans ses états,
malgré les dangers qu’il courait dans les guerres répétées entre
François Ier et Charles-Quint, et les troubles suscités pal
les guerres de religion. Il embellit Nancy, la fortifia y fonda
la ville neuve et mérita des Lorrains le surnom de Grand.
En 1552, le roi Henri II, allié avec les princes protestants
d’Allemagne contre Charles-Quint, arrive devant Metz et s’en
empare par surprise : Toul et Verdun tombent aussi en son pouvoir,
et le roi déclare qu’il veut réunir à la monarchie ces trois
villes, qui couvraient la Champagne. La Lorraine, malgré sa
neutralité, est occupée par son armée. Mais bientôt après, la
même année, l’empereur d’Allemagne recommence la guerre et marche
contre Metz avec 60,000 hommes. Le duc François de Guise la
défend avec héroïsme, et Charles-Quint est obligé d’en lever
le siège. C’est pendant ce siège que fut livré un combat au
faubourg Saint-Nicolas de Nancy entre Charles, duc d’Aumale,
et René de Rohan, avec 200 gentilshommes français et lorrains,
contre Albert, marquis de Brandebourg, à la tête d’une bande
d’aventuriers. René de Rohan y fut tué. Toul fut aussi menacé
par les Impériaux, mais sans succès.

La ville de Pont-à-Mousson dut au duc
Charles III la création d’une grande institution, l’Université,
qui date de 1572. Cette Université devint célèbre et florissante:
en 1608, elle était fréquentée par plus de 1600 élèves des familles
les plus illustres, sans compter 400 étudiants en droit et en
médecine Les Jésuites y dirigeaient l’enseignement littéraire.
Les troubles de la Ligue se firent sentir en Lorraine. Toul
fut assiégée et prise par les Ligueurs, qui la perdirent peu
après (1587). Pendant les guerres de ce temps, les princes protestants
d’Allemagne envahirent la Lorraine avec 30,000 hommes, prirent
Sarrebourg, incendièrent les faubourgs de Blâmont, qu'ils ne
purent prendre, et vinrent près de Pont-Saint-Vincent offrir
la bataille aux ducs de Lorraine et de Guise, dont l’armée était
bien inférieure en nombre à la leur. Ces princes par leur bonne
contenance et leurs manœuvres, purent éviter une déroute assurée.
Maizières fut alors brûlé par le duc de Bouillon.
C’est
à Nancy que les princes lorrains, assemblés avec d’autres seigneurs
ligueurs, dressèrent une remontrance au roi Henri III, pour
le déterminer à se déclarer chef de la Ligue (1589).
En
1590, les seigneurs, conduits par le duc Charles III, s’emparent
de Toul, après six jours de siège. Cette ville, qui avait beaucoup
souffert pendant les guerres civiles, se soumit à Henri IV,
qui la restaura et qui, en 1603, y fut reçu avec magnificence.
Le duc Charles III apporta encore de grandes réformes daims
l’organisation judiciaire. Il ordonna qu’il y eût des plaids
annuels dans la quinzaine après la Saint-Remy, dans chaque ville
et village de ses domaines et de ses vassaux. Son ordonnance
entre dans les plus grands détails sur les différents services
judiciaires, les fonctions des maires et autres gouverneurs
des villages, la police, etc. (1598).
Pendant le dix-septième
siècle, les pays du département de Meurthe-et-Moselle furent
victimes de guerres incessantes, provoquées par l’imprudence
du duc Chartes IV de Lorraine, esprit remuant et aventureux.
Ce prince, par ses intrigues avec les seigneurs contre Richelieu,
causa l’invasion de son territoire par les armées françaises.
Louis XIII envahit la Lorraine en 1631; ses armées ravagèrent
la contrée et s’emparèrent de Nancy, qui fut démantelée et appauvrie
par la famine et la peste. Le roi, qui occupa longtemps la Lorraine,
fit démanteler presque tous les châteaux forts du pays, tels
que Frouard, Pompey, Vézelise, Deneuvre et autres (1633-1636).
D’autres châteaux furent encore détruits par l’invasion des
Suédois, alliés de la France, en 1635. Saint-Nicolas-du-Port
fut pillé et incendié par eux.
En 1641, Louis XIII créa
à Toul un bailliage royal, et cette ville fut, réunie définitivement
à la France par le traité de Munster (1648). Le même bailliage
fut érigé en siége présidial pour le jugement en appel des causes
majeures (1685). Le ressort de ce siège était très-étendu ;
il fut restreint au seul Toulois par le traité de Riswyck.
Louis XIV, qui, comme Richelieu et Mazarin, convoitait la
Lorraine et cherchait une occasion pour la réunir à la couronne,
obtint du duc Charles IV, qui n’avait pas d’enfants, que ses
états seraient après sa mort réunis à la France. Son neveu le
prince Charles s’opposa à ce projet; le duc refusa d’y donner
suite et se jeta dans les bras des ennemis de la France. Mais
bientôt Louis XIV s’empara du duché (1670), qui fut pendant
les guerres de ce prince à l’abri des invasions allemandes,
mais pressuré sans pitié par les soldats français, qui démantelèrent
Lunéville.

Il ne lut rendu à ses vieux souverains
que par le traité de Riswyck, passé entre la France et l’Empire,
en 1697. Il faut en excepter des parties importantes de la Lorraine
allemande, abandonnées par le duc Charles, pour être après lui
irrévocablement et à toujours unies et incorporées à la couronne
de France.
A partir de cette époque, la contrée se releva
de ses ruines grâce à la bonne administration du duc Léopold
(1690-1729), qui fit une paix définitive avec le roi de France.
La paix, qui dura pendant tout son long règne, lui facilita
l’exécution de ses projets. En 1702, il établit le siége de
son gouvernement à Lunéville, qu’il releva de ses ruines. Le
palais que l’on y admire encore fut construit sur les dessins
du célèbre Boffrand, son architecte. Les faubourgs, l’hôpital,
les ponts sur la Vezouse furent restaurés. Le duc créa à Lunéville
un bailliage d’un ressort étendu. Il ne négligea pas non plus
la ville de Nancy, qu’il embellit et où il autorisa l’établissement
de la maison des Orphelines.
D’autre part, les fortifications
de Longwy (1682) et de Toul (1700) furent reconstruites par
Vauban, sur l’ordre de Louis XIV.
En vertu du traité de
Vienne (1736), le duc François II céda la Lorraine à Stanislas,
roi détrôné de Pologne, beau-père de Louis XV, et il reçut en
échange le duché de Toscane. Il fut stipulé dans cet acte, avec
le consentement de l’empereur d’Allemagne, que, après la mort
du vieux roi, la Lorraine reviendrait à la France.
L’installation
du roi Stanislas (1737) fut le commencement d’une ère de prospérité
sans égale pour la Lorraine, et qui valut au roi l’affection
de ses nouveaux sujets, d’abord peu favorables à ce nouveau
régime, qui s’annonçait en effet comme une transition à leur
réunion à la France.
Stanislas combla la Lorraine de nombreux
bienfaits. Les sciences et les arts, déjà florissants sous Charles
III et encouragés par le duc Léopold, reçurent de lui une plus
vive impulsion. Une bibliothèque publique fondée dans l’ancien
château de Nancy avec un caractère littéraire, amena la création
de la Société royale des sciences et belles-lettres (1751).
Stanislas établit le collège royal des médecins de Nancy et
celui des chirurgiens. Il donna 220,000 livres pour en employer
le revenu à des achats de grains destinés à secourir ses pauvres
sujets de Lorraine et de Bar, et à l’hospice Saint-Julien une
pareille somme pour la fondation de vingt-quatre places destinées
à de pauvres orphelins. Il embellit Lunéville, dont il fit son
séjour de prédilection. Il décora aussi Nancy de monuments avec
le concours des architectes Boffrand, Héré et Mique.
Le
roi Stanislas mourut à Lunéville des suites d’un accident, en
1766, généralement regretté de ses sujets.
Il s’accomplit
encore en Lorraine, dans les pays soumis à l’administration
française, des faits intéressants que nous devons signaler.
Les usages locaux de Toul et du pays toulois furent rédigés
en 1762. La ville de Baccarat vit s’établir dans son sein, en
1764, une usine appelée les verreries de Sainte-Anne, qui fut
le début des grandes manufactures de verreries et de glaces
actuelles si renommées dans le monde entier. En 1768, le château
de Lunéville fut converti en casernes où l’on put loger 6,000
chevaux. En 1770, l’ingénieur Meschini construisit à Toul le
nouveau pont sur la Moselle. La suppression de l’ordre des Jésuites
en France amena, en 1768, la translation de l’Université de
Pont-à-Mousson à Nancy. Le roi établit à Pont-à-Mousson une
école militaire annexée au collège, pour compenser la perte
qu’éprouvait cette ville (1776).

A la mort de Stanislas, la Lorraine fut
donc défînitivement réunie à la France. Elle avait la même étendue
qu’à la fin du seizième siècle, et comprenait le bailliage d’Allemagne,
aujourd’hui la Lorraine allemande, comme la Lorraine française.
Le département de Meurthe-et-Moselle était compris dans le bailliage
présidial de Nancy. Nancy était, vers la fin du dix-huitième
siècle, le siège d’une intendance de la généralité de Lorraine
et la résidence du commandant général des duchés de Lorraine
et de Bar.
Il y avait une cour souveraine de justice, des
chambres des comptes et des aides; un hôtel des monnaies et
une maîtrise générale des eaux et forêts.
En 1775, eut lieu
le démembrement du diocèse de Toul, qui était l’un des plus
vastes de l’Europe. Louis XV, voulant donner à Nancy un plus
grand éclat, obtint du pape qu’il y serait érigé un évêché,
en même temps qu’un second évêché à Saint-Dié. Le diocèse de
Toul fut considérablement réduit pour former ces nouveaux diocèses.
La Lorraine ne perdit pas sans regrets son autonomie; mais
elle fut bientôt appelée à jouer un noble rôle dans les destinées
de la patrie française pendant et depuis la révolution de 1789,
quoique ces premières années d’une ère nouvelle aient été un
peu troublées par de malheureux événements comme la révolte,
on 1790, du régiment suisse de Châteauvieux et de deux autres
régiments à Nancy, contre lesquels le général de Bouillé exerça
une répression terrible. C’est dans cette émeute que le jeune
Desilles, officier du régiment du roi, mourut percé de balles
dans le moment où, se jetant sur les canons, il voulait arrêter
l’effusion du sang.
Le département de Meurthe-et-Moselle
vit, en 1801; signer à Lunéville la paix de ce nom, entre la
France et l’Allemagne. Par ce traité, la rive gauche du Rhin
fut cédée à la France. Ses volontaires prirent une part glorieuse
aux grandes guerres de l’Empire, et plusieurs généraux distingués,
tels que Drouot, Pouget, Gouvion Saint-Cyr, sont originaires
du pays.
En 1814, les Alliés envahirent le département.
Toul résista bravement et obtint une capitulation honorable.
En 1815, cette ville échappa à l’humiliation d’être envahie.
Mais Lunéville et Nancy durent recevoir l’ennemi. Napoléon,
rentrant en France, au retour de l’île d’Elbe, rappela dans
une proclamation célèbre la résistance patriotique des paysans
Lorrains contre les envahisseurs.
La Restauration créa à
Nancy une école forestière, la seule de ce genre qui existe
en France. Chartes X, en visitant l’Est, séjourna à Lunéville,
où il inspecta le vaste champ de manœuvres. L’école normale
du département fut transférée de Toul à Nancy en1831.
Depuis cinquante ans, le département
a vu son industrie se développer et son agriculture prospérer.
L’ouverture du canal de la Marne au Rhin en 1855 et l’établissement
des chemins de fer créèrent de nombreuses voies pour l’écoulement
des produits agricoles et manufacturés. C’est dans cet état
de prospérité que la funeste guerre de 1870 surprit le pays.
Après les combats de Wœrth et de Forbach, l’armée allemande,
commandée par le prince royal de Prusse, fut dirigée sur Nancy
par le chemin de fer de Strasbourg. Le 12 août, des détachements
de cavalerie occupèrent Nancy sans résistance. Bientôt après,
le prince avait son quartier général à Lunéville, le 15 août,
et le 16 à Nancy. Le gros de l’armée du prince Frédéric-Charles
était alors à Pont-à-Mousson, qui devint un centre de réunion
de troupes allemandes cantonnées dans la contrée, à Thiaucourt,
à Dieulouard, etc., avant la bataille de Rezonville. Tout le
pays était couvert de troupes prussiennes, qui le sillonnèrent
en tous sens pendant les trois premières batailles devant Metz,
du 14 au 18 août. Mars-la-Tour fut le théâtre d’une de ces grandes
luttes où notre armée fut arrêtée par des forces décuples. On
y a érigé un monument en l’honneur des dix mille braves qui
sont tombés pour la patrie à Mars-la-Tour, Rezonville, Vionville,
Gravelotte et Saint-Privat. Toul, ville forte, fut assiégée
par le grand-duc de Mecklembourg, qui couvrait les derrières
de l’armée d’invasion sur Paris. Il y avait deux mille hommes
dans la place et 192 bouches à feu. La ville fut bombardée à
plusieurs reprises du haut du mont Saint-Michel et du mont Barine.
Après une courageuse résistance et 12 jours de siège, le feu
prenant de tous côtés, le commandant capitula (23 septembre).
L’Assemblée nationale décréta que Toul avait bien mérité de
la patrie pour sa belle défense. Longwy résista aussi vaillamment
aux Allemands ; mais, après un long investissement et un bombardement
de plusieurs jours, qui mit le feu à la moitié de la ville,
il capitula pour éviter une destruction complète..
Le département
fut lourdement chargé de réquisitions de toute nature, et foulé
par des passages innombrables de troupes ennemies. C’est à la
suite de cette cruelle guerre qu’il perdit les deux arrondissements
de Château-Salins et de Sarrebourg. Les écrivains allemands
qui ont poussé à l’annexion ont prétendu que les pays réclamés
par eux avaient été enlevés autrefois à l’Allemagne injustement,
tandis qu’ils avaient été réunis à la France en vertu de traités
publics, réguliers. D’ailleurs, l’adhésion spontanée des Lorrains
aux grandes institutions françaises de 1789, et leur patriotisme
pendant toutes les guerres de la République et de l’Empire prouvent
bien que l’union avait été ratifiée par le peuple lui-même et
n’était pas le résultat de la contrainte.
A la suite de
la perte de la plus grande partie du département de la Moselle,
l’arrondissement de Briey fut réuni au département mutilé de
la Meurthe.
Nancy


Refuge. Nancy est une ville ancienne, dont les titres historiques ne remontent pas cependant au delà du XIème siècle. En 1060 Albéric qualifie Gertrude, duchesse de Lorraine, du titre de duchesse de Nancy; mais il est présumable que celle ville existait longtemps auparavant. Dès le XIIIème siècle Nancy était la capitale du duché de Lorraine ; ce n'était toutefois encore qu'une forteresse, au centre de laquelle, se trouvait un palais assez vaste. Le duc Ferry III l'agrandit et y fit construire un magnifique palais ou château, où il faisait sa résidence. Vers 1373 le duc Jean en étendit l'enceinte, et Charles II continua les constructions commencées. Lorsque Charles le Téméraire envahit la Lorraine, Nancy était précédé de faubourgs qui furent rasés à rapproche des Bourguignons; sur leurs ruines, on, éleva des remparts, où s'immortalisa la noblesse lorraine. Ces fortifications furent considérablement augmentées de 1585 à 1621. La ville neuve fut commencée sous Charles III, mort en 1608, mais presque toutes, les constructions de cette époque ont disparu pour faire place aux beaux quartiers et aux magnifiques édifices élevés sous la bienfaisante domination de Stanislas, auquel la ville actuelle doit ses plus beaux monuments ; toutefois les habitants n'oublient pas les avantages et les bienfaits qu'ils doivent aux ducs de Lorraine. Nancy a souvent, été le théâtre de la guerre. Charles le Téméraire s'en empara eu 1475 ; la noblesse de Lorraine l’ayant repris l’année suivante, les habitants eurent à subir un nouveau siège, qui les réduisit à la dernière extrémité. Le duc René II vint à leur secours avec des forces imposantes, au moment où la famine la plus affreuse allait les forcer de se rendre, et prévint les assiégés de son arrivée par un fanal allumé sur les tours du village de St-Nicolas.

Les bourgeois reçurent René avec des marques de joie inexprimables. Ils avaient dressé sur son passage un tas d'ossements des animaux qu'ils avaient dévorés pendant le siège. Un croix fut planté près de l’étang où fut découvert le corps de Charles le Téméraire. Les Français s'emparèrent de Nancy et l'occupèrent pendant vingt-huit ans, depuis 1633 jusqu'au traité de Vincennes de 1661, qui stipulait la destruction des fortifications, ce qui fut en partie .exécuté. Louis XIV, ayant fait reprendre cette ville par Tourville en 1670 , fit relever les murailles de Nancy, qui furent de nouveau détruites en vertu du traité de Riswick, à l'exception de la citadelle et des portes de la ville neuve.
Nancy est dans une situation charmante, sur la rive gauche de la Meurthe, à l'extrémité d'un bassin fermé à l'ouest, au nord et au sud, par des coteaux très-élevés , et totalement découvert du côté du levant; des vignes tapissent les collines ; un grand nombre de belles maisons de campagne sont disséminées aux alentours et embellissent ce bassin, où l'œil s'arrête avec complaisance. De quelque côté qu'on y arrive, l'œil est agréablement surpris du paysage qu'il embrasse : par la route de Metz, on traverse une suite de jardins bien cultivés, on suit la riante vallée de la Meurthe, on aperçoit sur les collines des habitations charmantes, et l'on découvre Nancy avec ses édifices, avec ses longs faubourgs qui décorent d'une manière pittoresque les collines qui entourent une partie de la ville. Si on vient par la route de Lunéville, à peine a-t-on quitté St-Nicolas, qu'on aperçoit la chartreuse de Bosserville ; à gauche sont les magnifiques charmilles de Montaigu ; en face est le faubourg St-Pierre, long vestibule qui donne une belle idée de l'ensemble des habitations, dont il n'est que le prolongement. Les routes des Vosges, de la Bourgogne, et. de Paris par Toul, ne sont pas moins agréables dès qu'on arrive à 2 kilomètres de Nancy
Briey
Briey doit son origine à un camp romain
auquel aboutissaient trois voies militaires. Dans le VIIIème
siècle, cette ville dépendait du duché de Mosellane et passa
sous la domination des comtes de Metz, qui la cédèrent aux évêques
de la même ville, lesquels rengagèrent dans la suite aux comtes
de Bar. Agrandie et fortifiée par ses différents possesseurs
elle était défendue par une citadelle, par deux châteaux, et
par une forte enceinte de murailles, dont il reste encore de
vastes souterrains et quelques vestiges que le temps efface
tous lesjours. Les Messins l'assiégèrent en 1363 et en 1370;
le duc de Berg la saccagea en 1421; Charles le Téméraire s'en
empara en 1475.
La ville de Briey est bâtie en amphithéâtre
au pied et sur le revers d'une montagne, et se divise en haute
et basse ville. Ses jardins sont élevés en terrasse sur la pente
de la colline, dont le pied est arrosé par le Rupt-de-Mance,
qui serpente dans une agreste vallée que de superbes forêts
entourent de toutes parts.
L'église paroissiale de cette
ville a conservé dans toutes ses parties quelques ornements
d'architecture gothique ; on remarque au-dessus de l'ossuaire
un fort beau bas-relief du XVème siècle, représentant
une danse des morts qui mérite de fixer l'attention.
Lunéville
L'origine de Lunéville , ainsi que celle
de beaucoup d'autres villes, est enveloppée des plus épaisses
ténèbres. On sait seulement que des fouilles faites aux environs
firent découvrir autour d'une fontaine des médailles romaines
représentant Diane ou la Lune. La tradition rapporte qu'il y
avait en cet endroit un temple de Diane , et que Lunéville tire
son nom du culte que l'on rendait à cette déesse. L'histoire
ne parle de ce lieu avant le Xème siècle que comme
d'un hameau ou d'une maison de chasse ; c'était à cette époque
le chef-lieu d'un comté considérable, que le duc Mathieu II
réunit à ses États. Ses successeurs fortifièrent cette place,
dont Charles le Téméraire s'empara en 1476 , mais qui fut reprise
la même année par le prince de Vaudémont. Le duc de Lorraine,
Charles III, augmenta les fortifications de Lunéville, en 15S7,
pour mettre cette place en état de résister à l'armée des protestants
d'Allemagne , qui allaient en France secourir les calvinistes.
Sous Louis XIII, Lunéville fut pris et repris plusieurs fois
par les Français et les Lorrains ; les Français finirent, par
l'emporter d'assaut en 1638, après quinze jours de siège, et
en firent démolir les fortifications.
En 1801 il se tint
à Lunéville un congrès, et le 9 février fut signé en cette ville
le traité de paix qui terminait la guerre de la deuxième coalition.
D'après ce traité, le thalweeg du; Rhin, depuis sa sortie du
territoire helvétique jusqu'à son entrée sur le territoire batave
, formait la limite de là France et de l'Allemagne.
Lunéville
possède un très-beau palais, construit par Léopold, et considérablement
embelli par Stanislas : il ne reste des charmants bosquets qui
l'environnaient que celui qui sert de promenade publique. La
marquise du Châtelet, célébrée par Voltaire , a son tombeau
dans l'église paroissiale, dont l'architecture moderne mérite
d'être remarquée. Lunéville possède aussi un immense quartier
de cavalerie ; un vaste manège couvert, dont le toit est soutenu
par une charpente en bois de châtaignier hardie et bien ajustée
; un champ de Mars de deux cents hectares de superficie. C'est
une des plus belles garnisons de cavalerie qu'il y ait en France
: on y réunit assez fréquemment en automne un camp de cavalerie
pour exercer lès troupes aux grandes manœuvres.
Toul
La position de Tullum à Toul est démontrée
par les mesures des routes romaines décrites dans l'Itinéraire
d'Antonin et dans la Table de Peutinger, routes qui s'y réunissent,
et qui partent de Lingones, Langres, Augusta Trevirorum, Trêves,
et Divodurum, Metz. L'histoire nous donne le même résultat par
une suite non interrompue de monuments historiques. — La Notice
des provinces de la Gaule désigne cette ville sous le nom de
Tullo, ce qui prouve qu'elle n'avait pas changé de nom pour
prendre celui du peuple ; elle ne prit le nom de Tullum que
sous les premiers rois francs.
Sous Dagobert, elle portait
le nom de Leuci, et de Leuca dans le XIème siècle.
La ville et le diocèse de Toul dépendaient de la France
sous les rois de la première race, sous Charlemagne et Louis
le Débonnaire. Après la mort de ce dernier, ils firent partie
des États légués à Lothaire, son troisième fils, et devinrent
une province du royaume de Lorraine, dont Metz était la capitale.
En 1552, la ville de Toul fut définitivement réunie à la France.
C’était autrefois le siège d'un évêché considérable. — Au Xème
siècle, la ville de Toul n'était point entièrement fermée de
murailles ; elle n'avait d'autre enceinte que celle dite de
l'ancien château. En 1238, cette enceinte fut renversée par
ordre de Roger, évêque de cette ville, qui en fit construire
de nouvelles, garnies de tours, aux frais des bourgeois; et
dans lesquelles il enferma toute la ville, à l'exception de
ses deux faubourgs. Eu 1700, ces derniers ouvrages furent de
nouveau abattus, et remplacés sur un plus grand développement
par un rempart flanqué de neuf bastions. Ce sont les fortifications
qui existent aujourd'hui ; elles ont été élevées, aux frais
de l'État, sur les plans du célèbre Vauban.
Cette ville
est située au pied de coteaux couverts de vignes, dans une plaine
fertile, sur la Moselle, qu'on y traverse sur un beau pont en
pierre de sept arches. Les rues sont peu régulières et pavées
en cailloux. La place d'Orléans, plantée de beaux arbres, est
la seule remarquable.
Les principaux édifices sont: la cathédrale,
superbe basilique d'architecture gothique, commencée par saint
Gérard en 965, et achevée en 1496 par l'architecte Jacquemin
de Commercy ; elle est surtout estimée par sa légèreté ; la
voûte plate qui supporte l'orgue passe pour un chef-d’œuvre.
— La cathédrale de Toul s'est enrichie récemment d'une belle
statue provenant du remarquable mausolée de M. H. dé" Thiard
de-Bissy, jadis évêque et comte de Toul, plus tard évêque de
Meaux (successeur de Bossuet) et cardinal.
La Mort de Charles le Téméraire
Plan du site |
Moteur de recherche
| | Page Aide |
Contact
© C. LOUP 2025
.




