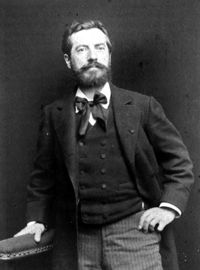Histoire du Haut Rhin

L'histoire de la Haute-Alsace peut se
diviser en trois parties :
La première partie va jusqu'à
Louis XIV et comprend les temps antérieurs à la conquête romaine,
la domination romaine elle-même, l'invasion et l'établissement
de la monarchie franque jusqu'aux successeurs de Charlemagne,
la période allemande depuis Othon jusqu'au Traité de Westphalie.
La deuxième partie commence à l'incorporation de l'Alsace à
la France, sous Louis XIV et finit au Traité de Francfort (1874).
La troisième partie date du Traité de Francfort et se continue
jusqu'à nos jours. Ce qu'on a pu recueillir de positif sur l'histoire
du pays avant l'arrivée des Romains, c'est qu'il était habité
par la race celtique. Les principales peuplades maitresses de
la Haute-Alsace étaient les Rauraques, Rauraci, qui habitaient
les collines du Sundgau et une portion des cantons suisses de
Bâle et de Berne ; les Séquanes, Sequani, qui s'étendaient jusqu'au
Rhin dans la Plaine d'Alsace et avaient pour voisins, du côté
des Vosges, les Leuciens, Leuci, et les Lingons, Lingones.

Les bourgades existant à cette époque,
et dont le nom est parvenu jusqu'à nous, sont : Gramatum, Offemont;
Larga, Largitzen ; Arialbin, Binningen ; Mons Brisiacus, Vieux-Brisach,
Olin, Edenbourg ; Argentonaria, Horbourg.
On croit avoir
reconnu sur le sommet des Vosges quelques vestiges d'anciens
Autels druidiques. Ce qui parait plus positif, c'est que, sous
le nom de Krutzman, une espèce d'Hercule sauvage était adoré
par les populations, et que le Rhin fut lui-même une des divinités
du pays.
Les Rauraques, afin de se soustraire aux envahissements
des peuplades germaniques qui traversaient continuellement le
Rhin pour s'établir en Alsace, prirent le parti d'émigrer. Mais
Jules César leur interdit de passer par la Province, nom donné
au territoire gaulois du Dauphiné, de la Provence, du Languedoc,
soumis aux Romains. Une autre occasion s'offrit à César, peu
de temps après, pour intervenir en Alsace, lorsque les Séquanes,
ayant à lutter contre les Éduens, appelèrent à leur secours
Arioviste, chef germain renommé par sa valeur. Ce dernier vainquit
les Éduens, mais il exigea des Séquanes le tiers de leur territoire
pour prix de son assistance.

Les Séquanes reconnurent alors qu'ils
avaient commis une grande imprudence en appelant Arioviste,
se rapprochèrent des Éduens, leurs anciens ennemis, et invoquèrent
la médiation de César. Le général romain accourut avec ses légions,
remporta une victoire éclatante sur les Germains et les força
de repasser le Rhin. César n'eut pas le temps d'organiser sa
conquête.
Mais, à partir du règne d'Auguste, les Romains
y fondèrent des colonies et cherchèrent à protéger le pays contre
de nouvelles incursions des Germains. Drusus fit élever plus
de cinquante Fortins le long du Rhin et y envoya huit légions
pour les garder
Des Routes furent percées pour relier entre
elles les anciennes villes ou celles qui se formaient. Ces Routes
militaires des Romains, admirablement établies, étaient formées
par un lit de cailloux ou de moellons liés par un ciment indestructible,
avec surface recouverte d'une couche de larges pierres, cimentées
aussi dans leurs intervalles. La chaussée du milieu était garnie
des deux côtés de trottoirs élevés qui servaient de montoirs
aux cavaliers, parce que les Romains n'avaient pas d'étriers.
Deux siècles de prospérité et de paix récompensèrent les intelligents
efforts du génie colonisateur des Romains. Mais les deux siècles
suivants, troublés par les révolutions impériales, par les ferments
de discorde que l'incertitude du pouvoir développait, furent
agités surtout par les menaces incessantes des hordes du Nord,
qu'une invincible fatalité poussait vers les rives du Rhin,
seule barrière qui les séparât de ces contrées occidentales,
objet de leur ardente convoitise.
![]() Malgré l'apaisement d'une
première révolte suscitée en l'an 70 par Civilis, malgré les
glorieux exploits de Crispus, sous Constantin, et les victoires
de Julien, qui envoya prisonnier a Rome le roi barbare Chnodomar,
malgré l'importante journée d'Argentomatum et la pacification
momentanée de la province par Gratien, il fallut bientôt renoncer
à la lutte. Stilicon, lieutenant d'Honorius, ayant retiré ses
troupes, les Barbares se ruèrent sur le pays sans défense et
en firent un désert. Aux Alains et aux Vandales succédèrent
les Alamans, qui tentèrent de fonder quelques établissements
en 407. Tout fut dispersé ou anéanti sous le passage d'Attila,
en 451. En 496, la victoire de Tolbiac, près de Cologne, venait
asseoir sur toute la contrée le pouvoir de Clovis et la domination
des Francs. C'est environ 60 ans après la naissance de Jésus-Christ
que commencèrent les premières prédications du Christianisme
en Alsace. Saint Materne fut le premier révélateur de la foi
nouvelle. Néanmoins, la nouvelle religion, à cause des nombreuses
invasions de Barbares, ne commença à fleurir qu'après la victoire
de Clovis. C'est ce roi qui, selon la tradition, jeta les premiers
fondements de l'Église Notre-Dame de Strasbourg (504). La Haute-Alsace,
ou Sundgau, comprise d'abord dans le duché d'Alemanie, forma
ensuite, avec la Basse-Alsace ou Nordgau, un duché particulier
du royaume d'Australie, jusqu'à la mort de Childebert II. En
vertu du Traité de Verdun (843), elle fut alors incorporée dans
le nouveau royaume te Lorraine. La division du territoire, à
cette époque, en cantons, Gaue, administrés au nom du roi par
des comtes, et en terres franches ou mundats, Immunitates, qui
appartenaient à l'Église ou relevaient d'administrations particulières,
explique, ainsi que l'éloignement du pouvoir central, le développement
simultané de deux puissances celle des évêques, que nous verrons
se soustraire plus tard, eux et leurs domaines, à toute domination;
celle des seigneurs, devenant la souche de puissantes dynasties.
Malgré l'apaisement d'une
première révolte suscitée en l'an 70 par Civilis, malgré les
glorieux exploits de Crispus, sous Constantin, et les victoires
de Julien, qui envoya prisonnier a Rome le roi barbare Chnodomar,
malgré l'importante journée d'Argentomatum et la pacification
momentanée de la province par Gratien, il fallut bientôt renoncer
à la lutte. Stilicon, lieutenant d'Honorius, ayant retiré ses
troupes, les Barbares se ruèrent sur le pays sans défense et
en firent un désert. Aux Alains et aux Vandales succédèrent
les Alamans, qui tentèrent de fonder quelques établissements
en 407. Tout fut dispersé ou anéanti sous le passage d'Attila,
en 451. En 496, la victoire de Tolbiac, près de Cologne, venait
asseoir sur toute la contrée le pouvoir de Clovis et la domination
des Francs. C'est environ 60 ans après la naissance de Jésus-Christ
que commencèrent les premières prédications du Christianisme
en Alsace. Saint Materne fut le premier révélateur de la foi
nouvelle. Néanmoins, la nouvelle religion, à cause des nombreuses
invasions de Barbares, ne commença à fleurir qu'après la victoire
de Clovis. C'est ce roi qui, selon la tradition, jeta les premiers
fondements de l'Église Notre-Dame de Strasbourg (504). La Haute-Alsace,
ou Sundgau, comprise d'abord dans le duché d'Alemanie, forma
ensuite, avec la Basse-Alsace ou Nordgau, un duché particulier
du royaume d'Australie, jusqu'à la mort de Childebert II. En
vertu du Traité de Verdun (843), elle fut alors incorporée dans
le nouveau royaume te Lorraine. La division du territoire, à
cette époque, en cantons, Gaue, administrés au nom du roi par
des comtes, et en terres franches ou mundats, Immunitates, qui
appartenaient à l'Église ou relevaient d'administrations particulières,
explique, ainsi que l'éloignement du pouvoir central, le développement
simultané de deux puissances celle des évêques, que nous verrons
se soustraire plus tard, eux et leurs domaines, à toute domination;
celle des seigneurs, devenant la souche de puissantes dynasties.
Parmi les cinq ducs qui représentèrent
d'abord en Alsace l'autorité royale, Athic ou Adalric, plus
connu encore sous le nom d'Éthico, est le personnage le plus
illustre que Alsace puisse revendiquer. Sans parler de sa descendance
immédiate, de son fils Adelbert et de son petit-fils Luilfrid
qui, tous deux, héritèrent de sa dignité, la lignée masculine
du duc Éthico embrasse les comtes d'Eguisheim, les ducs de Lorraine,
la maison de Habsbourg, les comtes de Flandre, de Paris, de
Roussillon, de Brisgau, d'Altenbourg, de Zaîhringen, de Bade
et de Lentybourg; par les femmes, cette illustre famille tient
aux empereurs d'Allemagne, et à Hugues Capet par Robert-le-Fort.
Le gouvernement des ducs d'Alsace ne fut signalé par aucun événement
politique important.
Sa fin nous conduit au règne de Charlemagne
qui, respecté au dehors, obéi au dedans, continua l'ère de paix
et d'organisation de l'administration précédente. Après la mort
du grand empereur, l'Alsace fut troublée par les guerres qui
eurent pour cause le partage de l'empire. Au Traité de Verdun,
en 843, elle échut à Lothaire. A la mort du fils de celui-ci,
Charles-le-Chauve et Louis-le-Germanique s'emparèrent de son
héritage et se le partagèrent. Le dernier ayant obtenu l'Alsace,
cette province fut ainsi détachée de l'empire franc. L'Alsace
incorporée à l'empire germanique eut, en 910, une nouvelle série
de ducs qui prirent alors le titre de ducs de Souabe et d'Alsace.
On en compte vingt-six, dont les quinze premiers de différentes
familles allemandes, et les onze autres appartenant tous à la
maison impériale de Hohenstauffen. Le dernier duc, Conradin,
envoyé en Italie à l'âge de seize ans, à la tête d'une armée,
pour disputer à Charles d'Anjou le royaume de Pouille et de
Sicile, fut vaincu à Tagliacozzo par Charles d'Anjou, pris et
décapité à Naples le 20 octobre 1268. L'autorité des ducs n'était
pas souveraine, et s'exerçait au nom de l'empereur. Mais le
haut rang des princes qui en étaient revêtus, presque tous fils
ou proches parents du souverain, rehaussa l'éclat de cette dignité,
devenue en quelque sorte héréditaire. Les landgraves, qui succédèrent
aux ducs, appartinrent sans exception à la maison Habsbourg-autrichienne.

C'est à la longue possession du landgraviat
par la même famille, à l'accumulation des richesses, à l'étendue
des domaines et à l'influence qui en furent les conséquences
naturelles, que Rodolphe I" de Habsbourg dut son élévation au
trône impérial, en 1273. Il n'est sorte de faveurs, distinctions
et privilèges, qui n'aient été constamment attaches à cette
dignité de landgrave, devenue comme l'apanage héréditaire des
fils puinés de la famille impériale, dont plusieurs, à l'exemple
de Rodolphe, n'ont quitté le gouvernement de l'Alsace que pour
aller s'assoir sur le trône des Césars.
Nous avons dû insister
sur cette aride généalogie des princes d'Alsace, parce qu'elle
nous semble résumer la partie la plus intime de l'histoire de
la province. Les évènements, qui se déroulèrent pendant leur
longue domination, appartiennent à un cadre plus général et
plus vaste que le nôtre, et il nous suffira de les noter, ou
rentrent dans les annales spéciales des villes de la contrée,
que nous essayerons bientôt de faire connaitre.
Jusqu'au
XVème siècle, outre les invasions normandes et anglaises,
les revendication armées des rois de France et les démêlés avec
la maison de Bourgogne, le pays fut presque continuellement
déchiré par des discordes intestines. Tous les pouvoirs avaient
grandi à la fois. Nous avons signalé l'origine de celui des
évêques. La Féodalité avait acquis en Alsace les mêmes développements
que dans le reste de la France. La grandeur et l'illustration
des ducs et des landgraves, trop haut placés pour descendre
aux détails de l'administration, avaient fait naitre d'autres
seigneurs.
A côté, au-dessous de ces puissants souverains,
s'étaient élevés les landvogt qui, laissant aux princes impériaux
les apparences du pouvoir, s'attachaient à en conquérir les
réalités.
La bourgeoisie des villes enfin opposait alternativement
aux prétentions du clergé les immunités et privilèges de l'empire,
puis aux réclamations de l'empire ses vieilles franchise épiscopales.
De ce conflit perpétuel, de cette incertitude sur l'étendue
et la légitimité de tous les pouvoirs, naquit une situation
confuse dont les désordres devinrent souvent de véritables brigandages.
C'est dans ces circonstances qu'apparut Luther, dont la doctrine
se répandit rapidement travers tout le pays.
Entre ses premières
prédications et la fondation par Calvin d'une Église réformée
à Strasbourg, en 1548, se placent le douloureux épisode de la
guerre des Rustauds, lutte des paysans contre la noblesse, et
le massacre des Anabaptistes, apôtres de l'égalité absolue.
Après cette période sanglante, la guerre de Trente-Ans en fut
comme le couronnement.
Colmar et Altkirch nous diront les
exploits de Gustave-Adolphe et du général Horn. La victorieuse
intervention de la France au Traité de Westphalie amène enfin
la réunion de cette belle province au sol français. L'union
de l'Alsace et de la France fut encore cimentée par la proclamation
des principes de 1789, qui répondaient trop aux sentiments,
aux souvenirs et aux espérances des habitants pour ne pas être
favorablement accueillis. L'égalité des cultes était surtout
une précieuse conquête pour une contrée où les dissidents formaient
une forte minorité de la population. Aussi, quand la France
républicaine fut menacée, l'Alsace se leva comme un seul homme
et courut aux frontières. Exposée la première à toutes les attaques,
à tous les assauts des puissances coalisées, jamais cette province,
devenue le premier boulevard de la liberté, ne faillit aux devoirs
que ses destinées nouvelles lui imposaient. Pas une plainte
ne s'éleva du sein de cette brave contrée, pas un murmure n'échappa
à cet héroïque pays, qui s'était fait, tout à coup et volontairement,
le soldat de sa nouvelle patrie.
Pendant la guerre de 1870-1871,
l'Alsace opposa une vigoureuse résistance aux Prussiens les
sièges de Strasbourg, de Belfort, en font foi. Lorsque le Traité
de Francfort fut signé, la députation nationale d'Alsace-Lorraine
protesta devant l'Assemblée nationale de Bordeaux en ces termes
« L'Alsace et la Lorraine ne veulent pas être aliénées. « Associées
depuis près de deux siècles à la France, dans la bonne comme
dans la mauvaise fortune, ces deux provinces, sans cesse exposées
aux coups de l'ennemi, se sont constamment sacrifiées pour la
grandeur nationale ; elles ont scellé de leur sang l'indissoluble
pacte qui les rattache à l'unité française. Mises aujourd'hui
en question par les prétentions étrangères, elles affirment,
à travers tous les obstacles et les dangers, sous le joug même
de l'envahisseur, leur inébranlable fidélité. « Tous unanimes,
les citoyens demeurés dans leurs foyers comme les soldats accourus
sous les drapeaux, les uns en votant, les autres en combattant,
signifient à l'Allemagne et au monde l'immuable volonté de l'Alsace
et de la Lorraine de rester terre française. »
Le 11 février
1874, la députation lorraine a protesté de nouveau au Reichstag
contre l'annexion.
Mais ces manifestations n'ont aucune valeur
aux yeux des Allemands qui prétendent occuper, comme étant une
terre de la Germanie, des territoires primitivement habités
par des tribus gauloises et faisant partie de la région géographique
de la Gaule. Ils ont pris l'Alsace et la Lorraine de force et
se soucient fort peu de ce qu'en pensent les habitants. Note
: Ce département, comme son voisin, le Bas-Rhin était sous domination
germanique, cette notice ayant été rédigée dans les années 1880.
Colmar
Le premier document écrit mentionnant
Colmar est daté de 823, quand Louis le Pieux fait don d’un domaine
dans la région de Columbarium, à l’abbaye de Munster. La région
est alors probablement occupée par quelques domaines fermiers.
La commune se développe progressivement et accède au statut
de ville au début du XIIIème siècle, sous la suzeraineté
de l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen. C’est à cette époque
que commence à s’installer diverses communautés religieuses,
telles que les Franciscains, les Dominicains et les Augustins.
En 1354, naît la Décapole, association de dix villes impériales
d’Alsace, qui a pour but de défendre les privilèges et le statut
des villes d’Empire et d’assurer leur sécurité. Cette ligue
a perdurée jusqu’à la Révolution française.

C’est aussi à cette époque que s’affirme
la domination des bourgeois sur la gestion de la ville au détriment
des nobles.
Les XVème et XVIème siècles
sont l’âge d’or de la ville. Il s’y construit de magnifiques
bâtiments et la ville connait la fortune par ses marchands,
mais aussi par son activité agricole. La réforme s’installe
sans heurts à Colmar en 1575.
La guerre de Trente Ans (1618-1648)
est à l’origine de grands bouleversements. Elle ruine la ville,
qui se met alors sous la protection de la Suède, puis de la
France. Après la guerre, la ville cherche à retrouver son indépendance,
mais Louis XIV maintient son emprise. Colmar doit céder et devient
ville royale en 1678 par le traité de Nimègue, tout en gardant
certains de ses privilèges. La ville devient peu à peu française….
La ville continue à croitre et devient préfecture du Haut-Rhin.
En 1870, la ville et la région sont cédées à l’Allemagne
à l’issue de la guerre, avant de redevenir française en 1918.
La ville refait un passage sous domination allemande pendant
la Seconde Guerre Mondiale
Mulhouse

Le site était probablement occupé de
longue date, des vestiges Gallo Romains et antérieurs y ont
été retrouvés. La première mention écrite du lieu remonte au
IXème siècle sous le nom de Mühl Hausen (Maisons
du Moulin). En effet la ville s'est construite dans une zone
comprenant des cours d'eau importants, propices à l'installation
de moulins. La ville est possession d'une abbaye avant de passer
sous la tutelle des Evêques de Strasbourg. Les Hohenstaufen
revendiquent la ville qui se place sous leur protection au XIIIème
siècle. La ville prospère alors et devient ville libre d'Empire
en 1308, un statut particulièrement avantageux elle est de fait
une petite république.
La ville rejoint la Décapole l'association
d'entraide de 10 villes d'Alsace. Au XVIème siècle
elle s'associe aussi aux cantons suisses et entre dans la Confédération
Helvétique. C'est aussi pendant cette période que Mulhouse adopte
la Réforme. La guerre de Trente Ans (1618-1648) qui est particulièrement
dévastatrice pour l'Alsace épargne Mulhouse qui est neutre,
au même titre que la Suisse. L'Alsace devient française à l'issue
de la guerre de Trente Ans et du traité de Westphalie mais Mulhouse
reste indépendante.
Au XVIIIème siècle, la ville
de Mulhouse s'industrialise et développe l'impression sur étoffe
avec ses fameuses manufactures d'indiennes, peintes à la façon
orientale. Lors de la révolution française, Mulhouse est une
terre isolée, entourée par les terres françaises, qui lui imposent
des tarifs douaniers dissuasifs. La ville économiquement étranglée
et abandonnée par la Suisse, demande son rattachement à la France,
ce qui est fait le 15 mars 1798. Ce rattachement tardif explique
pourquoi Mulhouse, bien qu'étant la plus grande ville du Haut
Rhin, n'en est pas la préfecture, le découpage administratif
ayant été fait quelques années plus tôt. La ville connait alors
un fort développement économique axé sur le textile et l'industrie
qui en découle. En effet, des filatures de coton sont construites
mais aussi des industries chimiques qui produisent des colorants,
nécessaires à cette industrie textile. L'industrialisation se
développe aussi dans les machines à vapeur et les locomotives.
L'annexion de l'Alsace en 1870 est un coup de frein à cette
expansion mais Mulhouse retrouve rapidement sa prospérité. De
même les années 20 et le retour à la France sont prospères,
l'industrie des mines de Potasse se développe.
Altkirch
La région est habitée dès le paléolithique.
Elle est colonisée par les Romains avant de subir les invasions
des Alamans, puis des Francs. Le Sundgau fait dès lors partie
du duché d’Alsace. Sous les Mérovingiens, la région est christianisée
par des moines irlandais.
Le terme de Sundgau apparait en
750, lorsque le duché est divisé en deux comtés, le Nordgau
et le Sundgau, englobant néanmoins une zone bien plus vaste
qu’aujourd’hui.
La région passe sous l’autorité du Saint
Empire Romain Germanique au Xème siècle avec un régime féodal.
La région fait partie du comté de Ferrette (dont le titre est
aujourd’hui porté par la famille Grimaldi, de Monaco) et qui
au XIIème siècle appartient à la famille de Montbéliard et reste
sous leur tutelle jusqu’en 1324. Cette période est marquée par
de nombreux conflits locaux.
En 1324, Ulrich III meurt sans
héritier mâle. Sa fille Anne apporte en dot le Sundgau à la
famille des Habsbourg, famille régnante d’Autriche.
La région
est touchée, tout au long des XIVème et XVème siècle, par la
peste et les guerres. Mais c’est surtout la guerre de Trente
Ans qui ravage la région. Les Suédois massacrent les paysans
qui ont tenté de se révolter et détruisent un grand nombre de
bâtiments. La région, comme le reste de l’Alsace est annexée
à la France et connait alors une politique de repeuplement.
Du XVIIIème siècle à nos jours, le Sundgau suit le même destin
que l’Alsace. Aujourd’hui, le Sundgau reste fortement agricole,
très peu d’industries y étant implantées. Vous croiserez donc
bon nombre de tracteurs sur ses petites routes….
Guebwiller

La ville est mentionnée pour la première
fois dans un acte de donation en faveur de l'abbaye de Murbach,
du 10 avril 774, lorsqu'un certain Williarius ratifie un acte
de donation dans laquelle apparait la forme primitive du nom
de Guebwiller appelée alors villa Gebunvillare. Il s'agit alors
d'un simple domaine agricole. La ville médiévale prendra forme
au cours du XIIème siècle autour de l'église Saint-Léger
et du château du Burgstall. La muraille d'enceinte est érigée
entre 1270 et 1287. Guebwiller, capitale de la principauté de
Murbach, prospère et compte 1 350 habitants en 1394. Au fil
des ans la ville connait de nombreux évènements historiques
: En février 1445, tentative d'assaut des Écorcheurs, après
avoir ravagé le pays. Mais Guebwiller étant protégée par son
enceinte fortifiée, les ennemis voulurent utiliser la ruse.
La surveillance s'étant relâchée, ils placèrent leurs échelles
sur la muraille mais une Guebwilléroise, Brigitte Schick, veillait
en secret et donna l'alerte. Les assaillants, pris de panique
par l'apparition miraculeuse de celle qu'ils prirent pour la
Vierge Marie, abandonnèrent leurs échelles. Celles-ci furent
conservées dans l'église Saint-Léger, en hommage à la Vierge
qui avait protégé la cité. Révolte des habitants contre l'autorité
des princes abbés de Murbach et leurs représailles.
Insurrection
des Rustauds en 1525, mise à sac de la ville par les Suédois
lors de la Guerre de Trente Ans ;
Guebwiller devient française
en 1648 suite à la ratification du traité de Munster. En 1657
il ne reste plus que 176 habitants à Guebwiller; entre 1761
et 1764 a lieu la sécularisation du chapitre de Murbach qui
s'installe en ville, dans le château de la Neuenbourg. La domination
de l’abbaye de Murbach prend fin à la Révolution française ;
A l'aube du XIXème siècle apparaissent les premières
entreprises textiles. C'est le début de la grande épopée de
l'industrie textile dans la capitale du Florival qui devient
le deuxième site textile d'Alsace après Mulhouse. On y fabrique
des toiles peignées, du ruban, des indiennes. On y file de la
laine et du coton ; 1er mai 1864 : premier concours gymnique
de France ; en 1905, Guebwiller compte 13 294 habitants ; durant
la Seconde Guerre mondiale, les Guebvillérois subissent le sort
de tous les Alsaciens-lorrains par l'incorporation de force
et l'occupation allemande. Ils sont libérés le 4 février 1945
par un groupe de blindés du 4ème régiment de spahis marocains
; l'industrie locale connait un nouvel essor dans les années
1946-1953 puis amorce un déclin irrémédiable.
Ribeauvillé

Cette ville est bâtie à l'entrée d'une
vallée pittoresque et entourée de beaux Vignobles. La cime de
la montagne qui s'élève à l'ouest est couronnée par les ruines
du Château de Ribeaupierre ; plus bas , sur la pente de la montagne,
on. aperçoit les ruines des deux châteaux de Giersberg et de
Saint Ulric bâtis sur des rochers escarpés.
Ribeauvillé
passe pour avoir été bâti au VIIème siècle. Cette ville a quatre
portes et se divise en quatre quartiers : la cité supérieure,
la jauge, le marché et la cité inférieure. A l'endroit le plus
élevé de la ville était le château du Prince, démoli en 1819.
Au-dessous de son emplacement s'élève une belle église paroissiale
où l'on remarque plusieurs monuments et le caveau sépulcral
des seigneurs de Ribeaupierre. Le centre de la ville est occupé
par un beau bâtiment qui sert d'hôtel de ville. Hors de la porte
inférieure est la belle promenade d'Herrengarten.
A 1 kilomètre
de Ribeauvillé, dans la vallée à droite de la route de Ste-Marie-aux-Mines,
un chemin bordé de peupliers conduit aux ruines de Notre-Dame
de Tusenbach, trône des musiciens de l'Alsace, lieu de pèlerinage
autrefois très fréquenté.
Thann

Cette ville, située sur la Thur, et sur
le chemin de fer de Strasbourg à Bâle, à l'entrée de la vallée
de St- Amarin, est bâtie dans une position pittoresque, au pied
d'une montagne couronnée par les ruines du château d'Engelbourg,
détruit par les Français en 1674. Les Suédois s'emparèrent de
Thann en 1632, et l'abandonnèrent presque aussitôt.
En 1634
et 1639, cette ville fut prise par le duc Bernard de Saxe-Weimar.
En 1674, elle tomba au pouvoir de l'armée impériale brandebourgeoise,
et fut prise peu de temps après par les Français.
On remarque
à Thann l'église de St-Thibaut, magnifique édifice bâti dans
le même style que la cathédrale de Strasbourg et classé au nombre
des monuments historiques. La pierre fondamentale en a été posée
en 1430, et la belle flèche pyramidale, haute de 100 mètres
a été achevée en 1516