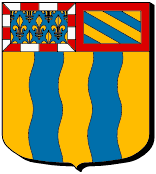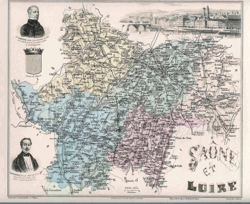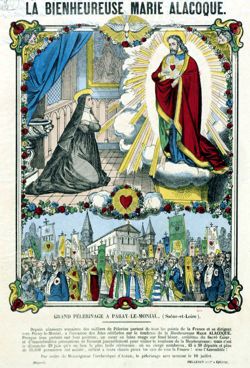Histoire de la Saône et Loire

Les Eduens, puissante tribu de la Gaule
centrale, occupaient, avant l'invasion romaine, la plus grande
partie du territoire dont a été formé le département de Saône-et-Loire.
C'est comme allié des Éduens, et appelé par eux, pour les aider
dans une guerre qu'ils soutenaient contre les Séquanais, que
César franchit les Alpes. L'occupation romaine ne rencontra
donc d'abord dans la contrée aucune résistance et n'y souleva
aucune opposition. Bibracte (Autun), la vieille capitale du
pays, fut adoptée par les soldats de César comme une seconde
patrie ; mais cette union, qui reposait sur un malentendu, ne
fut pas de longue durée ; lorsque les Éduens virent se changer
en conquête définitive une occupation qu'ils n'avaient acceptée
que comme un secours momentané, leur esprit national se réveilla
et les sympathies anciennes firent bientôt place à une hostilité
mal déguisée.
De leur côté, les conquérants, pour entraver
l'organisation de la révolte, changèrent à diverses reprises
les divisions administratives de la province. Une levée de boucliers
répondit à ces mesures vexatoires ; les esclaves gladiateurs
destinés aux cirques de Rome se réunirent sous un chef acclamé
par eux, le vaillant Sacrovir ; la population presque entière
se joignit à eux, et les Éduens tentèrent, mais trop tard, de
réparer la faute qu'ils avaient commise en appelant l'étranger
dans leur patrie.
Cette tentative échoua comme celle de
Vercingétorix dans l'Arvernie ; les dernières forces de la race
celtique s'y épuisèrent et la volonté des Éduens n'eut même
plus à intervenir dans le choix des maîtres qui se disputèrent
leur territoire.

Quand le colosse romain commença à vaciller
sur ses bases, quand les possessions de l'empire énervé purent
être attaquées impunément, la Saône fut franchie tour à tour
par les hordes barbares qui, des rives du Rhin ou du sommet
des Alpes, se ruaient dans les plaines de l'ouest et du midi.
Attila, avec ses Huns, passa comme une avalanche. Les lourds
Bourguignons s'arrêtèrent au bord du fleuve, et jusqu'à la venue
des Francs le pays fut possédé par deux maitres à la fois, les
Bourguignons et les Romains.
Les nouvelles divisions territoriales
qu'entraîna la conquête de Clovis, les partages de son héritage,
plus tard la constitution des grands fiefs donnèrent naissance
à un royaume, puis à un duché de Bourgogne, dont fit presque
toujours partie le département de Saône-et-Loire, mais dont
l'histoire trouvera sa place plus spéciale dans notre notice
sur Dijon et la Côte-d'Or. L'importance des villes détermina
d'abord la division administrative du pays en pagi ou cantons,
qui devinrent autant de comtés plus ou moins indépendants quand
prévalut, sous la seconde race, l'organisation féodale dans
la France entière, et ne furent réunis à la couronne que successivement
et beaucoup plus tard. L'Autunois, le Mâconnais, le Châlonnais
et le Charolais eurent donc chacun pendant longtemps une existence
particulière, dont se compose l'ensemble des annales du département.
L'Autunois tira son nom de la ville d'Autun, autrefois Bibracte,
l'ancienne capitale des Éduens. Cette tribu, par haine des Allobroges
et des Arvernes, s'allia étroitement avec les Romains aussi
eut-elle des citoyens admis dans le sénat avant toutes les autres
peuplades gauloises.
La foi chrétienne fut apportée dans
cette contrée dès le IIème siècle par saint Andoche,
prêtre, et saint Thirse, diacre, qui, malgré la protection d'un
riche habitant de Saulieu nommé Faustus, souffrirent le martyre
à leur retour à Autun ; en même temps qu'un marchand du nom
de Félix qui leur avait donné asile. Tetricus, général romain,
s'étant fait reconnaître empereur, entraîna les Éduens dans
son parti. Claude vint le combattre, ravagea les campagnes,
incendia et pilla les villes. Constance et Constantin réparèrent
ces désastres le pays fut tranquille et prospère jusqu'à l'invasion
des barbares.
Les rapides progrès du christianisme dans l'Autunois
et l'influence de l'évêque dans la capitale donnèrent de bonne
heure une prépondérance marquée au pouvoir clérical. Sur quatre
bailliages dont la province était composée, un seul, celui de
Bourbon-Lancy devint une baronnie de quelque importance. Le
Mâconnais (pagus Matisconensis) des Éduens eut sous les Romains
les mêmes destinées que l'Autunois. Sa position sur les bords
de la Saône en faisait un centre d'approvisionnement on y fabriquait
aussi des instruments de guerre. Sous la seconde race, le Mâconnais
est possédé par des comtes qui rendent leurs domaines héréditaires,
et arrivent par leurs alliances jusqu'à la couronne ducale de
Bourgogne. C'était un comte du Mâconnais, cet Othon-Guillaume
auquel le roi Robert fut obligé de disputer devant un concile
et par les armes les deux Bourgognes et le comté de Nevers.
Sa descendance resta en possession du comté jusqu'en 1245, époque
à laquelle il fut cédé à saint Louis par la comtesse Alix. À
l'exception d'une courte période pendant laquelle Charles VII
l'aliéna à Philippe le Bon, le Mâconnais est demeuré depuis
annexé au domaine royal ; depuis saint Louis, il relevait du
parlement de Paris, et les privilèges municipaux accordés par
ce prince aux habitants des villes furent maintenus jusqu'à
la Révolution de 1789.
Le pouvoir épiscopal profita moins
encore de l'extinction des comtes du Mâconnais que de l'importance
acquise par la puissante abbaye de Cluny. Le couvent fournit
un grand nombre de prélats au siège de Mâcon aussi fût-il occupé,
le plus souvent, par des personnages d'un grand nom et d'une
haute position dont l'influence fut souveraine sur les destinées
de la province.
Le Châlonnais était aussi compris dans le
pays des Éduens; il en est question, ainsi que de sa capitale
Cabillonum (Chalon), dans César, Strabon et Ptolémée. C'était
un poste important des légions romaines ; une large chaussée
fut construite pour relier Autun à la Saône. La tradition populaire
donne les environs de Châlon pour théâtre à l'apparition de
la croix miraculeuse autour de laquelle Constantin put lire
« Tu vaincras par ce signe » In hoc signo vinces.
Après avoir été traversé et ravagé par Attila, le Châlonnais
devint le centre de la première monarchie burgonde. Chalon était
la capitale du roi Gontran, et Clovis II y convoqua une assemblée
nationale. La position du pays, qui le désigna dès les premières
invasions comme le passage le plus favorable de l'est au centre
de la France et du nord au midi, ne lui permit d'échapper à
aucun des envahissements que nos pères eurent à subir. Après
les Romains, les Germains, les Helvètes, les Huns et les Bourguignons,
vinrent les Sarrasins, et après eux les Normands.
Jamais
terre ne fut foulée par tant d'ennemis différents et comme si
ce n'eût point encore été assez, après tant d'assauts, de devenir
le théâtre des luttes entre les maisons de France et de Bourgogne,
il fallut encore que le Châlonnais payât tribut aux guerres
de religion et à toutes nos discordes civiles. Le premier comte
héréditaire du Châlonnais fut Théodoric 1er; c'est
seulement en 1247 que, par suite d'échange, le comté échut à
la maison de Bourgogne; il y est resté jusqu'à la réunion du
duché à la France.
Le premier apôtre du Châlonnais fut Saint
Marcel, prêtre attaché à saint Potin et venu de Lyon avec lui
il souffrit le martyre en 161, sous le règne de Vérus.
Pendant
la période féodale, le pouvoir de l'évêque sur le Châlonnais
fut plus nominal que réel les comtes se laissaient investir
par eux de leur titre, mais sans renoncer à agir ensuite au
gré de leur caprice ou selon leur intérêt, les ducs de Bourgogne
et les rois de France, trop haut placés pour recevoir l'investiture
du comté des mains de l'évêque de Chalon, leur laissèrent en
réalité un cercle d'action plus libre et moins restreint. Il
est juste d'ajouter que le pays ne s'en trouva pas plus mal.
Les Ambatri et les Brannovii occupaient le Charolais et vivaient
dans une étroite alliance avec les Éduens ; sous les Romains
et les Bourguignons, leurs ,destinées furent communes.
L'administration
franque constitua le Charolais en comté, qui sous la première
race dépendit du comté d'Autun, et de celui de Chalon sous la
seconde. All XIIIème siècle, Hugues IV, duc de Bourgogne,
ayant acquis le comté de Chalon et ses dépendances, le donna
en apanage à son second fils Jean, qui épousa l'héritière de
Bourbon. Une seule fille naquit de cette union on la maria à
Robert, comte de Clermont, fils de saint Louis ce prince et
trois générations de ses descendants possédèrent donc le Charolais,
mais comme fief relevant du duché de Bourgogne. En 1390, Philippe
le Hardi le racheta moyennant 60,000 francs d'or. Il demeura
plus d'un siècle dans la maison ducale, et l'estime qu'elle
faisait de cette possession est attestée par le titre de comte
du Charolais que portaient ordinairement les fils aînés des
ducs de Bourgogne. A la mort de Charles le Téméraire, en 1477,
le Charolais fut compris dans les dépouilles de l'ennemi vaincu
que Louis XI réunit à la France. Ses successeurs, Charles VIII
et Louis XII, restituèrent ce comté aux héritiers de Marie de
Bourgogne, il fut donc rendu, en 1493, à Philippe d'Autriche,
père de Charles-Quint, et resta dans la maison d'Espagne jusqu'en
1684, mais cette fois comme fief de la couronne de France, à
la charge de foi et hommage, et soumis à la juridiction française.
Le prétexte dont on usa pour mettre fin à cet état de choses
mérite d'être rapporté. En dehors des grands événements qui
décidèrent de ses destinées, les régions qui composent le département
de Saône-et-Loire eurent leur part dans toutes les épreuves
que traversa la France sans avoir été marqué par des luttes
aussi violentes que dans d'autres localités. L'établissement
des communes l'agita au XIIIème siècle. Au XIVème,
le pays fut décimé par la peste noire ; treize familles seulement
survécurent à Verdun-en-Châlonnais. Ce fut ensuite l'invasion
des Anglais sous la conduite du Prince Noir, et, quelques années
plus tard, les brigandages des Écorcheurs. Du Guesclin, en 1366,
les avait décidés à le suivre en Espagne dans l'espoir d'un
riche butin; mais ils revinrent quelques années après et ravagèrent
tout le Mâconnais.
Nous les retrouvons, en 1438, en compagnie
de la peste et de la famine, dévastant le Charolais et les environs
de Paray-le-Monial, sous la conduite du fameux Antoine de Chabannes
; il fallut, pour en délivrer la contrée, que le comte de Fribourg,
gouverneur de la Bourgogne, convoquât la noblesse à une sorte
de croisade, les prisonniers mêmes ne furent point épargnés.
La guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, les
luttes qui précédèrent la réunion du duché à la France eurent
presque continuellement pour théâtre ces contrées douées d'une
telle vitalité que quelques années de paix leur rendaient une
prospérité relative.
Les discussions religieuses agitaient
sourdement la France depuis plusieurs années, lorsque le massacre
de Vassy fit éclater la guerre civile. La noblesse de Bourgogne
était peu favorable aux protestants, mais ils avaient de nombreux
adhérents dans les villes.
En 1562, un fameux capitaine calviniste
nommé Ponsenac parcourut la Bresse et le Mâconnais à la tête
d'une troupe de six à sept mille hommes, saccageant, pillant,
brûlant les couvents et les églises. Le capitaine d'Entraigues
et deux de ses lieutenants, Jean-Jacques et Misery étaient maîtres
d'une partie de la province, quand leur marche fut arrêtée par
le maréchal de Tavannes.
Quelques années plus tard, en 1567,
1570 et 1576, c'est contre les Suisses et les reîtres des Deux-Ponts
qu'il faut se défendre; ces derniers avaient traversé Ia Loire
à Marcigny, au nombre de 25,000 environ. L'anarchie régna en
Bourgogne pendant tout le temps de la Ligue, et même après l'abjuration
de Henri IV et la bataille de Fontaine-Française ; en 1593,
un article du traité de Folembray accordait au duc de Mayenne
la ville de Chalon comme place de sûreté. Sous Louis XIII, la
révolte de Gaston d'Orléans, frère du roi, appela les Impériaux
en Bourgogne ; la courageuse et patriotique résistance des habitants
fit obstacle aux funestes progrès de l'invasion, qui échoua
définitivement devant l'héroïsme de Saint- Jean-de-Losne. Le
pays se ressentit peu des agitations de la Fronde quelques communes
seulement eurent à subir les exactions de soldats indisciplinés
et d'une bande de rebelles qui ne compta jamais plus de 500
hommes et que commandait un aventurier du nom de Poussin de
Longepierre.
Les règnes suivants ne furent signalés que par
d'utiles travaux et de magnifiques améliorations (1789).
Le grand Condé, ayant fait sa paix avec la cour de Saint-Germain,
réclama du roi d'Espagne des sommes considérables, prix de ses
services pendant la guerre contre la France pour rentrer dans
cette créance, il saisit le Charolais une procédure s'ensuivit
comme s'il se fût agi de la dette d'un marchand, ou tout au
moins d'une seigneurie ordinaire on plaida, et un arrêt intervint
qui adjugea le comté à la maison de Condé. C'est seulement en
1761 qu'il fut racheté par Louis XIV et réuni au domaine royal.
En 1814, à la chute du premier Empire, le département fut traversé
par les troupes autrichiennes. Chalon, qui n'avait qu'une garnison
de 200 hommes, n'en résista pas moins au général Bubna, et l'ennemi
ne s'en rendit maître qu'après un vif combat soutenu, le 4 février,
par les habitants. Sa vengeance s'exerça sur Autun qui fut durement
traitée, et sur le château de Martigny- sous-Saint-Symphorien
qui fut incendié.
En 1870, la situation pouvait paraître
plus périlleuse. Autun couvrant l'important établissement du
Creusot, dont le matériel et les puissantes ressources devaient
être un objectif pour les envahisseurs victorieux; ils firent,
en effet, dans les premiers jours de décembre, quelques démonstrations
hostiles mais Garibaldi y avait alors son quartier général,
où des forces imposantes avaient été réunies, pour appuyer les
opérations de l'armée de l'Est, commandée par le général Bourbaki
; l'ennemi s'en tint donc à quelques reconnaissances autour
de la ville, et prit sa direction vers le département de l'Yonne
et la Loire.
La Révolution de 1789, qui donna à la France
unité et liberté, avait été accueillie par le département de
Saône-et-Loire avec le plus grand enthousiasme. Les habitants
sont restés fidèles au culte de leurs principes. En 1792, comme
en 1814 et en 1870, la patrie menacée ne trouva dans aucune
province de plus dévoués défenseurs. Le sentiment de la nationalité
est aussi fortement empreint chez le citoyen des villes que
dans la population des campagnes. Les développements de l’industrie
et du commerce, le soin des intérêts privés n'ont altéré ni
comprimé dans ce département les élans généreux, les aspirations
enthousiastes qui caractérisent les fortes races et les grands
peuples.
Le département a été créé officiellement à la Révolution
française, le 4 mars 1790, en application de la loi du 22 décembre
1789, à partir d'une partie de la province de Bourgogne. Les
états généraux du Charolais, réunis dans l'ancien couvent des
pères Blancs — revendu plus tard comme bien national — et libre
en tant que province indépendante réunie depuis peu à la couronne,
ont préféré installer la préfecture à Mâcon, plutôt qu'à Chalon-sur-Saône
; c'est ainsi que Mâcon est devenue le chef-lieu du département.
Macon
L'agglomération mâconnaise tire son origine
de l'établissement d'un oppidum et d’un port fluvial par le
peuple cette des Éduens. Elle est citée par Jules César au Ier
siècle av. J.-C.4. Connue alors sous le nom de Matiscone, la
ville se développe rapidement au cours des deux premiers siècles
de notre ère.
Au cours du IVème siècle, la ville
se fortifie. Au Moyen Âge, Mâcon est le chef-lieu d'un comté
rattaché au duché de Bourgogne, sis à l'extrémité du pont sur
la Saône menant aux domaines de Bresse du duché de Savoie. La
ville commandait l'accès à l'actuel Val Lamartinien, où l'extrémité
sud de la Côte de Bourgogne rejoint les premiers contreforts
des monts du Beaujolais, ouvrant la voie aux riches plaines
de la Loire.
En 1477, à la suite de la mort de Charles le
Téméraire, Louis XI confirme par lettres patentes les privilèges
de la ville et du comte de Mâcon.
En 1500, Mâcon est une
petite ville de 4 000 habitants environ, ville commerçante en
raison de sa situation sur les bords de la Saône, ville riche
de nombreuses églises et de monastères, ville fortifiée faisant
frontière entre la France et la Savoie. Les ordonnances de l'évêque
de Lyon François de Rohan en 1529, de l'évêque de Mâcon Louis
de Chantereau en 1530, du roi Henri II lui-même en 1551 dans
une lettre adressée à l'évêque de Mâcon sur l'inconduite des
religieux dans cette ville, sont des signes révélateurs de l'état
moral et spirituel d'un certain nombre d'ecclésiastiques à cette
époque. C'est en 1533 que les doctrines de Calvin sont répandues
à Mâcon par un ecclésiastique, Alexandre Canu, qui avait fait
un séjour à Neuchâtel et à Genève où il avait pris contact avec
Farel ami et disciple de Calvin. Ces doctrines furent favorablement
accueillies à Mâcon, surtout au début, dans les milieux bourgeois
et commerçants, ainsi que par certains membres du clergé. L'un
des plus anciens historiens de Bourgogne, le R. P. Fodéré a
écrit ceci :
« L'hérésie de Calvin ayant déjà pullulé
sourdement par dedans presque toutes les villes du Royaume,
depuis 1554, elle se glissa dans l'entendement des plus relevés
de Mâcon, lesquels néanmoins à ce commencement se tenaient secrets
; or, pour se bien instruire aux dogmes de cette nouvelle hérésie,
ils envoyaient souvent des plus capables d'entre eux à Genève.
»
Nous connaissons effectivement le nom d'un de ces
mâconnais, Antoine Bouvet, qui alla à l'Académie de Genève et
revint quelques années plus tard à Mâcon pour exercer les fonctions
de pasteur de la nouvelle Église. Les événements à Mâcon sont
complexes pendant toute cette période, le culte réformé sera
plusieurs fois supprimé puis restitué6.
Charles IX, venant
de Chalon, s’arrête le 3 juin 1564 dans la ville lors de son
tour de France royal (1564-1566), accompagné de la Cour et des
Grands du royaume : son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre,
les cardinaux de Bourbon et de Lorraine. La ville est stratégique
: c’est une porte d’entrée du royaume potentielle pour les Suisses
ou les mercenaires allemands dans le contexte des guerres de
religion. Il y est accueilli par la reine Jeanne de Navarre,
dite la « reine des Protestants », et mille cinq cents huguenots.
Du 14 au 21 septembre 1602, il y eut des pluies continuelles
dans la région : « La Saône déborda en septembre 1602 avec une
si grande inondation, que de mémoire d'homme on n'en avait jamais
vu de pareille8. Le faubourg Saint-Jean de Maiseau en fut plus
inondé que les autres et on y allait partout en bateau, même
au-delà des Tours des Carmes quoiqu'elles soient assez avancées
dans la ville. L'eau dégorgea en cet endroit-là par le vieux
fossé, avec tant de furie qu'elle faisait plus de bruit qu'une
écluse de moulin. »10.
Chalon-sur-Saône

L'origine de Chalon remonte aux temps
les plus reculés. Lors de la conquête des Gaules par les Romains,
la situation avantageuse de cette ville détermina César à y
former des magasins de grains à l'usage des troupes cantonnées
dans cette contrée. Auguste la visita lors de son passage dans
les Gaules mais le véritable bienfaiteur de Chalon, ou plutôt
de toute la Bourgogne fut l'empereur Probus, qui introduisit
la culture de la vigne sur les coteaux voisins la naturalisa
peu à peu dans le pays, et le dota ainsi d'une source inépuisable
de richesse. Constantin le Grand s'y arrêta avec ses légions
l'an 312 de l'ère chrétienne, lorsqu'il se rendait à Rome pour
combattre Maxence.
Cette ville a été ruinée plusieurs fois.
Les Germains la pillèrent et y mirent le feu, vers 264. Attila
s'en empara, après une vigoureuse résistance, et y mit le feu
en 451.

Elle tomba ensuite au pouvoir des rois
mérovingiens. Chrame la prit et la dévasta mais Childebert la
reconstruisit et lui rendit quelque importance. Les Sarrasins,
sous la conduite d'Abdérame, la saccagèrent en 732. Trente ans
après, Waifre, duc d'Aquitaine la ravagea. Elle fut rétablie
par Charlemagne qui y tint un concile où il recommanda le soin
de l'instruction publique et l'amour des sciences ; mais, après
la mort de ce monarque, la barbarie y reprit son empire. Lothaire
la saccagea en 834, y mit le feu, et y commit une atrocité révoltante
pour assouvir la haine qu'il portait aux fils du comte de Toulouse,
il fit saisir leur sœur, la belle et vertueuse Gerberge, admirée
par sa douceur et ses vertus, la fit traîner par les cheveux
sur le pont, où il la fit clouer dans un tonneau et précipiter
dans la Saône!
Les rois de France avaient un palais dans
cette ville au IXème siècle. Les Hongrois s'emparèrent
de Chalon en 937; et les grandes compagnies d'Écorcheurs, en1365,y
causèrent de nouveaux malheurs.
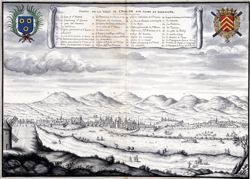
En1273, Édouard Ier, roi d'Angleterre,
à son retour de la Palestine, fut invité par le comte de Chalon-sur-Saône
à un tournoi que ce seigneur voulait donner en l'honneur des
guerriers revenant de la terre sainte. Édouard accepta, encore
que le pape lui adressât de pressantes exhortations de s'en
abstenir. Des hérauts d'armes annoncèrent alors dans toute la
Bourgogne que le roi d'Angleterre, avec les chevaliers qui l'avaient
accompagné en Palestine, tiendrait un pas d'armes contre tous
venants, Afin de s'y présenter avec plus d'honneur , Édouard
invita les chevaliers et les archers d'Angleterre qui voudraient
partager la fortune de leur jeune roi à se hâter de se rendre
le Bourgogne. Quand il entra dans champ clos il avait mille
Anglais sous ses ordres, et le comte de Chalon avait près du
double de soldats. Une jalousie nationale avait succédé au désir
primitif de fêter les pèlerins. Après qu' Edouard eut remporté
les honneurs du combat sur les comtes et les barons qui joutèrent
avec lui, les fantassins des deux nations s'attaquèrent à outrance;
mais l'avantage devait rester aux Anglais, chez qui le peuple
était exercé aux armes, tandis qu'en France la noblesse ne permettait
guère aux roturiers de développer leur bravoure. Les Anglais,
dit Matthieu de Westminster, s'abandonnant à leur colère, tuèrent
un très-grand nombre de Français, et comme c'étaient des gens
de condition vile on se souciât fort peu de leur mort; car c'était
des fantassins désarmés qui ne songeaient qu’à leur butin. Le
champs clos fut couvert de mort, et ce tournoi fut désigné par
le nom de la petite guerre de Chalon.
Chafon fut exposé à
de grands malheurs pendant les guerres civiles du XV et du XVIème
siècle; ils furent tels, dit un historien qu'ils eussent dû
être écrits en lettres de feu et de sang. Le comte de Fribourg
ayant rassemblé la noblesse de la province à Chalon, en tailla
en pièces une partie, et fit périr le reste par la main du bourreau
la Saône était si pleine de leurs corps, que les pêcheurs, au
rapport d'Olivier de la Marche, au lieu de poissons les tiraient
bien souvent deux à deux ou trois à trois, liés et accouplés
avec des cordes.
Chalon embrassa le parti de la Ligue, Mayenne
s'y retira en 1588,et en confia le commandement au seigneur
de l'Artusie qui feignit de vouloir livrer la place au maréchal
d'Aumont, auquel il extorqua 10 000 écus. Théodore de Rissy,
gouverneur de Verdun, se vengea de cette perfidie en faisant
tomber deux fois les Chalonnais dans une embuscade. Par représailles
l'Artusie pilla le château et ravagea les terres de l'évêque
Ponthus de Thyard qui, détestant ta rébellion de ses diocésains
s'était retiré à Bragny. Lors de la trêve de1595, Chalon, Seurre
et Soissons furent accordées au duc de Mayenne pour villes de
sûreté. Cette ville est dans une situation agréable, au milieu
d'une vaste plaine couverte de prairies, de champs fertiles,
de vignes et de taillis, sur la rive droite de la Saône et à
l'embouchure du canal du Centre, qui joint la Loire à Digoin.
Elle est avantageusement placée pour le commerce et généralement
bien bâtie: la partie située sur le bord de la rivière, le long
de laquelle règne un for beau quai, offre surtout un aspect
agréable et fort animé. Cependant, on n'y trouve aucun édifice
que l'on puisse citer pour sa grandeur et son architecture,
mai seulement quelques maisons particulières remarquables par
leur élégance. L'un des faubourgs, celui de St-Laurent, est
bâti sur la rive gauche de la Saône, que l'on traverse sur un
grand et beau pont de pierre, de style ancien, formé de cinq
arches hardies ; les piles sont garnies de contreforts surmontés
de lourds obélisques qui s'élèvent de plusieurs mètres au-dessus
des parapets et forment une décoration singulière.
La ville
de Chalon s'est considérablement accrue pendant la guerre continentale
ce qu'elle dut principalement à sa portion-sur le canal du Centre.
Lors de la déplorable invasion étrangère en 1814,ses habitants
montrèrent le plus grand courage, et coopérèrent activement
à la défense du territoire ; ils rompirent deux arches du pont
sur la Saône, et tinrent en échec, pendant vingt jours une division
autrichienne qu'ils empêchèrent de passer cette rivière. Pour
les récompenser de cette belle conduite, l'empereur leur fit
don de quatre pièces d'artillerie, qu'on leur retira sous la
restauration, qu'on leur rendit après la révolution de 1830,et
qui maintenant sont devenues inutiles depuis le licenciement
de la garde nationale.
Autun

C'est sous le règne de l'empereur romain
Auguste (-27/14) qu'a été fondée la cité d'Autun : son nom antique,
Augustodunum, signifie la forteresse d'Auguste. Auguste avait
la volonté de créer une grande cité en Gaule qui montrerait
la puissance romaine. Augustodunum fut donc doté de splendides
monuments qui font aujourd'hui encore sa renommée.
 La
création d'Autun attira les populations environnantes et notamment
les habitants de Bibracte, l'oppidum éduen, qui tomba peu à
peu dans l'oubli.
La
création d'Autun attira les populations environnantes et notamment
les habitants de Bibracte, l'oppidum éduen, qui tomba peu à
peu dans l'oubli.
Autun fut célèbre pour son école de rhétorique,
dont les premiers à avoir apporté les lettres à Trèves furent
les panégyristes, professeurs de rhétorique venant des écoles
d'Autun, Bordeaux, Rome et de Trèves même. Dans les discours
de 197 à 312, cinq sont composés à Autun. En 107 déjà cette
école de philosophie et de rhétorique d'Autun attire des étudiants
de tout l'Empire. Le poème de 148 hexamètres, est écrit par
un rhéteur de la fameuse école de rhétorique qui florissait
à Autun à l'époque de Constantin.
Prise par Julius Sacrovir
en l'an 21, elle fut le foyer de la révolte de ce Gaulois .
Au IIIe siècle, elle fut assiégée pendant sept mois, prise et
détruite par l'usurpateur Victorinus en 270 ; puis rebâtie dans
le siècle suivant par Constantin. Léger né vers 616 et décédé
en 678, était évêque d'Autun. Il fut torturé à Lucheux (Somme)
sur l'ordre du maire du palais Ébroïn, qui le fit ensuite assassiner.


La ville fut saccagée par les Sarrasins
du général Ambiza le 22 août 725, et suite à ce désastre, quelques
années plus tard en 733, Charles Martel la confie à Théodoric
Ier (708 - 755?), petit-fils de Bernarius, fondateur de la lignée
des Thierry comtes d'Autun, dont Thierry II d’Autun (748-804)
est frère du célèbre Guillaume de Gellone (751-28 mai 812).
Elle est à nouveau saccagée par les Normands en 888. Elle
fut depuis le Xème siècle le chef-lieu d'un comté
dépendant du duché de Bourgogne.
Au Moyen Âge, la ville
devient un important lieu de pèlerinage, et se voit dotée d'une
nouvelle cathédrale en plus de la Cathédrale Saint Nazaire d'Autun.
On venait y vénérer les reliques supposées de Lazare d'Aix,
non pas celles de Saint Lazare de Béthanie, celui de la Bible,
mais celles d'un évêque d'Aix-en-Provence du Vème
siècle ; ce dernier avait participé à l'évangélisation de la
Provence et avait été décapité sous le règne de Domitien, en
l'an 94. Le culte de Lazare d'Aix, dit aussi saint Lazare à
Autun au XIIème siècle répondait certainement à celui
de Marie-Madeleine présent à Vézelay. La cathédrale Saint-Lazare
(1120), église romane de type clunisien, est célèbre, grâce
à son tympan sculpté avec beaucoup de détails représentant le
jugement dernier et signé de l'artiste Gislebert. Ce portail
magistral doit aux chanoines d'Autun sa préservation exceptionnelle.
Les causes d'appel de la cour du Duc de Bourgogne, reconnaisent
que l'Abbaye de Saint-Martin d'Autun, possède d'ancienneté,
la haute, moyenne et basse justice sur la terre de "Chanchauvain
" aujourd'hui Champ-Chanoux et qui a appartenu aussi au Prieuré
de Chanchanoux, au finage de Saint-Eugène.
C'est le 13 juillet
1463, que les habitants de Saint-Martin et de Saint-Pantaléon
reçurent leurs lettres d'affranchissement de l'Abbé de l'Abbaye
de Saint-Martin d'Autun.
En 1788, Talleyrand devient évêque
d'Autun. Il fut élu député du clergé pour les États généraux
de 1789. Il prononça un vibrant discours en 1789 pour se faire
connaître, car il n'était venu qu'une fois auparavant.
Au
cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale
(1792-1795), la commune porta provisoirement le nom de Bibracte.
Le lycée du XVIIème siècle tient une place importante
dans l'histoire de la ville et même de la France puisque Napoléon
Bonaparte, qui lui a donné son nom actuel, ainsi que ses frères
Joseph et Lucien y ont fait leurs études. Ce lycée continue
de fonctionner de nos jours.
Charolles

l'époque carolingienne, le site est le
siège d'une vicomté dépendant d'Autun. Au Xe siècle, le lieu
est rattaché au comté de Chalon. En 1166, le comte rend hommage
au roi Louis VII tout en se reconnaissant vassal du duc de Bourgogne.
En 1237, la forteresse entre dans le domaine ducal lors de l'achat
du comté de Chalon par Hugues IV avec établissement d'un bailli.
En 1277, Charolles devient la capitale et le siège des états
particuliers du comté de Charolais ; le comté regroupe six châtellenies
et est inféodé à Béatrice de Bourgogne, nièce de Robert II de
Bourgogne.
En 1301, la ville reçoit sa charte de Robert
de Clermont, époux de Béatrice de Bourgogne7. En 1316, le lieu
est érigé en Comté7. En 1327, par mariage, la ville et le comté
passent à la maison d'Armagnac en la personne de Jean Ier d'Armagnac.
En 1391, Bernard VII d'Armagnac, petit-fils du précédent, ayant
de pressants besoins d'argent, vend le comté à Philippe II de
Bourgogne et la ville devient à nouveau le chef-lieu d'un bailliage.
En 1477, à la mort de Charles le Téméraire, le comté est
rattaché au royaume de France7. La ville comme le comté, extrêmement
fidèles à la maison de Bourgogne, sont gravement malmenés par
les troupes de Louis XI qui sont obligées de faire le siège
de toutes les places fortes du Charolais et d'en tuer les habitants,
enfants, femmes vieillards et hommes périssent défenestrés,
incendiés dans leur château, jetés dans les puits, ou écorchés
vifs. Louis XI n'en peut rien faire et décide de le rendre à
Marie de Bourgogne, femme de Maximilien Ier du Saint-Empire
non sans l'avoir parfaitement ravagé afin qu'il ne puisse servir
de base militaire à l'Empereur. De 1493 à 1684, Charolles est
restitué à la maison d'Autriche7 et les rois d'Espagne de cette
maison.
En 1684, le prince, Louis II de Bourbon-Condé se
voit attribuer le comté en paiement des dettes contractées par
les Habsbourg. En 1751, la ville est rattaché aux États de Bourgogne.
À la mort de Charles de Bourbon (1700-1760). Ce Comtes de Charolais
qui s'était rendu odieux par ses frasques, et demeurait, un
temps, à Charolles, son fief. La ville retiendra qu'il s'amusait
à tirer sur les couvreurs qui réparaient les toits. À la suite
d'un meurtre sans raison apparente, commis au pistolet. Louis
XV de France par son tuteur Le Régent lui accorda sa grace en
ces termes:"Mon cousin je vous accorde votre grâce, en même
temps que je signe celle, de celui qui vous tuera." À sa mort,
le comté passait à sa sœur, fille de Louis III de Bourbon-Condé.
En 1771, Louis XV achète le comté à Mlle de Charolais et le
réunit définitivement à la couronne7.
Charolles était, à
la veille de la Révolution, la 14e ville de la grande roue des
États de Bourgogne, siège du bailliage royal de Charolles, de
la maréchaussée et prévôté, du grenier à sel et de la subdélégation
de Charolles. Elle comprenait en outre une église collégiale
(l’église Saint-Nizier, composée théoriquement d’un Primicier-curé,
d’un sacristain et de dix chanoines (en fait de trois chanoines),
le prieuré de la Madeleine, un couvent de Picpus, de Clarisses
et de Visitandines, un collège et un hôpital général.
Louhans
Des traces d’occupation attestent d’une présence humaine à Louhans depuis le néolithique. L’endroit : une plaine entourée d’eau était il est vrai propice à la vie. Le nom Louhans viendrait d’ailleurs de Loewing ou de Loebing qui signifie lieu agréable entouré d’eau. Louhans apparaît pour la première fois dans des écrits sous le nom de villa Lovincum en 879 lorsque le roi Louis le Bègue en fait cadeau aux moines de St Philibert de Tournus. Ceux-ci installent un port du sel afin de taxer le commerce du sel qui descend des monts du Jura. Les puissants seigneurs des environs s’intéressent alors à Louhans qui de zone marécageuse commence à se développer en une bourgade commerçante, idéalement placée sur les axes de communication routiers et fluviaux. La ville se développe autour de la grande rue ceinte d’un rempart en brique pour la protéger notamment des attaques des francs-comtois. Le blason est fait de deux clés qui symbolisent les deux portes de la ville aux extrémités de la grande rue. A ces deux clés vient s’ajouter à l’accession au trône d’Henri IV, une fleur de lys dorée offerte par celui-ci pour remercier les Louhannais de ne pas avoir soutenu les Ligueurs qui ne voulaient pas d’un roi protestant. Les seigneurs d’Antigny de Vienne installent leur château au plus près du rempart (sur l’actuelle place de la libération) et s’autoproclament seigneurs de Louhans. Ils dotent en1269 la ville d’une charte de franchise qui instaure notamment le marché hebdomadaire du lundi. Les remparts et le château subissant de nombreux assauts au cours des XVème et XVIème siècles déclinèrent. Aujourd’hui les tours St Pierre et St Paul sont les seuls vestiges de ces fortifications.