Histoire des Deux Sèvres
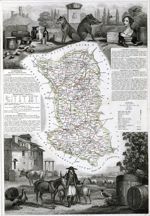
Des trois départements qui ont été formés
avec l'ancien Poitou, celui des Deux-Sèvres occupe la région
centrale confinant à l'est à la Vienne, et à la Vendée à l'ouest,
il fait vers le sud-ouest une pointe dans la Saintonge, à laquelle
il a emprunté 25,921 hectares de son territoire. Cette position
explique l'absence d'une histoire particulière pour cette contrée,
après les notices que nous avons données sur le haut et le bas
Poitou, dans les parties de cet ouvrage qui s'y rapportaient
plus directement.
De la conquête romaine à l'établissement
de la féodalité, nous n'avons pas à citer un seul fait qui ne
rentre ou dans l'histoire générale de la province, ou dans les
annales particulières des localités dont nous nous occuperons
plus loin. Comme le reste du Poitou, ce pays était habité par
les Pictonnes, quand les Romains l'envahirent. Après avoir pris
part à la lutte nationale, qui se termina par la chute d'Alésia
et la défaite de Vercingétorix, ils se soumirent à César, et
firent partie de l'Aquitaine, dont ils suivirent la fortune,
tour à tour conquis par les Wisigoths et par les Francs.
Au commencement du VIème siècle, saint Agapit et
saint Maixent prêchèrent dans le pays la foi nouvelle, et y
fondèrent une abbaye. Vers 732, les Sarrasins y parurent, mais
pour être bientôt dispersés par Charles-Martel. Sous les Carlovingiens,
quand le pouvoir des grands vassaux se substitua, dans la France
entière, à l'autorité royale, quand les puissants comtes de
Poitiers, créés par Charlemagne, eurent affermi leur domination
sur les vastes territoires devenus leurs fiefs héréditaires,
on vit se reproduire en petit, dans leur province, ce qui s'était
passé dans le royaume. Les barons, qu'ils avaient préposés à
l'administration des diverses parties de leurs domaines, affectèrent
vis-à-vis d'eux la même indépendance que les comtes affectaient
eux-mêmes envers le roi de France, et de même que l'État n'était
plus que l'assemblage fictif de provinces à peu près indépendantes,
le Poitou ne fut plus que la réunion de seigneuries obéissant
à des maîtres différents, soumises chacune à des lois et à des
usages particuliers et trop souvent en guerre les unes contre
les autres. C'est alors que prirent naissance ces désignations
de Niortais, de Bressuirois, de Mellois, souvenir rajeuni des
subdivisions gauloises, qui donnaient à chaque canton ou pagus
ses frontières, son administration et sa petite capitale. Ce
fractionnement était un obstacle à toute influence sérieuse
des populations dans les grandes affaires du pays. Il fallait
qu'un danger commun ou qu'un principe nouveau brisât les vieilles
barrières, ralliât toutes ces forces disséminées et refit un
corps de ces membres épars. Ce résultat, que l'ancien ordre
de choses ne permettait pas d'espérer de la paix, on l'obtint
d'abord de la lutte contre les Anglais, et plus tard, quelque
contradictoire que paraisse cette assertion des guerres civiles
et religieuses qui bouleversèrent la province. L'émotion répandue
par ces alternatives de succès et de revers finit par pénétrer
jusqu'au fond des contrées les plus insouciantes ou les plus
étrangères aux grands intérêts qui étaient en jeu ; les sympathies
des populations devenant un appoint important dans les opérations
de la guerre, on se préoccupa de part et d'autre de se concilier
leur intérêt, dont jusque-là on avait fait si bon marché.
C'est ainsi que nous voyons en quelque sorte mis aux enchères
le concours de la bourgeoisie des villes, et cette précieuse
alliance achetée au prix de chartes communales, de privilèges
commerciaux, qui initiaient les habitants à la vie publique.
Cette révélation de droits nouveaux, rayonnant des cités dans
les campagnes, y éveilla des sentiments de solidarité dans lesquels
était en germe le nationalisme français. Après une si longue
ignorance, et cet isolement séculaire de tous les intérêts généraux,
il dut y avoir beaucoup d'hésitation et de grandes incertitudes.
Les princes anglais, ducs héréditaires de Guyenne, comtes de
Poitou, étaient-ils bien des étrangers ? Et le roi de Paris,
qui était si loin et qu'on ne voyait jamais, était-il bien le
monarque légitime. Il fallut de longues années et de rudes épreuves
pour que la vérité se dégageât des événements. Les trois siècles
qui séparent le règne de Louis le Jeune de celui de Charles
VII y suffirent à peine ; mais, au XVème siècle,
le résultat était cependant en grande partie obtenu ; le Poitou
était province française et avait le sentiment de sa nationalité.
Un autre progrès s'était encore accompli, le pouvoir s'était
centralisé, et le roi, vainqueur de l'étranger, rattachait plus
directement à son autorité souveraine les provinces dont il
était le libérateur. Les habitants du territoire des Deux-Sèvres
commencent donc sortir de la passiveté où le régime féodal les
avait tenus jusqu'alors, et entrent dans la sphère d'action
au milieu de laquelle s'agitent les siècles suivants. Pendant
la période anglaise, quoique le pays fût souvent le théâtre
de la lutte et se trouvât presque toujours atteint par ses résultats,
les habitants n'eurent encore qu'un rôle relativement passif,
et furent, pour ainsi dire, moins acteurs que spectateurs c'est
seulement dans la période suivante que leur initiative commence
à se dessiner. Il semble que la population tout entière prît
à cœur de se venger de la longue insignifiance de son passé
par l'ardeur avec laquelle elle se jeta dans le grand drame
religieux du XVIème siècle. Il n'y eut pas une ville,
pas une bourgade qui ne se mêlât alors aux révoltes des protestants,
comme plus tard aux agitations de la Ligue.
Ce fut à Châtillon
en 1568 que les chefs du parti réformé se rassemblèrent pour
la première fois après s'être assurés des places voisines, telles
que Thouars, Parthenay, Oyron, etc. Dandelot, frère de l'amiral
Coligny, fit capituler Niort et passa au fil de l'épée la garnison
de la tour Magné. Saint-Maixent se rendit à lui dans le même
temps.
Les armées des ducs de Montpensier et d'Anjou se rencontrèrent
près de Pamproux, où la campagne se termina par une escarmouche.
Les chefs protestants et la reine de Navarre passèrent l'hiver
à Niort, où ils s'occupèrent à réunir des forces, à pourvoir
aux finances de leur parti par la vente des biens ecclésiastiques,
et à se ménager les secours de l'Angleterre. Après la journée
de Moncontour, si fatale aux protestants, les villes de Châtillon,
de Thouars et d'Oyron furent évacuées ; l'amiral Coligny recueillit
les débris de l'armée à Niort, et, après y avoir laissé garnison,
se retira à La Rochelle. Niort capitula à l'arrivée du duc d'Anjou,
et tout le Poitou se soumit. Une tranquillité, du moins apparente,
régna jusqu'en 1588. A cette époque, les protestants, menacés
dans La Rochelle, se remirent en campagne. D'Aubigné s'empara
de Niort et de Saint-Maixent. Thouars et les places environnantes
se rendirent aux protestants un an après. L'avènement de Henri
IV au trône ramena la paix. La guerre ne recommença qu'en 1621,
sous Louis XIII, lorsque le projet d'établir une république
protestante surgit dans le conseil des chefs protestants. La
Bretagne et le Poitou devaient être un des huit cercles de cette
république. L'énergie déployée en cette circonstance par le
cardinal de Richelieu et la présence du roi en Poitou déterminèrent
la soumission de Niort et de Saint-Maixent ; la prise de La
Rochelle, en 1628, mit le sceau à la paix définitive. Cent cinquante
ans de paix succédèrent à ces longues agitations mais le souvenir
des rivalités locales, le réveil des haines mal éteintes donnèrent,
en 1792, à l'explosion contre-révolutionnaire un caractère particulier
d'obstination. Quatre-vingt-sept communes du département se
soulevèrent et prirent une part active à la lutte.
Les arrondissements
de Bressuire et de Parthenay fournirent aux rebelles leurs principaux
chefs, La Rochejacquelein entre autres.
Pendant que Niort
devenait le quartier général de l'armée républicaine, Châtillon
était le siège du conseil supérieur de l'armée royale. Thouars
fut la première ville importante dont les Vendéens s'emparèrent
; Parthenay, Bressuire et un grand nombred e villes de la Gâtine
et du Bocage furent tour à tour prises ; reprises, incendiées,
démantelées, détruites même pendant cette déplorable guerre
civile. Nulle part ne fut plus manifeste et plus tranchée la
ligne qui séparait alors l'opinion des villes de celle des campagnes.
Autant la naïve ignorance, le culte du passé, les pieuses traditions
de famille firent des uns les aveugles instruments des agents
royalistes, autant l'intelligence des autres fut prompte à comprendre
le problème posé par la Révolution, autant cette conscience
de l'avenir les rattacha étroitement à sa cause.
C'est cette
foi également ardente et sincère des deux côtés qui donna à
la lutte ses proportions gigantesques ; l'héroïsme des uns n'eut
de comparable que le dévouement des autres, et aux fabuleux
exploits des intrépides paysans il n'y a à opposer que les glorieuses
et stoïques expéditions de ces gardes nationaux des villes,
eux aussi soldats improvisés, quittant, eux aussi, leur foyer,
leur famille, et sachant aussi mourir pour la cause qu'ils avaient
embrassée. Depuis la pacification, nous ne trouvons dans l'histoire
du département qu'un seul fait important à noter, c'est la fameuse
conspiration de Berton, en 1822. Si la guerre civile a trop
longtemps désolé le département des Deux-Sèvres il n'a pas eu,
en compensation, à souffrir de la guerre étrangère. Situé loin
de la frontière, il a dû à sa position de n'avoir subi ni les
hontes ni les malheurs des invasions. Ce qui ne l'empêcha point
de payer largement sa dette à la patrie, en envoyant ses enfants
aux armées qui, en 1814 et 1815 d'abord, puis en 1870 et 1871,
luttèrent si vaillamment, mais hélas si inutilement, pour repousser
l'étranger.
Quoique, depuis cinquante ans, les mœurs se
soient bien modifiées dans la contrée qui nous occupe quoique,
là comme ailleurs, s'accomplisse chaque jour l'œuvre de progrès
et d'assimilation, le département des Deux-Sèvres est encore
un de ceux qui a gardé, dans certaines parties, le plus de son
ancienne originalité nous en emprunterons quelques traits à
un de ses plus habiles administrateurs, M. Dupin, qui y fut
préfet dès les premières années de l'Empire :
« Le département
des Deux-Sèvres, composé de trois parties bien distinctes, savoir
le Bocage, qui comprend tout le nord-ouest, c'est-à-dire la
presque totalité des premier et deuxième arrondissements et
une partie du troisième ; le Marais, qui occupe une portion
sud-ouest du troisième arrondissement, et, enfin, la Plaine,
offre les mêmes différences dans la constitution physique et
morale de ses habitants. »
L'homme du Bocage a une taille
médiocre, mais assez bien prise ; tête grosse et ronde, teint
pâle, cheveux noirs, yeux petits, mais expressifs son tempérament
est bilieux et mélancolique son esprit est lent, mais non sans
profondeur son cœur est généreux, mais irascible sa conception
peu facile, mais sûre. Il a conservé toute la simplicité des
mœurs anciennes, quoique la guerre en ait un peu altéré la pureté.
Il est bon ; hospitalier, juste et d'une fidélité inviolable
à ses engagements ; mais taciturne à l'excès, méfiant pour tout
ce qui vient de l'autorité, fortement attaché au sol qui l'a
vu naître, plus attaché encore à la religion de ses pères, et
capable des actions les plus héroïques pour la défense de sa
foi. Dans tous les temps, on l'a vu prendre part aux guerres
religieuses. Son humeur mélancolique et les préjugés superstitieux
qui le gouvernent tiennent essentiellement au pays qu'il habite.
Il vit isolé dans sa chaumière, ne voyant autour de lui aucune
autre habitation. S'il sort pour cultiver son champ, il y est
encore seul ; de larges fossés, des haies impénétrables lui
interdisent la vue de son semblable. Il n'a d'autre société
que celle de ses bœufs, à qui il parle sans cesse, et pour qui
même il fait des chansons. S'il veut vendre quelques bestiaux
à une foire, la foire est rarement à plus d'une lieue ; souvent
même les marchands viennent le trouver dans son enclos. Il n'y
a dans ces contrées aucune ville qui répande la civilisation
aucune route qui y conduise les étrangers, qui favorise la circulation,
qui permette aux habitants de se fréquenter, et aux passions
humaines de s'adoucir et de s'user par un frottement journalier.
»
La Plaine est traversé par plusieurs grandes routes, et
ses habitants sont plus civilisés que ceux du Bocage ; ils ont
un caractère moins prononcé et plus confiant ; ils aiment le
repos, la danse, le vin, sans toutefois en faire excès leur
taille est plus élevée, leur physionomie plus ouverte, leur
carnation plus vive. Ils sont aussi braves, mais moins industrieux
et plus processifs ce qui provient sans doute de ce que leurs
propriétés n'ont pas des limites aussi immuables. Quoique leur
esprit, plus flexible, se soit plus facilement détaché des prêtres,
il n'est pas moins ouvert à tous les préjugés de l'ignorance.
Il existe pourtant, dans la Plaine, une différence assez notable
entre les catholiques et les protestants ceux-ci sont, en général,
plus laborieux et plus instruits. » L'habitant du Marais est
encore plus grand que celui de la Plaine il a plus d'embonpoint,
ses membres sont plus massifs, mais il manque de santé et d'agilité
; il est grossier, apathique et ne pousse pas loin sa carrière.
Une cabane de roseaux, un petit pré, quelques vaches, un bateau
qui sort à la pêche, et souvent à voler du fourrage le long
de la rivière, un fusil pour tuer les oiseaux d'eau, voilà toute
sa fortune et tous ses moyens d'industrie. » Les usages, sauf
les cérémonies des noces, qui offrent quelques traits particuliers,
n'ont rien de remarquable. Les fêtes et divertissements tiennent
aux travaux champêtres et à la croyance religieuse. C'est ainsi
que la récolte des châtaignes, dans certaines contrées, et,
dans d'autres, la toute des brebis, le fanage, la moisson sont
accompagnés de jeux et de danses ; que le jour de tel saint
il faut se régaler de crêpes pour empêcher le blé de se carier,
etc. Pendant l'été, il y a beaucoup de ballades ou fêtes champêtres.
C'est là que les hommes boivent et que les jeunes gens dansent
au son de la musette, ou plus souvent à la voix d'une vieille
femme qui chante gravement un air monotone et sans paroles ;
c'est là que se forment les inclinations, que s'arrangent les
mariages. Une jeune fille qui paraît à la ballade sans un garçon
qui lui tire les doigts est méprisée de ses compagnes. C'est
aussi aux ballades qu'on choisit les domestiques ils y viennent
parés d'épis, s'ils se destinent aux travaux de la moisson ;
de fleurs, s'ils veulent servir aux travaux du ménage. Les fêtes
de l'été ont donné naissance aux inclinations, les mariages
se concluent en automne. Le fiancé, accompagné d'un de ses parents
et d'un parent de sa prétendue, va faire les invitations. Il
a grand soin de régler l'ordre de ses visites sur les différents
degrés de parenté ; c'est une étiquette à laquelle on tient
strictement. Il attache dans chaque maison, au lit du maître,
un petit bouquet de laurier, orné de rubans, et fait son invitation
par un compliment très long, qui est le même pour tous et de
temps immémorial. Ces visites sont accompagnées de fréquentes
libations. Le jour des noces est suivi d'un lendemain plus joyeux
et plus bruyant encore ; l'épisode le plus caractéristique de
la cérémonie est le bouquet symbolique offert à la mariée par
les jeunes filles, ses compagnes, accompagnant leur offrande
d'une chanson qui n'a pas varié depuis trois cents ans, et qui
retrace toutes les peines réservées à la jeune femme dans son
ménage. Cette naïve complainte a été citée trop souvent et est
aujourd'hui trop connue pour que nous lui donnions place ici.
Nous ne dirons rien non plus des naissances et des funérailles,
qui ne présentent aucun détail de remarquable originalité.
Niort


L'origine du nom de cette ville, qui paraît celtique, ou peut-être provenir de deux mots danois-Anglos-Saxons, New-York, que l'on traduit par nouvel ouvrage, ville nouvelle, d'où la corruption des siècles avait fait Niort, se perd dans la nuit des temps. Elle était déjà considérable sous les rois de la seconde race ; car elle donnait le nom de Pagus niortensis, à une division territoriale de la province du Poitou. Besly, dans son Histoire des comtes de Poitou, cite un acte passé au IXème siècle, par-devant un notaire de Niort. Le château et le fort Foucault paraissent aussi avoir été primitivement construits vers cette époque, pour arrêter les incursions des Normands, qui alors remontaient la Sèvre, presque jusqu'à sa source, pour piller, voler et enlever les habitants des deux rives. Le même Besly parle d'un comte du Poitou, Guillaume IX, qui, en 1086, fonda à Niort un monastère d'un genre fort singulier, dans lequel on ne recevait que les femmes les plus débauchées, et les mieux disposées à rendre service au public. On croit que c'est dans ce même local que fut établi dans la suite le couvent des frères capucins. (Les couvents du genre du celui de Guillaume IX se sont depuis singulièrement multipliés à Niort, et dans ce moment on en compté jusqu'à cinq.) En 1104, le château et le fort Foucault, placé vis-à-vis, furent brûlés ; mais en 1158, l'un et l'autre furent reconstruits, ainsi que le moulin du château, pour le service de la place, par les soins de Henri II, roi d'Angleterre, qui, en 1252, avait épousé Aliénor ou Éléonore, duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitou, que venait de répudier le trop susceptible Louis VII, roi de France. En 1223, la duchesse Aliénor y établit sa résidence.

Niort a été assiégé onze fois : en 1223
, en 1230, en 1345, eu 1355 , en 1371, en 1373, en 1558, en
1559, en 1576 , en 1588, et en 1689. C'est au siège de Niort,
en 1558, que la comtesse du Lude, présente au dernier assaut,
accablait des reproches les plus amers les capitaines qui reculaient,
et promettait au contraire aux plus braves, pour prix de la
victoire, les plus jolies filles de Niort, qui, à cette époque,
comme a présent y étaient en assez grand nombre.
En 1285,
sous Philippe le Hardi, le port de Niort fut déclaré franc.
Niort tomba en 1360, sous le roi Jean II, dans la puissance
des Anglais, en exécution du traité de Brétigny ; mais il fut
repris, en 1371, par le connétable du Guesclin, aidé de la bravoure
des Niortais. En 1377, on creusa un nouveau port ; c'est le
canal actuel de navigation. Eu 1383 , construction d'un hôtel
de ville. En 1455, établissement des trois foires franches de
Niort. En 1461, lettres patentes délivrées par Louis XI, qui
accorda les privilèges de la noblesse au maire, aux douze échevins,
et aux douze conseillers qui faisaient partie du corps de ville,
pour en jouir à perpétuité eux et leurs descendants. En 1484,1498,
i548 , etc., confirmation de ces mêmes privilèges par Charles
VIII, Louis XII, Henri II, et plusieurs de leurs successeurs.
En 1565, lettres patentes délivrées par Charles IX, pour l'établissement
d'une cour ou juridiction consulaire. En 1602, maladie contagieuse,
qui fait périr une partie des habitants de Niort. En 1461, concession
par le pape, aux maire, échevins, conseillers, pairs et bourgeois
de Niort, du singulier privilège d'être ensevelis dans l'habit
et ceints du cordon des frères cordeliers. Le 28 novembre 1635,
naissance de Françoise d'Aubigné, plus connue sous le nom de
marquise de Maintenon, dans la prison de Niort, dite la Conciergerie,
où son père était détenu pour crime de fausse monnaie. Cette
prison, qui n'était pas alors celle qui existe maintenant, avait
une sortie sur la halle et l'autre dans la rue du Soleil ; elle
est actuellement habitée par divers particuliers, et connue
sous le nom de Passage de Candie, ancienne dénomination d'une
auberge qui avait succédé à la prison. Cette ville est la cinquième
de France qui eut primitivement une municipalité. Ses chartes
sont de 1222. Elle était protégée par un château formé de deux
grosses tours hautes de trente- cinq mètres et demi, et réunies
par un massif. Ce château ou donjon subsiste encore, et sert
de maison d'arrêt ; mais l'enceinte du château et les murs très-élevés
qui entouraient la ville ont été détruits, ainsi que les fossés
très profonds dont elle était ceinte; ils ont été remplacés
depuis la révolution par des rues bien alignées, et par des
maisons bâties avec goût et élégance.
La ville de Niort est
située sur le penchant de deux collines au pied desquelles coule
la Sèvre Niortaise, et possède d'agréables promenades. On y
arrive par de belles roules plantées d'arbres magnifiques ;
les environs offrent des sites charmants, notamment les rives
du ruisseau de Lambon, dont les eaux viennent se perdre dans
la Sèvre. Cette ville, autrefois mal bâtie, est devenue, par
les divers travaux qu'on y a exécutés depuis plusieurs années,
une des cités les plus agréables du Poitou. On y voit deux églises
paroissiales, dont l'une, qui passe pour être un ouvrage des
Anglais, est d'une très-belle architecture golfique: la flèche
a 88 pieds d'élévation ; l'hôtel de ville était l'ancien palais
d'Éléonore d'Aquitaine; il y avait une école d'horticulture,
vaste et bien entretenue, réunie au jardin de botanique, mais
elle n'existe plus.
Bressuire
Quelques écrivains pensent que Bressuire
est l'ancienne Segora mentionnée dans l'Itinéraire d'Antonin.
Guyard de Berville, dans son Histoire de du Guesclin, dit qu'en
1371, époque où les Anglais en étaient maîtres, cette ville
était considérable par le nombre et la richesse de ses habitants,
par la bonté de ses fortifications, et surtout par son château
: elle avait un gouverneur, une garnison, et du Guesclin fut
obligé d'en faire le siège dans toutes les formes ; il la prit
d'assaut et passa la garnison au fil de l'épée; le château capitula;
la ville fut pillée par le soldat, qui y fit un riche butin.
Avant la révolution, les guerres de religion, des causes générales
de dépopulation, et plusieurs banqueroutes éprouvées par ses
principaux fabricants, avaient déjà réduit cette ville à un
grand étal de décadence. L'enceinte de ses murs, qui ne servait
plus qu'à assurer la perception de l'octroi, attestait bien
encore son ancienne importance ; mais sur plusieurs points,
des jardins, des prés, des champs avaient remplacé les habitations.
La guerre de la Vendée a consommé sa ruine; elle fut alors entièrement
réduite en cendres, à l'exception d'une seule maison et de l'église.
On pense que l'établissement des routes stratégiques lui sera
très-profitable.
Cette ville, située dans une contrée agreste,
est bâtie sur une colline au bas de laquelle serpente la petite
rivière de l'Argenton. On y remarque une fort belle église entièrement
construite en granit, et surmontée d'une belle tour de 170 pieds
d'élévation, en forme de clocher.
Parthenay

Parthenay est une ville ancienne dont
l'origine est inconnue : on sait seulement qu'elle était autrefois
très-forte, qu'elle était entourée de doubles fossés et de triples
murailles, et qu'elle a soutenu glorieusement plusieurs sièges,
notamment en 1486, époque où elle se rendit à Charles VIII,
qui en fit détruire les fortifications. C'était anciennement
la capitale de la Gatine Parthenay souffrit considérablement
dans la guerre de la Vendée. Le 20 juin 1793, Westermann, qui
dans la Belgique s'était distingué par son audace, fut envoyé
au mois de juin avec sa légion dans la Vendée. Un corps des
royalistes, fort de six mille hommes, se rassembla à Parthenay,
sous les ordres de Lescure: Westermann s'y porte le 20 juin,
par une marche forcée. A deux heures du matin il égorge les
avant postes à la tête de douze cents hommes ; il pénètre avec
son infanterie dans cette petite ville, dont il a enfoncé les
portes à coups de canon; ses soldais y entrent au pas de charge
et exterminent tout ce qui ose leur résister. Un prêtre vendéen
allait mettre le feu à un canon, il est abattu par le sabre
d'un républicain. Lescure surpris résiste faiblement ; abandonné
de ses soldats, il ne doit son salut qu'à l'obscurité qui le
dérobe aux coups des vainqueurs. Westermann, n'osant pas s'engager
dans ce pays insurgé, reprend la route de Saint-Maixent. Lescure
rentre à Parthenay, et préserve cette ville des flammes auxquelles
voulaient la livrer les soldats, pour punir les habitants d'avoir
favorisé Westermann. Ce général, dont la troupe s'était grossie
des renforts qu'il avait trouves à Saint-Maixent, se présente
de nouveau devant Parthenay, d'où Lescure fuit à son approche.
Westermann, qui avait fait observer la plus exacte discipline
à ses soldats, écrit au gouvernement : «Ma légion ne sera pas
accusée d'avoir enlevé une obole aux habitants de Parthenay.
»
Parthenay est située près du Thouet, dans une contrée
entrecoupée de montagnes et de forêts, sur une colline qui la
divise en haute et basse ville. C'est une ville en général fort
mal bâtie, où l'on remarque les restes d'un ancien château,
entouré de fossés et de contrescarpes, et flanqué de cinq tours
; la porte Saint-Jacques, construction ogivale du XIIe siècle,
surmontée de créneaux et flanquée de deux tours elliptiques
de vingt mètres de hauteur ; l'église Saint- Jean , bâtie dans
le IXe siècle ; d'anciennes prisons très-fortes, élevées de
70 pieds audessus du Thouet, et dont font partie les tours de
l'horloge.
Thouars

L'origine de cette ville se perd dans
la nuit des siècles. Antérieurement à la conquête des Gaules
par Jules César, dans le temps que les Pictones étaient gouvernés
par des rois de leur nation, Thouars était une place extrêmement
forte, connue alors sous le nom de Childoac. Sous le règne de
Tibère, cette ville prit le nom latin de la rivière qui l'arrose,
Tuedae arx, dont on a fait par corruption Thouars. Depuis la
conquête des Gaules par les Francs, il n'en est fait mention
dans les chroniques qu'en 759, où cette ville fut emportée d'assaut,
saccagée, brûlée et rasée par Pépin le Bref. Il paraît que ce
n'était pas alors une ville très considérable, puisque Éginard,
auteur contemporain, la nomme dans ses annales Castellum Thoarcis.
Quoi qu'il en soit, elle ne tarda pas à sortir de ses ruines,
et à réparer ses pertes. Charles le Chauve, la donna avec le
titre de duc à un célèbre capitaine nommé Èble, dont un fils
du nom de Arnoul, s'établit à Thouars en 885, et fit fortifier
la ville. Au XIIIe siècle, les rois d'Angleterre, dont les vicomtes
de Thouars étaient les vassaux, y bâtirent un palais et deux
tours : l'une, appelée tour au Prévôt, pour le logement de leurs
gardes et la sûreté de leurs personnes ; l'autre, nommée tour
du prince de Galles (aujourd'hui tour Grénetière), pour être
occupée par leurs enfants et les principaux officiers de leur
maison. En 1372, le connétable du Guesclin, après s'être emparé
de Saint-Maixent, de Melle, etc., vint mettre le siège devant
Thouars avec une armée de plus de quarante mille hommes. Le
siège dura plusieurs mois On fut longtemps à combler les fossés
de la place, dont les moindres avaient plus de cent pieds de.
largeur, et plus de trente de profondeur. Deux assauts n'ayant
produit aucun résultat, le connétable fil venir de Poitiers
six pièces de canon pour foudroyer les remparts ; mais celte
artillerie servit moins qu'une machine de guerre, que l'on appelait
Truie, au moyen de laquelle on faisait jouer des balistes qui
lançaient des pierres énormes sur les remparts, et qui protégeait
des hommes armés de pics et de leviers avec lesquels ils sapaient
les murailles sans avoir rien à craindre des assiégés. Avant
de donner un dernier assaut, le connétable fit faire au gouverneur
une dernière sommation, et celui-ci, après avoir consulté son
conseil, se décida à capituler aux conditions suivantes; qu'il
y aurait une suspension d'armes jusqu'à la Saint-Michel; 2°
que si ce jour-là, le roi d'Angleterre en personne ou l'un des
princes ses fils ne se présentaient avec des forces suffisantes
pour en faire lever le siège, le gouverneur livrerait la place
au connétable. La ville n'ayant point été secourue, du Guesclin
se présenta sous ses murs la veille de la Saint-Michel de l'année
1372 ; le lendemain, les portes de Thouars lui furent ouvertes,
et il y fit une entrée triomphale. La ville de Thouars fut érigée
en duché en 1563, et en duché-pairie en 1585. Quelques années
avant, les protestants s'étaient beaucoup multipliés dans celle
ville, où ils bravaient, à couvert de la protection du duc,
les édits rigoureux dont ils étaient frappés ailleurs; la duchesse,
excitée par de fougueux prédicants, persécuta tous les monastères
d'hommes et de filles, chassa de Thouars les dominicains, et
brûla une partie du couvent des cordeliers, sous le prétexte
que ces moines l'avaient indiscrètement lorgnée de leurs cellules,
au moment où elle allait se mettre au bain; plusieurs églises
furent aussi brûlées ou démolies par ses ordres. Thouars était
autrefois une ville trois fois plus peuplée qu'elle ne l'est
aujourd'hui: le décroissement de sa population eut pour cause
la révocation de l'édit de Nantes, en r685. Cette ville avait
alors des fabriques considérables de serges et d'étainines,
auxquelles étaient occupées beaucoup de familles protestantes,
qui furent porter dans les pays étrangers leur industrie et
leurs capitaux. Depuis cette émigration, les fabriques ont considérablement
décliné.
La ville de Thouars est située sur le penchant
d'une colline dont le sommet est de niveau avec la plaine, et
dont l'extrémité touche au rocher qui couvrait l'ancienne Childoac
et le dominait, ce qui donne à cette ville la forme d'un amphithéâtre.
Le Thouet, en se courbant en arc vers le sud et l'ouest, l'entoure
dans plus de la moitié de son étendue, et lui sert ainsi de
fortification naturelle. Tout ce qui n'est pas entouré par la
rivière est fortifié de murs bâtis dans le XIII e siècle, flanqués
de grosses tours à la distance de 15 mètres les unes des autres.
Presque partout les murs ont 9 mètres de hauteur et 2 de largeur;
ils sont bâtis de moellons choisis et piqués ; quelques tours
même sont construites en pierre de taille : quatre cents ans
de vétusté et les sièges que ces murailles ont éprouvées, leur
ont à peine fait éprouver quelques dégradations. Thouars était
autrefois entouré d'un double fossé coupé en talus, au milieu
duquel était une fausse braie, que l'on a comblée avant 1789.
La ville avait six portes : la plus remarquable était la porte
au Prévôt ou de Poitiers; elle est composée de deux tours adossées
l'une à l'autre, et ayant chacune 120 pieds de hauteur et 24
de diamètre. Si l'on ajoute à ces fortifications un château
presque inabordable, revêtu de tout ce que l'art pouvait alors
ajouter à l'avantage de la situation, on concevra facilement
qu'avant l'usage du canon, Thouars devait être la plus forte
place du Poitou. Des nombreux édifices que possédait cette ville,
il ne reste plus que le château et quelques débris de l'abbaye
de Saint-Jean.






